22/08/2014
H[ilda] D[oolittle] Trilogie

Hommage aux anges
[1]
Hermès Trismégiste
est le patron des alchimistes ;
sa province est la pensée,
inventive, rusée et curieuse ;
son métal est le vif-argent,
ses clients, orateurs, voleurs et poètes ;
vole doc, ô orateur,
pille, ô poète,
prends ce que la vieille-église
trouva dans la tombe de Mithra,
bougie et écriture et cloche,
prends ce sur quoi la nouvelle-église a craché
et qu'elle a détruit et cassé ;
ramasse les fragments de verre brisé
et de ton feu et de ton haleine,
fais fondre et intègre ;
ré-invoque, re-crée
l'opale, l'onyx, l'obsidienne,
à présent éparpillés en tessons
que foulent les humains.
[II]
Tes murs ne tombent pas, dit-il,
parce que tes murs sont de jaspe ;
mais pas carrée, ai-je pensé,
une autre forme (octaèdre ?)
glissa à la place
réservée par règle et rite
pour les douze fondements,
pour le verre tréluisant,
car elle n'a que faire du soleil
ni de la lune pour luire ;
car la vision comme nous la voyons
ou l'avons vue ou l'avons imaginée
ou autrefois invoquée
ou conjurée ou l'avions conjurée
par un autre a été usurpée ;
j'ai vu la forme
qui aurait pu être de jaspe,
mais elle n'était pas carrée.
H[ilda] D[oolittle] Trilogie, traduit par Bernard
Hoepffner, éditions Corti, 2011, p. 57-58
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : h[ilda] d[oolittle] trilogie, hermès, mithra, destruction, jaspe, vision | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2014
Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec

les mains se referment
étreignent le vide
voudraient le saisir
l'empoigner pour de bon
en briser la frontière mais...
on ne le sait que trop :
le vide
n'épargne personne
c'est à peine c'est-à-dire
si la peine si le dire
si les roses et les choses
tout s'emmêle et se noue :
les battements du cœur et les mots indigents,
tout va, la pluie, l'absence, tout va bien
tout va bien
tout s'en va
tout est perdu :
très bien...
mais que l'échec au moins
on le tente au plus juste
oui
que l'échec humain soit :
notre plus bel échec.
Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec, images d'Élice Meng, Dernier Télégramme, 2014, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, jean-christophe bellevaux, bel échec, vide, peine, mot, échec | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2014
Louis Aragon, La Grande Gaîté [1929]

Le paradis terrestre
Le collectionneur de bouteilles à lait
Descend chaque jour à la cave
Il halète à la
Onzième marche de l’escalier
Et tandis qu’il disparaît dans l’entonnoir noir
Son imagination se monte se monte
Kirikiki ah la voilà
La folie avec ses tempêtes
Tonneaux tonneaux les belles bouteilles
Elles sont blanches comme les seins vous savez
Vers la gorge
Où le couteau aime les très jeunes filles
Il y a des hommes dans les restaurants
Et dans les pâtisseries
Ils regardent les consommatrices et leur repas
Froidit leur chocolat
Ils aiment les voir prendre un sorbet
Ça c’est pour eux comme pour d’autres
La forêt féérique où les apparitions du soir
Se jouent et chantent
Mais quand par surcroît de délices une voilette
Sur la crème ou la glace met son château de transparence
On peut voir soudainement pâlir et rougir
Le spectateur aux dents serrées
Des exemples comme ceux-là la rue en
Est pleine
Les cafés les autobus
Le monde est heureux voyez-vous
Louis Aragon, La Grande Gaîté [1929], dans Œuvres poétiques complètes, tome I, préface de Jean Ristat, édition publiée sous la direction d’Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 435.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, la grande gaîté, le paradis terrestre, restaurant, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2014
Christiane Veschambre, Fente de l’amour

au chemin creux
glaise et pierres
demeure
ma demeurée
m’attend
— pas moi
mais celle que la mort lavera
l’amour cherche
une chambre en nous
déambule dans nos appartements meublés
parfois
se fait notre hôte
dans la pièce insoupçonnée mise à jour par le rêve
creuse
entre glaise et pierres
un espace pour mon amour
n’ai que lui
pour osciller
comme la tige à l’avant de l’aube
au respir de l’amour
— la vaste bête
qui tient contre elle
embrassée
la demeurée du chemin creux
Christiane Veschambre, Fente de l’amour, illustrations de
Madlen Herrström, éditions Odile Fix (Bélinay, 15430
Paulhac), 2011, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, fente de l’amour, chemin, mort, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2014
Jacques Dupin, Chansons troglodytes, Gravir

Francis Bacon, Portrait of Jacques Dupin, 1990
Ta nuque, plus bas que la pierre,
Ton corps plus nu
Que cette table de granit…
Sans le tonnerre d’un seul de tes cils,
Serais-tu devenue la même
Lisse et insaisissable ennemie
Dans la poussière de la route
Et la mémoire du glacier ?
Amours anfractueuses, revenez,
Déchirez le corps clairvoyant.
Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 94.
Romance aveugle
Je me suis perdu dans le bois
dans la voix d’une étrangère
scabreuse et cassée comme si
une aiguille perçant la langue
habitait le cri perdu
coupe claire des images
musique en dessous déchirée
dans un emmêlement de sources
et de ronces tronçonnées
comme si j’étais sans voix
c’en est fait de la rivière
c’en est fini du sous-bois
les images sont recluses
sur le point de se détruire
avant de regagner sans hâte
la sauvagerie de la gorge
et les précipices du ciel
le caméléon nuptial
se détache de la question
c’en est fini de la rivière
c’en est fait de la chanson
l’écriture se désagrège
éclipse des feuilles d’angle
le rapt et le creusement
dont s’allège sur la langue
la profanation circulaire
d’un bond de bête blessée
la romance aveugle crie loin
que saisir d’elle à fleur de cendre
et dans l’approche de la peau
et qui le pourrait au bord
de l’horreur indifférenciée
[…]
Jacques Dupin, Chansons troglodytes, Fata Morgana, 1989, p. 21-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, chansons troglodytes, gravir, bacon, corps, mémoire, voix, chanson | ![]() Facebook |
Facebook |
17/08/2014
Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves

Le mont des Juifs
Voyage d’araignée,
blanc, la terre se répandait en poussière
de sable rougeâtre — forêt,
comme chevelure de tresses, cri d’animal,
lui heurtait la joue, herbe
piquait ses tempes.
Tard, lorsque le grand duc, bruissement
de cent nuits, traversait
le sommeil des genêts,
il se levait dans le hallier frémissant
des grillons pour voir un
blême chemin de lune qui montait
dans l’entrelacs des racines.
Il regardait par-delà le marécage.
Abrupt, indistinct, un reflet de lumière
le frôlait de son vol, le temps de ce
battement de cœur une sauvage
empaumure émergea des ténèbres,
hérissée, tête larmoyante.
Pressé entre les mains
le temps, non nommé : les essaims
qui, jaunes, suivaient
Curragh, nuées grondantes
au-dessus du lac, les abeilles
suivaient le pieux père,
il remuait les rames, il disait :
Je serai un mort dans la verte vallée.
Der Judenberg
Spinnenreise
weiß, mit rötlichem Sand
stäubte die Erde — Wald,
flechtenhaarig, Tierschrei,
stieß um die Wange ihm, Gras
stach seine Schläfe.
Spät, wenn der Uhu, Sausen
aus hundert Nächten, umherstrich
durch den Schlaf der Geniste,
hob er sich in der Grillen
Schwirrgesträuch, einen fahlen
Mondweg zu sehn, der heraufkam
an die seufzende Eiche, die Greisin, in ihrem
Wurzelgeflecht verging.
Über das Bruch sah er hin.
Jäh, undeutbar, Lichtschein
flog vorüber, diesen
Herzschlag lang ragte wüstes
Schaufelgeweih aus der Finsternis,
zottig, ein tränendes Haupt.
Unter die Hände gepreßt
Zet, unbenannt: die Schwärme,
gelb, die dem Curragh
folgten, tönende Wolken
über der See, die Bienen
folgten dem frommen Vater,
er rührte die Ruder, et sagte :
Ich werde tot sein im grünen Tal.
Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,
traduit de l’allemand par Jean-Claude Schneider,
Atelier La Feugraie, 2005, p. 84-87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d’ombres fleuves, le mont des juifs, grand duc, lune, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
16/08/2014
Romain Fustier, Mon contre toi

ma petite voleuse d'oreiller dont le visage reposé. dans une course-poursuite immobile. une traque silencieuse dans les nuages de ses songes. et je pars à sa recherche tandis qu'elle dort allongée devant moi. souffle calme. bouche phylactère. un message suspendu entre les lèvres. mon oreiller sous le visage. ma petite voleuse dort. s'arrêtant dans les bars de carrefour où l'on joue de la guitare la nuit. fonçant sue la fédérale dans une voiture de location. et je me lance à ses trousses. écartant les nuages de ses songes tandis qu'elle dort étendue devant moi. un vent du sud s'échappe de ses lèvres où je me glisse dans la bulle de son visage. ma petite voleuse d'oreiller dort et je deviens complice de sa fuite.
Romain Fustier, Mon contre toi, éditons de l'Atlantique, 2012, p. 48.
Romain Fustier anime avec Amandine Marembert la revue et les éditions Contre-Allées.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : romain fustier, mon contre toi, nuit, sommeil, voleuse, rêve, tendresse | ![]() Facebook |
Facebook |
15/08/2014
Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia
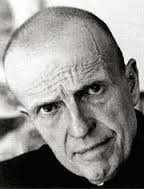
Qu'est-ce que, pratiquement, je poursuis ?
— La combinaison de mots, phrases, séquences, etc., que je sis seul à pouvoir bricoler et qui — dans ma vie pareille à toute autre, à une île où les conditions d'existence ne cessent d'empirer — serait mon vade-mecum de naufragé, me tenant lieu de tout ce qui permet à Robinson de subsister : caisse d'outils, Bible, voire Vendredi (si je dois finir dans une solitude à laquelle je n'aurai pas le cœur d'apporter le catégorique remède).
— Ou plutôt ce qui me fascine, c'est moins le résultat, et le secours qu'en principe j'en attends, que ce bricolage même dont le but affiché n'est tout compte fait qu'un prétexte. Au point exact où les choses en sont au-dedans comme au-dehors de moi, quoi d'autre que ce hobby pourrait m'empêcher de devenir un Robinson qui, travaux nourriciers expédiés, ne ferait plus que se glisser vers le sommeil, sans même regarder la mer ?
Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia, Gallimard, 1981, p. 195.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/08/2014
Ivar Ch’Vavar, Travail du poème
Le réel n’est pas ce que je vois, parce que je ne vois pas ce qui est là (pourtant bien là). Je ne vois rien du tout de ce qui est là. — Ce que j’appelle l’effet de réel, c’est quand je vois ce qui est là. Cela m’arrive. — Soit dans la "réalité" (immédiatement), soit dans une œuvre, par exemple en écoutant un morceau de musique, regardant un tableau ou un film, lisant un poème ou une page de roman. — Je n’ai jamais pu admettre qu’une œuvre soit moins "réelle" que la "réalité". On appelle souvent poésie l’œuvre où se produit un effet de réel : qui fait qu’on accède au réel, une sorte d’"illumination" ou je ne sais pas quoi qui fait qu’on voit, et que soi-même on devient réel, on est, on ne souffre plus du "trop peu de réalité", et c’est l’harmonie des Navahos ou la vie unitive des bouddhistes : le réel… On peut appeler poésie l’acte créateur qui constitue cette œuvre et donne à travers elle accès au réel… Souvent faut-il l’intercession d’un créateur pour voir ce qui est.

Les peupliers de Monet sont là et les vieux souliers de Van Gogh, les rochers de Cézanne, on apprend à voir en regardant ces tableaux ; et la musique de Bach, de Nielsen ou de Schnittke, on apprend à entendre la musique du monde. Le monde est là et un talus de Rimbaud est là, un ciel de Pierre Jean Jouve ; et Thomas Hardy ou Bernanos, Dostoïevski nous montrent des hommes et des femmes réels, et quand on lit Soleil hopi de Talayesa il y a des parois rocheuses qui sont là vraiment, présentes verticalement. — L’art n’a pas d’autre message. Ou s’il en a d’autres, ils n’appartiennent pas au même plan (plan du réel), le seul message de l’art, c’est que le réel est là, qu’il faut seulement tomber de le voir, comme qui dirait, et on est dans l’harmonie, ou l’acuité ou l’évidence, je ne sais pas comment vous appelleriez ça.
Ivar Ch’Vavar, Travail du poème, Préface de Laurent Albarracin, édition des Vanneaux, 2011, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivar ch’vavar, travail du poème, art, réel, harmonie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/08/2014
Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde / de personne

Grive musicienne
La grive
Quand s’achève le mois d’octobre
quand les vendanges sont passées
quand les vignes rouges blessées
par l’automne saignent sombres
quand les cyprès aux noires ombres
en haut des collines dressés
luttent contre les vents pressés
on voit la petite grive sobre
s’asseoir dans la vigne sous les feuilles
avec son panier à raisins
de son bec expert elle cueille
muscat, grenaches, grain à grain
elle en goûte tant qu’elle roule
dans la poussière, heureuse et saoule.
Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde, Seghers, 1990 [éditions Ramsay, 1983], p. 52.
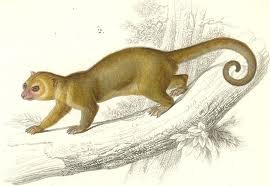
Kinkajou Poto Flavus
Le Kinkajou Potto
Alexandre von Humboldt
Possédait un Kinkajou
Il l’aimait son Potto, son pote
Il l’embrassait sur les joues.
Et le Kinkajou passait
Douce, extensive, sa langue
Sur la barbe bien brossée
Du savant en toutes langues.
Il faudrait se lever tôt
Pour trouver plus insolite
Que l’amour du grand linguiste
Pour son Kinkajou Potto.
Alexandre avait, dit-on,
Ô merveille naturelle
Deux coqs de roche femelles
Joyaux de sa collection.
Or un jour le Kinkajou
Recevut un télégramme
Qui venait de la Louisiane
Où pousse le bel acajou.
C’était de sa vieille mère :
« Faut qu’tu revienn’zaussitôt
Suite décès à ton père
Rois des Kinkajous Pottos. »
Alexandre n’était pas là
Et le Kinkajou (c’est moche !)
Tua les poulettes de roche
Et partant les emporta.
Le sens de cette aventure
C’est que le Kinkajou n’est
Pas un ours. Un ours n’aurait
Jamais pris la précaution
D’emporter des provisions
Ce n’est pas dans sa nature.
Jacques Roubaud, Les Animaux de personne, Seghers, 1991, p. 50-51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, les animaux de tout le monde de personne, humour, grive, kinkajou, rime | ![]() Facebook |
Facebook |
12/08/2014
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955

André du Bouchet par Giacometti
Rhétorique : dépouillés de la rhétorique, on ne se bat plus que les poings nus. (Ferblanterie des mythologies, armurerie comique et naturelle, etc.) On finissait par ne plus entendre que le choc des armures. Nous sommes aujourd’hui au point si intéressant, si vif, de nous reconstituer une coquille.
Dire : pourquoi est-ce que j’écris, ou veux écrire — pas exactement pour le plaisir, ou combler les trous du temps — ou précisément pour cela — l’oisiveté finit par se contre dire et donner un pouce à des forces. Si elle est appuyée par quelques inconvénients solides sur lesquels on peut compter — en dehors : travail, gymnastique, bonté, etc.
Aujourd’hui, comme chaque jour : il faut que la « poésie » devienne plus (autre chose) qu’un constat ou bien se démette. (Moralité, règle de vie, rythme impératif, non-impérieux — mais le mot est détestable.)
Rhétorique. Le « sonnet » devait être une sorte de garde-fou. Écrits par centaines. Des bonheurs relatifs — et de détail — assez pour rendre heureux dans une certaine mesure — mais dans l’ensemble, une fois bouclé le sonnet, rien de bien moderne, ni qui valait qu’on s’y attache ou s’y abîme. Il n’y avait plus qu’à recommencer. Mallarmé essaie d’en faire un absolu, un gouffre. Il s’y abîme. Tout près, justement, de forcer le langage : il n’écrit qu’une poignée de sonnets , au lieu de la multitude que le genre comporte.
De mon côté écrire des poèmes résolument enracinés dans l’effort de l’homme : il sera parfumé des idées du monde ambiant, choyé par le vent. L’eau lui lavera sa sueur. Mais d’abord lui-même —
(Reverdy. C’est ça la réalité telle que je la sens et la respire : mais il faut tout redécouvrir pour soi, comme si vous n’aviez jamais écrit, jamais rien dit. Mais cela je ne l’aurais jamais aussi bien su si je ne vous avais pas lu.)
ART : perpétuel.
Il n’y aura jamais de terme à cette surprise, à cet étonnement sans précédent que nous donnent un poème, une œuvre d’art, pour aussitôt (à condition de nous avoir donné cette surprise, cet étonnement) rentrer dans tout ce qu’il y a de plus familier. L’homme familier (« miracle dont la ponctualité émousse le mystère », Baudelaire) ne cessera jamais de s’émerveiller de lui-même, de se voir reflété dans les yeux de ses semblables.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie et préfacée par Clément Layet, éditions Le Bruit du Temps, 2011, p. 30, 31, 33, 34, 44, 58, 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, carnets 1949-1955, giacometti, rhétorique, poème, écrire, art | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2014
Nikolaï Zabolotski, Poèmes, et Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers

Zabolotski
L’adieu aux amis
Avec vos chapeaux à larges bords, vos longues vestes
Vos carnets de poèmes
Vous vous êtes dispersés en poussière
Comme font les lilas passé le temps des fleurs.
Vous reposez depuis longtemps dans ce pays
Sans formes préétablies, où tout se rompt, se mêle,
Se désagrège, où le tertre funéraire tient lieu de ciel,
Où l’orbite de la lune est immobile.
Là, dans une autre langue, un idiome brumeux,
Chante un synode d’insectes aphones.
Là, une petite lanterne à la main,
Le bonhomme-scarabée complimente ses amis.
Cette paix vous est-elle douce, camarades ?
Avez-vous bien tout confié à l’oubli ?
Maintenant vos frères sont les racines et les fourmis,
Les brins d’herbe, les soupirs, les colonnes de poussière.
Vos sœurs maintenant sont les œillets sauvages,
Les thyrses de lilas, les copeaux, les poules de passage…
Le frère que vous avez laissé là-haut
N’a plus la force de se rappeler votre langage.
Sa place n’est pas encore sur ce rivage
Où vous avez disparu, légers, comme des ombres,
Avec vos chapeaux à larges bords, vos longues vestes,
Vos carnets de poèmes.
1952
Nikolaï Zabolotski, Poèmes suivis de Histoire de mon incarcération, traduits et présentés par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n°986-987, juin-juillet 2011, p. 238-281.
Poème écrit en souvenir de Daniil Harms et d’Alexandre Vvedenski, poètes de l’Oberiou, dix ans après leur mort [Note de J.-B. Para]
Oberiou :sigle de : Obiedinienie Realnovo Iskousstva (Association de l'art réel), groupe littéraire fondé en 1927, auquel se joindra le peintre Malevitch.

Daniil Harms
Le court éclair survola le tas de neige
alluma la bougie tonnerre détruisit l’arbre
le mouton (tigre) épouvanté aussitôt
se mit à genoux
aussitôt fuirent les enfants du cerf
aussitôt la fenêtre s’ouvrit
et Harms passa sa tête
Nicolaï Makarovitch et Sokolov (1 et 2)
passèrent en parlant des fleurs et des nombres féériques
aussitôt passa de l’esprit de la poutre Zabolotski
lisant un livre de Skorovoda (3)
il était suivi par Skaldine (4) s’accompagnant d’un cliquetis
et les pensées de sa barbe tintaient. La chope de l’échine tintait
Harms par la fenêtre criait seul
où es-tu ma compagne
oiselle Esther envolée par la fenêtre
Sokolov lui depuis longtemps se taisait
sa silhouette partie devant
et Nicolaï Makarovitch renfrogné
écrivait des questions sur la papier
Zabolotski couché sur le ventre
voyageait dans un chariot
et au-dessous de l’ours Skaldine
volait un aigle du nom de Serge.
(Mars 1931)
Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers, traduit du russe et annoté par Yvan Mignot, avant-propos de Mikhaïl Iampolski, éditons Verdier, 2005, p. 408-409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nikolaï zabolotski, daniil harms, poésie russe | ![]() Facebook |
Facebook |
10/08/2014
Guillevic, Art poétique

Qu’est-ce qu’il t’arrive ?
Il t’arrive des mots
Des lambeaux de phrase.
Laisse-toi causer. Écoute-toi
Et fouille, va plus profond.
Regarde au verso des mots
Démêle cet écheveau.
Rêve à travers toi,
À travers tes années
Vécues et à vivre.
Ce que je crois savoir,
Ce que je n’ai pas en mémoire,
C’est le plus souvent,
Ce que j’écris dans mes poèmes.
Comme certaines musiques
Le poème fait chanter le silence,
Amène jusqu’à toucher
Un autre silence,
Encore plus silence.
Dans le poème
On peut lire
Le monde comme il apparaît
Au premier regard.
Mais le poème
Est un miroir
Qui offre d’entrer
Dans le reflet
Pour le travailler,
Le modifier.
— Alors le reflet modifié
Réagit sur l’objet
Qui s’est laissé refléter.
Chaque poème
A sa dose d’ombre,
De refus.
Pourtant, le poème
Est tourné vers l’ouvert
Et sous l’ombre qu’il occupe
Un soleil perce et rayonne,
Un soleil qui règne.
Mon poème n’est pas
Chose qui s’envole
Et fend l’air,
Il ne revient pas de la nue.
C’est tout juste si parfois
Il plane un court moment
Avant d’aller rejoindre
La profondeur terrestre.
Guillevic, Art poétique, dans Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant, préface de Serge Gaubert, Poésie / Gallimard, 2001, p. 166, 172, 177, 178,180 et 184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, art poétique, mot, rêve, mémoire, vivre, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2014
Henri Cole, Terre médiane (traduction Claire Malroux)

Masque
J’ai attaché un masque en papier sur mon visage,
mes lèvres presque au-dedans de sa petite bouche rouge.
Tournant la tête à gauche, à droite,
je ressemblais à quelqu’un que j’avais connu, ou été,
aux dents blanches bien droites, aux boucles juvéniles.
Ma vie ordinaire avait suivi son cours attendu,
comme une flèche d’argent se plante dans un cyprès.
Reste à ta place ou tu t’en repentiras, ai-je murmuré
au miroir. Pour réussir, j’avais fait des choses
que je détestais ; pour être aimé, j’avais rivalisé
de promiscuité ;
mon essence semblait se réduire seulement à cela.
Puis j’ai vu mes iris noisette monter à la surface,
comme des œufs accrochés à une plante aquatique,
lisses et clairs, dans un visage vide, un visage d’étang.
Mask
I tied a paper mask into my face,
my lips almost Inside its small red mouth.
Turning my head to the left, to the right,
I looked like someone I once knew, or was,
with straight white teeth and boyish bangs.
My ordinary life had come as far as it would,
like a silver arrow hitting cypress.
Know your place or you’ll rue it, I sighed
to the mirror. To succeed, I’d done things
I hated ; to be loved, I’d competed promiscuously :
my essence seemed to boil down to only this.
Then I saw ma own hazed irises float up,
like eggs clinging to a water plant,
seamless and clear, in an empty pondlike face.
Henri Cole, Terre médiane, édition bilingue, traduction de l’anglais (États-Unis) et présentation par Claire Malroux, Le Bruit du Temps, 2011, p. 86-87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri cole, terre médiane (traduction claire malroux), masque, aimer, visage | ![]() Facebook |
Facebook |
08/08/2014
E. E. Cummings, font 5 (traduction Jacques Demarcq)

Cinq
I
Quand tous les chevaux blancs seront au lit
voudrez-vous, ma vraie dame, vous promener
auprès de moi si à peine un semblant de ville
dans un énorme crépuscule vacille
et toucher (alors) d’un inexprimé
geste subit légèrement mes yeux ?
Et envoyer la vie loin de moi et la nuit
absolument jusqu’au fond de moi… Un prudent
puéril mouvement de votre bras
le fera tout à coup
fera
plus que des héros magnifiques aux stridentes
armures s’entrechoquant sur de grands chevaux bleus,
et les poètes les regardaient, faisaient des vers,
pleurant les chevaliers enfuis sous l’aveuglante lumière.
E. E. Cummings, font 5, traduction et postface de Jacques Demarcq, éditions NOUS, 2011, p. 97, 18 €.
Five, I
After all white horses are in bed
Will you walking besides me,my very lady,
if scarcely the somewhat city
wiggles in considérable twilight
touch(now)with a suddenly unsaid
gesture lightly my eyes ?
And send life out of me and the night
absolutely into me…a wise
and puerile moving of your arm will
do suddenly that
will do
more than heroes beautifully in shrill
armour colliding on huge blue horses,
and the poets looked at them, and made verses,
through the sharp light cryingly as the knights flew.
e. e. Cummings, is 5, in Complete Poems 1904-1962, revised,corrected, and expanded edition containing all the published poetry, by George J. Firmage, New York, Liveright, 1991, p. 303.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, font 5, traduction et postface de jacques demarcq, nuit, dame, chevalier, moyen âge | ![]() Facebook |
Facebook |





