03/06/2014
Octavio Paz, Arbre au-dedans
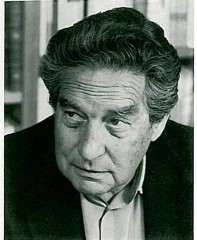
Dix lignes pour Antonio Tàpies
Sur les surfaces urbaines,
les feuilles effeuillées des jours,
sur les murs écorchés, tu traces
des signes charbons, nombres en flammes.
Écriture indélébile de l'incendie,
ses testaments et ses prophéties
désormais devenus splendeurs taciturnes.
Incarnations, désincarnations :
ta peinture est le suaire de Véronique
de ce Christ sans visage qu'est le Temps.
Octavio Paz, Arbre au-dedans, traduction F. Magne
et J-C. Masson, revue par J.-C. Masson, dans
Œuvres, Pléiade, Gallimard, 208, p. 558-559.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, arbre au-dedans, tapies, feuille, mur, signe, écriture, christ, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2014
Paul Nougé, Fragments

Entendre encore
le son de tes pas
sur la pierre
Pourquoi m'as-tu
reconnu ?
La nuit tombait.
Ton rire brisé
la vague
qui retombe
Et en fin de compte
les lèvres sèches
nous sommes
tombés là
dans le sable
(si l'on veut)
exténués
Je ne dis
que ce que
tu penses
J'attendais
ton image
dans le miroir
d'en face
Viens
même si tout est
perdu
Paul Nougé, Fragments,
éditons Labor, 1983, p. 20-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul nougé, fragments, entendre, nuit, lèvres, étreinte, image | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2014
Takuboku (1885-1912), Ceux que l'on oublie difficilement

J'ai compté les années d'espérance
et je fixe mes doigts
je suis fatigué du voyage
Il m'a donné la nourriture
et je me suis retourné contre lui
que ma vie est lamentable
Le soir au moment de se séparer
à la fenêtre du wagon j'ai bâillé
de tout cela je n'ai plus que regrets
Calmement sur une large avenue
une nuit en automne
respirer l'odeur du maïs que l'on grille
Tellement amaigri
ton corps ne semble plus
qu'un bloc de révolte
Combien triste l'instant
où l'on se dit lassé de ce monde paisible
où rien n'arrive
Elle attendait de me voir ivre
pour alors chuchoter
diverses choses tristes
Dans un vieux carnet rouge
restent écrits
le lieu et l'heure de notre rencontre
Takuboku, Ceux que l'on oublie difficilement,
traduit du japonais par Alain Gouvret,
Yasuko Kodaka et Gérard Pfister, Arfuyen,
1989, p. 8, 12, 17, 19, 22, 26, 39, 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : takuboku, ceux que l'on oublie difficilement, rencontre, regret, tristesse, nuit, odeur | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2014
André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre

Je suis sur les traces d'un autre
je suis sur les traces d'un autre
là, je ne me serais pas risqué si un autre — inattendu — ne s'était pas résolu à prendre les devants. tout cela demeuré, sinon, perdu ou fermé.
la perte même aujourd'hui de ce qui est perdu — mots à la hâte griffonnés debout illisibles, ou carnets eux-mêmes plus d'une fois perdus ou manquants — la perte même de ce qui est perdu m'apparaît aujourd'hui insignifiante. mesure pour moi d'une distance, hauteur, ou détachement — cela revient au même, et termes synonymes — prise, qui rend, lorsque je m'en avise, les choses plus respirables. et cette transcription lorsqu'à mon tour, et rapidement, je m'y serai résolu, apport de ce manque — manque sans regret — respirable.
perte de ce qui est perdu apparue insignifiante.
et voilà, sur ses blancs, pour autrui — et l'œil d'un autre que moi-même je puis être — le temps sur ses fractures à nouveau homogène, comme aisé.
[...]
André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre, dans Europe, "André du Bouchet", juin-juillet 2011, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, je suis sur les traces d'un autre, perte, mots, carnet, distance, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2014
Norge, La Langue verte (charabias et verdures)
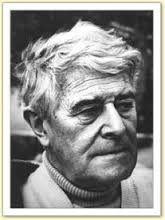
Zoziaux
Amez bin li tortorelle,
Ce sont di zoziaux
Qui rocoulent por l'orelle
Di ronrons si biaux.
Tout zouliq de la purnelle,
Ce sont di zoziaux
Amoreux du bec, de l'aile,
Du flanc, du mousiau.
Rouketou, rouketoukou
Tourtourou torelle
Amez bin li roucoulou
De la tortorelle
On dirou quand on l'ascoute
Au soulel d'aoûte
Que le bonhor, que l'amor
Vont dorer tozor.
Norge, La Langue verte (charabias et
verdures), Gallimard, 1954, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, la langue verte (charabias et verdures), oiseaux, chant, soleil, bonheur | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2014
Bertolt Brecht, Du pauvre B. B.

Du pauvre B. B.
III
Je suis gentil avec les gens. Je fais ce qu'ils font,
Je porte un chapeau melon. Je dis :
« Ce sont des animaux à l'odeur tout à fait spéciale. »
Et je dis : « Ça ne fait rien, j'en suis un, moi aussi. »
V
Le soir je réunis chez moi quelques hommes,
Nous nous adressons les uns aux autres en nous donnant
du "gentleman". Les pieds sur ma table ils disent : « Pour nous
Les choses vont aller mieux. » Et jamais je ne demande : « Quand ? »
VI
Vers le matin, dans le petit jour gris les sapins pissent
Et leur vermine, les oiseaux, commence à crier.
C'est l'heure où moi, en ville, je vide mon verre, jette
Mon mégot et m'endors, inquiet.
VIII
De ces villes restera : celui qui les traversait, le vent !
Sa maison réjouit le mangeur : il la vide. Nous sommes,
Nous le savons, des gens de passage
Et ce qui nous suivra : rien qui vaille qu'on le nomme.
Bertolt Brecht, Du pauvre B. B., traduction Maurice Regnaut,
dans Europe, "Bertolt Brecht", août-septembre 2000, p. 8-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bertolt brecht, du pauvre b. b., conformisme, humain, avenir, ville, inquiétude, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2014
Mina Loy (1882-1966), Velours mousseline, traduction Olivier Apert

Velours mousseline
Elle est froissée
Ses traits
au bord du cri
injure du temps
fuient la mort de partout
maintenus tant bien que mal par un filet de rides.
La place des seins disparus
est signalée par une épingle à nourrice.
Raide,
elle s'appuie contre la pierre angulaire
d'un grand magasin.
Seul mannequin à présenter
sa dernière création,
le patron original
de la misère.
Vêtue de lambeaux d'autrefois
qui ne suffiraient pas à un squelette.
Festonnée par l'éclat inattendu
d'un coton fleuri
la moitié de sa jupe noire
luit comme un miroir maculé
et réfléchit le caniveau —
un mètre de velours mousseline.
*
Chiffon Velours
She is sere.
Her features,
verging on a shriek
reviling age,
flee from death in odd directions
somehow retained by a a web of wrinkles.
The site of vanished breasts
is marked by a safety pin.
Rigid,
a rest against the comestone
of a department store.
Hers alone to model
the last creation,
original design
of destitution.
Clothed in memorial scraps
skimpy even for a skeleton.
Trimmed with one sudden burst
of flowery cotton
half her black skirt
glows as a soiled mirror
reflects the gutter —
a yard of chiffon velours.
Mina Loy, Choix de poèmes, traduits
par Olivier Apert, dans Les Carnets d'eucharis,
2014, n°2, p. 132.
Commande : 17 €, à
Nathalie Riera, L'Olivier d'Argens,
Chemin de l'Iscle, BP 44
83520 Roquebrune-sur-Argens
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mina loy, velours mousseline, traduction olivier apert, pauvreté, vieillesse, ride, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2014
Klaus Merz, Après Homère

Après Homère
Dans la chambre ronronne
le chat. Dehors
un chien qui erre.
À la fenêtre
une femme, elle attend.
Et personne pour l'écrire.
Dernière volonté
Il lui faudrait un Dieu
pour dire merci,
nous confia le vieillard.
Quant aux douleurs et doléances,
il s'en tirait plus ou moins
seul.
Spectacle
Le froid s'ajoute
au silence. L'heure bleue
fait son entrée.
Nous pressons le front
contre la vitre et
applaudissons tout bas.
Nach Homer
Im Zimmer schnurrt
die Katze. Draussen
ein streunender Hund
Am Fenster steht
eine Frau, sie wartet.
Und keiner schreibt's auf.
Letzter Wunsch
Lieb wär'ihm ein Gott,
um zu danken, gestand
uns der Alte.
Mit Schmerz und Klage
komme er eher
allein zurecht.
Schauspiel
Kälte paart sich
mit Stille. Die blaue
Stunde zieht ein.
Wir drücken die Stirn
ans Fensterglas und
spenden leise Applaus.
Klaus Merz, Après Homère, traduction
Marion Graf, dans La revue de belles-lettres,
2013-2, p. 20-21, 26-27, 28-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : klaus merz, après homère, dernière volonté, spectacle, femme, attente, silence, douleurs | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2014
Jean-Claude Pirotte (1939-24 mai 2014), Revermont

sans nouvelles d'ailleurs
et n'étant pas d'ici
ma présence m'écœure
et mon absence aussi
*
ce n'est pas assez dire
que je suis seul et nu
en vérité c'est le bonheur
fredonnant les trilles du diable
de cette vie je peux maudire
seul et nu devant ma table
aux horizons imaginaires
et quel instrument que mes nerfs
un violoneux fantôme joue
mes mêmes airs jour après jour
et cela me tue à ravir
Jean-Claude Pirotte, Revermont,
Le temps qu'il fait, 2008, p. 65, 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, revermont, présence, absence, solitude, musique | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2014
Buson (1716-1783), Le parfum de la lune

les journées lentes
s'accumulent
si loin autrefois
le poirier en fleurs
sous la lune
une femme lit une lettre
je marche, je marche
songeant à des choses et à d'autres
le printemps s'en va
au bord du chemin
des jacinthes d'eau arrachées fleurissent
la pluie du soir
la nuit, des voix d'hommes
irriguant les champs
la lune d'été
la nuit voilée
les grenouilles brouillent
l'eau et le ciel
Buson (1716-1783), Le parfum de la lune,
traduction Cheng Wing fun et Hervé
Collet, Moundarren, 1992, p. 55, 59,
68, 80, 90, 93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buson, le parfum de la lune, pluie, jacinthe, printemps, grenouille | ![]() Facebook |
Facebook |
23/05/2014
Antonio Gamoneda, extraits de Chansons de l'erreur

I
Tu as écouté la plainte de la mer. Elle annonce
une imminence.
Libère-toi
de la pensée : cette
imminence te dépasse.
Libère-toi
Ne réponds pas
à la plainte de la mer.
II
Le destin n'existe pas mais il est traversé de racines rouges. Ainsi
est, fut, ma pensée traversée
par l'étincelle de la négation.
Ainsi
les heures crient, prononcent
leur inutile prophétie :
la pourpre
et l'extinction
du lever du jour.
III
Oui, la négation avance
dans mes veines.
Elle loge
dans la sentine creuse
de la pensée.
À proprement parler
pas de pensée en moi. La fausseté
me possède, l'unique fruit
permis dans cette
épaisseur vivante.
IV
Il y a de la colère dans la grisaille. La lumière gagne les [cours
et les cordes divisent ombres et minéraux.
La lumière soutient doucement la majesté des oiseaux, réunit
en un même instant quiétude et vertige.
As-tu pensé la lumière hors de tes yeux ?
Pense la lumière.
Non ;
tu ne peux la penser : elle
te pense, toi.
Ferme les yeux.
Antonio Gamoneda, extraits de Chansons de l'erreur,
traduit de l'espagnol par Jean-Pierre Bériou et Martine Joulia,
dans Europe, avril 2014, n° 1020, p. 284-285.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio gamoneda, extraits de chansons de l'erreur, mer, destin, pensée, négation, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
22/05/2014
Octavio Paz, Liberté sur parole

La vie tout simplement
Appeler le pain par son nom et que se pose
sur la nappe le pain de chaque jour ;
faire la part du feu, donner à nos rêves,
au bref paradis, à l'enfer,
au corps et à la minute ce qu'ils réclament ;
rire comme rit la mer, comme le vent rit,
sans que le rire sonne comme des bris de verre ;
boire et dans l'ivresse posséder la vie ;
danser sans perdre le tempo ;
toucher la main d'un inconnu
par un jour de pierre et d'agonie
et que cette main ait la fermeté
que n'eut pas la main de l'ami ;
passer par la solitude sans que le vinaigre
torde ma bouche, ni que le miroir
repère mes grimaces, ni que le silence
se hérisse dans un grincement de dents :
ces quatre murs — papier, plâtre,
tapis chiche, foyer jaunâtre —
ne sont pas encore l'enfer promis ;
que ne me blesse plus ce désir,
gelé par la peur, plaie froide,
brûlure de lèvres non embrassées :
l'eau claire jamais ne suspend son cours
et certains fruits tombent mûrs ;
savoir partager le pain — et le partage,
le pain d'une vérité commune à tous,
vérité de pain qui nourrit notre faim
(si je suis homme, c'est par son levain,
un semblable parmi mes semblables) ;
lutter pour que vivent les vivants,
donner vie aux vivants, à la vie,
et enterrer les morts et les oublier
comme la terre les oublie : comme des fruits...
et qu'à l'heure de ma mort j'arrive
à mourir comme les hommes et que me soit donné
le pardon, et la vie perdurable
de la poussière, des fruits, de la poussière.
Octavio Paz, Liberté sur parole, traduction Jean-Claude Masson,
Pléiade, Gallimard, 2008, p. 28-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, liberté sur parole, pain, corps, rire, solitude, baisers, vérité, homme | ![]() Facebook |
Facebook |
21/05/2014
Zbigniew Herbert, Épilogue de la tempête

J'ai donné ma parole
j'étais très jeune
et la raison conseillait
de ne pas donner sa parole
il me suffisait de dire
je vais réfléchir
on n'est pas pressé
il n'y a pas le feu
je donnerai ma parole après le bac
le service militaire
quand j'aurai bâti ma maison
mais le temps explosait
il n'y avait plus d'avant
il n'y avait plus d'après
dans le maintenant aveuglant
il fallait choisir
j'ai donc donné ma parole
parole _ nœud coulant
parole définitive
dans les rares moments
où tout devient léger
transparent
je pense :
« parole
je retirerai bien
la parole donnée »
cela dure peu
car l'axe du monde grince
les gens défilent
les paysages
les cercles colorés du temps
et la parole donnée
est coincée dans ma gorge
Zbigniew Herbert, Épilogue de la tempête,
Œuvres poétiques complètes III, traduit du
polonais par Brigitte Gautier, Le bruit du
temps, 2014, p. 235-237.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zbigniew herbert, Épilogue de la tempête, parole, regret, temps, nœud | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2014
Margherita Guidacci (1921-1992), En relisant Ovide

Hôte de ta maison
Hôte de ta maison dans la chambre
la plus haute, je sens tes rêves monter
du sol et s'entremêler aux miens
pour s'évanouir ensemble
en suivant la même verticale et se jeter
au milieu des étoiles. Quelle joie
de chercher alors par les deux fenêtres
(jumelles et opposées) les amitiés
célestes auxquelles tu m'initias :
contempler au nord Altaïr
et au sud Bételgeuse !
Météores d'hiver
Étoiles fugaces, dauphins du ciel,
avec vous voyage mon âme,
un bond lumineux dans les vagues
bleues de la nuit,
vers mes lointains amis désirés
qui peut-être aperçoivent le signe, et qui, pensant
avec une nostalgie pareille à la mienne
aux douces heures passées ensemble,
prient pour que nous soit donnée une nouvelle rencontre,
et déjà la prière est exaucée :
l'affection simultanée, dans le sillage de l'étoile,
nous étreint dans un embrassement immatériel.
Margherita Guidacci, En relisant Ovide, traduit de l'italien
par Iris Chionne et Pierre Présumey, dans Conférence, n° 36, printemps 2013, p. 399-400.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : margherita guidacci, en relisant ovide, étoile, amitié, rencontre, chambre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2014
Lucio Mariani, Restes du jour, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para

Testament du joueur de cartes et poète
Quand s'éteindra
ma lanterne brumeuse, intermittente
et que j'aurai quitté le grand réfectoire
si l'un des fennecs
qui fouillent les urnes funéraires
avait la lubie —quia absurdum —
de relier mes papiers
avec une aiguille et des baguettes de bois
pour observer mes reliques sous verre
et expliquer qui je fus,
qu'il se garde de tirer des conclusions,
sous peine d'expier à coup de verges
sa contrefaçon de l'histoire.
Car mon œuvre ne fut que travaux en cours,
règles à polir, baumes volatils,
sources et issues accidentelles
voix précaires et tentatives d'homme orchestre,
rien d'autre en somme
que les stations transitoires d'une vie à grands traits.
Tout le jeu consistant à changer
corps et pensée
sous la tignasse bleue des hêtres.
Lucio Mariani, Restes du jour, traduit de l'italien par
Jean-Baptiste Para, Cheyne, 2012, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucio mariani, restes du jour, jean-baptiste para, joueur de cartes, poète, vie, voix | ![]() Facebook |
Facebook |





