30/04/2016
William Cliff, En Orient

j’ai vu la chambre où Cavafis est mort
dans la misère
il avait dû vendre l’appartement
qu’il possédait
pour n’en occuper qu’une seule chambre
avec l’Arabe
un « serviteur » qui vécut près de lui
jusqu’à sa mort
celui qui m’a fait visiter la chambre
m’a déclaré
que Cavafis est mort dans l’ignorance
du monde entier
pas un seul de ses congénères hellènes
ne l’a aidé
quand le cancer a rongé son pharynx
et l’a tué
l’image que certains nous ont donnée
de Cavafis
est celle d’un monsieur très distingué
qui recevait
chez lui de fins lettrés et leur disait
ses beaux poèmes
en buvant de l’ouzo et grignotant
la noire olive
à la lumière de chandelles pour
qu’on ne voie pas
les rides courir et laisser leurs stries
sur son visage
on dit aussi qu’il allait dans la rue
enveloppé
d’une vaste cape noire et flottante
pour se donner
l’air d’un artiste il était d’une taille
indifférente
le nez tombant le visage allongé
et assez laid
mais les yeux dilatés d’une étonnante
vivacité
se jetaient en tous sens pour scruter les
gens qui passaient
étant de famille aristocratique
mais tout à fait
ruinée il aurait eu trop de fierté
pour demander
la charité et se serait ainsi
laissé mourir
dans ce meublé qui s’appelle aujourd’hui
Pension Amir
au numéro quatre deuxième étage
rue Sharm-el-Sheik
ne vivent plus que des Arabes à deux
ou trois par chambre
avec entre les lits un bec à mèche
pour bouillir l’eau
du thé qu’on offre aux étrangers qui viennent
voir où vécut
un des plus grands poètes de ce siècle
mort inconnu
William Cliff, En Orient, Gallimard, 1986, p. 61-63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, en orient, cavais, charme, misère, poète, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2016
Laurent Albarracin, Le Grand Chosier

Les orages grondent et grondent mais ils grondent
Sans qu’on sache d’où cela vient, comme une vitre
Tremble, comme sous la poussée d’un taureau vague,
Un taureau venant, taureau se formant dans l’air.
Né de son souffle, de son pas ou de son coup
D’épaule, les orages grondent et ils naissent
D’eux-mêmes, de la caresse de leur puissance,
Du doux frisson de la colère qui les roule,
Grondent de plaisir comme un éboulis de fauve
Où ronronne un torrent d’eau claire entre ses dents,
Eau qui est salive qui dévaste sa pente.
Tels des châteaux d’air en marche sur le gravier —
L’être est amplification de sa venue —
Les orages grondent en s’en faisant l’écho.
Laurent Albarracin, Le Grand Chosier, Le corridor bleu,
2016, p. 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, le grand choisir, orage, puissance, colère, écho | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2016
Claude Dourguin, Points de feu

Pourquoi la littérature, l’art en général, dites-vous ? Hé bien comme libération, la seule, de la servitude, de la finitude.
Couleurs, textures, senteurs, odeurs, bruits, sons, matières, substances : tout cela nous requiert et nous attache, besoin éprouvé et satisfaction profonde.
La mort physique à quoi l’on assiste fait éprouver avec une évidence violente qu’elle est bien la seule réalité, le seul événement qui valide le « toujours » et le « jamais plus ».
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 64, 81, 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, vivre, art, libération, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2016
Images : Reflets, au Palmen Garten (Francfort)
©Photos Chantal Tanet, 24 avril 2016
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images, reflets au palmen garten (francfort) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2016
Roger Giroux, L'arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre

J’étais l’objet d’une question qui ne m’appartenait pas. Elle était là, ne se posait, m’appelait par mon nom, doucement, pour ne pas m’apeurer. Mais le bruit de sa voix, je n’avais rien pour en garder la trace. Aussi je la nommais absence, et j’imaginais que ma bouche (ou mes mains) allaient saigner. Mes mains demeuraient nettes. Ma bouche était un caillou rond sur une dune de sable fin : pas un vent, mais l’odeur de la mer qui se mêlait aux pins.
Roger Giroux, L’arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre, Mercure de France, 1979, p. 9.
Lieu-je et Lettre ont été réédités par Éric Pesty éditeur, avril 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, l’arbre le temps, suivi de lieu-je et de lettre, question, voix, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2016
Umberto Saba, Il Canzionere

Je rêvais abattu sur le sol...
Je rêvais abattu sur le solà un bien ancien.
J’étais à Trieste, dans ma petite chambre.
Je regardais un léger nuage rose
planer, en se fanant, dans le ciel bleu.
Il se dissipait dans les airs ; je me représentais mon destin
par le sien dans une brève poésie.
Alors « maman — disais-je — je sors » et en hâte,
je me précipitais chez mon cher ami pour la lire.
« Que fais-tu, fainéant ? » Et une main m’éveilla :
et je vis, en ouvrant les yeux vers le ciel,
au milieu de la fumée et des explosions l’avion sur nous.
Je vis des décombres de maisons effondrées,
des soldats courir comme fuyant dans la débâcle,
et au loin, au loin le rivage.
Umberto Saba, Il Canzoniere, traduction René de
Ceccatty, L’Âge d’Homme, 1988, p. 177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2016
André Frénaud, La Sainte Face

La femme de ma vie
Mon épouse, ma loyale étoffe,
ma salamandre, mon doux pépin,
mon hermine, mon gros gras jardin,
mes fesses, mes vesses, mes paroles,
mon chat où j’enfouis mes besoins,
ma gorge de bergeronnette.
Ma veuve, mon essaim d’helminthes,
mes boules de pain pour mes mains,
pour ma tripe sur tous mes chemins,
mon feu bleu où je cuis ma haine,
ma bouteille, mon cordial de nuit,
le torchon pour essuyer ma vie,
l’eau qui me lave sans me tacher.
Ma brune ou blanche, ma moitié,
nous n’aurons fait qu’une couleur,
un soleil-lune à tout casser,
à tous les deux par tous les temps,
si un jour je t’avais reconnue.
André Frénaud, La Sainte Face,
Poésie /Gallimard, 1985, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, la femme de ma vie, énumération | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2016
Christian Prigent, La Vie moderne

(une petite panne)
Joue la moderne un peu question sexe et va
Pas t’écouter cuvette auto-déplora
Triste ô pâle ahuri touriste à pas sa
Voir à quel sein vouer tes desiderata.
C’est fête la fesse et la chair non oui oh
Oui je dis j’obtempère et si mon petit
Doigt va dans des trous gais goûter le coulis
Des perplexités ça va ça va mollo
La libido (zéro alibi : au trot !),
Mais le vache accroc c’est madame qu’on pâme
À ne pas savoir où l’immiscer son âme
Parmi l’incarnate promiscuité, no ?
Christian Prigent, La Vie moderne, un journal,
P.O.L, 2012, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la vie moderne, une petite panne, sexe | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2016
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux

Il ne suffit pas d’ouvrir la fenêtre
pour voir les champs et la rivière.
Il ne suffit pas de n’être pas aveugle
pour voir les arbres et les fleurs.
Il faut également n’avoir aucune philosophie.
Avec la philosophie il n’y a pas d’arbres : il n’y
a que des idées.
Il n’y a que chacun d’entre nous, tel une cave.
Il n’y a qu’une fenêtre fermée et tout l’univers
à l’extérieur ;
et le rêve de ce qu’on pourrait voir si la fenêtre
s’ouvrait,
et qui n’est jamais ce qu’on voit quand la fenêtre s’ouvre.
Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux, traduction
Armand Guibert, Gallimard, 1960, p. 143.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, armand guibert, philosophie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2016
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize : recension
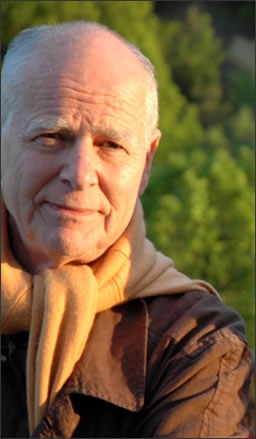
Commençons par un court descriptif. J 13 débute par un bref Prologue (daté de 2009), suivi de deux séquences de dimensions inégales (2010, ‘’Le grand pense-bête », 2011, ‘’Les formules’’(1)) ; l’année 2011 fournit également J 14 et J 15, et le volume se clôt avec J 16 pour l’année 2012. Si l’on ne considère que les datations qui organisent le texte, J 13 et J 14 se présentent sous la forme d’un journal, mais journal parfois abandonné ; rien entre 13 octobre 2010 et le 17 janvier 2011, entre le 28 avril et le 28 mai 2011. S’y mêlent réflexions sur la relation au monde, sur l’écriture, etc., en prose ou en vers, la distinction étant parfois inopportune. J 16, écrit en vers, ne cesse pas, loin de là, d’interroger le rapport au langage. Cette esquisse descriptive vise à souligner que ce nouveau volume est très construit, comme les précédents ; parmi les motifs qui reviennent d’un livre à l’autre, celui de la séparation me semble être privilégié dans la mesure où il est mis en valeur dans J 15, qui ne compte que deux mots :
nous
sommes
Il y a là, en même temps, affirmation de la présence et constat d’une coupure. Voilà qui évoque le ‘’coup de foudre’’ qui retient par ailleurs l’attention de Pesquès : il aide en effet à comprendre que « l’origine est une fracture ; et qu’avec lui, derrière lui, après lui, l’œuvre relève de la fragmentation. » (175) Écrire la colline de Juliau, ce qu’elle est, ne peut se faire que dans son absence et une part importante des remarques portent sur ce point, la séparation, le « gouffre » entre ce qui est vu, entre les choses, et la langage, les mots. Il s’agit bien de « faire des choses avec des mots » (54), mais la colline, comme le corps, ne sont en rien « ce que les mots en disent » (19). D’une certaine manière, il n’est peut-être pas d’autre sujet d’écriture que celui-là ; le paysage, le corps sont devant moi, et sont pour toujours obscurs en ceci qu’avec les mots je vais les construire, mais pas les donner à voir. Ce que reprend inlassablement Pesquès d’un livre à l’autre. Ici : les phrases sont vouées à « la construction d’un colline » (27), « la construction d’une sensation, c’est tout l’effort d’écrire » (112) ; au hasard, dans un des livres précédents : « Les choses ne sont pas ce que les mots produisent. Elles émergent de ce qu’ils séparent »(2).
Cette séparation acceptée justifie le caractère inachevable de l’écriture de Juliau, et certaines ‘’formules’’ écrites au cours des années « demandent à être revisitées, repensées, débattues » (9) : ce qui est avancé dans le prologue annonce que l’objet du livre ne peut être nouveau. Donner le nom de ce qui est devant soi est possible « trajectoire du renard, histoire de la limace, chevreuil dans les vignes » (125), et l’on pourra lire les mots grillon, sauterelle, huppe, mulot, blaireau, pie, ou « Chevreuil à dix pas. Perdrix mixte » (123), on ne sera pas pour autant dans la représentation. Il ne s’agit pas de ‘’découvrir » » que les mots ne sont pas les choses ! Ce qui importe, ce sont les approches de ce qu’est la séparation entre le langage et les choses. Quand Pesquès écrit « Il n’y a séparation que parce qu’il y a quelque chose qui veut être retrouvé, je veux dire inventé à nouveau pour avoir été tranché » (87), la proposition est proche du lien établi à différents moments entre « séparation » et « origine ». Proximité encore avec les vers cités d’Alain Veinstein (153) :
Je ne fais rien d’autre, au fond,
Que m’enfouir le visage dans ces phrases
Pour y retrouver l’odeur de ma mère
La tentative, toujours à recommencer, de dire ce qui est vu — ce qui est vu est mis en cause dès que les mots sont écrits — divise le sujet, alors partie avec les choses, partie avec les mots. Il n’est guère concevable de passer outre, ou plutôt le silence ne peut être compris que « désir interdit, inhumain, transgressif », il n’est que dans « la jouissance et la mort » (163) ; le tragique, dans la relation à la langue, est justement que son usage implique « l’éloignement, la séparation » (55), les choses étant « toujours en excès sous la phrase » (152)
Donc : il faut s’obstiner à écrire, pour accepter ce qui est dessaisissement, condition pour « le pluriel vécu de l’identité » (130), le désir. Si le jaune est omniprésent dans les volumes de La face nord de Juliau, c’est qu’il est la couleur de la sexualité (« pas du jaune, du sperme »,150), et qu’il porte la pluralité, écrit par anagramme nauje, aujen (117) ou « Jaune, JAUNE, jaune » (107). Ce corps en désir, pluriel, est plus présent dans J 16, dans la mesure où la colline s’éloigne, où s’imposent alors « 2 nus/sans le moindre mot » (231), une approche du silence étant possible. D’ailleurs les mots et des connotations liées traditionnellement au corps amoureux imprègnent le long poème pour exprimer « une sorte d’amour réel » : nu (nue, nus), nudité, jouir, ventre, chair, excitée, anfractuosité, écoulement, tendu, « l’épanouie imprenable » — et envahissent le discours, jusqu’aux « cuisses de la phrase ». Ce n’est donc pas hasard si dans la dernière section du livre Pesquès entend « écrire sans accessoires ni chuchotement » (212) — on reconnaît là une citation de Mallarmé dans Crise de vers —, et ainsi (tenter de) trouver une « langue brisée d’amour » (227).
Il faudrait, il faudra, relire tous les volumes de La face nord de Juliau, suivre le lent cheminement et comprendre, dans ce qui peut n’être qu’inachevable, que la poésie bute « sur le fin fond du dicible » (92). Suivre aussi la relation complexe entretenue avec la peinture — les essais de Pesquès dans ce domaine sont à lire avec sa poésie ; ici, est évoqué le peintre de Lascaux, qui « parle dans la nuit » et « en arrache une image » (124). Alors relire l’ensemble comme « une sorte de ready made du gouffre de toute vie, l’évidence du désir incluant son accomplissement écarté. À la fois le « parti pris des choses » et ce qu’elles sont : insaisissables. » (126).
——————————————————————————————
- Certains éléments laissent penser à des ajouts postérieurs : Pesquès introduit des citations dans J 13, II et III (2011) — une liste des auteurs sollicités est donnée page 155 —, mais les vers repris d’Alain Veinstein sont extraits de Scène tournante publié en 2012.
- Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 57.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, 252 p., 18 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 7 avril 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, treize à seize : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2016
Étienne Faure, Légèrement frôlée
La nuit quelqu’un pleure en elle
plus souvent qu’autrefois.
Sur le ponton, sa peur
— chair évidée des poissons servant d’appâts —
cent fois réveillée, c’est la noyade.
Ce chagrin d’un autre, elle le porte
ainsi qu’un deuil à très haute tension
dans la gorge, au sternum, sous les os.
Puis, le jour revenu, le sang circule,
chacun respire,
de nouveau la vie va reprendre,
on a eu peur ; pourtant
l’amour que le mort lui porte
n’a pas quitté ce corps, chair votive
où la beauté résiste à fleur de peau
— tant le mort pense à elle —
comme en janvier fleurissent
les camélias du littoral
malgré le froid, puis fanent,
offerts à la jetée.
les camélias du littoral
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon,
2007, p. 60.
Étienne Faure a publié Vues prenables (2009),
Horizon du sol (2011), La vie bon train (2013),
Ciné-plage (2015).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, légèrement frôlée, les camélias du littoral, perte, chagrin | ![]() Facebook |
Facebook |
19/04/2016
Robert Pinget, Mahu ou le matériau
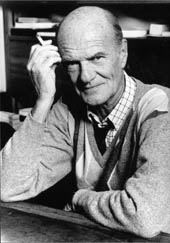
Le chèque
Un chien se présente au couvent de Sainte-Fiduce. Il demande à la bonne sœur de faire des prières pour que son maître le retrouve. Son maître l’a perdu un jour à la chasse et depuis personne n’en a entendu parler. Mais lui, il a rôdé sans cesse jusqu’à cette idée de prières.
La bonne sœur le fait attendre au parloir. Elle revient quelques instants après et lui dit que la Mère Supérieure ne veut pas entendre parler de prières pour les chiens. Inutile d’insister. Les dernières faites au couvent contre la règle l’ont été pour une chèvre. Des ennuis épouvantables en sont issus. Cette chèvre apparaissait à tout propos, un peu partout, dans des attitudes pieuses, et vraiment ça n’était pas convenable. On finissait dans le pays par la confondre avec sainte Fiduce elle-même qui, comme chacun sait, apparaît souvent.
Le chien à ces paroles rougit, rougit, rougit. La bonne sœur lui demande ce qu’il a. Et lui, naïvement, lui dit qu’il a été cette chèvre assez longtemps. Qu’il n’y pouvait rien, qu’il espérait retrouver son maître plus facilement sous cette forme. « Mon maître m’a perdu en chassant le jour de la Toussaint. »
[...]
Robert Pinget, Mahu ou le matériau, éditons de Minuit, 1952, p. 82-83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert pinget, manu ou le matériau, chien, chèvre, maître, nonne | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2016
Robert Walser, Nouvelles du jour

Elle et lui
Lui tout autant qu’elle, apparemment, sont à considérer comme cultivés. Il avait vu le monde, elle aussi, il était plein d’esprit, elle ne l’était pas moins. Tous deux, on peut le dire, ont atteint les sommets de la vie, entourés des riants pâturages d’une éducation supérieure. Leur soif de savoir leur a fait connaître une foule de gens et de contrées. Ils ont habité à droite et à gauche, ont découvert toutes sortes de mœurs, d’objets et de circonstances, tout en se distinguant par leur calme et leur retenue d’une part, leur vivacité et loquacité de l’autre. Sur les rives d’un lac, la femme se fit bâtir une maison et invita cet homme, qu’elle aimait, à s’installer chez elle tout à son aise. Lui qui, de son côté, la plaçait aussi très haut, ne savait pas s’il devait accepter ou décliner son offre. Apparemment hésitant, tâtonnant, pesant le pour et le contre, il aimait à sonder et tergiverser. Au fond, elle n’était pas différente, je veux dire qu’elle était savante et vivait partout en esprit. Elle résidait ailleurs avec son âme, loin du séjour de son corps. Du moment qu’elle l’aimait, ce fait lui était pénible, et ainsi donc, elle ne l’aimait pas. Pour lui, c’était pareil. Lui appartenant, il appartenait à une autre. Le sachant ambivalent et peu fiable, elle lui faisait des reproches.
[...]
Robert Walser, Nouvelles du jour, traduction de l’allemand par Marion Graf, éditions Zoé, 2000, p. 117-118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelles du jour, marion graf, couple, idéal, robert walser | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2016
Aragon, Théâtre / Roman

Thérèse, ou L’acteur ne parvient pas à s’endormir
Des pas dans l’épaisseur des murs des meubles, des méandres
De ma mémoire Des soupirs Ce que je fus ce que je suis
Me tiennent éveillé La maison la rue À cette heure de l’ombre
Tous les bruits les plus bas les plus forts Un passant
Qui me ressemble les freins d’une voiture et je n’arrive pas
À comprendre si c’est au dehors ou dans moi
Tous les bruits sont contre-nature
J’écoute invinciblement j’écoute la rumeur mortelle de ma vie
J’entends battre un volet la voile d’un navire
Un vent je ne sais d’où venu m’apporte de partout
Le chant morne des drapeaux en berne
Je chavire ou le lit Je m’enfonce je verse
Vers toi ma Terre qui m’attires
Comme tu fais le plomb
Terre ma femme ma faiblesse à la fois
Et ma force
Terre ma terre où je tombe
Terre profonde à mon fléchir
À la mesure de ma pesée
Terre couleur de mon sommeil
Terre ma nuit mon insomnie
Aragon, Théâtre / Roman, Gallimard, 1974, p. 217-218.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, théâtre roman, thérèse, acteur, bruit, terre | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2016
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup

La chasse au loup
À cette heure incertaine où l’obscur dispute
Au jour son royaume la déesse repue
Rappelle ses valets avant que de céder
Au sommeil tous les oiseaux se sont tus et les
Pâles enfants des hommes tremblent dans leurs draps blancs
Lorsqu’un rêve très ancien vient les visiter
À la vitre étoilée de la chambre l’ombre
Bleue de la bête qui regarde et attend
*
À l’enclume de la nuit apollon martèle
La lune vieille casserole cabossée
Et blanchie aux feux ronflants de l’empire des
Morts voici l’heure des métamorphoses et des
Enchantements Ô théâtre où tout s’échange et
Se déplie les mots comme fleurs de papier
[...]
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup,
Gallimard, 2007, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup, sommeil, rêve, enfance, apollon | ![]() Facebook |
Facebook |









