12/02/2025
Jules Supervielle, Le Forçat innocent

Petite, petite, que veux-tu ?
Est-ce une petite morte
Qui se cache là derrière ?
Non, elle est vivante
Et voilà qu’elle sourit
De manière rassurante.
Un visage entre deux portes,
Un visage entre deux rues,
Plus qu’il n’en faut pour un homme
Fuyant son propre inconnu.
Jules Supervielle, Le Forçat innocent, dans
Œuvres poétiques complètes, Pléiade /
Gallimard, 1996, p. 253.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le forçat innocent, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2019
Michel Collot, Le parti-pris des lieux : recension
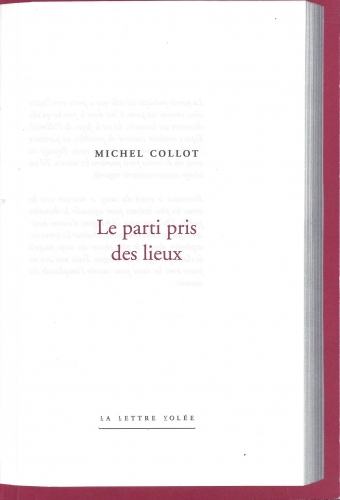
Connaisseur de la poésie moderne et contemporaine, Michel Collot a beaucoup écrit à propos du paysage*. Le parti pris des lieux rassemble pour l’essentiel des poèmes en prose à propos de paysages ’’naturels »’’, puis de paysages urbains ; suivent une série de rêves et des poèmes écrits après une résidence à Charleville. Les dernières séquences constituent une ouverture, réflexions sur l’architecture grecque et sur des peintures de paysages. Ajoutons que, d’un bout à l’autre, l’écriture des paysages est souvent moyen de définir ce qu’est pour lui la poésie.
Les paysages, vus directement ou réinventés grâce aux tableaux, sont des espaces explorés de diverses manières et liés au temps, ‘’lieu mémoire’’. Deux courts avant textes annoncent ces caractéristiques, j’en extrais la première phrase : « La parole poétique est celle qui se porte vers l’autre rive, comme un pont » et « Remonter le cours du sang, se tourner vers les zones les plus intimes pour agrandir le domaine public ». Ce qu’apprennent les proses données autobiographiques, c’est l’absence pour Michel Collot d’ancrage dans un paysage pendant l’enfance, contrairement à celui qui, né dans un village de Bourgogne ou des Landes, apprécie d’en dire les charmes ; il a vécu dans cette absence de lieu qu’est toute banlieue, loin de la Champagne paternelle et du Vaucluse maternel : « n’étant nulle part », il devint capable d’une « adhésion fugitive » à un lieu jusqu’alors inconnu, chaque fois que « le temps d’un instant, se nouait un certain accord entre moi et le monde, entre le ciel et la terre, entre la nature et les hommes. » C’est ensuite par l’écriture qu’il invente ses propres paysages.
L’inconnu ne devrait jamais être inquiétant, il apparaît plutôt comme une chance puisqu’il oblige chaque fois à « faire l’épreuve de [notre] relation intime avec le monde » et, ce faisant, à reconnaître notre « appartenance au monde ». L’écriture du paysage, à partir de ces prémices, abandonne l’idée commune du lyrisme comme expression du moi : il est ici « expression du sujet hors de soi qui explore son propre inconnu à travers l’étrangeté du monde et des mots ». Ce sont des fragments de cette exploration qui sont proposés, les paysages les moins aimables pouvant être appréciés. Ainsi, on sait que « la mondialisation habille le globe de teintes uniformes », cependant rien n’empêche de voir la ville autrement que grise et de la réinventer à partir des matériaux disponibles devant soi. Un exemple : Michel Collot, assis un soir d’hiver dans un abribus, voit sur l’immeuble en face de lui la mention d’une pension de famille et il commence à « imaginer la vie des pensionnaires », puis il découvre dans les vitres d’une fenêtre ouverte « un paysage inaperçu », enfin une jeune fille à sa fenêtre le fait rêver — jusqu’au moment où l’autobus arrive. Ce poème récit illustre la manière dont peuvent se révéler autres les choses du monde.
Il faut évidemment prêter une attention particulière à ce qui nous entoure pour comprendre, non qu’il y a des choses cachées dans le quotidien mais plutôt qu’à tout moment peut naître une émotion, que l’imagination s’empare aisément d’un détail. Alors, le lieu et le temps se transforment, parfois de manière inattendue : ainsi, « au bord du précipice (…) on plonge dans les entrailles de la terre » et, entre les murettes, on s’égare dans un « dédale de couloirs » vers quelle issue ? « le vide », et l’on se dit, en l’espérant et en le craignant : « Le Minotaure nous y attend » — avant à nouveau de marcher sur un sentier plus avenant. Un autre ’’lieu’’ privilégié — espace et temps s’y confondent — est le sommeil, grâce auquel le narrateur « plonge dans la nuit des temps, descend au fond de la grotte obscure des sensations. » La paroi où la cordée progresse est aussi mouvement vers l’inconnu et la plus petite erreur peut conduire à la chute, alors « une main se tend, une voix répond », « L’échange est renoué », la chute écartée. Il est donc des lieux dangereux qui, par leur nature même, peuvent conduire à la disparition. Dans les poèmes de Michel Collot, le vide est toujours proche : celui des cauchemars n’est dissipé que par le jour, qui aide à « échapper à l’abîme du sommeil et à la masse obscure des rêves. » Le vide est également présent dans la vie de chaque jour, ainsi la jeune femme qui a fait rêver le narrateur « s’appuy[ait] sur le garde-corps », et lui-même prend garde à vérifier, lorsqu’il se trouve à un étage élevé, qu’un appui à une fenêtre le préservera de la chute ; dans un rêve, il voit une « rambarde très basse » et, rapporte-t-il, « je crains de tomber ».
Il faut sans cesse ouvrir les yeux pour voir ce qui échappe au premier regard pour lequel tout est indistinct, et comprendre progressivement que toujours un « rayon (…) perce à jour toutes choses (…) : les voici de nouveau visibles, et rendues à leur part d’invisible. » Ainsi la poésie : beaucoup « de mots éculés, sans cesse remâchés pour retrouver enfin par la grâce d’une image la saveur de la langue. » Cette exploration des lieux est sans cesse révélation, des « ramifications secrètes » de la paroi rocheuse au surgissement de la rivière un temps partie dans « l’épaisseur obscure » de la terre. Ainsi de la poésie : « la ligne devient sens, le sens prend la tangente — tangent à l’infini ».
Michel Collot, Le parti-pris des lieux, La Lettre volée, 2018, 128 p., 19 €.Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 décembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, le parti-pris des lieux, exploration, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2018
Pierre Reverdy, Le gant de crin

Le lyrisme n’a rien de commun avec l’enthousiasme, ni avec l’agitation physique. Il suppose au contraire une subordination quasi-totale du physique à l’esprit. C’est quand il y a le plus : amoindrissement de la conscience du physique et augmentation de la perception spirituelle, que le lyrisme s’épanouit. Il est une aspiration vers l’inconnu, une explosion indispensable de l’être dilaté par l’émotion vers l’extérieur.
La carrière des lettres et des arts est plus que décevante ; le moment où on arrive est souvent celui où on ferait bien mieux de s’en aller.
Pierre Reverdy, Le gant de crin, Plon, 1927, p. 36-37, 60
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le gant de crin, lyrisme, enthousiasme, inconnu, carrière | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2017
Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert
Pratiquer l’écriture c’est pratiquer, sur sa vie, une ouverture par laquelle la vie se fera texte. Le vocable est l’étape vers l’inconnu où l’esprit paiera le prix de sa témérité ; cet inconnu sans lequel la pensée ne serait qu’une pensée morte et jamais une pensée à mourir, au plus vif, au plus écartelé de sa mort.
Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert, Gallimard, 1978, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le soupçon le désert, écriture, vie, esprit, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2016
Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance

Photo André Perlstein
Une autre fois, il me semble qu’avec plein d’autres enfants, nous étions en train de faire les foins, quand quelqu’un vint en courant m’avertir que ma tante était là. Je courus vers une silhouette vêtue de sombre qui, venant du collège, se dirigeait vers nous à travers champs. Je m’arrêtai pile à quelques mètres d’elle : je ne connaissais pas la dame qui était en face de moi et qui me disait bonjour en souriant. C’était ma tante Berthe ; plus tard, je suis allé vivre presque un an chez elle ; elle m’a peut-être alors rappelé cette visite, ou bien c’est un événement entièrement inventé, et pourtant je garde avec une netteté absolue le souvenir, non de la scène entière, mais du sentiment d’incrédulité, d’hostilité et de méfiance que je ressentis alors ; il reste, aujourd’hui encore, assez difficilement exprimable, comme s’il était le dévoilement d’une « vérité » élémentaire (dorénavant, il ne viendra à toi que des étrangères ; tu les chercheras et tu les repousseras sans cesse ; elles ne t’appartiendront pas, tu ne leur appartiendras pas, car tu ne sauras que les tenir à part…) dont je ne crois pas avoir fini de suivre les méandres.
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994, p. 137-138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d'enfance, guerre, inconnu, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
30/04/2016
William Cliff, En Orient

j’ai vu la chambre où Cavafis est mort
dans la misère
il avait dû vendre l’appartement
qu’il possédait
pour n’en occuper qu’une seule chambre
avec l’Arabe
un « serviteur » qui vécut près de lui
jusqu’à sa mort
celui qui m’a fait visiter la chambre
m’a déclaré
que Cavafis est mort dans l’ignorance
du monde entier
pas un seul de ses congénères hellènes
ne l’a aidé
quand le cancer a rongé son pharynx
et l’a tué
l’image que certains nous ont donnée
de Cavafis
est celle d’un monsieur très distingué
qui recevait
chez lui de fins lettrés et leur disait
ses beaux poèmes
en buvant de l’ouzo et grignotant
la noire olive
à la lumière de chandelles pour
qu’on ne voie pas
les rides courir et laisser leurs stries
sur son visage
on dit aussi qu’il allait dans la rue
enveloppé
d’une vaste cape noire et flottante
pour se donner
l’air d’un artiste il était d’une taille
indifférente
le nez tombant le visage allongé
et assez laid
mais les yeux dilatés d’une étonnante
vivacité
se jetaient en tous sens pour scruter les
gens qui passaient
étant de famille aristocratique
mais tout à fait
ruinée il aurait eu trop de fierté
pour demander
la charité et se serait ainsi
laissé mourir
dans ce meublé qui s’appelle aujourd’hui
Pension Amir
au numéro quatre deuxième étage
rue Sharm-el-Sheik
ne vivent plus que des Arabes à deux
ou trois par chambre
avec entre les lits un bec à mèche
pour bouillir l’eau
du thé qu’on offre aux étrangers qui viennent
voir où vécut
un des plus grands poètes de ce siècle
mort inconnu
William Cliff, En Orient, Gallimard, 1986, p. 61-63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, en orient, cavais, charme, misère, poète, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |






