15/12/2019
Claude Dourguin, Paysages avec figure : recension
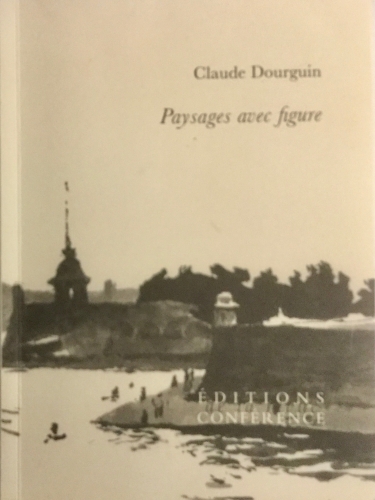
Dans ses écrits sur la peinture, Claude Dourguin a parfois décrit l’« esquisse narrative » de certains tableaux titrés Paysage avec figures, elle choisit ici de retenir des paysages qui, tous, sont des « révélateurs », « cristallisent (...) goûts et affections », habités par une figure, celle du compagnon disparu qui n’apparaît que sous la forme "il" ou partie du "on". Aucune hiérarchie entre les lieux n’est établie ; même si prédominent mer et montagne, ce qui importe est la possibilité de découvrir, apprendre — donc vivre —, et aussi de sortir du temps, de la durée quotidienne, chaque paysage devenant une « réserve imaginaire ».
En 1951, la sculptrice Barbara Hepworth disait à propos de Saint-Ives, en Cornouailles, où elle vivait, « Je fais partie du pays, un paysage marin dont les origines remontent à des centaines de milliers d’années » ; c’est un sentiment analogue qu’éprouve Claude Dourguin dans ce lieu où elle retrouve maintes traces d’un passé ancien, y revivant « la rumeur puissante qui hante le cycle arthurien » et, en même temps, le village a été construit de sorte à prendre une forme favorable pour le regard, où « les collines (...) font amphithéâtre pour observer la mer de près ». On peut être là dans le présent, dans le partage et, cependant, dans un autre temps.
L’émotion d’être, ensemble, « sans âge, relié à quelque chose de très ancien », naît également loin de la mer, dans un autre village. Il est une constante dans ce qui fait aller ailleurs — le lieu du retour à la vie "normale" n’est jamais nommé —, c’est la certitude qu’à chaque fois les heures s’émancipent de l’horloge », que rien ne peut rappeler ce qui, justement, oblige à tenir compte du temps, au fait que vivre dans une société exige une présence. Tous les paysages évoqués, parcourus à un moment ou à un autre en couple, ont permis de saisir le vif des choses du monde. À Naples, par exemple, outre la mer « dont la vue est toujours réconfortante », le visiteur s’arrête à l’un des multiples étals aux poissons pour leur « beauté simple, profuse, offerte, composition sans façon du quotidien » ; la beauté des choses de la nature — arbres, eaux, ciels — est sans cesser remarquée, décrite, et l’est aussi ce qui modifie les connaissances, change la manière de regarder le monde. Dans la vallée du Layon, avec la visite du moulin cavier de Thouancé, est « retrouvée l’humeur franche de qui parcourt, observe, mesure, analyse, comprend le paysage et lui donne sens », donc ce qui permet de vivre en harmonie avec lui. Cette harmonie ne nécessite pas toujours la variété des formes naturelles, elle naît également de la traversée du désert glacé russe quand il n’y a « nul obstacle ni présence, rien pour la [= la vue] limiter » ; alors, « espace et temps [sont] souverains, formes d’ici-bas dans leur nudité ». Paradoxe apparent : l’unité du lieu s’impose comme celle de la haute montagne quand, après un « passage ingrat », on connaît la « blancheur de révélation » de la neige. L’unité n’est pas donnée, il a fallu « s’être colleté au rocher », avoir « surmonté les moraines, bataillé », et les étals napolitains exigent un apprentissage du regard pour être perçus comme offerts.
Quels que soient les lieux parcourus, ils sont ouverture vers autre chose, parfois même ils contiennent un autre paysage ; ainsi, à partir d’une certaine dimension la forêt devient semblable à la mer (« la futaie (...) comme une mer », « on voyage en forêt comme on s’embarque pour la haute mer »), toute limite pour la vue disparaissant. Les paysages sont tremplin vers un ailleurs, l’un présente le « sortilège d’une métamorphose », l’autre, la haute montagne, fait entrer « dans un univers autre où s’opèrerait une transsubstantiation des matières ». Ils appellent aussi les souvenirs et suscitent des rêveries ; un jour, quand on s’égare dans la neige et passe la nuit près d’un feu de branchages, alors « le monde [... est] poreux au rêve, [ouvre] à la littérature et vice versa ». Certes, la nature est toujours bien présente avec par exemple, à l’île de Batz, une flore et une « faune locales (...) exceptionnelles » ou, ailleurs, avec le plaisir d’« affronter le froid et se mêler aux arbres » ; cependant la traversée du monde « jamais ne se détache vraiment des œuvres ».
Rien dans Paysages avec figure qui évoque une anthologie, mais quelques citations et des allusions suffisent au lecteur pour qu’il accompagne le mouvement du paysage aux textes, à la peinture, à la musique même. La mer, la Bretagne très présente, font apparaître Corbière, Gracq, on suit les chemins de Nerval dans le Valois et la montagne a une « unité monumentale, claudélienne » ; on se souvient ici et là de Follain, de Supervielle, de Baudelaire, de Rimbaud, de Valéry, et l’on cherche dans sa mémoire tel tableau de Klee, de Whistler, de Turner, de Constable, on retrouve un fragment du Samson et Dalila de Saint-Saëns ; etc. — une seule exception, dans le désert de l’Asie centrale, « nulle peinture, nul poème, nulle œuvre littéraire (...) ne venait (...) répondre » aux rêveries. Pour en rester aux citations, Claude Dourguin a choisi en épigraphe un fragment d’un poème de Hölderlin ("En bleu adorable") dans la traduction de du Bouchet : « Riche en mérites, mais poétiquement toujours, / Sur terre habite l’homme » : c’est, elliptiquement, énoncer un principe de vie, que l’on reconnaît d’un bout à l’autre de ses parcours.
Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, 144 p., 17 €. Cette note d lecture a été publiée par Sitaudis le 15 novembre 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2019
Claude Dourguin, Paysages avec figure

(Naples)
Le passant se faufile entre des façades hautes noircies par les années, percements irréguliers, entablements brisés, étages dissemblables indemnes de toute fureur réhabilisatrice ; des porches vastes introduisent à des vestibules superbes à colonnes, les marches déboîtées d’une église servent à l’étalage d’une quincaillerie d’occasion, des arrière-cours où s’entasse un capharnaüm hétéroclite d’ustensiles, de vieilles motos et de plantes, livrent leurs loggias d’altitude à la gaieté des lessives ; des palais s’accoudent à la vie populaire, leurs façades aux larges fenêtres à frontons posent, noblesse oblige, leur belle architecture à peine visible en l’absence de recul. La rue affirme la plus vivante des royautés — on y fait son marché, on y discute, travaille, conclut toutes sortes d’ententes, d’échanges, on y vent et y achète à peu près tout, on peut venir à y dormir, on y joue, on s’y affronte parfois ; on s’y repose, à terre, accroupi contre un mur à deux pas du chantier pour manger sa pizza pliée a libretto sans rien manquer du spectacle.
Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, p. 134.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, naples, rue, diversité | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2019
Claude Dourguin, Paysages avec figure

Le ciel et la terre, rien d’autre. Alentour, petites élévations irrégulières, toutes rabotées, relief de vieux massif, sur la lande offerte son tapis rêche déroulé à perte de vue, dalles, de proche en proche la roche affleure. Vaste espace dégagé, le regard que rien ne borne s’élance jusqu’à l’horizon, unité très assourdie des teintes — brun décoloré, lessivé de la lande et gris du granit, gris éteint, lui aussi raclé, récuré, le plus lourd fait signe au plus léger, correspondance singulière d’une matière à l’autre ; même ton pour lui répondre, la cohorte de nuages, placide, qui pousse toutes ses toiles gonflées. Le désir brut de s’élancer engage les pas — ni chemin, ni sentier, des traces vagues, terre plus mince, trop ingrate, végétation plus rase, socle rocheux, des passages sans dessein offrent leurs voies, se laissent emprunter, on va pour aller, saisi d’une ivresse de liberté ; nulle direction assignée, toute une contrée, un pays, ouvert, livré au seul vis-à-vis du plus grand es ciels et pour combler l’œil, herbes, buissons et pierres, un ample, entêtant panorama.
Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, p. 74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, chemin, liberté | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2018
Claude Dourguin, Ciels de traîne

Il y a toujours plus de vérité dans la réalité passée par l’art, la peinture, la littérature, que dans son état brut, comme elle se livre à la perception. Tout est faux — au sens d’exactitude — chez Stendhal et nul comme lui pour nous apprendre l’italianité, l’opéra, la passion, évoquer la vie de province sous la Monarchie de Juillet, désigner la bêtise etc. Chardin en dit davantage sur la nature des fruits que ceux qui sont devant nous sur la table.
Qu’entendre par cette « vérité » ? La part profonde du mystère, de tremblement, d’obscurité, d’infini, approchés, suggérés ; l’au-delà de l’apparence dans chaque artiste saisit un fragment, différent chaque fois, une face nouvelle, sans que jamais il puisse être épuisé.
*
La langue ne parvient à cerner le réel en sa complexité, en sa totalité, en sa fragilité, mais elle donne autre chose que lui, son aura, sa part tremblante justement, ce qui le déborde, peut-être sa face voilée, incertaine qui le relie à un ailleurs sinon à une transcendance. Oui, la langue dans son effort de désignation, d’appréhension se charge de mystère, et ce n’est pas rien : même inadéquat, même insuffisant ce mouvement vaut qu’on le tente.
Claude Dourguin, Ciels de traîne, Corti, 20I1, p. 44-45 et 17.
* * *
Soirée autour de Tête en bas d’Étienne Faure,
avec un hommage à Julien Bosc, éditeur et poète,
le jeudi 18 octobre, à partir de 19 h,
librairie Liralire, 116, rue Saint-Maur, 75011, Paris.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, vérité, ciels de traîne, art, peinture, langue, stendhal | ![]() Facebook |
Facebook |
24/07/2018
Claude Dourguin, Laponia

(en Laponie)
Ici à traverser les centaines de kilomètres sans âme qui vive que le blanc unifie, j’éprouve l’espace nu, bien des fois il m’a semblé le pousser devant moi, à l’infini toujours reconstitué, inépuisable, et peut-être est-ce folie dont me tient l’exaltation, avancer projetée ers là-bas, allégée, délivrée des attaches et du regard pas dessus l’épaule, toute entière dessein, tendu vers l’avenir inconnu, illusoire peut-être, qui se confond avec le franchissement des distances. Alors cet élan sans rupture que rien n’arrête — un jour, la mer, seule — tient lieu de destin.
Claude Dourguin, Laponia, 2014, p. 42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, laponia, parcours, destin, infini | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2016
Claude Dourguin, Points de feu

Nos sociétés ont fait des choix idéologiques, plus nombreux que jamais ceux que Nietzsche appelle « les philistins de la culture » — s’entend ceux qui aiment l’art pour son divertissement et/ou l’idée qu’ils se font d’appartenir à une élite.
L’auteur c’est d’abord, l’étymologie nous le rappelle avec bonheur, celui qui accroît. Certainement pas celui qui « crée » — on se demande d’ailleurs comment et par quelle opération du Saint-Esprit, comme il se disait naguère de manière, heureusement irrévérencieuse. Cette imposture (pleine de prétention) qui nous rebat les oreilles avec les « créateurs » de tous poils est devenue insupportable tant elle prévaut partout.
L’exigence d’une tâche.
Virginia Woolf également dénonçait le « I, I, I », la permanence du sujet, du moi dans l’écrit.
L’impression, parfois, que l’on est parmi les derniers à regarder encore les étoiles du ciel, à se satisfaire de cette contemplation, de ces moments, de leur silence.
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 131, 141-142, 153, 155, 157.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, société, culture, auteur, imposture, sujet, étoile | ![]() Facebook |
Facebook |
12/08/2016
Claude Dourguin, Points de feu

Bien sûr, le seul « monde meilleur », celui où nous sommes heureux sans limite jamais imposée, noud accomplissons, c’est celui de l’art. Ce qui était pressentiment dans la jeunesse, horizon tentateur sinon promis, devient au fil de la vie, une certitude, la seule consolation, le seul destin qui vaille. À condition, cependant, que le flux des jours ne le déserte pas, qu’il soit irrigué par le monde d’ici, ne se sépare pas du terreau de la vie.
L’inacceptable, ce serait le monde désenchanté – n‘être plus surpris, ému, heureux sans raison face à l’arbre qui s’étire tout seul dans le champ vaste, face au liseré de neige qui hisse les montagnes au ciel, au bruit de la fontaine au seuil de la nuit, quand parvient soudain aux narines l’odeur de feu d’une cheminée, celle des coings mûrs aux abords de la haie ; à seulement marcher et voir se poursuivre le chemin là-bas de l’autre côté de la vallée.
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 37, 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, bonheur, art, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2016
Claude Dourguin, Points de feu
Mars sur sa fin : l’orge est sorti de terre, la grande parcelle a changé de couleur imperceptiblement (je l’ai sous les yeux, au sens propre puisqu’elle s’étend à quelques mètres en contrebas, chaque jour), brun roux puis strié à peine, irrégulièrement selon le sol, de vert pâle, puis quadrillé de franches bandes vertes. Les tiges ont à peine quelques centimètres mais cela suffit : désormais chaque matin une bande de chevreuils — deux adultes et trois jeunes — prennent leur petit déjeuner en même temps que moi. Souvent ils renouvellent l’opération le soir, tôt vers six heures, six heures et demie. Ils broutent en tranquillité, nonchalants comme s’ils savouraient les jeunes pousses succulentes, tendres à coup sûr, et, sans doute, le font-ils — quelle raison de les croire dénués de goût ?
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : printemps, claude dourguin, points de feu, orge, chevreuil, goût | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2016
Claude Dourguin, Points de feu

Pourquoi la littérature, l’art en général, dites-vous ? Hé bien comme libération, la seule, de la servitude, de la finitude.
Couleurs, textures, senteurs, odeurs, bruits, sons, matières, substances : tout cela nous requiert et nous attache, besoin éprouvé et satisfaction profonde.
La mort physique à quoi l’on assiste fait éprouver avec une évidence violente qu’elle est bien la seule réalité, le seul événement qui valide le « toujours » et le « jamais plus ».
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 64, 81, 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, vivre, art, libération, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2014
Claude Dourguin, Journal de Bréona

Notes sur la montagne
La contemplation de la montagne implique une intériorité plus grande que celle de la mer. D'ailleurs, s'il n'est pas rare de rencontrer sur les quais, sur les rivages des personnes (de toutes sortes) accoudées ou assises face à la mer en observations silencieuse, le cas est beaucoup moins fréquent en montagne. À cause de l'agitation permanente, des mouvements de l'eau, des vagues même peu marquées, la mer donne l'idée de la vie — changeante, imprévisible —suscitant une curiosité sinon une attente — que va-t-il se passer maintenant ? « La mer, toujours recommencée ! » C'est toute une trame anrrative, avec ses anecdotes en sus, le passage d'un bateau de pêche, l'apparition d'une voile là-bas, le train des nuages au ciel, qui se met en place. La montagne, elle, souvent déserte, immobile ne connaît que les modifications de la lumière, beaucoup moins rapides sous les climats qui sont les siens. Quant à l'intérêt pour les météores il exige une attention subtile, une patience attentive indifférente à la monotonie.
Claude Dourguin, Journal de Bréona, Isolato, 2014, p. 55-56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, journal de bréona, mer, montagne, mouvement, immobilité | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2012
Claude Dourguin, Les nuits vagabondes
Je ne sais quel incident, retard pris dans le dédale des déviations, de routes secondaires non signalisées, nous fit arriver aux abords d'une petite cité maritime bien après le coucher du soleil. Heure, lassitude, il n'était pas question de poursuivre. Un toit ? Il n'y pensait pas. L'air, très doux, balançait les étoiles pâles au ciel, dans la perspective d'une avenue vaguement industrielle des bâtiments cubistes découpaient l'ombre, côté terre de grands pylônes inscrivaient pour les visiteurs d'autres planètes leurs chiffres cabalistiques. Pour une fois, ils semblaient porteurs d'une beauté — futuriste et, si l'on songeait à l'énergie mystérieuse dont ils supportaient les fils — vaguement mystique. Une petite route transversale prise au hasard permit de s'éloigner un peu, découverte en bout de champ voué à la culture maraîchère une banquette d'herbe, nous nous installâmes ente deux couvertures. Sur l'Ouest, une grande lune rousse s'était levée, hésitante derrière un voile de nuages blancs d'une extrême finesse. Pleine, elle se tenait proche, d'une taille, semblait-il excessive, grand œil distrait ouvert sur la scène. Au ciel gris bleu sans profondeur, éteint par d'imperceptibles nuées en bandes longues, errantes, on ne distinguait plus que quelques étoiles, discrètes. La nuit se tenait coite dans l'air humide et tiède, nul indice ne permettait de se situer, campagne indéterminée, incertaine peut-être même, ville campagne pour Alphonse Allais ? L'étrangeté venait de cette indéfinition tranquille, de ce suspens sous l'œil chassieux de la lune et de l'absence sans traces de ce pourquoi nous nous étions mis en route.
Un sommeil bref fut le lot de ce que j'éprouvai comme une traversée les yeux bandés. Vers cinq heures, un gigantesque bruit de ferraille à quoi se superposa puis se mêla, chaos tonitruant, celui de moteurs — automobiles, camions, dont on entendait passer les vitesses, accélérations, l'une derrière l'autre, moulinettes aiguës, ou, courtes saccades de gros transporteurs ; décélérations brèves, diminuendo, il devait y avoir un feu rouge proche —, ce vacarme secoua l'aube, très vite s'intensifia puis finit, à la manière d'un gaz, par occuper la totalité de l'espace.
Claude Dourguin, Les nuits vagabondes, éditions Isolato, 2008, p. 27-29.
© Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, les nuits vagabondes, voyage, sommeil, bruit | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2012
Claude Dourguin, Laponia

Sans que l'on sache pourquoi, imprévu, offert que l'on découvre voici un jour de rémission. Le matin fleurant la glace a tendu une ciel d'azur pâle dont le cœur s'émeut, fragile, insolite. Froissé de blanc au lever, les heures une à une l'ont lissé, purifié, et il règne désormais impeccable, dépositaire de l'élégance arctique faite de dépouillement, de subtilité, de vigueur à la fois. Impressionné, saisi comme par la déférence instinctive au seuil de lieux saints, on avance plus grave qu'à l'ordinaire, mais c'est une gravité pleine, heureuse.
Le chemin forestier coupe à travers les pins, vient longer un lac modeste, figure blanche sur fond blanc combien plus vivante et suggestive que celle de Malevitch, sur quelques kilomètres l'esprit se propose une petite énigme esthétique à résoudre. Les pins reviennent, clairsemés, avec leurs branches irrégulières, mal fournies, leur port un peu bancal qui témoigne assez de ce qu'ils endurent. Nul tragique, pourtant, ne marque le paysage, entre conte et épopée plutôt la singularité des lieux soumis à des lois moins communes que les nôtres, obligés à un autre ordre. Chaque arbre tient à son pied, qui s'allonge démesurée et filiforme son ombre claire, grise sur la neige. Ces grands peuplements muets et fragiles d'ombres légères comme des esprits, le voyageur septentrional les connaît bien, une affection le lie à eux. Il traverse sans bruit leur lignes immatérielles dans le souvenir vague, qui les fait éprouver importunes, grossières, de la densité, de la fraîcheur, de l'odeur terrestre ailleurs, sur quelque planète perdue.
Claude Dourguin, Laponia, éditions Isolato, 2008, p. 37-38.
©Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, laponia, grand nord, neige, pins | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2011
Claude Dourguin, Ciels de traîne
 La frontière entre littérature et non littérature, complètement occultée depuis une trentaine d’années, correspond à celle qui sépare l’évocation et la désignation. Étant bien entendu que le registre de langue, à lui seul peut relever de l’évocation : dire l’amour dans la langue de Racine éveille des harmoniques, des entrecroisements de références, un véritable système suggestif, tellement riche qu’il place d’emblée dans la littérature, dans son champ : cela, bien sûr, ne préjuge pas de l’œuvre, ni de sa qualité.
La frontière entre littérature et non littérature, complètement occultée depuis une trentaine d’années, correspond à celle qui sépare l’évocation et la désignation. Étant bien entendu que le registre de langue, à lui seul peut relever de l’évocation : dire l’amour dans la langue de Racine éveille des harmoniques, des entrecroisements de références, un véritable système suggestif, tellement riche qu’il place d’emblée dans la littérature, dans son champ : cela, bien sûr, ne préjuge pas de l’œuvre, ni de sa qualité.
Toute œuvre digne de ce nom nourrit une recherche de l’Être et des formes du vrai (sinon de la vérité) — dans son langage, ses objets, les sensations puis les perceptions du monde extérieur s’il est requis. Faute de cette ambition ou de ce questionnement, il s’agit d’une activité d’agrément, d’une construction plus ou moins habile, plus ou moins plaisante, d’un numéro (comme on parle d’un numéro de music-hall ou de cirque), une voltige de signes.
Corollaire, on peut poser qu’il ne saurait y avoir de recherche ou d’expression artistique hors de son incarnation dans une multiplicité de situations, de réalités qui sont celles de la vie ici-bas. Voir Rilke qui a écrit là-dessus les pages les plus belles et définitives.
Il y a toujours plus de vérité dans la réalité passée par l’art, la peinture, la littérature, que dans son état brut, comme elle se livre à la perception. Tout est faux — au sens d’exactitude — chez Stendhal et nul comme lui pour nous apprendre l’italianité, l’opéra, la passion, évoquer la vie de province sous la Monarchie de Juillet, désigner la bêtise etc. Chardin en dit davantage sur la nature des fruits que ceux qui sont devant nous sur la table.
Qu’entendre par cette « vérité » ? La part profonde du mystère, de tremblement, d’obscurité, d’infini, approchés, suggérés ; l’au-delà de l’apparence dans chaque artiste saisit un fragment, différent chaque fois, une face nouvelle, sans que jamais il puisse être épuisé.
La difficile, passionnante question de la langue. Relative mais tout de même réelle une confiance nous rassure : certes, la langue ne parvient à cerner le réel en sa complexité, en sa totalité, en sa fragilité, mais elle donne autre chose que lui, son aura, sa part tremblante justement, ce qui le déborde, peut-être sa face voilée, incertaine qui le relie à un ailleurs sinon à une transcendance. Oui, la langue dans son effort de désignation, d’appréhension se charge de mystère, et ce n’est pas rien : même inadéquat, même insuffisant ce mouvement vaut qu’on le tente.
Il n’est pas interdit de tenir à une certaine conception de la littérature, qui n’est pas tout à fait une activité comme une autre. On peut la vouloir, la prétendre engagement de tout l’être. S’ensuit une certaine façon de conduire la vie, si l'on veut que l’écrit soit recevable. La littérature n’est pas que le fruit de la planche à billets (dans tous les sens !), à elle, il lui est interdit de se payer de mots. Une certification, une authentification, une réserve or — la vie, justement, sa conduite — sont obligatoires, le devraient du moins. Faute de quoi autant vaut le tout venant du quotidien, nul besoin des draperies de la littérature.
Claude Dourguin, Ciels de traîne, éditions José Corti, 2011, p. 13, 14, 44-45, 17, 19.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, ciels de traîne, littérature et réel, littérature et non littérature | ![]() Facebook |
Facebook |






