06/10/2024
Étienne Faure, Séries parisiennes : recension
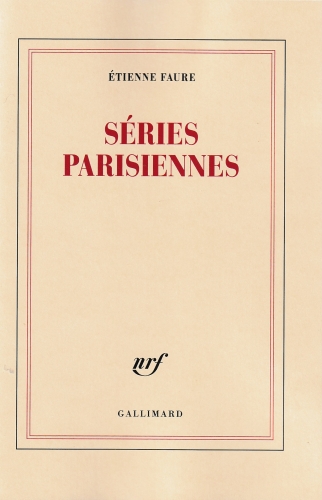
On pourrait rêver de réunir les poèmes, vers et proses, écrits à propos de Paris entre 1900 et aujourd’hui, on aurait sans doute le sentiment qu’il existe plusieurs villes du même nom dans le même lieu, d’Apollinaire à Réda, de Léon-Paul Fargue à Roubaud. Séries parisiennesentrerait aisément dans cet ensemble, on y entend la voix particulière d’Étienne Faure, sa manière de vivre la langue qui invente "son" Paris, on y reconnaît des motifs présents depuis ses premiers livres, on y retrouve une forte attention à la composition et à l’unité d’un ensemble.
Séries parisiennes est composé de 16 ensembles, tous titrés "Côté + nom" : "Côté Seine", "Côté rue" pour les premiers, "Côté voix", "Côté H" pour les derniers. "Côté cage" (la cage de l’ascenseur d’un immeuble) rassemble « Dix-sept haïkus dans l’ascenseur » de construction syllabique régulière (5-7-5) ; tous les autres groupes comptent 6 vers ou proses, sauf "Côté mains" avec 12 quintils — donc 15 groupes de 6 vers à quoi s’ajoutent 6x2, soit à nouveau 17. Jeu des nombres et la thématique hors la cage est présente dans les haïkus : le baiser, les oiseaux, les voix, les écrivains (avec Balzac), etc. Les figures sont limitées à quelques paronomases, « les remous/les rumeurs », « intemporelles/intempéries », « se carapatent/Carpates » ; l’emploi du vocabulaire noté familier ou argotique par les dictionnaires, très rare chez Étienne Faure, est présent ici peut-être pour mieux marquer le caractère urbain de l’ensemble (zef, se tirer, (d’une femme) la mieux roulée, piaule).
La phrase des poèmes se développe le plus souvent à partir d’un mot ou d’un thème ; elle peut s’ouvrir avec deux mots repris à la sortie en ordre inverse avec changement de genre, (nom/ adjectif, « le vert et le noir »/« paysage noir et vert tendre »). Dans la prose d’ouverture, le lecteur passe de fenêtre à spectacle, manteau d’arlequin, théâtre, scène de genre, acte un, acteurs, jeu, chandelle (pour évoquer le théâtre ancien). Ces reprises sont un des moyens pour construire des poèmes, en prose ou en vers, d’un seul tenant, l’unité pouvant aussi être obtenue par l’emploi d’un ensemble homogène de couleurs : dans le second poème du recueil pour caractériser la saleté de la Seine, « vert trouble », « or gris sale », « eau rouille », couleurs opposées au bleu outremer, à l’azur. L’aspect trouble de l’eau n’empêche pas son mouvement, symbole habituel du « temps qui coule », comme l’eau « passe et file » vers la mer.
Le ton est donné, on ne découvrira pas un Paris insolite, pas plus que ses monuments ; rien d’autre à voir que le quotidien, ce qu’offrent la rue, les bancs, les allées du cimetière, les parcs, quelques personnages résolument à l’écart de la société, « (ces) vieux Rimbaud qui marchent ». Rien que le quotidien et s’attacher à ce qui échappe souvent au regard alors qu’il suffit de lever la tête, suivant en cela le Baudelaire des fenêtres : « Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. » Le piéton des Scènes parisiennes observe ce qui semble être une « scène de théâtre », reconstitue ou invente « Tout un fracas de vies intérieures », engrange un matériau offert à qui veut le voir tout comme il saisit au cours de ses marches des phrases, des fragments de récits. L’observation des habitués des bancs, dans les parcs, est différente. Immobiles et souvent silencieux, ils semblent « à l’écart du temps qui passe », dans un autre univers, celui des souvenirs.
Le narrateur sans cesse imagine des vies, également des scènes amoureuses où le couple, bien que dans la chambre, semble hors du monde de la ville, comme s’il s’étreignait sur un « grabat de feuilles / de paille » et s’entend aussi un « froissement de litière » ; l’étreinte entraîne un vocabulaire connotant la nature et elle impliquait également une position des corps pour rappeler la dyade Éros-Thanatos : devenus des « gisants » et « leur mort est à son comble ». Il reconstitue aussi des ruptures (« pour avoir trop bu »), l’un partant « refaire sa vie », ou « attendant l’autre (elle ne vient pas) ». Tout peut être point de départ d’une fiction, voix et gestes glanés dans les rues suscitant de courtes pièces. Cette attitude de voyeur en quête de ressources est d’ailleurs dite dans un poème qui renvoie le lecteur « aux livres anciens » où un personnage observe une scène érotique par le trou d’une serrure avant de devenir lui-même acteur.
Les livres — les livres de poèmes — sont partout dans les Séries parisiennes. Un ensemble de poèmes est consacré à des écrivains qui, tous, ont été attentifs aux choses ordinaires de la vie ; ils sont nommés (Follain, Guillevic, Réda, Goffette, Vaché), ou reconnaissable par un détail, Stéfan par « litanies », « Judas », plus clairement par « stéfaniennes ». À côté de ces hommages, le lecteur collecte des citations, de ces auteurs et, dans les poèmes, de Rimbaud (« On ne part pas »), de Ronsard ("Mais ce mien corps enterré/s'il est d'un somme fermé/Ne sera plus rien que poudre »), fragment recopié par le narrateur qui le lit au Père Lachaise. Il repère une allusion probable à un titre d’Étienne Faure (Vues prenables, 2009) dans « Rêvent-ils (…) d’autres vues imprenables », ou il se souvient du Verlaine de Sagesse(« Le ciel est, par-dessus le toit ») avec « La mort est par-dessus les toits ».
La mort est présente pour le narrateur par le souvenir des disparus, proches ou non, par le souvenir de ce qu’ils furent ; ainsi la mère définitivement absente, « un beau vide », ou tous ceux devenus sans visage ; parfois, il se vit « rattrapé par le néant des aïeux sans racines, qui n’auront bientôt jamais existé ». À côté des drames personnels, l’Histoire est le temps pour tous de la mort ; le dernier ensemble, est titré « H » — initiales dans « Les Humbles champs d’Honneur de l’Histoire Humaine » — et plusieurs recueils d’Étienne Faure s’achèvent avec l’évocation de ce qui ne fait en rien honneur aux humains. La guerre était annoncée par les cloches et leur bruit peut encore l’évoquer, trace d’un autre temps, comme les couteaux des bouchers dans un abattoir ; pour le narrateur, c’est le grincement des roues, des freins d’un vélo qui appelle le souvenir des années 1940 et des rafles de juifs, l’envoi dans les camps d’extermination, ce sont aussi les déformations du corps à cause des privations qui restent les empreintes des années de guerre.
Les potences finissent par être « arrachées » et tous sont enfin « à l’air libre »… On sait bien que la poésie ne changera pas le cours des choses, qu’elle n’empêchera pas le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie (parmi d’autres plaies trop présentes) de prospérer ; cependant, qu’un ensemble à propos d’une perception très personnelle de Paris se termine en évoquant la peste brune, toujours vivante sous des formes plus ou moins avenantes, n’est pas indifférent.
Étienne Faure, Séries parisiennes, Gallimard, 2024, 156 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 19 juillet 2024.
Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, séries parisiennes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2023
Étienne Faure, Vol en V
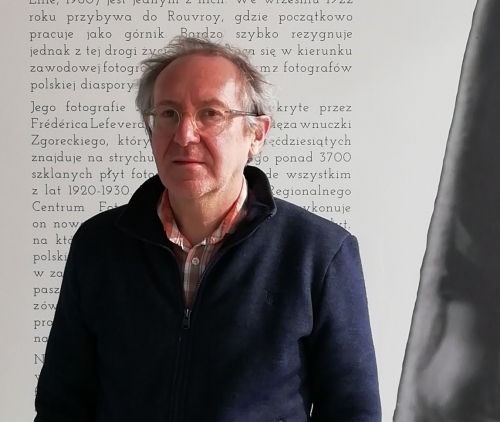
L’interférence des yeux sous le porche
où nous nous sommes abrités à cause
de l’eau qui fait rage, bel orage, électrise
l’arcade, commence à nous envouter au point
de non-retour à nos destinées respectives, désirs
qu’il pleuve, qu’il pleuve, bergère urbaine
sous la voûte en abîme que la vie reflète,
inverse,
U
l’air est connu, mais on se fait reprendre
aux yeux de lac artificiel au bord de l’hydro-
électrique décharge entre deux averses — arcane,
c’est un peu moi qui suis là-bas dans ses yeux
quand elle regarde en long et en large où aller,
pressentant l’impossible retrait en arrière-
saison, chez soi, faux domicile, à présent plongée
en son for intérieur, enfance avec,
et tout ce qui s’y verse — la pluie redouble —
si proche et fluide est la vision d’autrui,
soudain clairvoyance.
sous le porche
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, pluie, regard | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2023
Étienne Faure, Et puis prendre l'air
L’ennui léger à la fenêtre enduré dès l’enfance, à regarder passer dans le ciel quelque chose, attendre un événement venu des nues : un nuage effilé par le vent, le passage de l’avion disparu par l’embrasure des arbres, un V d’oiseaux très haut en solitude rebroussant leur chemin en lançant des signaux aux autres animaux restés au sol, cet ennui lentement scruté derrière la vite avait changé progressivement de sens, glissé par la force des ans — nouveaux cirrus, autre altitude — parmi les nuages qui commençaient à s’amonceler, non plus singuliers mais pluriels — les ennuis. Et de loin le rire clair qui tout balaie au ciel de mars, à nouveau en mouvement.
-
-
-
- Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, p.103.
-
-
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et pis prendre l'air, ennui | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2023
Étienne Faure, La vie bon train.
La nuit quand le train va si vite
qu’on ne voit rien
rouler perd tout son sens
— il n’est plus sûr alors qu’une gare attende,
à l’autre bout fasse un trajet qui relie les deux lieux
ordonnancés un départ une arrivée,
car nul retour, aucun aller n’est visible,
à regarder par la vitre envahie de noir :
miroir vide où suis-je ?
Voici l’hiver aux jours réduits, qui emporte le corps
engendré vite autrefois, le moral au noir fixe,
dans un état pour une éternité transitoire
d’aucune utilité car jamais abouti
(et donc de ton sperme personne ne sera né)
maillon sans chaîne, wagon désormais sans attache
ni ascendance, ni hoirs, ni rien d’approchant.
voici l’hiver
Étienne Faure, La vie bon train (proses de gare),
Champ Vallon, 2013, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etienne faure, la vie bon train, solitude, voyage | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2023
Étienne Faure, Horizons du sol
Longtemps condamné au lit comme à l’internement,
il scrutait fixement dans les papiers peints
des motifs d’évasion, lignes de fuite,
des baies en auréole où s’embarquer
pour l’infini l’espace d’une heure,
les yeux ronds d’étonnement que la vie s’y cache,
tapissée au gré des saisons de nymphes
aux blancheurs de gel
— les corps aussitôt peints devenant des nus —
ou bien des fleurs insistantes,
exhalant quoique fanées depuis longtemps
un même enfermement dans la torpeur
spectrale — non pas sommeil —
à flotter en surface aux côtés de son propre corps,
dépouille, non, remuement que le soir
dément.
trouble du soir
Étienne Faure, Horizon du sol,
Champ Vallon, 2011, p. 44.
Photo Chantal Tanet, 2011
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, horizons du sol | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2023
Étienne Faure, Vues prenables
À chaque alliance, premier lit, remariage,
la peau des murs avait changé,
ici offrant l’illusion du feuillage
d’une toile de Jouy inspirée des fêtes
à la campagne où le motif s’organise
en chemins, en rivières,
où court une tige fleurie sur un fond picoté
que les fabricants avaient reproduit maintes fois,
au bout du siècle effeuillé près du lit.
Parmi les vases, cassolettes, chandeliers, lampes,
on vivait volets tirés dans la pénombre
pour ne pas abîmer les tentures
et que les papiers peints ne passassent
trop vite
il y avait bien cachés dans les ramures
des souvenirs au matin réveillés, tête lourde,
en lés répétés où dormait le pavot
et les vies imprimées là, sans raccords.
la peau des murs
Étienne Faure, Vues prenables,
Champ Vallon, 2009, p. 83.
Photo T.H., 2012
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, nostalgie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2023
Étienne Faure, Légèrement frôlée
Où est l’exil
en sueur, en train jadis accompli
si le avions, presque
à la vitesse du mensonge, nous déposent
en des lieux prémédités de loin,
transmis par la parole, des papiers
traduits ou rédigés dans la langue des mères,
où est l’exil, un écart temporel
réduit à rien — espace crânien
où l’on revient sur ses pas pour retrouver
l’idée perdue en route —
heure de seconde main aujourd’hui effacée
devant l’entrée des morts, ou le seuil,
par politesse ultime de la mémoire
ici trahie, en creux, quand l’avion atterrit
qui ne comblera donc rien, jamais
l’amplitude intime de la perte.
il revient les mains vides
Étienne Faure, Légèrement frôlée,
Champ Vallon, 2007, p. 90.
photo Chantal Tanet, 2011
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, exil, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2022
Étienne Faure, Vol en V
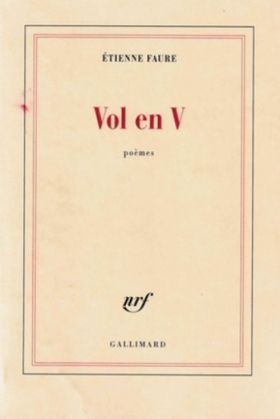
Les livres d’Étienne Faure, de Légèrement frôlée à Vol en V, se caractérisent autant par leur unité formelle que par celle de la thématique. Les poèmes recueillis ici ont été pour l’essentiel publiés dans des revues, réunis en huit ensembles titrés de dimension à peu près égale (de dix à douze vers), sauf le second ("Que ne suis-je", dix-huit) et le dernier ("Jours de repos", dix-sept). En épigraphe avant le premier ensemble, deux citations en relation avec le titre, de Rilke (« Nous nous touchons comment ? Par des coups d’ailes ») et de William Carlos Williams (« Comme à chaque saison c’est le désir qui les fait venir de si loin »), suggèrent aussi des lignes de lecture. D’autres extraits, avant un groupement de poèmes ou précédant un poème situent le recueil dans un horizon poétique (Thomas Bernhard, Hölderlin, Vinci, Gombrowicz, Sylvia Plath, Baudelaire), tout comme les allusions à tel poète (Villon, Louise Labé, Musset, Césaire et Apollinaire — qui est même présent avec un vers de Zone) et l’emploi de mots de diverses langues (anglais, allemand, espagnol, polonais).
En accord avec le titre, les oiseaux apparaissent à différents moments du texte, sous ce terme général, parfois qualifié (« oiseaux garancés »), plus souvent désignés par un mot précis. On trouve l’hirondelle et, rencontrés au cours d’un voyage, les oiseaux des îles, mais plus souvent les oiseaux de la ville, ceux notamment du cimetière du Père Lachaise fréquenté par le "je" narrateur (pies, corbeaux et corneilles). Les oiseaux ont une fonction précise liée à la poésie d’Étienne Faure : pour une partie d’entre eux, les poèmes sont construits à partir de ce qui est regardé, écouté, senti, touché. Corbeaux et corneilles sont les « fruits noirs de l’hiver », à voir le linge suspendu aux fenêtres on imagine une vie, « des désirs à distance » ; l’on entend les « parlements des corbeaux », le « boucan des oiseaux », le bruit des voix, « le fond de l’air embaumait l’orage », on se souvient du « parfum de résine » et de divers matériaux « pressentis par les doigts ». Cette "poésie du corps" implique la marche, pour « voir le plus de choses » et éprouver le « raffut du monde », aussi pour « continuer d’écrire comme d’être ébloui / à regarder le monde ».
Les peintres et leurs tableaux sont, justement, un élément de cette poésie du regard. Peintres d’oiseaux — Breughel a peint La Pie sur le gibet, Johannes Larsen les oies bernaches qui partent plein sud — mais pas seulement, aussi Kirchner, Van Gogh, Paul Schaan, Soulages, etc. Par ailleurs, mettant en scène le portrait ancien d’une femme qui regarde avec passion celui qui la photographie, le narrateur devient « lui aussi le photographe » regardé. Il n’est pas surprenant qu’il se demande « comment peindre les sons » puisque la musique est « dans l’air, en vol ». L’homme, depuis Icare, a une relation particulière à l’oiseau ; ici, les aigles et ceux qui font de la voltige en parapente, en même temps « déploient / maintenant leur pleine envergure / plume ou rémige de polyester ». Une autre relation est établie entre l’oiseau, son vol et les humains, précisément avec l’écriture, longtemps « écrire et voler étaient le sort des plumes ».
Les migrateurs empruntent « la route en V » et, quelques mois plus tard, eux « qu’on avait cru défunts » sont « réapparus en V ». Ces migrateurs en évoquent d’autres : la grand-mère du narrateur « sans patrie / sans amis », une vie aux espoirs déçus. Étienne Faure, ici comme dans tous ses livres, est attentif à l’Histoire, en particulier à celle des gens ordinaires, à tous ces oubliés sans nom. Le narrateur s’arrête devant une petite plaque sur un mur, seule trace d’un homme abattu à cet endroit pendant la dernière guerre — que dire ? « nous allons mourir et personne n’en saura rien » — et il rappelle qu’il vit dans un quartier de Paris qui fut « raflé en Quarante-deux ». Il entend le « bruissement du temps » (on pense à Mandelstam), découvre « la place herbue du théâtre » d’une cité disparue, et la forme de nuages dans le ciel lui rappelle les montgolfières de 1870, la Commune contre les Prussiens.
L’écriture d’Étienne Faure est reconnaissable par certains caractères récurrents de livre en livre. La plupart des poèmes sont construits en une seule phrase qui, d’un bout à l’autre, explore le thème retenu — en cela peu proustienne. Cela ne signifie pas que des poèmes en deux (le premier, entre autres) ou trois phrases soient exclus, loin de là. Les vers ne sont pas rimés mais les consonances et les paronomases abondent ; on accumulerait les exemples : « en pleine / flexion, extension, affliction, action », « les fleurs bisannuelles, bigarrées, bizarres », « le minéral brouhaha des mots, fracas d’une langue insistante » et, en jouant avec les langues, « un songe — a song —/vieux regain — again — refrain » ; etc.. Les vers non comptés ne sont pas pour autant de la prose qui va à la ligne ; prenons un poème au hasard, pour constater qu’Étienne Faure se soucie du rythme, ainsi pour le premier poème : 14/11/11/124/13/13/12/16/11/11/13/13/11/11/11/8.
On relève fort peu de rejets hors de la norme (« go-/élands », « haut-/de-forme », mais un emploi important de tournures et mots familiers, qui répondent à leur manière au souci de dire la vie quotidienne ; on lira donc grolles, godasses, nippés, grimper sec, tu parles ; tomber des cordes, des curés, des bobards, etc. On notera que huit poèmes débutent par « Que ne suis-je », titre de l’ensemble, renvoi à Jude Stéfan (Que ne suis-je Catulle, 2010) qui lui-même connaissait "Que ne suis-je la fougère" de Charles-Henri Ribouté (1708-1740). Ce qui est nouveau formellement dans ce recueil, à côté de poèmes très courts, ce sont deux poèmes qui débordent largement le format habituel, et un essai de calligramme (autre allusion à Apollinaire), un autre de haïku.
Les oiseaux reviennent dans la dernière partie du livre, notamment « un wróbel » (mot polonais pour "moineau"), dont le bruit du vol, de la fuite, est traduit par « frrrrt », mot qui termine le livre. La poésie d’Étienne Faure travaille les « horizons multiples » de la langue pour faire passer quelque chose de ce qui est là, devant chacun qui prête attention à ce qu’il rencontre ; pour cela, il faut sans doute apprendre à regarder, écouter, et « noter la phrase avant qu’elle ne s’envole / froissement perpétuel des mot
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, 144 p., 16 €; Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 17 juin 2022.
Le commentaire de sitaudis.fr
Gallimard, 2022
144 p.
16 €
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2022
Étienne Faure, Vol en V

Les dieux sont courroucés sur l’Ukraine, il tonne,
ça résonne tout le long de la frontière cernée
de saules et de bouleaux, deux tristesses, deux détresses
— pousser malgré l’eau des marais et la terre sableuse
parmi les tombes d’outre-tombe (terre et ombre)
d’outre-rivière en son temps signataire
du pacte sinueux germano-soviétique —,
les croix en bois dans le jardin
plantées comme s’il en poussait après la pluie
ont repris leur élévation vers le ciel
bleu égaré, vieille antienne
évanouie finalement après qu’on est passé clore
le sujet comme on clôt l’incident de toute une vie,
ne sachant si les tombes affalées
parmi les Versgissmeinnicht et les orties
avaient appartenu un temps au camp
des assaillants, des réfugiés, ni de quel
pays démantelé l’hiver fut recomposé,
ni
de quel bois les souvenirs se chauffent.
Bang
dans un jardin planté de croix
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 131.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, ukraine, passé, tombe | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2022
Étienne Faure, Vol en V

Dans la ville à pied, sans repli, sans arrière-
pays, origines, hors cela, il emprunte
au début sous le nom de rue, pont, grève,
un parcours exempté de fil, anonyme,
laissant l’impasse pour attraper les quais
via les passages, les cours et circuler
inclus dans la foule en mue sans arrêt
selon l’heure ou l’allure à laquelle on passe,
interdit soudain sous un nom, un bouquet
au mur scellé (mortellement blessé)
après la chute de naguère, le bruit d’un corps au sol,
épitaphe à jamais cernée du crible des impacts
encore au mur, semblant redire : passant,
nous allons mourir et personne n’en saura rien,
ou bien continuer de parler aux vivants
plus avant, ceux qui vont te survivre
— et le flâneur éclairé sous un angle
un instant exposé au soleil du soir,
médite à découvert avant de traverser vite,
regagner l’ombre.
passage à découvert
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, marche, anonyme, épitaphe | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2022
Étienne Faure, Vol en V

Accroché au linge comme on s’agrippe aux livres,
il met en route une machine à laver,
le ronronnement lui fait une présence,
à lessiver on ne sait quel affront du sort,
dans le virage accélérant le mouvement qui
sépare avenir et passé, eau claire et eau usée,
partagés par on ne sait quel hasard,
aléa de la vie centrifuge en allée ailleurs,
hors de son cœur à l’étroit dans sa cage
inapte à contrer l’air qui hésite à sortir,
entrer, redire ce qui le chiffonne, tout ce qu’il ne sait
pas faire, perplexe — choix des textiles, cotons délicats,
vie en couleurs, vie synthétique, mélange,
autres fibres —, on croirait, ces grands draps, des pagnes,
des saris, des sarongs, des toges, tout un monde
de paréos mis à sécher aux fenêtres
au motif qu’il fait beau dehors avec vue sur cour,
Paris, les toits, la rue, autres perspectives.
tambour à l’essorage
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, présence, hasard, trouble | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2021
Étienne Faure, Légèrement frôlée

Le cœur serré sans préavis
entre les murs du bâtiment gris public
d’où les cris fusent, on croirait une enfance
à cause des barreaux qui restreignent
la vue du ciel
les origines restituées
comme on s’en trouve à même les livres
enracinés dans la mémoire
avec l’ennui et les récitations
— craie, encrier, cire d’abeille —
la cour d’école au gravier jaune où crisse
une espèce de véracité française,
racines, à force d’être lues, plausibles
et crues finalement, oui, avec effet rétroactif
tant le désir de croître est commun aux souvenirs
d’une enfance implantée au hasard des sols,
l’autre en papier relue, comme apprise.
Papier relu
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 88.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, école, enfance, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2021
Étienne Faure, Ciné-plage

Sous d’apatrides vêtements aux couleurs
perdues dans la bataille
ils arrivaient par l’Europe en neige,
alors champ équivoque où germaient les victoires défaites,
puis repartaient pour cause de guerre en sens inverse,
pour les beaux yeux d’une patrie disant des mots d’adieu
dans une langue occasionnelle,
n’importe quoi qui comblât l’écart
en train de se creuser depuis l’arrière
jusqu’à l’amovible première ligne
approchée la nuit dans l’éclat d’armes blanches,
la lutte acharnée des chairs pour quelques mètres,
ici ressortissants drapés dans la boue
des gisants d’avant-hier autre époque,
en d’identiques raideurs nationales.
quelques mètres
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015, p. 126.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, ciné-plage, bataille, guerre, patrie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2021
Étienne Faure, Tête en bas,
Sur les tombeaux d’Europe autrefois de l’Est
éclairés d’une mèche en flamme
les morts réclamaient la mémoire
alerte et vacillante
de ceux demeurés en surface, et des pensées profondes
gravées au burin dans la pierre
qui rappelleraient l’objet perdu de leur combat,
explicitant leur vie au fond du marbre
en quelques mots, numéros, ceux qu’on marque
ordinairement sur la peau pour ne pas
oublier ce qu’on devait faire
ce jour-là de sa vie, de son temps
— passer la frontière, défendre un pays —
sous la répétition des oies dans le ciel
avant l’énième migration en V
ou WW selon la langue.
vacille la mèche
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 132.
Photo Chantal Tanet.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, tombrazu, objet perdu, migration | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2021
Étienne Faure, Et puis prendre l'air
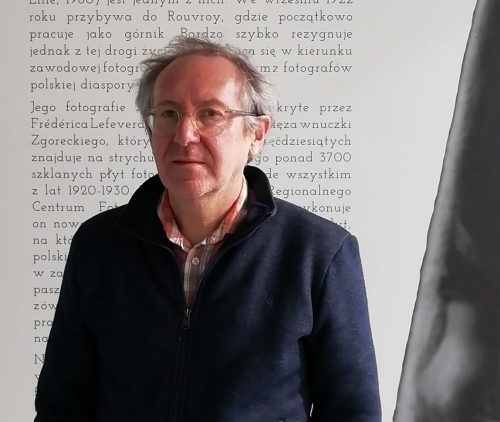
L’ennui léger à la fenêtre enduré dès l’enfance, à regarder passer dans le ciel quelque chose, attendre un événement venu des nues, infime : un nuage effilé par le vent, la vitesse de l’avion disparu par l’embrasure des arbres, un V d’oiseaux très haut en solitude rebroussant leur chemin et lançant des signaux aux autres animaux restés au sol, cet ennui lentement scruté derrière la vitre avait changé progressivement de sens, glissé par la force des ans — nouveaux cirrus, autre altitude — parmi les nuages qui commençaient à s’amonceler, non plus singuliers mais pluriels — les ennuis. Et de loin le rire clair qui tout balaie au ciel de mars, à nouveau en mouvement.
Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, p. 103.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, ennui, ciel, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |











