16/10/2014
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute : recension
La vie moins une minute (vers d'un des poèmes) s'ouvre par une allusion au conte de Perrault, Barbe Bleue : c'est l'annonce de deux récits, vite mis en place et que l'on suit dans les trois parties du livre, celui d'une enfance dans une famille, celui d'une histoire amoureuse. Les deux récits, source d'autres histoires esquissées et presque aussitôt interrompues, s'entrecroisent, l'un appelant l'autre, au point qu'on ne peut toujours démêler les fils tant des éléments de l'un sont enchâssés dans l'autre.
Le conte de Barbe Bleue réapparaît de manière allusive avec l'introduction du placard, celui qui ne doit pas être ouvert, mais, parodie, si la narratrice pousse une porte, contrairement à l'épouse curieuse du conte, elle précise : « Avant de sortir, j'ai veillé à tout remettre en ordre ». Le conte est encore présent, avec insistance, par le rappel du contrat : « C'est un contrat, et si on le rompt on ne lèse que soi » ; et la contrainte, édictée ici par la narratrice, devient dans le couple une condition de son équilibre, et même de son existence : « Tu accepteras mes mystères et j'accepterai les tiens », la règle pouvant d'ailleurs être jouée: « je te dis rien, je te dis tout ». Le conte est également présent dans le récit de l'enfance, puisqu' « on invente des histoires pour les derniers petits », et c'est l'enfant qui réclame la suite de l'histoire avec son insatiable « et après ? ». La demande d'une suite de l'histoire se dit, peut se dire ailleurs, partout identique expression du désir de savoir : « What happens next ? » ; mais la formule "et après", reprise dans un autre contexte, signifie alors "qu'est-ce que ça fait ?", non plus tentative de se satisfaire mais mots de la désillusion. Enfin, le conte entre dans le récit amoureux avec le "Il était une fois", qui associe dans un poème Valentine et Sade ; dérision peut-être de la saint Valentin, et le divin marquis se trouve à l'aise puisqu'il est question de sodomie et de femmes dans les égouts.
Les éléments de récits, dispersés, seraient à associer par le lecteur, sans à vrai dire qu'il puisse reconstituer une histoire cohérente ; c'est heureux, nous ne sommes pas dans la représentation et il suffit de repérer des bribes, depuis les lieux communs revisités, attachés aux discours sur l'enfant — bébé a peur et a faim, mon enfant ne mange pas (« il faut manger si on ne veut pas finir crevée ») —, jusqu'à la présence de « maman », la découverte de la manière dont sont conçus les enfants, la passage de l'état de petite fille à l'adolescence et à l'amour. Rien de linéaire : si la narratrice semble revenir sur une enfance dans la seconde partie (titrée "Looping", donc suggérant un retour, un renversement de perspective) : « j'ai été cette petite fille solitaire », la dernière partie retourne à l'enfance, d'où vient le titre du livre : « l'enfant bascule, tête en avant / plus rien dire sinon la chute / la vie moins une minute ».
La sortie de l'enfance, c'est la rencontre de l'amour ? Sans doute mais, pas plus que ceux relatifs à l'enfance, les fragments d'une histoire amoureuse ne se prêtent à une reconstruction linéaire, ne serait-ce qu'à cause de la difficulté de passer, d'un poème à l'autre, d'un narrateur féminin à un narrateur masculin. Mais c'est surtout qu'aucun récit amoureux ne peut trouver un ordre sans réponses aux questions posées à la fin de la première partie : « Comment faire pour vivre ? [...] Comment faire pour vivre à deux ? » et « Comment (re)devenir 1 femme ». Il y aura donc l'amour réalisé (« j'ai fait tomber ma pudeur aux oubliettes »), les « amours déchues », l'amour-toujours, les étreintes (« prends-moi dans tes draps ») dont on ne peut dire qu'elles ne sont que corps en mouvement : « claquements et rythmes / éphémères et pourtant » ; il y a aussi le passage de « l'amour : un » à « maintenant il est deux » (p. 69), et l'ironique « belle comme un os à moelle ». Tout cela, brisé, elliptique, avec retours et contradictions, restitue quelque chose de la "vraie" vie, bien mieux qu'un récit ordonné.
Au désordre, aux croisements et superpositions des récits, il faut ajouter d'autres fils, par exemple celui des lectures qui s'introduisent dans les vers. On reconnaîtra par exemple le cimetière marin — associé aux vagues et aux varechs — ou Hawthorne avec la maison aux sept pignons, ou Liszt avec la rhapsodie en do, etc. On lira aussi, dans le poème qui ouvre la seconde partie, une manière d'hommage à Rimbaud : ici, le titre "Dingo" et le vers « Je commençai par les hallucinations olfactives », évoquent « L'histoire d'une de mes folies » et « Je m'habituai à l'hallucination simple » de "Alchimie du verbe". Autre rencontre ? On se souvient que, dans "Après le déluge", on lit « le sang coula, chez Barbe Bleue ». Une autre relation, celle-là constante, est celle à Lewis Carroll ; Marie de Quatrebarbes retrouve la grâce des énoncés nonsensiques, en faisant se succéder des vers que le lecteur ne peut assembler pour construire un sens, comme « si monsieur Smith voulait bien me la faire / du savon noir pour récurer » ; on verra là aussi une manière de poser la question du vers, mais laissons ce problème de côté. Nombreux aussi les énoncés dans lesquels s'introduit un vers qui rompt la lecture : « des plaisirs immédiats / elle joue son ombre / sont ceux de la chair et c'est tout /» (souligné par moi). D'autres ruptures contribuent à détruire, ou gêner, le rassemblement des bribes de récit, ce sont les jeux de mots de toutes sortes trop nombreux pour qu'on les rassemble ; jeu sur l'homophonie (« l'anneau se ressert autour du doigt », passage de "de ses seins" à dessin"), l'inversion (« fait des claques et des têtes à bulles »), la polysémie, y compris en anglais (« sheath », signifiant "préservatif" et "vagin"), la variation sonore (« ça décapite .../ ça décapote ... / çadécapsule »), etc.
Que conclure d'une lecture réjouissante ? La vie moins une minute confirme la maîtrise de la langue, le souci de construction d'un ensemble, le goût du récit et l'humour que l'on reconnaissait dans les livres précédents (1) de Marie de Quatrebarbes.
_______________________________________________
(1) Les pères fouettards me hantent toujours (Lanskine, 2012) et Transition pourrait être langue (Les Deux Siciles, 2013).
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute, Lanskine, 2014, 14 €
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, récit, enfance, amour, humour, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2014
Juan Gris, Écrits : "Des possibilités de la peinture"

Des possibilités de la peinture [1924]
[...]
Un objet devient spectacle aussitôt qu'il y a un spectateur pour le considérer. Or, on peut considérer cet objet de multiples manières. Ainsi une table peut être considérée âr une ménagère dans un but plus ou moins utilitaire. Un menuisier remarquera la façon dont elle est faite et la qualité de bois employé à sa fabrication. Un poète — un mauvais poète — imaginera tout autour la paix du foyer, etc. Pour un peintre elle sera tout simplement un ensemble de formes plates colorées. Et j'insiste sur les formes plate, car considérer ces formes dans un monde spatial serait plutôt l'affaire d'un sculpteur.
Donc, chaque objet peut offrir des aspects professionnels très variés, mais il y a en plus des aspects professionnels quelque chose que nous pourrions appeler l'idée première des objets. Cette idée ou notion est en dehors des professions et des vérités scientifiques. C'est quelquefois même une erreur héréditaire. Scientifiquement, toutes les lignes verticales sont convergentes vers le centre d'attraction terrestre ; humainement, elles sont parallèles. malgré ces aspects différents, la table dont j'ai parlé tout à l'heure est la même idée de table pour la ménagère, le menuisier et le poète. Ce n'est que les éléments qu'ils en tirent qui sont différents.
Or, pourquoi vouloir s'un peintre tire de cet objet des éléments d'autres professions ? Pourquoi ne se contenterait-il pas simplement des éléments qui appartiennent à sa propre profession ? Celui qui en peignant une bouteille pense à exprimer sa matière au lieu de peindre u ensemble de formes colorées, mérite d'être verrier plutôt que peintre.
[...]
Juan Gris, Écrits, La Nerthe, 2014, p. 12-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juan gris, Écrits : "des possibilités de la peinture", idée, objet | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2014
Pierre Reverdy, La lucarne ovale

Grandeur nature
Je vois enfin le jour à travers les paupières
Le persiennes de la maison se soulèvent
Et battent
Mais le jour où je devais le rencontrer
N'est pas encore venu
Entre le chemin qui penche et les arbres il est nu
Et ces cheveux au vent que soulève le soleil
C'est la flamme qui entoure sa tête
Au déclin du jour
Au milieu du vol des chauve-souris
Sous le toit couvert de mousse où fume une cheminée
Lentement Il s'est évanoui
Au bord de la forêt
Une femme en jupon
Vient de s'agenouiller
Pierre Reverdy, La lucarne ovale, dans Œuvres complètes, tome I, édition présentée et annotée par Étienne-Alain Hubert, Flammarion, 2010, p. 109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la lucarne ovale, jour, nudité, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2014
Édith Azam, À propos de la poésie féminine

À propos de la poésie féminine
À côté de chez moi, il y a une forêt, et dans cette forêt, il y a des limaces. Elles sont jaunes fluo. Je ne les aime pas. Aussi chaque matin, après avoir avalé mes tartines, je prends mon fusil tire-bouchons, mes deux molosses grandes babines, et nous partons leur faire la chasse. La chasse aux limaces est un jeu de fille. C’est un jeu de fille car aucun garçon sérieux ne jouerait à la chasse aux limaces. Mes chiens ne sont pas des garçons sérieux, si molosses soient-ils, et babines comprises ; mes chiens n’ont rien de très viril, preuve en est, ils arpentent la forêt avec moi pour jouer à la chasse au limaces. S’ils ne le faisaient pas, un tas de questions me viendraient à l’esprit. Mes chiens sont-ils virils ? Mes chiens sont-ils des garçons ? Les garçons sont-ils des chiens ? Tous les garçons sont-ils des chiens ? Les garçons-chiens sont-ils des hommes ? Comment devenir un homme? Là, vous comprendrez sans difficulté, que tout cela, la question de la virilité ou d’être un homme n’a rien à voir avec la chasse aux limaces. Pour ce qui est de la poésie et de la féminité, cela n’étonnera personne : il en va de même. Il n’est pas plus d’écriture féminine, que de chasse masculine, etc…, à la limite oui, il est quelque part sur terre, une limace poétique. Et quelque part aussi, des poèmes sur les limaces, mais pas beaucoup si mes informations sont bonnes. Bref, certes, je concède volontiers, qu’il m’est impossible d’écrire en me grattant les couilles. Cela dit, pas certain que je l’eusse fait si Jean Nussu. (Suivez suivez ! Je vous en prie, en plus c’est drôle ! ) Du reste, se gratter les parties, est-ce la seule manière d’écrire un poème ? Car s’il est une chose qui reste, et une seule à sauver, sûr, ce ne sont pas les êtres et leurs noms de papier, mais bien les textes. Or, lorsqu’il s’agit d’écriture, de quoi parle-t-on ? Sans doute pas du taux de testostérone ou progestérone dans le sang. Le texte à lui tout seul fait sexe, au sens où le lecteur le pénètre autant qu’il le reçoit, et ce, indépendamment de son auteur, n’en déplaisent aux narcissiques patenté(e)s, baiseurzébaiseuses chroniques, incorrigibles libidineux-zéneuses, qu’ils soient auteurs, lecteurs, critiques ou autres. Et pour finir et pour faire simple, les mythes, comme les anges, n'ont pas de sexe. Homme ? Femme ? Mais de quoi on se mêle ? Ou, pour dire autrement : coupons-leur noms et tête : mélangeons tout !
Édith Azam, À propos de la poésie féminine (inédit)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, À propos de la poésie féminine, limaces, chiens, sexe, homme | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2014
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction Philippe Di Meo
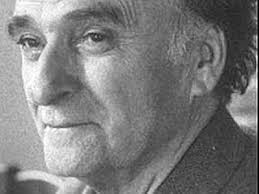
Petits métiers
Comment puis-je oser
vous appeler ici, vous faire signe de la main.
Une main qui n'est plus que son ombre
avare et mesquine
et d'ailleurs une serre, mais tendre comme de la mie de pain.
Et pourtant, quelque chose maintenant la soutient,
e ne sais s'il s'agit d'une crampe ou d'une force ;
pour autant qu'elle vaille elle est toute vôtre,
et vous donnez-lui la force de vous appeler.
Donnez-lui une plume qui ne se torde,
faites que sa pointe ne trébuche sur la feuille.
Il me semble n'avoir rien à écrire
pour commencer ce télex
qui doit tout le néant traverser
(la brûlante difficulté qui brule comme soufre,
qui corrode, étourdit. )
Mais j'essaierai de suivre la trace, au moins, d'un amour —
en dehors, là dans l'obscurit&
profonde des prés du passé.
Ainsi
............................................................
[...]
Mistieròi
Come elo che posse 'ver corajo
de ciomarve qua, de farve segno co la man.
No man che no l'é pi de la só ombria
cagnina e caía.
anzhi 'na sgrifa, ma tèndra 'fa molena.
Epuro ades calcossa la tien sú.
no so se 'n sgranf o se 'na forzha ;
par quel che l'é, la é tuta vostra,
e voi dèghe l'polso par ciamarve.
Dèghe 'na pena che no la sa schinche,
fè che la ponta sul sfój no la se inciónpe.
Me par de no 'ver gnent da méter-dó
par scuminzhiar 'sto telex
che tut al gnent bisogna che 'l traverse
(tut al gran seramént
che 'l brusa come solfer
che l'incaróla e l'intrunis).
Ma proarò la trazha, almanco, de 'n amor —
fora par là inte 'l scur
orbo dei pra del passà.
Cussì
..................................................
[...]
Andrea Zanzotto, Idiome, traduit et présenté par Philippe Di Meo, Corti, 2006, p. 145-147 et 144-146.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, traduit et présenté par philippe di meo, petits métiers, main, écriture, force | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2014
Alain Veinstein, Voix seule

Aujourd'hui
Encore une approche manquée...
Trop de mots, décidément,
trop de mots tonitruants.
La terre, jusqu'à nouvel ordre,
n'a rien d'un théâtre
où se déploie le merveilleux.
Seul le froid s'invite dans l'air,
s'infiltre, se resserre,
épaissit le silence.
Il m'accompagne depuis l'enfance
ce silence glacé
dans le calme accablant
du noir.
Aujourd'hui
Voix
en grandes capitales rouges,
oubliée et remontée
de l'épaisseur de la nuit,
restée à l'abri de la mort.
Dans le recoin où je vis,
je la rejoue de mémoire,
elle résiste,
ne se laisse pas faire,
chante, oui,
de ne pas chanter.
À chaque instant
je suis sur le point de la perdre,
à chaque instant
tout peut être perdu.
Alain Veinstein, Voix seule, Seuil, 2011, p. 139, 175.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, voix seule, mot, terre, froid, nuit, voix, chant, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2014
Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux

La lumière point là où le soleil ne brille pas
La lumière point là où le soleil ne brille pas.
Là où la mer ne s'étend pas, les eaux du cœur
Épandent leurs marées,
Et, spectres brisés, des vers luisants plein la tête,
Les choses de lumière
Passent à travers la chair là où la chair n'habille pas les os.
Une chandelle dans les cuisses
Échauffe la jeunesse et la graine et brûle la graine de la vie.
Là où la graine ne lève pas
Le fruit de l'homme s'ouvre dans les étoiles
Brillant comme une figue.
Là où la cire n'est pas, la chandelle montre ses cheveux.
L'aube point derrière les yeux.
Des pôles du crâne et de l'orteil, le sang venteux
Glisse comme une mer.
Ni clôturées, ni jalonnées, les giclées du ciel
Fusent à la verge
Révélant dans un sourire l'huile des larmes.
La nuit dans les orbites arrondit
Comme une lune de poix la limite des globes.
Le jour éclaire l'os.
Là où le froid n'est pas, la morsure des vents fait tomber les épingles
Qui retiennent les robes de l'hiver.
La taie du printemps pend au bord des paupières.
La lumière point sur des lots secrets
Sur des crêtes de pensées où les pensées sentent dans la pluie.
Quand meurent toutes les logiques
Le secret de la glèbe pousse à travers l'œil
Et le sang saute dans le soleil.
Au-dessus des lopins incultes l'aube fait halte.
Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux, dans
Œuvres, I, édition établie par Monique Nathan et Denis Roche,
Seuil, 1970, p. 368-369.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dylan thomas, poèmes, traduction patrick reumaux, lumière, mer, sang, aube, saison | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2014
Hölderlin, Lettre à sa mère, dans Œuvres

À sa mère
Francfort, le .... novembre 1797
[...]
Vous me demandez quel est mon sentiment actuel, au moment où je vous écris. Pour parler franc je dois dire que je suis en désaccord avec moi-même. D'un côté le souci raisonnable de mon caractère qui supporte à peine les impressions contradictoires auxquelles m'expose ma situation et les besoins les plus justifiés de mon esprit semblent exiger que je quitte un état où se forment toujours deux parties, l'un pour et l'autre contre moi, dont l'un me rend presque exalté et l'autre très souvent morne, abattu et parfois un peu amer. Tel fut, tout au long de ces deux années, mon sort constant, et c'était inévitable, je l'avais nettement prévu dès les premiers mois. Sans doute, le mieux eût été de maintenir des rapports aussi vagues que possible avec les deux parties, en me tenant tranquillement à l'écart. Cela est faisable quand on vit chez soi, mais pas dans une position où l'on est forcé d'avoir de nombreuses relations. Vous pensez bien que, dans une situation que l'on tient à conserver, on ne peut pas toujours agir selon son idée. J'ai donc dû m'exposer plus ou moins aux rencontres de tout genre, chose inévitable pour n'importe qui dans une position comme la mienne, à moins de devenir un zéro complet. Or, je le répète, je suis convaincu que si je suis obligé de prolonger cette expérience de deux années, ce sera toujours plus ou moins au détriment de mon caractère et de mes forces ; mon devoir semble donc m'imposer le choix d'un état qui comporterait moins de dispersion. Je connaîtrais beaucoup moins de conflits de ce genre , si par exemple, je répartissais mon enseignement entre diverses maisons d'ici ou de Mannheim, ou d'une autre grande ville [...].
Hölderlin, Œuvres, publié sous la direction de Philippe Jaccottet, traduction des Lettres par Denise Naville, Pléiade, Gallimard, 1967, p. 429-430.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hölderlin, lettre à sa mère, trouble, identité, relation, précepteur | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2014
Max Ernst, Écritures
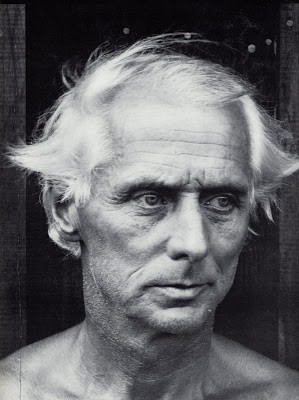
photo Frédéric Sommer, 1964
Des éventails brisés
Les crocodiles d'à présent ne sont lpus des crocodiles. Où sont les bons vieux aventuriers qui vous accrochaient dans les narines de minuscules bicyclettes et de jolies pendeloques de glace ? Suivant la vitesse du doigts, les coureurs aux quatre points cardinaux se faisaient des compliments. Quel plaisir c'était alors de s'appuyer avec ne gracieuse désinvolture sur es agréables fleuves saupoudrés de pigeons et de poivre !
Il n'y a plus de vrais oiseaux. Les cordes tendues le soir dans les chemins du retour ne faisaient trébucher personne, mais, à chaque faux obstacle, des sourires cernaient un peu plus les yeux des équilibristes. La poussière avait l'odeur de la poudre. Autrefois, les bons vieux poissons portaient aux nageoires de souliers rouges.
Il n' y a plus de vraies hydrocyclettes, ni microscopie, ni bactériologie. Ma parole, les crocodiles d'à présent ne sont plus des crocodiles.
Max Ernst, Écritures, Gallimard, 1970, p. 12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, Écritures, surréalisme, image, imaginaire | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2014
Christian Hubin, Touchant à une zone centrifuge

Touchant à une zone centrifuge
Abusive, non légitimée (rendue à quoi, altérant quoi ?) : la poésie, site classé, négociant sa reconversion.
*
Laissons-nous, aux meilleurs moments, nous laver de l'identité. Laissons-nous, émus, nous en remettre.
*
Restant à soi-même son cantus in-firmus, son mini Lascaux portatif.
*
Une logorrhée interchangeable poissant tout. L'invisible pressé au ramis. Le gluten des phrases transitoires.
*
Ozone entre les contours, les bribes de comptines de sens.
*
Rate qui flotte au fil du courant, portant sur le ventre les bubons, les présents vers ce qui l'escorte.
*
Outil de ce qui ne peut pas se dire.
*
Le particules sapides de l'air ; sa destitution du contenant.
*
Le polype invisible que la lecture apporte. Les pauses par tic propitiatoire, orphelinat expectatif.
*
Restituer les plis de sons, des hochements muets de sténoses — quelque chose peut-être en accord, en poudroyante faculté de — là où on est. Où la prosternation perplexe — nos ravages, dans la langue, de nains décatis.
Christian Hubin, Touchant à une zone centrifuge, dans Rehauts, n° 26, octobre 2010, p. 3-4.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian hubin, touchant à une zone centrifuge, poésie, identité, sens, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2014
Antonio Tabucchi, Petits malentendus sans importance
Rébus
Cette nuit j'ai rêvé de Myriam. Elle portait une long vêtement blanc qui ressemblait, de loin, à une chemise de nuit ; elle marchait sur la plage, les vagues étaient immenses, effrayantes, et se brisaient en silence, ce devait être la plage de Biarritz, mais elle était totalement déserte : j'étais assis sur une chaise longue, la première d'une interminable rangée, toutes inoccupées ; mais peut-être était-ce une autre plage, car je ne me souviens pas d'avoir vu de telles chaises longues à Biarritz, ce n'était qu'une plage symbolique ; je lui ai fait signe pour l'inviter à s'asseoir, mais elle a continué à marcher comme si elle ne m'avait pas vu, en regardant droit devant elle et, quand elle est passée près de moi, j'ai senti une rafale de vent glacé sur mon corps, comme si un halo l'entourait : alors, stupéfait mais non surpris, j'ai compris d'elle était morte.
Parfois, une idée ne semble plausible que de cette manière : en songe. Sans doute parce que la raison est timorée et ne parvient pas à combler les vides, entre les choses, à reconstituer une totalité, une forme de simplicité ; elle préfère les solutions complexes regorgeant de lacunes ; c'est alors que la volonté s'en remet au rêve. À l'inverse, peut-être rêverai-je, demain ou un autre jour, que Myriam est vivante ; elle marchera au bord de la mer et répondra à mon appel, s'installera à mes côtés sur une chaise longue, sur la plage de Biarritz ou une autre plage symbolique ; elle remettra ses cheveux en place, comme elle avait coutume de le faire, d'un geste lent, alangui, sensuel, et, face à la mer, elle désignera une voile ou un nuage , et elle rira, et nous rirons, heureux d'être là ensemble, de nous être retrouvés à notre rendez-vous.
[...]
Antonio Tabucchi, Petits malentendus sans importance, traduction de cette nouvelle par Christian Paoloni, Christian Bourgois, 1987, p. 33-34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio tabucchi, petits malentendus sans importance, rêve, illusion, plage | ![]() Facebook |
Facebook |
05/10/2014
Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason

Il fait aujourd'hui, après une journée de pluie, un temps étrangement limpide, un excellent temps pour aller acheter des livres. Selon moi, je l'ai déjà dit, acheter des livres et en lire sont deux activités différentes, mais la première n'est pas moins noble que la seconde ; elle lui est même étroitement apparentée, puisque le lecteur est au mieux de sa fureur quand il a entre les mains un livre à lui, et d'ailleurs le lecteur doit être convaincu que tout solide en forme de livre est un réceptacle de forces magiques, démoniques, violentes. Une bibliothèque est un dépôt d'instruments, matras et cornues, servant à évoquer animaux des profondeurs, bannières d'abîmes, arômes d'aisselles angéliques. Qui achète un livre a d'ores et déjà assimilé une partie non négligeable, de son mana. En ce qui me concerne, je suis en fait capable d'acheter, outre des livres, des disques, des cahiers, du papier, des crayons, des stylos ; un jour, dans un moment de glorieuse panique, je me suis acheté plusieurs pantalons. Autrefois j'achetais des cravates, mais il n'y avait rien à lire. Aujourd'hui, j'ai mal au dos et j'ai pris un médicament qui m'a un peu abasourdi. Pourquoi écrire, alors ? Pourquoi ne pas aller m'étendre dans un lieu sans danger, vu qu'aujourd'hui c'est la fête de ma faiblesse. Parmi les mystères de la littérature, il en est un qu'il ne faut pas négliger : c'est que la tâche de parcourir cette route, qui depuis toujours n'en finit pas, est confiée à des individus maladifs, lesquels sont d'autant plus hargneux que la tâche est au-dessus de leurs forces.
Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason, ou du lecteur et de l'écrivain considérés comme déments, traduit par Danièrel Van de Velde, Seuil, 1987, p. 128-129.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
04/10/2014
Li Po, Parmi les nuages et les pins
En montagne buvant avec un ermite
Tous deux nous buvons parmi les fleurs écloses
Une coupe une autre puis encre une coupe
L'ivresse m'assoupit il est temps que tu partes
Mais demain matin si tu veux reviens avec ton luth
Dialogue sur la montagne (4)
On me demande pourquoi je vis sur la Montagne Verte
Je souris sans répondre le cœur en paix
Les fleurs des pêchers s'en vont au fil de l'eau
Il est une autre terre un autre ciel que ceux des hommes
Sur les rapides de la rivière Lingyang
Les rapides font retentir leur grondement
De chaque côté des nuées de singes
Les flots tourbillonnants déferlent en avalanche
Entre les bancs de rochers même un canot passe à peine
Bateliers et pêcheurs
Combien de perches ici ont dû se briser
Li Po, Parmi les nuages et les pins, traduit du chinois par
Dominique Hoizey, Arfuyen, 1984, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : li po, parmi les nuages et les pins, méditation, solitude, ivresse, fleurs, eau | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2014
Mathieu Bénézet, Poèmes uniques, dans Rehauts

Tes habits d'aujourd'hui
Rue du Moulin Vert un rejet de gly
cine se prit dans es cheveux Je
t'évoquais dans tes habits d'aujourd'hui
Tu pars comme on dit au travail
dans un journal à Saint-Denis
(J'y écrivis naguère encore hier demain qui sait)
Ô la glycine je nous connus neuf
ans déjà rue du Château, rue des Plantes
les allers et retours
charriant le petit panier du repas
(Ô fête d'une sieste sous un ciel de chambre)
(fête du poulet grillé dans un four)
Si profondément se forme un pas d'homme
(moi) il te regarde chaque jour
dans tes habits d'hier d'aujourd'hui
demain qui sait
Rue Jean Sicard, Paris le 30.X.1991
Mathieu Bénézet, Poèmes uniques, dans Rehauts,
n° 33, 2014, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathieu bénézet, poèmes uniques, dans rehauts, amour, fête, regard, glycine | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2014
Charles Dobzynski, La question décisive

1929-29 septembre 2014
Extrait de son premier recueil :
Le chant du chômeur
Je suis le chômeur
Je viens par les plaies
Je porte les rumeurs à la gorge des baies
Je suis le chômeur et je forge ce temps
Comme une clé pour ouvrir les poitrines
D'où surgiront de grands drapeaux battants !
Je suis le chômeur
Le donneur de présence aux margelles du jour
Je suis celui qu'on veut conduire au vide
Qu'on veut réduire au spectre de ses cris
Qu'on veut clouer à tous les carrefours
Ainsi qu'une pancarte indiquant où commence
Le no man's land et la blessure des midis
Je suis celui qu'on jette aux vitres
Qu'on plie et qu'on oublie aux angles des distances
Et ma faim s'arrondit en un bolide dur
Pour étrangler le silence
Mais mon amour au fil de source
Passera par l'aiguille infinie du futur !
[...]
Charles Dobzynski, La question décisive, Pierre Seghers,
1950, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles dobzynski, la question décisive, chômeur, temps, oubli, futur | ![]() Facebook |
Facebook |






