17/09/2017
Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau

Autoportrait
À quoi bon détailler toutes ces circonstances
raconter vaguement sa vie ?
tandis que je feuillette un livre sur Rembrandt
me revient la question d’un collègue me demandant
pourquoi j’écris à la première personne
le moi, je le concède, est haïssable
j’aimerais bien d’ailleurs certains jours m’en défaire
me fondre pour de vrai dans le décor
bucolique évoqué dans ces vers
mais il s’attache l’animal
refuse de s’évaporer dans la brume
qui pourtant lui plaît bien quand à fleur d’eau
dans les matins d’automne on la voit qui lévite
et même s’il lui prenait l’envie
(imaginons un jour de bile vraiment noire
où il se sentirait décidément trop lourdaud)
de devenir diaphane et pour de bon
basculait d’un plongeon sans retour,
il y a fort à parier qu’au dernier moment
comme je sais très bien nager
je ramènerais moi-même ce maudit moi
sur la berge sans peine
car nous ne pesons que le poids d’un seul
et nous continuerions ensemble
à naviguer dans la vie
mon double et moi
à parler d’une seule voix.
Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l’eau,
Champ Vallon, 1993, p. 57-58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, laïus au bord de l’eau, autoportrait, le moi, double | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2017
Jules Supervielle, Le Corps tragique

Le milieu de la nuit
Je vois ma plume au milieu de la nuit
Qui met un peu de lumière autour d’elle.
Mais la vapeur de la locomotive
Entre ces murs de plus en plus rétive
Qui me le dira d’où vient-elle ?
J’ai beau penser fer, chaudière, charbon,
Je ne vois pas à quoi je leur suis bon,
Je ne sais plus d’où me viennent ces mots
Ni l’alphabet dont les lettres cessèrent
Si brusquement de m’être familières.
Comme quelqu’un qui a perdu son cœur
Je suis ailleurs jusqu’en mes profondeurs
Et je me sens tellement insolite
Que tout m’est bon à me servir de gîte.
À la merci de contraires sans foi
Je suis partout où s’affirment leurs lois,
Et cependant la bougie se consume
Et le train file et je suis dans ma chambre.
Les montagnards de mon rêve s’égaillent
Et je me sauve au fond des couvertures.
Jules Supervielle, Le Corps tragique, dans
Œuvres poétiques complètes, Pléiade / Gallimard,
édition Michel Collot, 1996, p. 595.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le corps tragique, le milieu de la nuit, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2017
Aragon, Le paysan de Paris (1926)
Le songe du paysan

Il y a dans le monde un désordre impensable, et l’extraordinaire est qu’à l’ordinaire les hommes aient recherché sous l’apparence du désordre, un ordre mystérieux, qui leur est si naturel, qui n’exprime qu’un désir qui est en eux, un ordre qu’ils n’ont pas plutôt introduit dans les choses qu’on les voit s’émerveiller de cet ordre, et impliquer cet ordre à une idée, et expliquer cet ordre par une idée. C’est ainsi que tout leur est providence, et qu’ils rendent compte d’un phénomène qui n’est témoin que de leur réalité, qui est le rapport qu’ils établissent entre eux et par exemple la germination du peuplier, par une hypothèse qui les satisfasse, puis admirent un principe divin qui donna la légèreté du coton à une semence qu’il fallait à d’innombrables fins propager par la voie de l’air en quantité suffisante.
Aragon, Le paysan de Paris (1926), dans Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade / Gallimard, 2007, p. 484.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le paysan de paris (1926), le songe du paysan, croyance, ordre, désordre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2017
Benoît Casas, L'agenda de l'écrit

14 septembre
Naissance de Dante Alighieri
Le dire est faible : ma parole sera courte
j’ai mémoire, vue nouvelle, d’un enfant, langue au sein.
Je voulais voir la lumière, je voyais.
Benoît Casas, L’agenda de l’écrit,
Editions Cambourakis, 2017, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l’agenda de l’écrit, naissance de dante alighieri, 140 signes | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2017
Borges, Éloge de l'ombre
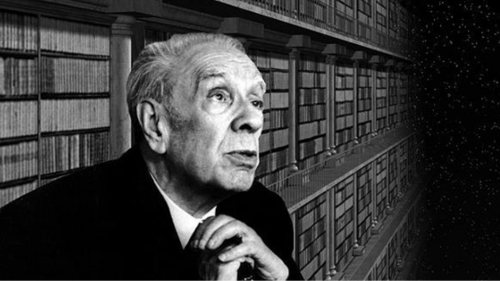
Labyrinthe
De porte, nulle part, jamais. Tu es dedans
Et l’alcazar embrasse l’univers
Et il n’a point d’avers et de revers,
Point de mur extérieur ni de centre secret.
N’espère pas que la rigueur de ton chemin
Qui obstinément bifurque sur un autre
Qui obstinément bifurque sur un autre
Puisse jamais finir. De fer est ton destin
Comme ton juge. N’attends point la charge
De cet homme-taureau dont l’étrange
Forme plurielle épouvante ces rêts
Tissés d’interminable pierre.
Il n’existe pas. N’attends rien. Pas même
Au cœur du crépuscule noir, la bête.
Borges, Éloge de l’ombre, traduction J.-P. Bernès
et N. Ibarra, dans Œuvres complètes, II, Pléiade /
Gallimard, 1999, p. 161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : borges, Éloge de l’ombre, labyrinthe, attente, destin, forme, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2017
Claude Chambard, Le chemin vers la cabane

le jardin est désert
aucun chemin n’en part
ciel vert le matin
ciel rouge le soir
un assemblage un paysage
la porte du paradis
est condamnée
faute de clef
il n’y a pas de sentier derrière la porte fermée
partout le paysage est interrompu
par de méchantes larmes
(en Petite Sologne)
Claude Chambard, Le chemin vers la cabane, le bleu
du ciel, 2008, p. 16.© Photo Michel Durigneux.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, le chemin vers la cabane, en petite sologne, paysage, jardin | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2017
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque

(…) comment a-t-on le droit d’apprendre à lire, à écrire, si la lecture et l’écriture conduisent à légitimer la mort de jeunes hommes valides, ni soldats, ni combattants, de femmes, d’enfants, de vieillards ? comment peut-on apprendre à lire, à écrire les alphabets de langues dans lesquelles ont été pensées et consignées, en toute légalité, des lois (en France, en Italie, en Allemagne) qui triaient les humains, séparant ceux qui étaient destinés à la vie de ceux qui devaient disparaître pour « raison de naissance » ?
Les mots formés par ces alphabets, la grammaire, la syntaxe de ces langues avaient autorisé, légitimé même, les mécanismes intellectuels et les rouages techniques de l’administration d’un génocide industriel. Non pas comme dans une guerre géopolitique, qui se déroule avec un début e tune fin, quand on tue des ennemis pour l’emporter dans un conflit, mais comme dans une extermination métaphysique, sans fin, hors du temps et de l’espace, où les actions résultent d’une haine inexpiable où la mort elle-même se dérobe aux mortels.
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, La librairie du xxe siècle, Seuil, 2017, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice olender, un fantôme dans la bibliothèque, langue, génocide, haine, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2017
Buson, Le parfum de la lune

les journées lentes
s'accumulent
si loin autrefois
le poirier en fleurs
sous la lune
une femme lit une lettre
je marche, je marche
songeant à des choses et à d'autres
le printemps s'en va
au bord du chemin
des jacinthes d'eau arrachées fleurissent
la pluie du soir
la nuit, des voix d'hommes
irriguant les champs
la lune d'été
la nuit voilée
les grenouilles brouillent
l'eau et le ciel
Buson (1716-1783), Le parfum de la lune,
traduction Cheng Wing fun et Hervé
Collet, Moundarren, 1992, p. 55, 59,
68, 80, 90, 93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buson (1716-1783), le parfum de la lune, nuit, lune, pluie, printemps | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2017
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de Fra Angelico

Dernière invitation
Au voyageur solitaire — l’espèce est rare, mais il s’en trouve encore — qui ne se résigne pas aux formes tièdes et standardisées de la mort à l’hôpital telle que la garantissent les États modernes, à celui-là qui, plus encore, est terrorisé à l’idée du sort expéditif et impersonnel auquel sera voué son corps au moment des obsèques, Lisbonne continue d’offrir une appréciable variété de choix pour un noble suicide. Cette ville dispose en outre des infrastructures es plus décentes, les plus raffinées, les plus diligentes et surtout les plus économiques pour le traitement de ce qui subsiste après un suicide bien réussi : l’inévitable cadavre.
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de Fra Angelico, traduction Jean-Baptiste Para, Christian Bourgois, 1989, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio tabucchi, les oiseaux de fra angelico, jean-baptiste para, dernière invitation, suicide, lisbonne | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2017
Natalia Ginsburg, Les petites vertus

Le silence
J’ai été entendre Pelléas et Mélisande. Je ne comprends rien à la musique. Seulement je me suis mise à comparer les mots des vieux livrets d’opéra (« Je paie avec mon sang — l’amour que j’ai mis pour toi »), paroles fortes, sanglantes, lourdes, avec les paroles de Pellaés et Mélisande (« J’ai froid — ta chevelure »), paroles fuyantes, aquatiques. De la fatigue, du dégoût pour les paroles fortes et sanglantes, sont nées ces paroles aquatiques, fuyantes.
Je me suis demandé si ce n’est pas cela (Pelléas et Mélisande) qui a été le début du silence.
Parce que, parmi les tares les plus graves et les pus étranges de notre époque, il faut citer le silence. Ceux d’entre nous qui, de nos jours, ont essayé d’écrire des romans, connaissent la difficulté, la gêne qui vous saisit lorsqu’il s’agit de faire parler entre eux des personnages. Pendant des pages et des pages, nos personnages échangent des commentaires insignifiants, mais chargés d’une lamentable tristesse. « Tu as froid ? » « Non, je n’ai pas froid » « Veux-tu un peu de thé ? » « Non, merci » « Tu es fatigué ? » « Je ne sais pas. Oui je suis peut-être un peu fatigué. » C’est ainsi que parlent nos personnages. Ils parlent ainsi parce qu’ils ne savent plus comment parler.
Natalia Ginsburg, Les petites vertus, traduction Adriana R. Salem, Flammarion, 1964, p. 135-136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natalia ginsburg, les petites vertus, opéra, pelléas et mélisande, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2017
Esther Tellermann, Carnets à bruire

Ne m’effleurait
votre
incise théâtre
de pierres linges
recouvraient
les paumes
j’induisais votre
souffle
à l’intérieur
de mes sillons
je
respire
vos aurores de
papier comme si
l’ombre
prenait
feu
Esthet Tellermann, Carnets
à bruire, La lettre volée, 2014, p. 74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, carnets à bruire, théâtre, souffle, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2017
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela
Comptine des civilisations
Pigeon vole voici voilà
voici la veuve voilée
harpe des douleurs
fleurie et transpercée
Vierge ou Niobé.
Voici voilà en la aréna
le taureau qui s’est arrêté
il ne sera pas mis à mort
le public le torero
dans un verre d’eau se sont noyés.
Pigeon hibou vautour vole
vol à l’immensité
un fémur renversé
un osselet de pierre
pour prier pour siffler.
Le sphinx Janus Uranus
je ne sais quels dieux trouvés
abandonnés oubliés
inconnus mais révérés.
Les ruines l’ossuaire
civilisations éteintes
les cités imaginaires
inhumaine vérité
bien au-delà de la Terre
s’endorment dans les stellaires
monastères ministères
cimetières.
Première poussière
poussière lumière
désert étoilé.
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela,
Gallimard, 1979, p. 47-48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, comptine des civilisation, ruine, taureau | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2017
John Ashbery (1927-3 septembre 2017), Fragment, Clepsydre, poèmes français

C’est sûrement sur une des pages intérieures
Que l’histoire de sa timidité sera écrite
Avec toutes les pensées libertines d’un trajet
Grossièrement en forme de cœur autour d’un marais
Qui pour beaucoup de nous sera le voyage ultime
Vu la petite quantité de grâce qu’on nous a accordée.
Cette banalité qui est en fin de compte notre
Possession la plus précieuse, parce que permettant de
Nous élever au niveau de nous-mêmes, ce qui serait peu de chose
Sans la présence d’un tas d’amis et d’ennemis, tous
Disposés à nous prêter serment, nous comptant
Peu sur cet anoblissement de dernière heure, restent
Colossaux, leurs chapeaux à larges bords figurant
Toute la honte de la gloire, nous enfermant dans l’idée du nombre :
L’éther divisant nos victoires, anciennes et futures : dents et sang.
John Ashbery, Fragment, Clepsydre, poèmes français), traduction Michel Couturier, Seuil, 1973, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ashbery, fragment, clepsydre, poèmes français, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
04/09/2017
Jacques Bens (1931-2001), Sonnets irrationnels

Capricieux
Sur quinze lignes célèbres de Musset
Nous sommes seuls, je suis jeune, vous êtes belle,
Si, contre un peu d’ennui, notre esprit se rebelle,
Malgré mille chagrins entre nous élevés,
Madame, accordez-nous la douceur d’un caprice.
Laissez-nous emporter, fascinés, captivés,
Par une heure d’oubli, parfum de mirabelle,
Pétales effeuillés, jasmins en ribambelle,
Jardins de ces plaisirs que nous avons rêvés.
Madame, accordez-vous la douceur d’un caprice.
Le plaisir ? Ce n’est pas le plaisir sacrifice,
Aveugle et sans amour, que je vous offre ici.
C’est l’amour sans regret, sans peine, sans entrave,
Qui fait briller les yeux d’une lumière grave,
Et dont on garde au cœur le sourire adouci.
Jacques Bens, Sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, sonnets irrationnels, muser, plaisir, caprice, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
03/09/2017
Gennadi Aïgui, Sommeil : un chemin dans un champ

Sommeil : un chemin dans un champ
à quoi bon — presque inexistant — ta rage
pour en chercher un autre
dépossédé de cendres ?
quel don pour toi de ce chemin ? son ombre
referme quelque chose…
de nourriture non-terrestre :
absente… tu ne trouveras pas
les traces
du visiteur premier…
Guennadi Aïgui, Hors-commerce Aïgui, textes réunis et
traduits par André Markowicz, Le Nouveau Commerce,
1993, p. 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gennadi aïgui, sommeil : un chemin dans un champ, absence | ![]() Facebook |
Facebook |






