03/10/2017
Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie

Littérature = affrontement catastrophique à l’innommable.
Je pars de ceci qui concerne empiriquement TOUS les êtres parlants : qu’aucun des discours positifs (science, morale, idéologie, religion…) ne rend compte de l’expérience que nous faisons intimement, chacun pour notre compte, du monde (de la manière dont le réel nous affecte). Parce que le monde (le monde dit « extérieur » société, politique, histoire — et le monde « intérieur » — nos « cieux du dedans » — mémoire, inconscient, imaginaire) ne nous vient pas comme sens, mais comme confusion, affects ambivalents, jouissance et souffrance mêlées, chaos, fuite, polyphonie insensée.
Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie, L’Ollave, 2017, p. 22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, Ça tourne, notes de régie, littérature, incollable, réel, confusion, chaos | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2017
Guillevic, Relier

Brabant
Voir l’étendue
Venir vers toi.
L’espace est plus
Que du volume
Qui veut s’ouvrir.
L’espace n’est pas
Quelque chose qui se donne.
Le souffle de l’étendue
S’appelle l’espace.
Tourne le dos à l’espace
Il te rattrapera.
Tout cela
Que tu ne caresseras
Que de l’œil.
Même si ce paysage
Ne veut pas de toi,
Plonges-y ton front.
De ce paysage
Ne se lèvera
Que ce que tu feras se lever.
Prends autrement
Ce que tu ne peux
Prendre dans tes mains.
Guillevic, Relier, Gallimard,
2007, p. 307-308.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, relier, brabant, espace, paysage | ![]() Facebook |
Facebook |
01/10/2017
Raymond Queneau, Battre la campagne

Le bon vieux temps
Le moissonneur pour son Noël
s(achète une faux
une faux électronique
plus rapide que l’éclair
elle compte aussi les épis
qui tombent à chaque andain
elle en détermine le prix
compte tenu du marché commun
elle peut s’autoréparer
s’il lui arrive quelque anicroche
elle peut si l’on veut chanter
un air à la mode
le moissonneur est bien content
il met une bûche dans l’âtre
et dans un ancien récipient
où dort une soupe verdâtre
il taille le pain de ciment
pour s’en faire un solide emplâtre
fume sa pipe un bon moment
puis s’endort dans des draps blanchâtres
et passe la nuit en rêvant
aux plaisirs un peu douçâtres
que l’on avait au bon vieux temps
Raymond Queneau, Battre la campagne,
Gallimard, 1968, p. 94-95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, battre la campagne, le bon vieux temps, électronique | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2017
Vladimir Maïakovski, Lettre à Lili Brik, 1917-1930

Ce qui s’ensuivit
Plus qu’il n’est permis,
plus qu’il ne faut, —
comme
un délire de poète surplombant le rêve :
la pelote du cœur se fit énorme,
énorme l’amour,
énorme la haine.
Sous le fardeau,
les jambes
avançaient vacillantes,
— tu le sais,
je suis
pourtant bien bâti —
néanmoins
je me traîne, appendice du cœur,
ployant mes épaules géantes.
Je me gonfle d’un lait de poèmes,
sans pouvoir déborder, —
jusqu’au bord, et pourtant je m’emplis encore.
Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik, 1917-1930,
traduction Andrée Robel, Gallimard, 1969, p. 94-95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir maïakovski, lettres à lili brik, 1917-1930, cœur, rêve, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2017
Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Annette Kolb
Château de Duino, 24 janvier 1912
(…) le triste rôle qu’il [l’homme] joue dans l’histoire de l’amour : la seule force qu’il y montre, ou presque, c’est la supériorité que la tradition lui assigne, et celle-là même, il l’assume avec une négligence qui serait simplement révoltante, si la distraction, les absence de son cœur n’avaient eu souvent de grands motifs, qui le justifient en partie. Mais personne ne m’empêchera de voir ce que le rapport entre cette amante absolue et son pitoyable partenaire manifeste de façon définitive : à quel point tout ce qui est réalité, accompli, supporté d’un côté, celui de la femme, s’oppose à l’absolue insuffisance de l’homme en amour. Elle se voit décerner, si vous me permettez cette image banalement explicite, le diplôme de capacité d’amour, quand il n’a encore en poche qu’une grammaire élémentaire où la nécessité lui a fait apprendre quelques mots dont il forme à l’occasion des phrases, aussi belles, aussi exaltantes que les fameuses premières phrases des manuels de langue pour débutants.
Rainer Maria Rilke, Œuvre, III, Correspondance, édition Philippe Jaccottet, Seuil, 1974, p. 195-196.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, Œuvre, iii, correspondance, philippe jaccottet, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2017
Georges Bataille, William Blake, La Littérature et le mal
L’enseignement de Blake se fonde ( …) sur la valeur en soi — extérieure au moi — de la poésie. " Le Génie Poétique, dit un texte significatif1, est l’Homme véritable, et le corps, ou la forme extérieure de l’homme, dérive du Génie Poétique… De même que tous les hommes ont la même forme extérieure, de même (et avec la même variété infinie) ils sont tous semblables par le Génie Poétique... Les Religions de toutes les Nations sont dérivées de la réception du Génie Poétique Propre à chaque Nation... De même que tous les hommes sont semblables (encore qu'infiniment variés), de même toutes les Religions ; et comme tout ce qui leur ressemble, elles n'ont qu'une source. L'homme véritable, à savoir le Génie Poétique, est la source." Cette identité de l'homme et de la poésie n'a pas seulement le pouvoir d'opposer la morale et la religion, et de faire de la religion l'œuvre de l'homme (non de Dieu, non de la transcendance de la raison), elle rend à la poésie le monde où nous nous mouvons.Ce monde en effet n'est pas réductible aux choses, qui nous sont en même temps étrangères et asservies. Ce monde n'est pas le monde profane, prosaïque et sans séduction, du travail (c'est aux yeux des "introvertis", qui ne retrouvent pas dans l'extériorité la poésie, que la vérité du monde se réduit à celle de la chose) : la poésie, qui nie et détruit la limite des choses, a seule la vertu de nous rendre à son absence de limite ; le monde, en un mot, nous est donné quand l'image que nous en avons est sacrée, car tout ce qui est sacré est poétique, tout ce qui est poétique est sacré.
« All Religions are one » (Toutes les religions ne sont qu’une), vers 1788 [›• ∫•, Poetry and Prose, edited par G. Keynes, Londres, Nonesuch Press, 1948, p. 148-149). « Tous les hommes sont semblables par le Génie Poétique » : « La poésie doit être faites par tous, non par un », disait Lautréamont.
Georges Bataille, William Blake, dans La Littérature et le mal, Œuvres complètes, ix, Gallimard, 1979, p. 225.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, william blake, dans la littérature et le mal, génie poétique, lautréamont, poésie, sacré | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2017
Anne de Staël, Le cahier océanique

Temps de pierre
Tout le mouvement du monde
« reçu » et sur le coup « renvoyé »
Pierre d’exactitude
Elle atteint la minute à la tête
Et contre elle s’aiguise le dard
Son ombre l’entrecoupe de Présent
La tient entrouverte comme un boîtier
Anne de Staël, Le cahier océanique, La Lettre
volée, 2015, p. 117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne de staël, le cahier océanique, pierre, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2017
Camille Olivier, éparpillements

Cahier 2
chacun va d’une maison à l’autre
de ses parents à soi-même parents
le fil électrique bouge
il y a du vent
se soulèvent les hirondelles
une maison est retranchement
endroit de repos sans oscillation
plus de relations coupées
(enfin on a remis mon carillon à onze heures
du matin vous vous rendez compte quelle honte)
et quand je sors retrouvant le mouvement
entre deux points
les animaux viennent à ma rencontre
pas seulement les veaux bruns aux yeux ronds
mais le faon, mais le pinson
viennent à ma rencontre
pour que je revienne sauvage aussitôt
on m’a mise dans la maison des rêves
mais ce n’était pas le bon moment
et je souffrais comme une bête
une bête folle se cogne contre la vitre
va vers la lumière
on pourrait tout imaginer et
on ne pourrait rien faire
pas même laver un carreau
pas même nettoyer une porte
tu délimitais les parterres faisant le tour
et le centre était envahi d’herbes hautes
Camille Loivier, éparpillements, isabelle sauvage,
2017, p. 61-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, éparpillements, cahier, maison, bêtes, sauvage, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2017
Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood
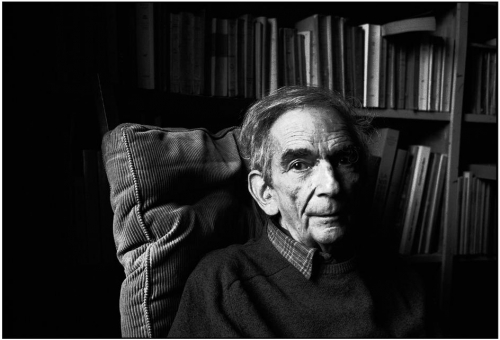
Une ombre peut-être, rien qu’une ombre inventée
Et nommée pour les besoins de la cause
Tout lien rompu avec sa propre figure.
Se faire entendre une voix venue d’ailleurs
Inaccessible au temps et à l’usure
Se révèle non moins illusoire qu’un rêve
Il y a pourtant en elle quelque chose qui dure
Même après que s’en est perdu le sens
Son timbre vibre encore au loin comme un orage
Dont on ne sait s’il se rapproche ou s’en va.
Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood,
Fata Morgana, 1988, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-rené des forêts, poèmes de samuel wood, ombre, voix, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2017
Philippe Jaccottet, Tâches de soleil, ou d'ombre. Notes sauvegardées.

Les iris poussent au hasard dans un enclos d'herbes hautes — couleur mauve ou violet sombre — sortis de leurs papiers de soie parmi leurs dures lames vertes. Ou ceux, de couleur jaune, qui poussent dans les marais et les canaux. Et ces toutes petites fleurs basses — jaunes ou roses — qui s'accrochent aux pierres, aux rochers, qui leur tiennent lieu de pelage, doux, gras et chaud, modeste et tenace.
*
Le parfum des iris, très doux, sucré, presque suave, évoquant, me semble-t-il, l'idée qu'on a pu se faire, adolescent, du féminin : de quoi vous tourner la tête... Avec cette espèce de chenille d'un jaune éclatant, solaire, mais si bien cachée sous les pétales bleu pâle comme sous des langues d'eau. Mais le mot "chenille" gêne, et "brosse" tout autant. Une réserve de poudre d'or, un pelage d'or, une toison peut-être, cachée dans la soie de la robe ?
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre, Notes sauvegardées, 1952-2005, Le Bruit du temps, 2013, p. 47, 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, taches de soleil, ou d'ombre, notes sauvegardées, iris, parfum | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2017
Jules Renard, Journal, 1887-1910

Elle avait une peur ridicule du ridicule.
On place des éloges comme on place de l’argent, pour qu’ils nous soient rendus avec les intérêts.
Il jouait du piano d’une façon remarquable avec un seul doigt.
La psychologie. Quand on se sert de ce mot-là, on a l’air de siffler des chiens.
Tout est beau. Il faut parler d’un cochon comme d’une fleur.
Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 55, 59, 64, 75, 92.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ules renard, journal, 1887-1910, ridicule, éloge, psychologie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2017
Franz Kafka, Lettres à Felice
À Grete Bloch, 8. V. 14
Jusqu’à présent (…) j’ai obtenu tout ce que je voulais, mais pas tout de suite, jamais sans détour, le plus souvent même sur le chemin du retour, toujours au cours de l’ultime effort, presque au dernier moment si tant est qu’on en puisse juger. Pas trop tard, mais presque trop tard, c’était tout juste le dernier martelage du cœur. Et puis je n’ai jamais obtenu non plus la totalité de ce que je voulais, en général d’ailleurs tout n’était plus disponible, et tout l’eût-il été que je n’aurais pas pu en venir à bout, mais quoi qu’il en soit j’en recevaus toujours un gros morceau, et même le plus souvent le principal. En soi naturellement ces lois qu’on trouve soi-même ne signifient absolument rien, elle ne sont toutefois pas sans signification pour caractériser celui qui les découvre, d’autant qu’une fois trouvées elles le dominent avec une sorte de matérialité réelle.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 655-656.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, ii, traduction marthe robert | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2017
William Faulkner, Les Larrons

C’était samedi matin, vers 10 heures. Ton arrière grand-père et moi, nous étions dans le bureau de l’écurie de louage. Père assis à son bureau en train de compter l’argent et de vérifier avec la liste des factures de livraison les sommes que je venais de collecter dans le sac de toile en faisant le tour de la Place ; et moi assis sur la chaise contre le mur, attendant midi, l’heure où je toucherais les dix cents de mon salaire du samedi (de la semaine) et où on rentrerait à la maison et où je serais enfin libre de rattraper (on était en mai) la partie de base-ball qui se jouait sans moi depuis le petit déjeuner : l’idée (pas la mienne, celle de ton arrière grand-père) étant que même à onze ans un homme devait depuis un an déjà assumer le coût et les responsabilités de sa place au soleil, de l’espace qu’il occupait dans l’économie de ce monde (du moins celle de Jefferson, Mississippi). Tous les samedis matins je partais avec Père immédiatement après le petit déjeuner, tandis que tous les autres garçons de notre rue se contentaient de s’occuper de balles, de battes et de gants — pour ne rien dire de mes trois frères qui, étant plus jeunes et par conséquent plus petits que moi, avaient plus de chance, à supposer que tels étaient bien la logique et les présupposés de Père : puisque tout adulte digne de ce nom pouvait prendre en main ou assumer la responsabilité économique de quatre enfants, n’importe lequel de ces enfants, à plus forte raison l’aîné, suffirait pour prendre en charge les déplacements nécessaires à cette économie (…)
William Faulkner, Les Larrons, Pléiade / Gallimard, 2016, p. 785-786.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, les larrons, responsabilité, jeu, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2017
André Breton, Les Pas perdus

Max Ernst
L’invention de la photographie a porté un coup mortel aux vieux modes d’expression, tant en peinture qu’en poésie où l’écriture automatique apparue à la fin du xixe siècle est une véritable photographie de la pensée. Un instrument aveugle permettant d’atteindre à coup sûr le but qu’ils s’étaient jusqu’alors proposé, les artistes prétendirent non sans légèreté rompre avec l’imitation des aspects. Malheureusement l’effort humain, qui tend à varier la disposition d’éléments existants, ne peut être appliqué à produire un seul élément nouveau. Un paysage où rien n’entre de terrestre n’est pas à la portée de notre imagination. Le serait-il que lui déniant a priori toute valeur affective nous nous refuserions à l’évoquer. Il est, en outre, également stérile de revenir sur l’image toute faite d’un objet (cliché de catalogue) et sur le sens d’un mot comme s’il nous appartenait de le rajeunir. Nous devons en passer par ces acceptions, quitte ensuite à les distribuer, à les grouper selon l’ordonnance qu’il nous plaît. C’est pour avoir méconnu, dans ses bornes, cette liberté essentielle que le symbolisme et le cubisme ont échoué.
André Breton, Les Pas perdus, dans Œuvres complètes, I, édition Marguerite Bonnet, Pléiade / Gallimard, 1988, p. 245.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, les pas perdus, photographie, écriture automatique | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2017
Louis Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris (1797)

Cartes de restaurateurs
Vous les recevez en entrant tout imprimées ; c’est une feuille in-folio. Tel accoudé sur une table, les médite longtemps avant de se décider ; tel tâte son gousset pour savoir s’il a vraiment de quoi dîner, car l’on ne dîne plus à bon marché. Faites bien votre calcul, si vous ne voulez pas être pris au dépourvu, et laissez votre montre ou votre tabatière au comptoir, en gage d’une moitié de poularde.
Vous voyez bien les prix, mais vous ne voyez pas le plat ; quand il arrive, ce qu’il contient pourrait être servi dans une soucoupe, ou dans une palette à saignée. On voit au firmament la croissance de la lune, on ne voit chez les restaurateurs que la décroissance des plats ; et les prix sont fixes et invariables, comme l’étoile polaire. La viande est découpée en filigrane, et bientôt le sera en dentelle. On dirait que les bœufs sont devenus pas plus gros qu’un dindon ;(…)
Si vous demandez d’un tronçon d’anguille à la Tartare, on vous en apporte ; mais ce tronçon n’a que jusqu’à un pouce et demi de longueur ; ayez soin que la carte dise combien vous en aurez de pouces, sans quoi votre tronçon ne sera qu’une roulette. Il en est de même de tous les autres mets, c’est l’exiguïté la plus délicate : on dirait qu’on vous apporte des échantillons d’un repas futur.
La goinfrerie est la base fondamentale de la société actuelle : on ne songe sérieusement qu’à manger, qu’à bien dîner ; et tous ces miroirs qui décorent ces salles de restaurateurs, réfléchissent l’égoïsme qui seul dévore tout à son aise ; et qui, quand il a dîné, n’est touché de l’infortune de personne.
Louis Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, 1797, p. 72-76 (Gallica)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis sébastien mercier, cartes de restaurateurs, le nouveau paris | ![]() Facebook |
Facebook |







