12/07/2025
Camille Loivier, torii

tout cela n’est peut-être arrivé que par amour. Un amour blessé qui préférait mourir
l’enfance est à l’âge des contes, des légendes et des mythes, elle en a la force, l’aveuglement
je suis prête à tout pour reconquérir le cœur de celle qui m’apporte un bonheur plus grand que moi
un amour prêt au sacrifice pour ne pas déchoir, pour obtenir, posséder, garder le cœur de l’aimée, unique, à soi,
pour cet amour seul j’existe, si tôt venue à lui, la passion va jusqu’au désespoir
amour incompris, impossible, je suis tellement dedans, dans sa force, que j’en oublie la ligne de démarcation entre la vie et la mort. Elle semble abstraite comme une ligne droite dans un livre de géométrie
Camille Loivier, torii, Isabelle sauvage, 2025, p. 125.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, sacrifice, interdit | ![]() Facebook |
Facebook |
11/07/2025
Camille Loivier, torii

Ce ne sont peut-être pas des dahlias, ces grosses têtes de fleurs plus grandes que moi, qui me regardent et me parlent, à qui je réponds avec naturel, sans aucune hésitation. Nous bavardons côte à côte, assise sur la dernière marche de l’escalier de pierre recouvert de lichen. Nous parlons de vent et de la lumière. J’ai gardé le souvenir distinct de nos conversations à bâtons rompus, l’eau qui manque, la chaleur étouffante de midi. Notre tête est une fleur, disaient-elles, les pétales protègent le cœur qui est un ventre rempli de graines que le soleil va porter lentement à maturité. J’ai ensuite coupé les têtes un peu flétries, je les ai effeuillées après m’être adressée à chacune. Nous étions d’accord sur tout, nous n’avions peur de rien.
Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, conversation | ![]() Facebook |
Facebook |
10/07/2025
Camille Loivier, torii

les écureuils traversent d’un jardin à un autre, transfrontaliers grâce aux arbres dont les branches se rejoignent par-dessus les murets, ils vont du passé au présent car chaque jardin contient une tranche de temps. La strate la plus ancienne où je sais qu’ils se retrouvent me fait les envier. Ils côtoient un temps que je n’ai pas vécu, cachent des noisettes là où des souvenirs qui ne m’incluent pas me préoccupent. Ils peuvent aller et venir dans le temps avec l’aisance d’une qui écrit, qui se balance d’avant en arrière. Qui, dans les lignes qu’elle trace, avance puis recule.
Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2025
Camille Loivier, torii

si les sonorités des chants d’oiseaux m’ont éloignée de ma route bordée de murets longs et étroits, au moins aurai-je écrit, au moins cette durée vaine de vivre aura été comblée par cette écriture qui n’a pas plus de sens que les tracés des vers de bois sous l’écorce desquamée qui me semblaient une écriture des temps reculés, quand les humains n’étaient pas encore des humains, et qu’ensuite je n’ai fait que penser à cette écriture des vers sur le bois, je me suis résignée à l’écouter, à la retranscrire, à refuser son silence et son insignifiance, à espérer qu’elle retienne notre mémoire
Camille Loivier, torii, isabelle sauvage, 2025, p. 45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, torii, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2022
Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent

les lignes indéfiniment se poursuivent
mais les lignes transversales — les branches des arbres qui passent au-dessus des murs, les rivières qui courent au-dessous des ponts, les ronces qui vont partout comme les bêtes à quatre pattes, les oiseaux qui sillonnent le ciel bas tout à leur aise, les nuages, les éclaboussures, les brises — ne nous ont pas encore traversée, elles continuent prises dans leur élan de s’éloigner, vers l’ubac et vers l’adret
si l’image de l’éléphant, si les sonorités du piano nous ont éloignée transversalement de notre route bordée de murs longs et étroits, au moins aurons-nous écrit, au moins cette durée vaine de vie aura été comblée par cette écriture qui n’a pas plus de sens que les tracés des vers de bois sous l’écorce desquamée, qui nous semblaient une écriture des temps reculés, quand les humains n’étaient pas encore des humains, et qu’ensuite nous n’avons fait que penser à cette écriture des vers sur le bois, nous nous sommes résignée à l’écouter, à la retranscrire, à refuser son silence et son insignifiance, à espérer qu’elle retienne notre mémoire
[...]
Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, dans la revue de belles-lettres, 2022, I, p.77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, lignes, écriture, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2022
Camille Loivier, Swifts
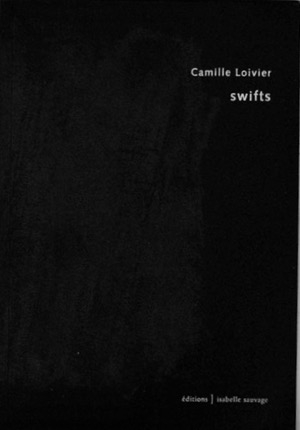
Le titre de chacune des trois parties du livre implique que les échanges avec les animaux ne passent pas par la langue humaine : "La langue de la chienne", "La langue des swifts", "La langue du sanglier" ; c’est de la possibilité même de "parler à" dont il est question et ce n’est pas hasard si le mot le plus employé dans le livre est « silence ». L’absence d’échange est suggérée dans le poème précédant les trois ensembles : une allitération, « vol dans le vent vite » (poursuivie avec « vent, ventre »), annonce en effet les swifts, les martinets*, et l’évocation de ces oiseaux suggère l’absence, le plus souvent, d’une relation possible avec l’animal : les martinets sont incapables de vivre au sol (« ils ne sauraient se relever »), uniquement occupés à se nourrir et à jouer entre eux.
"La langue de la chienne" met en place les éléments d’un récit, dans un décor plutôt misérabiliste ; un « cygne sale nage sur l’eau sale » d’un canal encombré de plastique, près d’un pont des tentes et un brasero..., un homme et sa chienne marchent, image de la « tristesse », un swift passe dans le ciel et la narratrice, sous la forme du "je", regarde la scène. Le lieu, qu’on imagine urbain, disparaît ensuite ; la mer est évoquée, seulement liée aux souvenirs, et les personnages évoluent toujours dans une campagne caractérisée par la maison, la terre, les blés, l’herbe, les bois, les champignons, les animaux, le vent. Le livre débute en mai et l’écoulement du temps est marqué par le changement de saison (« les blés sont coupés ») et par une indication plus précise (« juillet », « automne »). Dans cet univers qui semble sans conflit existe un paradoxe par rapport à un point de vue dominant, « c’est le silence qui nous rassemble tandis que la parole nous coupe ».
En effet, la séparation entre l’homme et l’animal est totale, faute d’une langue commune (de là les titres des trois ensembles). Comment échanger ? La chienne accompagne l’homme — le père de la narratrice — et « suit son regard », sa salive soigne les écorchures ; dans une scène nocturne, cette narratrice imagine que le sanglier aveuglé par des phares, immobile, « rêve », et elle « baisse la vitre pour lui parler à l’oreille / il [l’]écoute sans bouger » ; fiction, le fossé restant infranchissable. Les liens entre l’homme et l’animal s’opèrent par le toucher, le regard, les sons ; alors les mots sont « inutiles dérisoires / qui disent moins que les battements de cils », et si l’on accepte de l’animal « l’incapacité de parler avec la bouche » on sait aussi que « les yeux parfois en disent plus long ». La narratrice fait plus qu’écouter les martinets (« souffle siffle son aigu »), elle voudrait « parler la langue des swifts », langue de la liberté de ceux qui volent. L’écriture ne fait qu’accroître le silence entre l’homme et l’animal, non seulement parce que la chienne, par exemple, ignore que « quelque chose est écrit », mais le papier « absorbe en vrac » les mots. Que reste-t-il, sinon l’illusion de pouvoir fonder une autre langue ? Et par quel moyen ? « Je l’approche dans le vent ». Cette recherche à partir de ce que, par nature, on ne peut saisir, apparaît également dans la tentative de sortir du silence avec l’homme à la chienne, le père.
enfoncés dans le silence
nous marchons côte à côte
à chercher des mots dans le vent
La séparation est analogue à celle d’avec tout animal, cependant d’une autre nature puisque rien n’empêche les paroles de circuler. La narratrice « ne veut pas le silence mais le fuir », sans que ce qui éloigne, dont le lecteur ne saura rien, soit surmonté ; le silence entre eux, sans doute ancien, ne pourrait être rompu que par le père : « j’ai attendu que tu parles ce jour-là » — souvenir d’une rencontre où il est resté mutique, et il a refusé tout échange réel jusqu’à sa disparition ; parfois « on ne parle pas la même langue / dans la même langue ». Il faudrait retrouver « quelque chose comme une intonation de langue oubliée », croire qu’il existe une « langue des temps anciens », « enfouie », qui pourrait renaître, et la narratrice revient au mythe, rassurant, d’une langue antérieure aux mots, langue adamique « accrochée à l’odeur / au bruit au vent », susceptible d’être comprise pour tout être vivant.
Peut-on échapper à « l’emprise du silence » qui a dans le livre pour corollaire la solitude et la peur ; dans la maison, seuls les bruits extérieurs prouvent l’existence d’autrui. À la nature où vivent faon, sanglier, martinet, etc., sont opposés le vide, la mort avec les images de la tombe, des ossements comme si, le plus souvent, il n’y avait « plus moyen de fuir », puisque l’« on parle une langue sans savoir avec qui ». Le dernier vers, « le ciel est vide », précède l’image de la « voile noire », signe de la mort de celui qu’Yseut attend en vain.
_______________________________________________________
* « swift », mot onomatopéique qui désigne le martinet en anglais.
Camille Loivier, Swifts, éditions isabelle sauvage, octobre 2021, 76 p.,16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 février 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, swifts, martinet, langue, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2021
Camille Loivier, éparpillements

je suis dans la maison des rêves tant
de gens rêvent d’une maison de s’y maintenir
ils passent des années à la réparer à
l’aménager parfois toute une vie si bien
qu’à la fin chaque pièce est pleine à craquer
et le jardin laisse à peine plus de liberté
alors à ce moment-là on s’arrête
(la maison explose)
la main exposée
l’araignée à longues pattes qui grimpe sur le mur
en plein milieu n’est pas craintive elle est
chez elle sans nul doute fine et jeune
la maison file au bout de ses pattes
il n’y a personne à l’intérieur
Camille Loivier, éparpillements, isabelle sauvage,
2017, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, éparpillements, maison, araignée | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2021
Camille Loivier, Swifts

III. La langue du sanglier
Les animaux sont entrés dans ma vie
ils me poursuivent de leurs yeux agrandis
par l’incapacité de parler avec la bouche
tandis que leur langue multiple passe
par tout le corps dans un courant ininterrompu
mais les yeux parfois en disent plus long
— tu ouvres la bouche mais aucun son ne sort
les swifts crient dans le ciel
alors je viens avec mon père dans le silence
(...)
Camille Loivier, Swifts, éditions isabelle sauvage,
2021, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, swifts, la langue du sanglier, animal, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2021
Camille Loivier, d'abandon

perdue
au sol
il n’y a plus rien
qu’un aplat sur la terre
(si quelqu’un tendait la main)
passe
un souffle de vent à la surface de la peau
folle patience
on attend de ne plus peser
de ne plus penser, car
penser ne signifie rien
simple comme
un corps qui s’épuise
— remuer ferait mal —
(danse en nous figée)
on est de la pierre
on est
Camille Loivier, d’abandon,
Faï fioc, 2020, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, d’abandon, d'abandon, immobilité | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2021
Wang Wen-hsing, Pensées libres à Pluie d’étoiles

Pensées libres à Pluie d’étoiles
Dans la rue, j’ai vu quelqu’un qui me ressemblait. Mais je ne sais pas comment je me suis rendu compte qu’il me ressemblait. Me serais-je déjà vu ? Je me suis vu de fac e. Mais c’est son dos que j’ai vu et reconnu comme semblable au mien. Il se penchait pour ouvrir la portière de sa voiture. Le plus étrange est que je ne fus pas du tout surpris, exactement comme André Gide l’a écrit : s’il ouvrait la porte de sa chambre et que derrière se trouvait la mer, il ne serait pas du tout étonné.
Tout plaisir prend naissance dans la curiosité.
Les hommes sont des tigres ou des loups. Ils ne peuvent se débarrasser de leur nature de loup. Méchanceté de la nature humaine.
Wang Wen-hsing, Pensées libres à Pluie d’étoiles et autres aphorismes, traduction Camille Loivier (chinois de Taïwan), dans la revue de belles-lettres, 2021-I, p. 9, 11, 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wang wen-hsing, pensées libres à pluie d’étoiles et autres aphorismes, camille loivier | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2021
Camille Loivier, Cardamine

(fleur)
quand je cueille une fleur dans le jardin
je le fais toujours en lui parlant
je n’entre pas dans les détails mais explique
aucune fleur ne consent à être coupée
même le gel qui viendra la brûler en une nuit
ne la fait quitter le jardin sans regret
je peux mesurer la portée de mon geste
à sa faiblesse
une fleur que l’on invite à l’intérieur
on la brise
on lui dit tu n’es plus une fleur
Camille Loivier, Cardamine, Tarabuste, 2021, p. 34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, cardamine, fleur, jardin | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2019
Camille Loivier, Une voix qui mue : recension
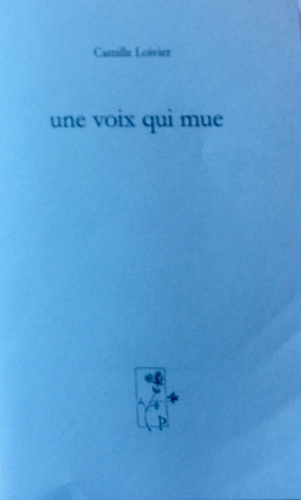
Une voix qui mue est le premier d’une nouvelle série de plaquettes et de livres des éditions Potentille : une couverture différente avec un rabat dans lequel les pages sont insérées et avec une nouvelle vignette. Camille Loivier a déjà publié aux mêmes éditions Joubarbe (2015) ; elle enseigne la littérature de langue chinoise et la traduit — récemment un livre de Hong-Ya Yan, écrivain et réalisateur taïwanais (Le passe muraille, 2018). Son long poème est consacré à la difficulté d’être dans une langue, c’est-à-dire de construire sa relation au monde — peut-être à être soi avec les autres.
Le poème s’ouvre comme un aparté, avec des vers entre parenthèses qui portent sur le désir d’un lieu, de sa nécessité pour vivre ; le rejoindre, c’est retrouver « derrière (…) la rupture / ce qui lie ». Qu’est-ce que le lieu peut apporter ? ce qui est essentiel pour l’identité de la narratrice, la « trace de soi », au point que l’on puisse y vivre sans craindre sa nudité. Ce lieu est nommé plus loin, il s’agit de Taipei, capitale de Taïwan, et il est désigné par « bercail », où, explicitement (sens de "bercail"), elle dit être « comme dans [s]a ville natale » — « c’est donc [s]a ville natale » —, et, fortement, « née une seconde fois », et « j’y suis née ». Vivre à Taipei, c’est connaître la plénitude, toutes fissures de la vie éloignées, et cette certitude d’un accomplissement est restitué dans quelques vers où la seconde naissance dans la ville s’apparente à la fois à la présence du corps dans le ventre maternel et à sa sortie dans le monde. L’ensemble de vers débute par « naître ; » et est immédiatement suivi par « retourner à la chaleur moite et poisseuse » et, plus avant, « on est à l’intérieur d’une serre chaude », puis
soudain on est libre, amphibie
on respire dans l’eau, on est là
dans le monde partie rattachée
au reste
on n’est plus séparée
Cet attachement à la ville chinoise ne peut être dissocié de la langue de Taipei, de Taïwan. Camille Loivier précise que la langue maternelle, celle de Nankin, qui « remonte » et diffère de la langue commune, a été perçue comme une sorte de « patois » et que le changement de langue, à Taipei, a été senti comme une mue de la voix. La langue chinoise, lors de son apprentissage, a été éprouvée comme « une langue / qui ne se parle pas », donc qui ne nécessitait pas d’interlocuteur. Langue pour soi, qu’il n’est pas indispensable de parler, sinon « à soi-même à voix basse ». S’il y a « silence des mots » pour qui la pratique, la langue, alors, conduit à une « complète solitude », ce qui ne semblait pas gêner la narratrice. Le bouleversement semble être survenu quand la langue chinoise a été parlée autrement, ce qui a permis la mue, la transformation ; alors, la langue peut être parlée, et non plus dans la solitude, et est « entendue (…) / telle qu’elle devait me délivrer » : il n’y a plus simplement des signes écrits mais la possibilité d’un tu, d’échanges. Le sentiment d’avoir découvert sa voix (et, évidemment, une voie) est tel que, chaque année, revenir à Taïwan, est à la fois « naître et mourir », perte d’une langue et (re)naissance d’une autre. Sans qu’il y ait croisement de l’une et l’autre, d’où peut-être toujours un manque.
Une voix qui mue, seul texte de Camille Loivier, sauf erreur, qui présente des éléments biographiques, évoque l’enfance où l’« on vit au ralenti » et où se décide pour longtemps une relation à la langue, aux langues, relation au fondement ensuite de ce qu’est le je-tu : rupture du silence, apprentissage du monde. Dans La rivière aux amoures, Camille Loivier écrit, « A-t-on vraiment envie de devenir adulte ? », elle répond sans ambiguïté dans Une voix qui mue, oui, en sachant qu’il faut parfois accepter de perdre ce qu’on pensait être indispensable pour mieux, beaucoup mieux, le retrouver. `
Camille Loivier, Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019, 32 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 août 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, taïwan taipei, enfance, langue maternelle | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2019
Camille Loivier, une voix qui mue

je suis retournée sur les lieux
où j’ai retrouvé l’enfance
le temps avait arrêté de s’écouler
nous venions du passé
nous venions du temps long et de
l’univers clos, nous venions
de l’époque où nos mères sont jeunes et
nous sourient, où nos pères nous
portent sur leurs épaules, il est si
enivrant de voir le monde d’en haut
plus haut, encore plus haut
on vit au ralenti, extrêmement
précautionneux de nos pas
et de nos
gestes
c’est cela qui m’arrive
je retourne à Taipei
comme dans ma ville natale
c’est donc ma ville natale car
je n’en ai pas d’autre
Camille Loivier, une voix qui mue, Potentille,
2019, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, enfance, passé, ville natale | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2017
Camille Olivier, éparpillements

Cahier 2
chacun va d’une maison à l’autre
de ses parents à soi-même parents
le fil électrique bouge
il y a du vent
se soulèvent les hirondelles
une maison est retranchement
endroit de repos sans oscillation
plus de relations coupées
(enfin on a remis mon carillon à onze heures
du matin vous vous rendez compte quelle honte)
et quand je sors retrouvant le mouvement
entre deux points
les animaux viennent à ma rencontre
pas seulement les veaux bruns aux yeux ronds
mais le faon, mais le pinson
viennent à ma rencontre
pour que je revienne sauvage aussitôt
on m’a mise dans la maison des rêves
mais ce n’était pas le bon moment
et je souffrais comme une bête
une bête folle se cogne contre la vitre
va vers la lumière
on pourrait tout imaginer et
on ne pourrait rien faire
pas même laver un carreau
pas même nettoyer une porte
tu délimitais les parterres faisant le tour
et le centre était envahi d’herbes hautes
Camille Loivier, éparpillements, isabelle sauvage,
2017, p. 61-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, éparpillements, cahier, maison, bêtes, sauvage, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2017
Camille Loivier, éparpillements

Cahier 1
[…]
je suis le minotaure à qui on sacrifie l’enfance
au coin il y a un corps que je vais piétiner
avec le lierre en boule et la glycine
la maison disparaît et s’alourdit
des sortes d’ailes poussent pour s’éloigner de soi
s’enfonce dans ce qui se déforme
des parties s’imbriquent dans les autres
des morceaux s’enjambent puis se fondent
une cicatrice apparaît
au coin se perd
une encoche rappelle
— une prairie et trois buses en cercle dans le ciel planent —
Camille Loivier, éparpillements, isabelle sauvage, 2017, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, éparpillements, minotaure, enfance, maison, prairie | ![]() Facebook |
Facebook |





