26/11/2021
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous

sursis d’été à
l’heure d’hiver roux
trois rouges-gorges
jouent à la guéguerre
avant l’aurore
écrire toute une vie
sans autre connaissance
que — la perte —
des chants et des fleurs)
*
Puis la mousse se gorge quand le tilleul lâ
che tout
Toute la forêt détone entre les sabots
des bêtes
Une langue se tend du plexus à leurs yeux
mi-clos
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous,
éditions Héros-Limite, 2021, p. 27-28.
©Photo Ianna Andréadis
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, été, hiver, rouge-gorge, bête | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2021
Shakespeare, Sonnets

5
Ces heures, dont l’œuvre raffinée a créé
Ce regard merveilleux où tous les yeux s’attachent,
Seront plus tyranniques envers leur propre ouvrage,
Détruisant tout ce qui excellait en beauté.
Car, jamais en repos, le temps mène l’été
Jusqu’au hideux hiver et l’anéantit,
Sève toute glacée, feuilles vertes en allées,
Beauté vêtue de neige et partout nudité,
Alors s’il ne restait de l’été un parfum,
Liquide emprisonné entre des murs de verre,
La beauté et sa puissance d’engendrer mourraient
Sans même laisser un souvenir de ce qu’elles furent.
Mais les fleurs distillées, confrontées à l’hiver,
Perdent leur apparence, leur essence survit.
Shakespeare, Sonnets et autres poèmes, traduction Jean-Michel Déprats, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 257.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, jean-michel déprats, beauté, hiver, été | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2021
Gabrielle Althen, La fête invisible

Dans le jardin qui enlaidit
La chose déjà fanée se pose et se repose
Chaleur avec amour
En qui jamais nous n’avons cru assez
Te dévisagent
L’été a dévasté les couleurs
La moelle en est blessée
Aller suffit
Office de vie
Boire avive la flèche de la soif !
Gabrielle Althen, La fête invisible,
Gallimard, 2021, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabrielle althen, la fête invisible, jardin, été | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2018
Geoffrey Squires, Silhouettes

Eau grise
une petite butte d’arbres
à quoi penses-tu on
ne peut pas demander ça
c’est si bien d’être à l’écart de tout le monde
le doux champ de son ventre
fragile chaleur d’été
juste naturel
Grey water
a little spit of trees
what are you thinking
not allowed to sak that
how nice to be away from anywhere
the soft fiel of her belly
frail summer heat
only natural
Geofrey Squires, Silhouettes, traduction
François Heusbourg,Unes, 2018, p. 21 et 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geofrey squires, silhouettes, françois heusbourg, écart, ventre, été | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2017
Anne Perrier (1922-2017), Poèmes 1960-1986
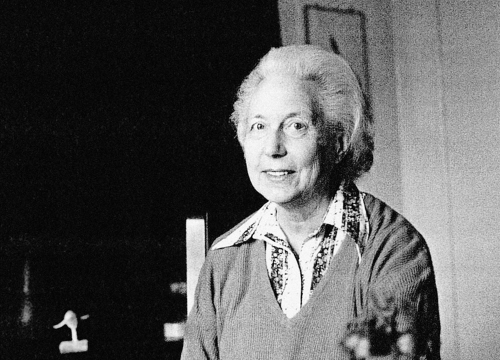
Qui tombe des pommiers
O papillons de l’enfance
Ne touchez pas à l’ombre des pétales
Leur seule transparence
Me sépare de l’ineffable
Clarté
Ne me conduisez pas
Vers les fleuves d’été
Que faire de tout l’éclat
De juillet
Quand c’est la douce la
Douce éternité
Qui traverse le jour
Quand c’est l’amour
Pommiers pommiers et roses
O simples cerisiers
Quand c’est l’amour qui pose
À la ronde son pied
Anne Perrier, Poésie 1960-1986, préface
de Philippe Jaccottet, L’Âge d’Homme,
1988, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne perrier, poèmes 1960-1986, philippe jaccottet, pommiers, été, éternité | ![]() Facebook |
Facebook |
03/02/2017
Laurent Fourcaut, Arrière saison

Pas d’histoire
À toute force il faut narrer sinon on crève
le sens est à ce prix quel ennui ! le mouvant
cours des êtres des choses pris dans ce carcan
dépérit. On raconte tant de trucs sur Ève
comment la jouerez-vous ailleurs qu’en la vie brève ?
Sanglante fin d’été de ce sang qu’écrivant
on tire sans arrêt du petit pélican,
il hante le regard lutte contre le rêve.
Ne me parlez pas d’histoire je n’en veux point
je veux l’effondrement dans la meule de foin
l’abrupte samba des corps danse imperceptible
à qui danse le goût qu’on prend au doux comptoir
où le temps se la coule sans faire d’histoir
e où l’on existerait enfin hors de la Bible.
Laurent Fourcaut, Arrière saison, Le Miel de l’Ours, 2016, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, arrière saison, histoire, narration, vie brève, été, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2016
Jules Supervielle, Oublieuse mémoire

Oublieuse mémoire
Pâle soleil d’oubli, lune de la mémoire,
Que draines-tu au fond de tes sourdes contrées ?
Est-ce donc là ce peu que tu donnes à boire
Ces gouttes d’eau, le vin que je te confiai ?
Que vas-tu faire encor de ce beau jour d’été
Toi qui me changes tout quand tu ne l’as pas gâté ?
Soit, ne me les rends tels que je te les donne
Cet air si précieux, ni ces chères personnes.
Que modèlent mes jours ta lumière et tes mains,
Refais par-dessus moi les voies du lendemain,
Et mène-moi le cœur dans les champs de vertige
Où l’herbe n’est plus l’herbe et doute sur sa tige.
Mais de quoi me plaignais-je, ô légère mémoire,
Qui avait soif, Quelqu’un ne voulait-il pas boire ?
Jules Supervielle, Oublieuse mémoire, dans Œuvres poétiques
complètes, édition Michel Collot, Pléiade/Gallimard,
1996, p. 485.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, oublieuse mémoire, herbe, été, oubli, boire | ![]() Facebook |
Facebook |
01/09/2016
Paul de Roux, Poèmes des saisons
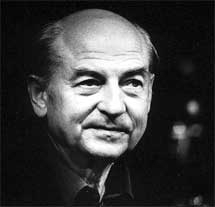
En hommage à Paul de Roux, décédé dans la nuit du 27 au 28 août
D’où viens-tu, Été qui n’est plus là quand même
ce serait ta saison, et qui soudain nous effleures et nous gagnes ?
toi qui te vêts des plus lourds, des plus fastueux atours,
des feuilles les plus larges et des denses poussières, Été
à la trop courte nuit, renversant villes et campagnes
sous des ciels où s’effrite longuement la lumière, nuit
inventant des labyrinthes pour ses amants,
levant des futaies pour de blanches larmes de lune, et toi
oublié ou absent, soudain
faisant mentir le poids des jours, l’effluve
du tilleul chevauchant une imperceptible brise
serait ta résidence parmi nous ?
Paul de Roux, Poèmes des saisons, dessins de Gabrielle
de Roux, le temps qu’il fait, 1989, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, poèmes des saisons, été, nuit, labyrinthe, amant | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2015
Jean Tardieu, Margeries
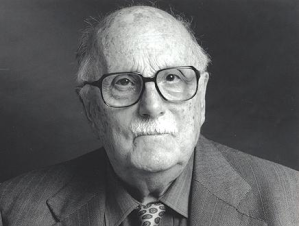
Un oiseau loin de moi
Un oiseau loin de moi
Une fleur sous la neige
Une maison qui brûle
Un noir mourant de soif
Un blanc mourant de faim
Un enfant qui appelle
Le vent dans le désert
La ville abandonnée
L’étoile solitaire
En voilà bien assez
Pour que je vous ignore
Beaux jours de mon été.
Jean Tardieu, Margeries,
Gallimard, 1986, p. 167.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, poème, oiseau, été, solitude, fleur | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2015
Jean-Luc Sarré, Les journées immobiles

c’est ailleurs on dirait
loin du ciel
loin du bleu tumulte qui interdit
il y a de la terre dans les masses bruissantes
dans les cernes
les volumes
dans les ombres devenues fragiles
il y a du mauve dans ces ombres
c’est l’été
dans une autre lumière
l’odeur est celle des pierres avant la pluie
*
on ne sait rien de l’été
rien de ces quelques mots qu’il dénoue
trop lourds souvent
pareils à ces branches basses
vautrées dans la poussière
au milieu de l’allée
ou à ces fleurs encore
écloses parmi les pierres
isolées rouges
fragiles au cœur du ruissellement
Jean-Luc Sarré, Les journées immobiles, 1990 ;
Flammarion, p. 72 et 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, les journées immobiles, été, mots, fleur, pierre, ciel, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2015
Édouard Levé (1965-2007), Suicide

Un samedi au mois d’août tu sors de chez toi en tenue de tennis accompagné de ta femme. Au milieu du jardin tu lui fais remarque que tu as oublié ta raquette à la maison. Tu retournes la chercher, mais au lieu de te diriger vers le placard de l’entrée où tu la ranges d’habitude, tu descends à la cave. Ta femme ne s’en aperçoit pas, elle est restée dehors, il fait beau, elle profite du soleil. Quelques instants plus tard, elle entend la décharge d’une arme à feu. Elle accourt à l’intérieur de la maison, elle crie ton nom, remarque que la porte de l’escalier qui conduit vers la cave est ouverte, y descend et t’y trouve. Tu t’es tiré une balle dans la tête avec le fusil que tu avais soigneusement préparé. Tu as laissé sur la table une bande dessinée ouverte sur une double page. Dans l’émotion, ta femme s’appuie sur la table, le livre bascule en se refermant sur lui-même avant qu’elle ne comprenne que c’était ton dernier message.
Je ne suis jamais allé dans cette maison. J’en connais pourtant le jardin, le rez-de-chaussée et la cave. J’ai revu la scène des centaines de fois, toujours dans les mêmes décors, ceux que j’ai imaginés la première fois que l’on me fit le récit de ton suicide. Cette maison était dans une rue, elle avait un toit et ne façade arrière. Mais rien de tout cela n’existe. Il y a le jardin où tu sors une dernière fois dans le soleil et où ta femme t’attend. Il ya la façade vers laquelle elle court lorsqu’elle entend la décharge. Il y a l’entrée, où la raquette se trouve, la porte de la cave et l’escalier. Enfin il y a la cave où gît ton corps. Il est intact. Ton crâne n’a pas explosé comme on me l’a dit. Tu es comme un jeune joueur de tennis qui se repose après un match sur le gazon. Tu en sais maintenant plus que moi sur la mort.
Édouard Levé, Suicide, Folio Gallimard, 2015 [P.O.L, 2008], p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édouard levé, suicide, été, tennis, fusil, femme, cave, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
03/11/2015
Claude Chambard, Le chemin vers la cabane & Tout dort en paix, sauf l'amour

le matin les tourterelles
la pluie goutte dans la cheminée
il faudrait ne pas quitter la chaleur
du lit
cet été-là
le lit n’a jamais été défait
aucun oiseau n’a chanté
un jour j’ai marché
le long d’une voie ferrée
aucun train n’est passé
rien ne voulait de mes guenilles
(ritournelle)
Claude Chambard, Le chemin vers la cabane,
Le bleu du ciel, 2008, p. 21.
Maintenant, l’argile absorbe la mer et le pays, les nuages s’amoncellent au bord du ciel. La paix insonore isole la forêt de l’autre côté des barrières fermées à clef & la mer en vagues claires se repose. Le jour prochain est un luxe. Maintenant, est le plus petit feuillage, la plus petite cabane de la forêt. Maintenant, est un son, le plus calme, un son qui repose, qui a le pouvoir de lier les rêves, qui entraîne au retour, vers l’enfant dans la montée blanche.
Claude Chambard, Tout dort en paix, sauf l’amour, Le bleu du ciel, 2013, p. 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, le chemin vers la cabane ; tout dort en paix, sauf l’amour ; oiseau, été, mer, son | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2014
Jean-Luc Sarré, La part des anges

On n'a pas le cœur à défaire
pour les vider de nos vacances
les valises qui encombrent l'entrée.
Les fantômes sentent la naphtaline
et le plaisir n'est plus le même
de convier le jour à noyer
un salon qui nous paraissait
vaste il y a seulement deux mois.
On ôte un suaire, on se vautre,
ni heureux ni triste, égaré
parmi les images de l'été
— elles et la nuit et la musique.
Mêler sa voix à celle des autres
en laiqqanr croire qu'on sait lire
ces indéchiffrables portées
ne fait pas longtemps illusion.
« Cheval sanglé jusqu'aux faugères
tu seras mon solfège » dit l'enfant
en pressant les flancs d'un dimanche
qui rentre rênes longues, encolure basse.
Jean-Luc Sarré, La part des anges, La Dogana,
2007, p. 91, 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, la part des anges, vacances, fantôme, été, cheval, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2014
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers

Une semaine avec James Sacré
Animaux
I
Animaux velus sales et grossièrement familiers je vous vois : je lèche un sexe rouge et me réfugie dans vos fourrures et près de vos dents.)
Langage
Nul animal n'y est sauf
Grand cheval rouge ou licorne grande
Misère le mien (lequel ?) m'arrache
Des larmes il traîne à l'envers la charrue
Je rage quoi disparaît
Dans le temps parti je langage
Je vais rêver l'été sera clair il faudra un texte qui prenne régulier le format de la page voilà au centre de l'enfance (l'été s'y abreuve) un cerisier grandit la lumière est l'évidence du bleu je vois par dessus des buissons un bord de tuiles une maison je regarde je désire un poème qui serait du silence le même bleu (j'y bois la transparence de nulle écriture) au centre un cerisier n'y rêve pas que je meurs.
[...]
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 27-28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, été, poème, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2013
Constantin Cavafy, Jours de 1908

Jours de 1908
Il s'est retrouvé cette année-là sans travail ;
il vivait donc des cartes,
du trictrac et des prêts.
Une place, à trois livres par mois, dans une petite
papeterie lui avait été proposée.
Mais il la refusa sans hésiter.
Ça n'allait pas. Ce n'était pas un salaire pour lui,
jeune homme assez instruit, âgé de vingt-cinq ans.
À peine s'il gagnait par jour deux shillings, ou trois.
Que tirer de plus, pauvre garçon, des cartes et du trictrac
dans les cafés populaires de son rang,
même s'il jouait habilement, même s'il choisissait pour partenaires
des sots.
Quant aux prêts, n'en parlons pas.
Il obtenait rarement un thaler, c'était un demi-thaler le plus souvent,
il devait même parfois se contenter du shilling.
Pour une semaine quelquefois, ou davantage,
délivré des effrayantes veillées,
il allait se rafraîchir aux bains, nager le matin.
Ses vêtements étaient dans un état minable.
Il portait un costume, toujours e même, un costume
couleur cannelle, très fané.
Ah, jours de l'été mille neuf cent huit,
votre vision idéale, esthétisée,
fait abstraction du costume couleur cannelle, très fané.
Votre vision l'a gardé
tel qu'au moment de s'en défaire, d'enlever
les vêtements indignes, les sous-vêtements reprisés.
Tout nu ; parfaitement beau ; une merveille.
Les cheveux négligés, un peu ébouriffés ;
les membres légèrement hâlés
d'aoir été nus sur la plage, aux bains.
Constantin Cavafy, traduit du grec par Maria Tsoutsoura, dans
Europe, "Constantin Cavafy", n° 1010-1011, juin-juillet
2013, p. 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, jours de 1908, pauvreté, jeu, été | ![]() Facebook |
Facebook |





