05/09/2016
Henri Thomas, Poésies
Un oiseau
Un oiseau, l’œil du poète
s’en empare promptement,
puis le lâche dans sa tête,
ivre, libre, éblouissant.
Qu’il chante, qu’il ponde, qu’il
picore, mélancolique,
d’invisibles r ains d emil
dans les prés de la musique,
quand il regagne sa haie,
jamais cet oiseau n’oublie
les heures qu’il a passées
voltigeant dans la féérie
où les rochers nourrissaient
leurs enfants de diamant,
où chaque nuage ornait
d’une fleur le ciel dormant.
On trouvera l’oiseau mort
avant les froids de l’automne,
le plaisir était trop fort,
c’est la mort qui le couronne.
Henri Thomas, Poésies, Poésie /
Gallimard, 1970, p. 76-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, un oiseau, poète, mémoire, imaginaire, plaise, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
03/09/2016
André Frénaud, Les Rois mages

Sans amour
Il va sous les végétations de la lumière,
le cœur sans amour.
Le monde se creuse comme la mer.
Le sourire éclatant du désespoir
tiendra-t-il jusqu’à la mort prochaine ?
André Frénaud, Les Rois mages,
Poésie/Gallimard, 1987, p. 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, les rois mages, sans amour, mort, lumière, désespoir | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2016
Claude Dourguin, Points de feu

Pourquoi la littérature, l’art en général, dites-vous ? Hé bien comme libération, la seule, de la servitude, de la finitude.
Couleurs, textures, senteurs, odeurs, bruits, sons, matières, substances : tout cela nous requiert et nous attache, besoin éprouvé et satisfaction profonde.
La mort physique à quoi l’on assiste fait éprouver avec une évidence violente qu’elle est bien la seule réalité, le seul événement qui valide le « toujours » et le « jamais plus ».
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 64, 81, 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, vivre, art, libération, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2016
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Aborder la terra incognita.
Celle de voir l’écriture nous quitter — qui est celle de la destruction du désir en relation avec un corps qui cesse lui aussi d’avoir envie, comment cette souffrance peut-elle traverser une forme pour dire son effondrement ?
Défi qui serait spécifiquement un combat de poésie : inventer l’expression de la disparition du désir de dire. Situation à la fois simple et extrême, dont la limite est peut-être la banalité même de cette cessation comparable à l’inconnu de la mort.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, terra incognito, désir, écriture, corps, disparition, poésie, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
03/02/2016
Henri Thomas, Poésies : Un oiseau

Un oiseau
Un oiseau, l’œil du poète,
s’en empare promptement,
puis le lâche dans sa tête,
ivre, libre, éblouissant.
Qu’il chante, qu’il ponde, qu’il
picore, mélancolique,
d’invisibles grains de mil
dans les prés de la musique,
quand il regagne sa haie,
jamais cet oiseau n’oublie
les heures qu’il a passées
voltigeant dans la féérie
où les rochers nourrissaient
leurs enfants de diamant,
où chaque nuage ornait
d’une fleur le ciel dormant.
On trouvera l’oiseau mort
avant les froids de l’automne,
le plaisir était trop fort,
c’est la mort qui le couronne.
Henri Thomas, Poésies, Poésie /
Gallimard, 1970, p. 76-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, poésies, un oiseau, poète, mélancolie, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2016
Apollinaire, Funérailles
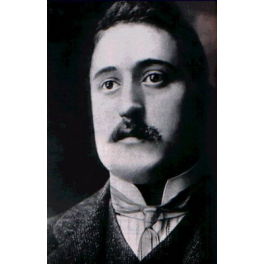
Funérailles
Plantez un romarin
Et dansez sur la tombe
Car la morte est bien morte
C’est tard et la nuit tombe
Dors bien dors bien
C’est tard et la nuit tombe
Dansons dansons en rond
La morte a clos ses yeux
Que les dévots prient Dieu
Dors bien dors bien
Que les dévots prient Dieu
Cherchons des prie-dieu
La mort a fait sa ronde
Pour nous plus tard demain
Dors bien dors bien
Pour nous plus tard demain
Plantons un romarin
Et dansons sur la tombe
La mort n’en dira rien
Dors bien dors bien
La mort n’en dira rien
Priez les dévots mornes
Nous dansons sur les tombes
La mort n’en saura rien
Dors bien dors bien
Guillaume Apollinaire, Pèmes divers, dans
Œuvres poétiques, Pléiade / Gallimard,
1965, p. 575.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, funérailles, danse, mort, prière, romarin | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2016
Pascal Quignard, Princesse Vieille Reine

[...] Le vendredi 17 septembre 1808, le père de George Sand se rendit de Nohant à La Châtre afin de faire un quatuor chez les Duverret.
Il y dîna, tint parfaitement sa partie de violon, les quitta à onze heures.
Le cheval, qui avait pris le galop en quittant le pont, heurta dans l’obscurité un déblai de pierres, manqua rouler, se releva avec une telle violence qu’il projeta son cavalier derrière lui, à dix pieds de là.
Les vertèbres du cou furent brisées. Le père de George Sand avait trente et un ans. On le plaça sur une table d’auberge. On transporta le mort sur sa table, avec une lanterne sourde tenue devant lui, afin de voir dans l’obscurité, jusqu’à Nohant. On réveilla l’enfant de quatre ans, qui était en train de dormir, et on lui dit que son père était mort en revenant de faire du violon.
Orpheline de père, enfant d’une servante méprisée et à demi-folle, petite-fille d’une vieille dame aristocratique et malade (princesse de songe, riche comme Crésus, habillée comme l’as de pique, triste à étouffer, excellent musicienne). Aurore, quand elle fut adolescente, au désespoir d’avoir été arrachée à la paix du couvent où elle était heureuse, tout à coup, « vingt pieds d’eau dans l’Indre » l’attirent.
Pascal Quignard, Princesse Vieille Reine, Galilée, 2015, p. 51-53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort, orpheline, couvent, quignard | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2015
James Sacré, Dans l'œil de l'oubli, suivi de Rougigogne

J’ai bien conscience souvent que j’écris en mêlant les temps verbaux comme si je voulais mettre ensemble dans un temps présent aussi bien le passé que ce qui ressemble à du futur quand on se prend à rêver, à dire les mots « demain », « plus tard » : le désir d’un présent qui serait aussi bien l’infini que l’éternité dans le plus fugitif arrêt du temps qu’on s’imagine pouvoir vivre. Ce présent, qui ne peut exister pour nous qui n’en finissons pas de vieillir, n’est-il pas la pupille de cet œil de l’oubli dans laquelle je n’ai jamais rien vu pour la bonne raison que n’existant sans doute pas je ne peux que penser ce présent comme une tache aveugle de mon existence, un trou noir dans lequel toute celle-ci s’engouffre lentement jusqu’à la mort.
James Sacré, Dans l’œil de l’oubli suivi de Rougigogne, Obsidiane, 2015, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans l’œil de l’oubli, présent, passé, écriture, temps, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2015
Marie Cosnay, Sanza lettere (road movie)

on avait perdu un mot dans les sous-sols, impossible de traverser, le couloir retient toute une généalogie, les uns piétinent les autres dans un espace qui ne s’élargit pas sous la pression des corps, prenant appui sur les genoux et les fesses on cherche l’air en surface cogne au plafond et de corps en corps va jusqu’à ma mort Elle est venue ma mort je ne dis pas ça à cause d’un printemps mais d’un trop plein de printemps, de saisons, après une impression sordide, un changement de genre et de cap Transformons les corps entassés dans le hall en lettres Évaporons-nous en récits disais-je Passons par le trou de la serrure mais personne n’y arrivait
d’autant que le désir de liberté lui-même mourait ; m’agrippant je cherchais dans le hall une idée pour survivre ; il semblait plus que tout autre chose dégueulasse mon élan de survivre ; je m’agrippais à la dégueulasserie c’est-à-dire que malgré la mort qui me fonçait dessus je tenais les rênes
Marie Cosnay, Sanza lettere (road movie), éditions de l’Attente, 2015, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, sanza lettere (road movie), corpd, mort, printemps, liberté, survivre | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2015
Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, II

Nous y [le laboratoire] étions bien parce que nous pouvions nous laver, avoir des robes propres, travailler à l’abri. La culture du kok-saghyz* ne donnerait pas de résultat avant 1948, la guerre serait finie. Nous étions loin du camp, nous n’en sentions plus l’odeur. Nous ne voyions que la fumée qui montait des fours crématoires. Quelquefois le feu était si fort que les flammes jaillissaient des cheminées, immenses, jusqu’au ciel. Le soir, cela faisait à l’horizon un rougeoiement de hauts fourneaux. Nous savions que ce n’étaient pas des hauts fourneaux. C’étaient les cheminées des fours crématoires, c’étaient des gens qu’on brûlait. Il était difficile d’être bien et de ne pas penser jour et nuit à tous ces gens qu’on brûlait jour et nuit — par milliers.
Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, II, éditions de Minuit, 1970, p. 74-75.
* variété de pissenlit dont la racine pouvait servir à fabriquer du caoutchouc.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlotte delbo, une connaissance inutile, ii, camp de concentration, crématoire, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2015
Édouard Levé (1965-2007), Suicide

Un samedi au mois d’août tu sors de chez toi en tenue de tennis accompagné de ta femme. Au milieu du jardin tu lui fais remarque que tu as oublié ta raquette à la maison. Tu retournes la chercher, mais au lieu de te diriger vers le placard de l’entrée où tu la ranges d’habitude, tu descends à la cave. Ta femme ne s’en aperçoit pas, elle est restée dehors, il fait beau, elle profite du soleil. Quelques instants plus tard, elle entend la décharge d’une arme à feu. Elle accourt à l’intérieur de la maison, elle crie ton nom, remarque que la porte de l’escalier qui conduit vers la cave est ouverte, y descend et t’y trouve. Tu t’es tiré une balle dans la tête avec le fusil que tu avais soigneusement préparé. Tu as laissé sur la table une bande dessinée ouverte sur une double page. Dans l’émotion, ta femme s’appuie sur la table, le livre bascule en se refermant sur lui-même avant qu’elle ne comprenne que c’était ton dernier message.
Je ne suis jamais allé dans cette maison. J’en connais pourtant le jardin, le rez-de-chaussée et la cave. J’ai revu la scène des centaines de fois, toujours dans les mêmes décors, ceux que j’ai imaginés la première fois que l’on me fit le récit de ton suicide. Cette maison était dans une rue, elle avait un toit et ne façade arrière. Mais rien de tout cela n’existe. Il y a le jardin où tu sors une dernière fois dans le soleil et où ta femme t’attend. Il ya la façade vers laquelle elle court lorsqu’elle entend la décharge. Il y a l’entrée, où la raquette se trouve, la porte de la cave et l’escalier. Enfin il y a la cave où gît ton corps. Il est intact. Ton crâne n’a pas explosé comme on me l’a dit. Tu es comme un jeune joueur de tennis qui se repose après un match sur le gazon. Tu en sais maintenant plus que moi sur la mort.
Édouard Levé, Suicide, Folio Gallimard, 2015 [P.O.L, 2008], p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édouard levé, suicide, été, tennis, fusil, femme, cave, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2015
Paul de Roux, Au jour le jour 5
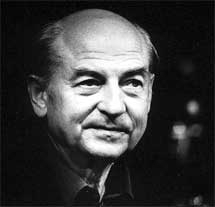
L’approche de la mort peut être vécue dans la confiance — et pas nécessairement dans la peur animale. Des hommes sont morts dans la confiance. Mais cela, c’est l’aboutissement de ce qu’ils ont pensé, senti, vécu antérieurement, dans leur vie de futurs mourants. Nous avons du mal à admettre (et pour cause) que chaque instant de notre vie est décisif. Que c’est maintenant, tout de suite, ici, où que ce soit et dans quelque circonstance que ce soit, qu’il nous appartient de nous éveiller. (Quel autre terme employer ?) Et qu’est-ce que c’est s’éveiller ? « Vie et mort, ce que nous exigeons, c’est la réalité. » (Thoreau, cité par Jaccottet dans Nuages.) La conscience de la réalité est notre éveil, l’aiguiser est notre tâche de chaque instant, car ce n’est que dans l’instant, l’instant même, qu’il nous échoit de percevoir la réalité, ce bois couturé de la table, ce ciel nébuleux, le souvenir des morts, n’importe quoi : la réalité.
Paul de Roux, Au jour le jour 5, carnets 200O-2005, édition établie et présentée par Gilles Ortlieb, Le bruit du temps, 2014, p. 149-150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, au jour le jour 5, carnets, mort, confiance, instant, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
04/09/2015
Pascal Quignard, Petits traités, VI

Photo B. Desprez
Si je parle tout disparaît. C’est la nuit, et c’est la mort qui s’ouvre à partir d’elle. Dans le silence qu’on rompt, la femme aimée disparaît à la vue. Si le livre est visible, je ne le lis pas. Je le vois. Si tu parles, tu ne lis pas davantage. Garde le secret, contiens-le dans le silence, et la mort et l’abandon de la vulve chaude se tiendront loin de toi.
Le langage est pour la famille, ou pour la société, ou pour la cité. Le sexe et la mort — qui sont les deux autres dons que la vie nous accorde — doivent être préservés du contact avec le langage. La passion et la jouissance reposent sur l’exclusivité et le respect du silence.
Pascal Quignard, Petits traités, VI, Maeght, 1980, p. 167 et 169.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, vi, langage, parole, silence, passon, sexe, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2015
Nelly Sachs, Départ au désert

Départ au désert
Quitter soudain
la table du repas
et sans autre arme que son corps
s’en aller là-bas où les hyènes rient
Rendre visite aux pierres
qui se levèrent aussi un jour
pour revêtir la raideur de millions d’années
Tendre l’oreille pour épier
la faible plainte enfantine
au sein des sources cachées
qui veulent jaillir au monde
pour désaltérer les langues d’étoiles assoiffées —
le zodiaque des langues
qui lapent la lune opaline
et perdent tout leur sang
dans le frémissant rubis du soleil
Se lever soudain de table
s’enfoncer dans la racine de minuit
laisser un éclair fulgurant
déchirer notre poussière
Voir devant soi dans les sables du désert
le mirage vert des flammes végétales
la blancheur insoutenable des secrets dévoilés
la prière qui se déverse par les jointures de la mort
et les neiges éternelles de la rédemption —
Nelly Sachs, traduit de l’allemand par
Barbara Agnese, dans Europe, "Henri Heine",
"Nelly Sachs", août septembre 2015, p. 207-208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, dépat au désert, pierre, source, étoile, langue, nuit, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2015
Georges Perros, Papier collés, notes

La terre est belle. Le visage de l’homme parfois proche de l’idée qu’on se fait d’un Dieu à notre image. Et malgré tout ce bonheur qui nous entoure, qui nous fait signe, quelqu’un, un jour, a osé parler du courage de vivre. Quelqu’un, un jour, s’est suicidé. Les plus grandes têtes ont répondu non au questionnaire suprême. Pas un homme, peut-être, depuis toujours, pas un homme prêt à recommencer sa vie. La mort effraie, et presque tous les hommes s’en vont sans cris, sans larmes, sans terreur. Tous les charmes que dispensent l’écoulement des jours, et les jeux proposés ici-bas, rien ne résiste à l’ennui, à la fatigue, à l’usure de notre sensibilité. Le temps d’aménager en hâte notre intérieur, et déjà la cloche sonne. Il faut partir. Tout laisser, tout perdre, cette femme que l’on a aimée, cette nature qui nous a bouleversé. Comment ne pas comprendre les milliers d’à quoi bon qui éclatent et s’évaporent dans l’indifférence de l’espace. À quel degré de chaleur, de souffrance, de déchirement, l’à quoi bon lui-même s’annule-t-il, laissant son homme sans autre ressource que celle de vivre sous ses ruines et ne plus trouver force que dans sa respiration, dans sa présence même ?
Georges Perros, Papiers collés, Le Chemin, Gallimard, 1960, p. 28-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papier collés, notes, vie, visage, mort, sensibilité, perdre | ![]() Facebook |
Facebook |






