11/04/2020
Jean de Sponde, Les Amours

XI
Tous mes propos jadis ne vous faisoient instance
Que de l’ardent amour dont j’estois embrazé :
Mais depuis que vostre œil sur moy s’est appaisé
Je ne vous puis parler rien que de ma constance.
L’Amour mesme de qui j’esprouve l’assistance,
Qui sçait combien l’esprit de l’homme est fort aisé
D’aller aux changements, se tient comme abusé
Voyant qu’en vous aimant j’aime sans repentance.
Il s’en remonstre assez qui bruslent vivement,
Mais la fin de leur feu, qui va se consommant,
N’est qu’un brin de fumée et qu’un morceau de cendre.
Je laisse ces amans croupir en leurs humeurs
Et me tient pour content, s’il vous plaist de comprendre
Que mon feu ne sçaurait mourir si je meurs.
Jean de Sponde, Les Amours, dans Œuvres littéraires,
Droz, 1978, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, les amours, constance, feu, ardeur | ![]() Facebook |
Facebook |
08/04/2020
Bashô, Le Faucon impatient

Un éclair soudain
dans les ténèbres s’en va
le cri du héron
Champignons des pins
des feuilles d’arbres inconnus
sont restées collées
Automne s’en va
quand elle a ouvert le main
bogue de châtaigne
Dans sa robe de plumes
emmitouflées bien au chaud
pattes du canard
Ah le feu de braise
du visiteur sur le mur
l’ombre se profile
Bashô, Le Faucon impatient, traduction
René Sieffert, POF, 1994, p. 203, 207,
215, 241, 245.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, le faucon impatient, héron, automne, feu | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2017
Jacques Izoard, La Patrie empaillée
Déjà nous attendons juin,
et que les rixes craquent,
ensoleillées comme
tant d’autres appareils du corps :
les yeux dans leurs loges,
gloutons et sereins,
les dents d’aix, les sûres
traces de doigts sur la jambe,
entre les cuisses bleues-belles,
longues du feu tapi.
Jacques Izoard, La Patrie empaillée,
Grasset, 1973, p. 72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques izoard, la patrie empaillée, attente, corps, yeux, feu | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2017
Louise Labé, Sonnet III

Sonnet IIII
Depuis qu’amour cruel empoisonna
Premierement de son feu ma poitrine,
Tousjours brulay de sa fureur divine,
Qui un seul iour mon cœur n’abandonna.
Quelque travail, dont assez me donna,
Quelque menasse & procheine ruïne :
Quelque penser de mort qui tout termine,
De rien mon cœur ardent ne s’estonna.
Tant plus qu’amour nous vient fort assaillir,
Plus il nous fait nos forces recueillir,
Et toujours frais en ses combats fait estre :
Mais ce n’est pas qu’en rien nous favorise,
Cil qui les Dieus & les hommes mesprise :
Mais pour plus fort contre les fors paroitre.
Louis Labé, Sonnets, dans Œuvres, Slatkine,
1981, p. 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, poison, feu, cœur, combat | ![]() Facebook |
Facebook |
23/03/2017
Ivan Alechine, Enterrement du Mexique
Proche du porc
L’aube soulève le toit de chaume
sans eau sans nourriture
je veux forcer l’enclos
c’est en octobre la fête des premiers fruits et des enfants de moins de cinq ans
je dors d’un œil
l’autre se lève
à travers un trou dans la toile
je vois les feux de la cérémonie à fleur de terre
leurs flammes sont les cris joyeux
des enfants dits akiélis — esprits —
elles montent aux ciel — bataillons de flammes —
combattre les 400 Mimixcoas — les étoiles de l’infini du Nord qui voudraient en finir avec notre vie
il y a un sang de l’aube
comme il y a un sang du soir
le soleil file le coton des nuages
sang de naissance
sang de mort
c’est la lumière saisie par l’eau
que l’on capture dans les coupes votives
demain on sacrifiera trois taureaux
avec leur premier sang on peindra du doigt
le maïs et les fleurs
les flacons d’eau de sources et les flèches votives
hommes esclaves des fleurs
hommes sous le poids des fleurs
Ivan Alechine, Enterrement du Mexique, Galilée, 2016, p. 82-83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivan alechine, enterrement du mexique, porc, taureau, fête, feu, sang | ![]() Facebook |
Facebook |
16/01/2017
Andrea Zanzotto, Vocatif, suivi de Surimpressions, traduction Philippe Di Meo

Vide des toiles d’araignée
par les fissures et les vallées,
vide de naissance et de sang.
De l’eau et quel verbe pierreux
tu déposes au pied de ces monts, de ces collines,
et quel vert sans pitié
vous révélez dans un feu
inégal et néfaste
ou — c’est égal — dans un feu
effilé, équilibré
contre le mur où je pleure ; et le mur s’élève
depuis la tête lasse
lasse de naître et de naître encore
dans l’atroce vie bourdonnante.
Andrea Zanzotto, Vocatif suivi de Surimpressions,
traduit de l’italien et présenté par Philippe Di Meo,
Maurice Nadeau, 2016, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, vocatif suivi de surimpressions, philippe di meo, naissance, sang, feu, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2016
Gustave Roud, Les fleurs et les saisons

Capucine, l’éclat de rire, défi, cristal, d’une petite nonnain qu’un ravisseur exclut galamment du moutier dans la nuit d’une chanson Vieille-France… Est-il d’autre ressemblance entre la plante et la jeune cloîtrée ? Une encore, peut-être, cette corolle qui brûle comme son corps.
Car toutes les capucines, même celles des Canaries où perche une profusion de fleurs minuscules, jaunes et plumeuses comme un hommage aux oiseaux de leur patrie, toutes semblent participer du feu. Aucune de leurs fleurs qui ne soit flamme ou reflet de flamme. Une bordure d’impératrice des Indes est une longue chaine de brasiers, rubis et velours (ce velouté de soie et de fumée qu’on voit au flamboiement des torches nocturnes.) Le long des piliers, des barrières, des colonnes, l’ample guirlande des Lobb rassemble et fige selon une sorte de magie pétrifiante les lueurs, les éclats, les sursauts, l’incendie des feux terrestres ou des météores.
Gustave Roud, Les fleurs et les saisons, La Dogana, 2003, p. 61-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, les fleurs et les saisons, capuche, feu, flamme | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2016
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière
En hommage à Yves Bonnefoy, 1923-1er juillet 2016
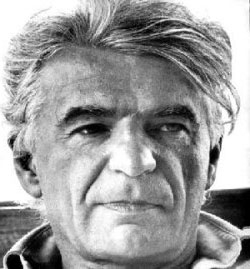
L'agitation du rêve
I
Dans ce rêve le fleuve encore : c'est l'amont,
Une eau serrée, violente, où des troncs d'arbres
S'entrechoquent, dévient ; de toute part
Des rivages stériles m'environnent,
De grands oiseaux m'assaillent, avec un cri
De douleur et d'étonnement, — mais moi, j'avance
À la proue d'une barque, dans une aube.
J'y ai amoncelé des branches, me dit-on,
En tourbillons s'élève la fumée,
Puis le feu prend, d'un coup, deux colonnes torses,
Ont un porche de foudre. Je suis heureux
De ce ciel qui crépite, j'aime l'odeur
De la sève qui brûle dans la brume.
Et plus tard je remue des cendres, dans un âtre
De la maison où je viens chaque nuit,
Mais c'est déjà du blé, comme si l'âme
Des choses consumées, à leur dernier souffle,
Se détachait de l'épi de matière
Pour se faire le grain d'un nouvel espoir.
Je prends à pleines mains cette masse sombre
Mais ce sont des étoiles, je déplie
Les draps de ce silence, mais découvre
Très lointain, très proche la forme nue
De deux êtres qui dorment, dans la lumière
Compassionnée de l'aube, qui hésite
À effleurer du doigt leurs paupières closes
Et fait que ce grenier, cette charpente,
Cette odeur du blé d'autrefois, qui se dissipe
C'est encore leur lieu, et leur bonheur.
[...]
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière, Poésie / Gallimard, 1995 (1987), p. 85-86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, ce qui fut sans lumière, rêve, feu, cendre, blé | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2015
Edward Estlin Cummings, Paris

plus
pâle
que tous les pourquois
tapis
entre tes omoplates découvertes. — Voici
venir un solide gaillard en sarrau
de l’autre côté de la fenêtre, touchant les becs
de gaz un à un de sa canne
magique (au bout de laquelle une boule
de feu bouillonne enthousiaste)
vois
là et là ça explose
silencieux en crocus d’éclats. (Cela fait bien assez
de vie pour toi. Je comprends. Une fois
encore...) glissant
un peu plus bas ; embrasse-moi de ton corps soudain
incurvant de complètes questions chaudes
Edward Estlin Cummings, Paris, traduit de l’anglais et présenté par
Jacques Demarcq, Seghers, 2014, p. 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward estlin cummings, paris, jacques demarcq, magie, feu, baiser | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2015
Henri michaux, Nous deux encore

Nous deux encore
Air du feu, tu n’as pas su jouer.
Tu as jeté sur ma maison une toile noire. Qu’est-ce que cet opaque partout ? C’est l’opaque qui a bouché mon ciel. Qu’est-ce que ce silence partout ? C’est le silence qui a fait taire mon chante.
L’espoir, il m’eût suffi d’un ruisselet. Mais tu m’as tout pris. Le son qui vibre m’a été retiré.
Tu n’as pas su jouer. Tu as attrapé les cordes. Mais tu n’as pas su jouer. Tu as tout bousillé tout de suite. Tu as cassé le violon. Tu as jeté une flamme sur la peau de soie pour faire un affreux marais de sang.
Son bonheur riait dans son âme. Mais c’était tromperie. Ça n’a pas fait long rire.
Elle était dans un train roulant vers la mer. Elle était dans une fusée filant vers le roc. Elle s’élançait quoique immobile vers le serpent de feu qui allait la consumer. Et fut là tout à coup, saisissant la confiante, tandis qu’elle peignait sa chevelure, contemplant sa félicité dans la glace.
Et lorsqu’elle vit monter cette flamme sur elle, oh...
Dans l’instant la coupe lui a été arrachée. Ses mains n’ont plus rien tenu. Elle a vu qu’on la serrait dans un coin. Elle s’est arrêtée là-dessus comme sur un énorme sujet de méditation à résoudre avant tout. Deux secondes plus tard, deux secondes trop tard, elle fuyait vers la fenêtre, appelant au secours.
Toute la flamme alors l’a entourée.
[...]
Henri Michaux, Nous deux encore [1948], dans Œuvres complètes, II, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Pléiade / Gallimard, 2001, p. 149-150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, nous deux encore, feu, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
06/02/2015
Hilda Doolittle, Trilogie

La floraison du bâton
[8]
Je suis tellement heureuse,
je suis la première ou la dernière
d’un vol ou d’un essaim ;
je suis pleine de nouveau vin ;
je suis marquée par un mot,
je suis brûlée par le bois,
tirée de braises rougeoyantes,
ni coupée, ni marquée par l’acier ;
je suis la première ou la dernière à renoncer
au fer, à l’acier, au métal ;
je suis allée en avant,
je suis allée en arrière,
je suis allée de l’avant depuis le bronze et le fer,
jusque dans l’Âge d’Or.
H(ilda) D(oolittle), Trilogie, traduit par Bernard
Hoepffner, Corti, 2011, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilda doolittle, trilogie, la foraison du bâton, vivre, feu, âge d'or | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2014
William Faulkner, "La Nouvelle-Orléans", dans Croquis de la Nouvelle-Orléans

L'artiste
Un rêve, un feu sur lesquels je n'ai pouvoir me guident hors des sentiers sûrs et balisés de la solidité et du sommeil que la nature a créés pour l'homme. Un feu dont j'ai hérité malgré moi, et que je dois alimenter de verbe et de jeunesse et du vaisseau même qui le porte — le serpent qui dévore sa propre engeance —, sachant que je ne pourrai jamais donner au monde ce qui en moi cherche à se libérer.
Car où est la chair, dans quelle main le sang, aptes à modeler dans le marbre, sur la toile ou le papier, ce rêve qui est en moi et qui demande à vivre ? Je ne suis, moi aussi, qu'une motte informe de terre humide issue de la douleur et destinée à rire, à lutter, à pleurer, ne connaissant la paix que le jour où l'humidité partie, elle retournera à la poussière originelle et éternelle.
Mais créer ? Qui, parmi vous qui n'êtes pas la proie de ce feu, pour connaître cette joie, si fugace soit-elle ?
William Faulkner, "La Nouvelle-Orléans", dans Croquis de la Nouvelle-Orléans, suivi de Mayday, traduit d el'anglais par Michel Gresset, Gallimard, 1988, p. 63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, "la nouvelle-orléans", dans croquis de la nouvelle-orléans, création, feu, rêve, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2014
James Joyce, Finnegans Wake, traduction Philippe Lavergne

[...]
Mais qui vient par ici avec ce feu au bout d'une perche ? Celui qui rallume notre maigre torche, la lune. Apporte les ramours d'olive sur la boue des maisons et la paix aux tentes de Cèdre, Néomène ! Le banquet du tabernacle s'aproche. Shop-shup. Inisfail ! Tinckle Bell, Temple Bell ; ding ding disent les cloches du Temple. Sur un ton de synéglogue. Pour tous ceux d'esprit vif. Et la vieille sorcière qu'on damemnomme Couvrefeu siffle de son allée. Et hâtez-vous c'est l'heure pour les enfants de rentrer à la maison. Petits, petits enfants, rentrez chez vous dans vos chambres. Rentrez chez vous vivement, oui petits, petits, allez, quand le loup-garou est dehors. Ah, éloignons-nous, restons chez nous où la bûche dans son foyer brûle lentement !
L'obscurité tombe, (tint, tint) sur tout notre monde phénoménalement drôle. De l'autre côté la marée visite la berge du marais près de la borne de la route. Alvem marea ! Nous voici encircumenvelpeau d'obscurité. Hommes et bêtes ont froid. Il y a sur eux comme un souhait de n'être rien ni quoi que ce soit, ou seulement ce qui précède au pas de porte. Jardins zoologiques 8 Drr, deff, deucalion, pzz, appelle Pyrrha ! Ah où donc est notre épouse fondatrice, hautement honorable et salutaire . Le fou du logis est entré. Haha ! Hussard, où est-il ? À la maison, deux claires voix. Avec Nancy Hands. Tchitchi ! Le chien s'est enfui par les halliers. Oui hou ! Isegrim aux oreilles pendantes. Bon voyage !
[...]
James Joyce, Finnegans Wake, traduit de l'anglais et présenté par
Philippe Lavergne, Gallimard, 1982, p. 263.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, finnegans wake, philippe lavergne, feu, sorcière, nuit, enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2014
Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012 : recension

Il y a près de quarante ans que le premier livre de poèmes de Jean-Paul Michel a été publié (C'est une grave erreur que d'avoir des ancêtres forbans, 1975). Depuis, une œuvre complexe s'est construite, jalonnée de réflexions à propos de la poésie — pas seulement la sienne —, plus généralement de l'art, et la plus grande partie est réunie dans ce fort volume d'Écrits sur la poésie. Les textes sont d'origine variée : lettres, carnets, "conseils aux jeunes écrivains" (pour suivre une tradition bien établie), entretiens, études, préfaces, mais cette diversité et le passage du temps n'empêchent en rien une quasi permanence de la pensée, aussi bien pour ce que représente la poésie et l'art, la relation au monde que pour la permanence des références et la conduite de l'écriture.
D'entrée de jeu la poésie, l'art sont liés au vécu en ce qu'ils sont saisis comme seuls moyens de vivre « digne » dans le monde, et ce motif de la dignité est repris à différents moments, depuis l'affirmation forte quant au rapport entre poésie et langue (« la poésie est le seul usage digne de la parole », 55 ; souligné par Michel, comme dans les autres citations) jusqu'à, dans les dernières pages, la tâche à nouveau assignée à la poésie « de rendre à chaque chose, à chaque dieu, à chaque homme sa dignité » (283). Dans un hommage à Khaïr-Eddine, Michel définit la grandeur de ce poète par le fait qu'il aurait toujours su « appeler à l'insurrection de la dignité, de la liberté, de la beauté, de l'audace » (230). La dignité — estime, respect de soi-même — est une recherche individuelle, l'activité de création s'éloigne de tout projet de transformation du monde ; peu est dit explicitement à ce sujet, mais sans ambiguïté : il n'est que des « affirmations béates touchant demain » (138), et « la promesse d'une dignité pour tous [...] fut l'abaissement de tous, pas même le salut d'un seul » (137).
Bref, la poésie, l'art doivent « se défendre de la vulgarité du monde »(209), c'est-à-dire échapper au « sérieux du travail et de l'épargne », à tout ce qui rend acceptable l'angoisse de vivre, tout comme ils aident à dépasser les contraintes zoologiques (la faim, la peur, etc.), pour vivre le « sans mesure », le poétique, c'est-à-dire « trahir l'effroi, déployer le cérémonial, entrer dans le sacrifice » (180). On reconnaît là des éléments de la pensée de Bataille, l'un de ceux qui, pour Michel, ont su affronter "l'impossible" et considérer qu'il fallait vivre dans le défi, le dépassement de soi pour, enfin, se « connaître inconnu de soi » (230), pour comprendre que l'on écrit « contre ce que l'on est » (33). Reviennent au fil des réflexions les noms des figures idéales, choisies, de ceux pour qui écrire engageait tout l'être, poètes ou philosophes, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Hopkins, Mallarmé, auxquels s'ajoutent dans une liste Héraclite, Socrate, Dante, Shakespeare, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoïevski. C'est la réunion de ceux qui se sont arrachés à la « vie inessentielle » (10), « figures éblouissantes » (94), vrais « saints » (98) dans l'histoire de la pensée.
Le rejet des "valeurs" de la société marchande ou de l'engagement pour des "lendemains qui chantent" n'implique pas le refuge dans une bulle hors de toute atteinte. Les choix peuvent paraître hautains, ils se sont formés par l'expérience des choses et n'excluent évidemment pas une relation sensible au monde, bien au contraire : c'est par le poème, toujours, qu'il est possible de « répondre, par un signe juste, à l'éblouissant éclat de ce qui est » (265). Cette réponse ne peut naître que de la « commotion de l'expérience » (75) : alors est vécu le « feu » — mot récurrent pour exprimer que seule la violence ressentie peut susciter l'écriture. Cet ébranlement aide à prendre conscience de ses manques, de son « insuffisance personnelle » (92), mais aussi à faire face au « grand réel [et à] lui répondre » (149). L'émotion n'est rien si elle n'est pas prise en charge par la langue, pour que soit découverte l'étrangeté de ce qui s'écrit, de nouvelles réécritures ne visant qu'à conserver ce qui « brûle » (221) ; les caractères du premier choc exigent pour être restitués que l'écriture s'apparente à une « bataille » (175), qu'il faut engager son « courage », toutes ses « forces» (id.) pour la mener à bien.
Le poème est juste, la poésie a quelque efficace quand est offert au lecteur avec force, tension, probité, hauteur quelque chose de « l'éclat du scintillant mystère » (163) du monde, quand il perçoit dans les mots « la résistance des choses mêmes » (163). But inatteignable ? sans doute, mais le seul qui vaille qu'on s'y consacre. La réussite serait que les lecteurs, comme celui qui a écrit, se découvrent « à eux-mêmes étrangers » (57) ; c'est dire que pour Michel un livre non seulement doit toucher mais faire mal — un livre publié en 1991 avait pour titre Je lis Hölderlin comme on reçoit des coups —, agir sur le lecteur en l'arrachant au quotidien, déplacer chez lui ce qui était établi : la beauté doit "frapper".
Le pari pour la poésie, l'art, de transformer l'être implique de vivre en « horrible travailleur », selon le mot de Rimbaud, modèle en cela (avec Hölderlin), souvent cité, présent même sur la couverture des Écrits sur la poésie avec un typogramme de Jean Vodaine. Ce travail implique une écriture avec des ciseaux, mieux vaut toujours réduire qu'ajouter, « Écrire, c'est toujours re-lire : corriger, déplacer, espacer, aérer, supprimer, isoler ce qui doit, à la fin, permettre au livre de conserver mieux tel pouvoir propre, tel improbable éclat » (136) ; dans un autre texte, le propos est précisé : « Écrire, c'est relire, corriger, déplacer, interdire, imposer silence, donner forme, jusqu'à ce que le texte tremble de vérité, de passion de la vérité, du désespoir de la vérité » (174).
"Donner forme" : on comprend l'extrême attention portée à la composition et la référence aux collages de Matisse, le rôle donné à la typographie (jeux des polices, de leurs dimensions, opposition du romain et de l'italique, espaces, etc.), éléments qui appartiennent au rythme ; on comprend que Michel soit devenu éditeur pour ne rien laisser de côté dans cette « fête » (57) qu'est pour lui la construction d'un ouvrage : ce n'est qu'à cette condition que le livre peut faire « signe vers un possible "sens"» (157).
Je n'ai fait qu'esquisser ce qui m'a semblé soutenir la réflexion de Michel dans un livre dense, qui — avec bonheur — exige beaucoup du lecteur, traversé d'un bout à l'autre par le désir d'exalter la beauté, ce qui "brûle" : ce qui est. Toujours en se souvenant que la poésie ne vaut qu'à « la condition qu'elle invente sans fin sa forme et sans fin sa fin » (121).
Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012, Flammarion, 2013, 320 p. Recension parue dans Europe, avril 2014.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012, art, création, expérience, écriture, feu | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2013
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Au feu, à l'étang, le visage couleur de la nuit,
odeur de la journée, le visage d'innocente,
de pourpre fleur, de garçon livide, de porc
blanc, de poisson roi, de sale enfant,
qui criait, au feu, à l'étang, au sumac,
à la saveur des baies et des tiges,
la morte répandue, la rose éparpillée, la salie,
tout au feu, à l'étang, les draps, les nuages autour
de la cheminée, même le héros, le premier parleur
au baiser, le premier loup qui dort, au feu,
à l'étang, au parfum.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit, p. 38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, feu, eau, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |






