13/10/2013
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue
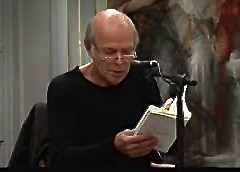
En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée dans l'air, étendant les bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : « Je brûle ! Je brûle ! » — a non-domination de soi et l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.
C'est approcher non pas le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.
Le poème est ce jouir. Le poème est ce nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 76-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue, poème, mort, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2013
Jacques Roubaud, Quelque chose noir
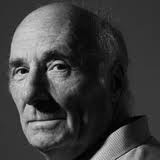
Mort
Ta mort parle vrai ta mort parlera toujours vrai. ce que parle ta mort est vrai parcequ'elle parle. certains ont pensé que la mort parlait vrai parceque la mort est vraie. d'autres que la mort ne pouvait parler vrai parceque le vrai n'a pas affaire avec la mort. mais en réalité la mort parle vrai dès qu'elle parle.
Et on en vient à découvrir que la mort ne parle pas virtuellement, étant ce qui arrive, effective au regard de l'être. ce qui est le cas.
Ni une limite ni l'impossible, dérobée dans le geste de l'appropriation répétitive, puisque je ne peux aucunement dire : c'est là.
Ta mort, de ton propre aveu, ne dit rien ? elle montre. quoi ? qu'elle ne dit rien. mais aussi qu'en montrant elle ne peut pas non plus, du même coup, s'abolir.
« Ma mort te servira d'élucidation de la manière suivante : tu pourras la reconnaître comme dépourvue de sens, quand tu l'auras gravie, telel une marche, pour atteindre au-delà d'elle (jetant , pour ainsi dire, l'échelle). » je ne crois pas comprendre cela.
Ta mort m'a été montrée. Voici : rien et son envers : rien.
Dans ce miroir, circulaire, virtuel et fermé. le langage n'a pas de pouvoir.
Quand ta mort sera finie. et elle finira parcequ'elle parle. quand ta mort sera finie. et elle finira. comme toute mort. comme tout.
Quand ta mort sera finie. je serai mort.
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, mort, vrai, langage | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2013
André Frénaud, Depuis toujours déjà

Ecco me
À force de l'aimer saurai-je la contraindre ?
A-t-il brillé pour moi le vrai regard ?
Qui voulais-je prouver ? Où me perdre ? Où me prendre ?
Mais à qui fut jamais promise, quelle ?
Ô ci-devant vainqueur, contre toi le temps gagne.
Aurai-je assez menti !
J'ai retrouvé la déchirure inoubliable.
L'enfance qui m'accompagnait, les yeux perdus,
s'est redressée avec son vrai visage : c'est moi.
J'ai bouclé ma vie, j'ai achevé le tour, découvrant
la pesante encolure de ma mort.
André Frénaud, Depuis toujours déjà [1970], dans La Sorcière de
Rome, Depuis toujours déjà, Poésie / Gallimard, 1984, p. 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, depuis toujours déjà, eeco me, enfance, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2013
Jean Tardieu, Accents

Premier dernier amour
Tout est mort. Même les désirs de mort
Sont morts. Ce qui grandit est sans figure.
Les mains, les yeux, — déserts. Toute mesure
S'effondre après ce feu qui brise un corps.
Rien — ni espoir ni doute — n'ouvre plus
La porte où le soleil vient nous attendre.
Les fruits profonds, par l'orage abattus,
Sont morts : l'esprit possède enfin leurs cendres ;
Avide, — seul, — et maître d'une nuit,
Où le ciel pleut, où le mouvement plonge,
Où, sur l'objet qu'il efface, bondit
L'appel sans voix qui confond tous nos songes.
Jean Tardieu, Accents, Gallimard, 1939, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jena tardieu, accents, premier dernier amour, sans voix, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2013
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

19-20 mai 1942
Condamné à mort par les Allemands, je prends la chose courageusement jusqu'au moment où l'on me dit qu'on viendra me faire la barbe au début de l'après-midi, dernière toilette avant l'exécution. Cette dernière toilette, événement sur lequel toute mon attention était fixée, m'avait masqué l'événement ultime que serait l'exécution. Or, maintenant que j'en connais l'heure, ma pensée peut aller au-delà, de sorte que je vois disparaître le dernier écran placé entre la mort et moi par ce détail de protocole. Rien ne me séparant plus de l'exécution elle-même, mon courage fait place à une angoisse indescriptible. Je sens que je ne tiendrai pas le coup, que je pleurerai et hurlerai quand on me mènera au poteau.
Je rêve ensuite qu'on publie des souvenirs de mon collègue du Musée de l'Homme, Anatole Lewitzky (fusillé effectivement par les Allemands le 23 février de cette même année). Notant jusqu'à la dernière minute ses impressions de condamné, il raconte comment l'exécution a eu lieu dans une sorte de parc d'exposition désaffecté, aux abords du Mont Valérien. Ses compagnons et lui, on les a fait s'adosser chacun à une reconstitution de case ronde africaine, en pisé ou en argile séchée. Lewitzky raconte que, devant la porte de la case qui lui tiendrait lieu de poteau d'exécution, il y avait sur le sol un poulet ou un squelette de poulet (comme on peut voir en Afrique, sur des autels domestiques, des plumes provenant de volailles égorgées pour des sacrifices, ainsi que des crânes ou mâchoires d'autres animaux). Le texte se termine par une sorte de testament politique ou profession de foi : mots d'ordre, pronostics plein de confiance quant à l'issue de la guerre.
Michel Leiris, Nuis sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 143-144.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuirs sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, angoisse, mort, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2013
Leonardo Rosa, Épigraphe pour un amour

Épigraphe pour un amour
Nos jours ont été si brefs et si hauts dans le ciel ami
les rêves de la maisonnette blanche
avec l'ombre tendre du cerisier
qui s'élargit dans le jardin pour nous protéger
En toi il ne restera de moi que les larmes
ensevelies dans la région d'enfance et peut-être le nom
qui fut le premier don de mon père
et que tu aimais dire jadis
comme une chose à toi.
Pour les nuits du froid dans le cœur
il ne me restera que l'ombre de ton corps dénudé.
Epigrafe per un amore
Furono brevi i nostri giorni e alti nel cielo amico
i sogni della bianca piccola casa
con l'ombra molle del ciliego
adagiata in giardino a coprirci.
In te di mio non resterà che il pianto
sepolto nell'angolo d'infanzia e forse il nome
che fu il primo dono di mio padre
e che tu amasti pronunciare un tempo
come cosa tua.
Per le notti fredde nel cuore
io non avrò che l'ombra del tuo corpo nudo.
Leonardo Rosa, dans NU(e) n° 29, "Leonardo Rosa", coordination Raphaël Monticelli, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonardo rosa, Épigraphe pour un amour, mort, jardin, corps, nom, revue nue | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2013
Étienne Faure, Légèrement frôlée — Horizon du sol

Où est l'exil
en sueur, en train jadis accompli
si les avions, presque
à la vitesse du mensonge, nous déposent
en des lieux prémédités de loin,
transmis par la parole, des papiers
traduits ou rédigés dans la langue des mères,
où est l'exil, un écart temporel
réduit à rien — espace crânien
où l'on revient sur ses pas pour retrouver
l'idée perdue en route —
histoire de seconde main aujourd'hui effacée
devant l'entrée des morts, sur le seuil,
par politesse ultime de la mémoire
ici trahie, en creux, quand l'avion atterrit
qui ne comblera donc rien, jamais
l'amplitude infinie de la perte
il revient les mains vides
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 90.
Comme on sort de la ville,
d'un quartier loin du cœur,
l'été longeant les rues ombragées, il arrive
la frôlant — la mort et ses fragrances —
qu'on en garde ombre et parfum mêlés,
de ces jardins le sombre pressentiment
d'un jour d'été, noir à l'idée de mourir tout à l'heure
bien avant les fleurs grillagées,
en plein contraste ayant senti,
belle ironie du nez, le mort venir
dans le mélange des parfums de fleurs
qui font desséchées à cette heure
une espèce de pot-pourri
— vite évanoui, car le jaune agressif au nez
d'un champ de moutarde inhalée
bientôt l'efface, campagne
où la route est tracée,
éperdument ne laissant qu'un lacet dans la tête.
frôlée
Étienne Faure, Horizon du sol, Champ Vallon, 2011, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, horizon du sol, la perte, l'exil, fleurs, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2013
Jean Paulhan, Le clair et l'obscur

Je me suis trouvé en Quatorze, un jour d'avances et de reculs, coincé, entre quelques morts et mourants, dans une maison à demi démolie, sur laquelle s'obstinait pourtant le tir de l'artillerie — de plus d'une artillerie, car la maison, se trouvant à égale distinction des deux lignes et bien en vue, ne servait pas moins de cible à nos canons qu'aux canons adverses. Personne, de vrai, ne savait au juste qui se trouvait dedans, en sorte que, par l'effet d'une modestie commune aux hommes de guerre, chacun pensait y voir l'ennemi. Non pas tout à fait à tort, car nous n'occupions qu'une partie de la ruine. Mais il faut l'avouer, nous ne songions guère, pour le moment, à détruire nos voisins — si tant est qu'il y avait des ennemis — ni même à les chasser.
Au fait, à quoi songions-nous ? Imaginez là-dessus une lumière d'éclipse, des éclats ronflant à droite et à gauche, le bruit d'orgue que fait un obus en plein vol, un cadavre qui vous regarde sans vous voir, un cheval éclaté comme un poisson de grands fonds et, dans une poussière de pierre et de fumée que traversaient des fusées éclatantes, de tous côtés, le désordre et la dislocation.
Tout cela était étrange, mais à certains égards merveilleux. Et je dois avouer qu'il m'arriva un instant de m'en réjouir : que de feux d'artifice ! Que de châtaignes et de girandoles, de crapauds et d'acrobaties, de clowneries et de parades ! D'aimables figurants faisaient le mort à la perfection. Quel spectacle ! Est-ce donc pour moi qu'on a monté tout ça ?
C'était là sans doute une réflexion égoïste. Ce fut, en tout cas, une réflexion imprudente. Car elle déclencha presque aussitôt le sentiment irrésistible (avec l'angoisse qui s'ensuit) que je me trouvais dans quelque farce gigantesque. Non, rien là-dedans en pouvait être vrai. De toute évidence, il ne s'agissait que d'un cauchemar, dont je tentai de me tirer en donnant de grands coups de soulier dans une glace demeurée, par quel hasard ? intacte, et même brillante. La glace se fendilla, s'écailla, puis s'écroula dans un grand bruit, et je connus très bien que je ne rêvais. Je le connus, et me trouvai, chose curieuse, satisfait — en tout cas comblé. Il faut bien que la vérité — fût-elle atroce — nous soit d'un grand prix..
Jean Paulhan, Le clair et l'obscur, préface de Philippe Jaccottet, Le temps qu'il fait, 1985, p.27-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, le clair et l'obscur, philippe jaccottet, guerre de 14, fusée, glace, mort, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2013
William Cliff, Marcher au charbon

Londres
Sur un trottoir de cette ville
on l'a trouvé étendu mort
j'ignore encor s'il faisait froid
dehors quand il s'est résigné
à se laisser crever j'ignore
aussi ce qu'a duré son a-
gonie si le remords a tra-
versé son âme au moment du
trépas (c'était un beau garçon
intelligent sentimental
un des plus fins produits
de notre bourgeoisie
d'avoir lu Nitche et d'autres livres
ça lui aura été fatal —
ainsi l'on parle des défunts
sans savoir ce qu'ils ont été,
il ne nous reste de plus d'un
que lourd silence et corps figé.
L'oubli t'a rendu plus ténu
qu'un fil de vent dans la bourrasque :
peut-être que ce qui perdure
de toi n'est que cette écriture.
William Cliff, Marcher au charbon,
Gallimard, 1978, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, marcher au charbon, londres, mort, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
26/01/2013
Mathieu Bénézet, Ode à la poésie (janvier 1984-janvier 1987)

Ode à la poésie
II
et ma solitude fit un pas que j'ai le cœur à chanter
comme un enfant ô tous doivent un jour connaître une ombre
au bord d'un puits au bord d'un chant où est l'ultime dialogue
le premier qui fut fondé de joie et de mort en profondeur paisible
ô coups d'un orage ce n'est pas en vain qu'en toute saison la langue
nous fond en elle comme plomb et nous cache à nous-mêmes
énorme flambée des anciens jours il suffit qu'à nouveau tu l'accueilles
pour qu'à son tour elle n'ordonne plus d'aller à la mort ni dans le fleuve
mais s'apaise si brève dans le tournoiement de l'amour déchirant et
un vent souffle sur les brûlures du passé et invente un jardin
respiration du temps emplie de peines qui nous pousses vers les ombres
tu peux prêter la main à qui l'emplit du chant commun de chaque
jour de l'âme minuscule et commune des hommes de chaque jour
où les enfants jouent ensemble toujours il est un reste de chant que j'ai
cœur à inventer alterné de défaites et de joies anonymes roses
pour mon bien je regarde à vos doigts la trace d'une beauté odorante
dans le bruit de vos jeux si clairs j'entends comme l'oubli de la mort
qui m'attend pauvres silhouettes d'enfants c'est moi bien sûr
[...]
Mathieu Bénézet, Ode à la poésie (janvier 1984-janvier 1987),
William Blake & CO, 1992, p. 39-40.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathieu bénézet, ode à la poésie (janvier 1984-janvier 1987), ombre, mort, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2012
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes

Et tu as traversé la mort
comme en la neige l’oiseau
toujours noir scellant l’issue…
Le temps a dégluti
les adieux que tu lui offris
jusqu’à l’extrême abandon
au bout de tes doigts
Nuit d’yeux
S’immatérialiser
Ellipse, l’air a baigné
la rue des douleurs…
Und du gingst über den Tod
wie der Vogel im Schnee
immer schwarz siegelnd das Ende –
Die Zeit schluckte
was du ihr gabst an Abschied
bis auf das äusserste Verlassen
die Fingerspitzen entlang
Augennacht
Körperlos werden
Die Luft umspülte – eine Ellipse –
die Strasse der Schmerzen –
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes, traduit de l’allemand
par Lionel Richard, Denoël, 1967, p. 258-259.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, brasier d’énigmes et autres poèmes, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
15/08/2012
Joyce Mansour, Carré blanc

Herbes
Lèvres acides et luxurieuses
Lèvres aux fadeurs de cire
Lobes boudeurs moiteurs sulfureuses
Rongeurs rimeurs plaies coussins rires
Je rince mon épiderme dans ces puits capitonnés
Je prête mes échancrures aux morsures et aux mimes
La mort se découvre quand tombent les mâchoires
La minuterie de l’amour est en dérangement
Seul un baiser peut m’empêcher de vivre
Seul ton pénis peut empêcher mon départ
Loin des fentes closes et des fermetures à glissière
Loin des frémissements de l’ovaire
La mort parle un tout autre langage
Joyce Mansour, Carré blanc, éditions Le Soleil noir,
1961, p. 121 et 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joyce mansour, carré blanc, herbes, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
10/07/2012
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
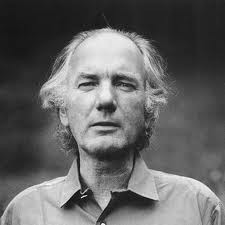
Ma mort viendra bientôt
par le champ, fatiguée,
quand les ombres
des corbeaux noirs
se précipitent sur l'herbe
et, derrière la maison, l'arbre
ferme les paupières
dans la neige
et quand soufflent
les mots
de l'hiver qui approche
L'âme malade, regardant
autour d'elle,
ne glisse plus vers le village.
Mein Tod kommt bald
über den Acker, müd,
wenn in das Gras
die Schatten stürzen
schwarzer Raben
und hintern Haus der Baum
die Lider schließt
im Schnee
und mahen Winters
Worte wehn...
Die kranke Seele huscht
umblickend nicht mehr
auf das Dorf
hinüber.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand
et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée", La Différence, 2012, p. 97 et 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2012
Louise Labé, Sonnet XIIII
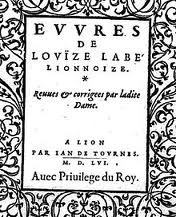
Sonnet XIIII
Tant que mes yeux pourront larmes espandre,
A l'heur passé avec toy regretter,
Et qu'aux sanglots & soupirs resister
Pourra ma voix, & un peu faire entendre :
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du mignart Lut, pour tes graces chanter :
Tant que l'esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien fors que toy comprendre :
Ie ne souhaitte encore point mourir.
Mais quand mes yeux ie sentiray tarir,
Ma voix cassee, & ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel seiour
Ne pouvant plus montrer signe d'amante :
Prirey la Mort noircir mon plus cler jour.
Louise Labé, Œuvres, Lyon, chez Jean de Tournes,
1555, p. 118, dans Gallica, Bibliothèque numérique de la BNF.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2012
Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes

Moi aussi j'oublie des choses. Ça me rend triste. Ou bien c'est ce qui me rend le plus triste. La tristesse c'est pas vraiment à cause de George W. ou de notre optimisme américain ; la tristesse c'est le fait d'admettre qu'une vie peut ne pas compter. Ou, comme il y a des milliards de vie, ma tristesse grandit avec la conscience que des milliards de vie n'ont jamais compté. J'écris cela sans que mon cœur se brise, sans sortir de mes gonds. C'est peut-être ça la vraie cause de ma tristesse. Ou peut-être, Emily Dickinson, mon amour, l'espoir n'a-t-il jamais été cette chose avec des ailes. Je ne sais pas, je m'aperçois seulement qu'à l'heure du journal télévisé, je change de chaîne. Cette nouvelle disposition pourrait révéler un effondrement de la personnalité : I. M. E. L'Incapacité à Maintenir l'Espoir, qui se traduit par une absence de foi innée dans les lois suprêmes qui nous gouvernent. Cornel West dit que c'est ce qui ne va pas avec les noirs aujourd'hui : trop nihilistes. Trop effrayés par l'espoir pour espérer, trop usés pour l'aventure, en fait trop près de la mort je pense.
Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes, Traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, "Série américaine", José Corti, 2010, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claudia rankine, si toi aussi tu m'abandonnes, tristesse, oubli, mort | ![]() Facebook |
Facebook |





