07/09/2014
André Frénaud, Parmi les saisons de l'amour

Les fils bleus du temps
Les fils bleus du temps
t'ont mêlée à mes tempes.,
toujours je me souviendrai
de ta chevelure.
Après l'amertume
tant d'autres pas vides,
loin par-delà l'oubli,
mort de tant de morts
si même vivant,
un éclat de ton œil clair
est monté dans mon regard,
toute l'ardeur de ta beauté
se répand même à voix basse
dans tous les jours de ma voix,
un signe épars dans le miroir transformé,
une douceur dans la confusion de mes songes,
une chaleur par les seins froids de ma nuit.
Je meurs de ma vie,
je n'ai pas fini.
Je te porterai encore,
mon feu amour.
André Frénaud, Parmi les saisons de l'amour, dans
Il n'y a pas de paradis, Poésie /Gallimard, 1967
[1962], p. 169.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, parmi les saisons de l'amour, temps, souvenir, amour, mort, tendresse | ![]() Facebook |
Facebook |
31/08/2014
Rachel Blau Duplessis, Brouillons, traduction Auxeméry

Midrush
Œuvres parmi
les morts pour cerner
le flot vivant des
espoirs envolés couronnes illuminées,
après avoir rejoint les couples toasts,
tremblant de peur clignotement des lampe
dans une arche goudronnée. autour des portes et des maisons.
Impossible de
donner aux détails
assez de
foi, assez de force
pour ce qui est
affirmation
cercles, pustules, charivari cercle jardin surveillé
varicelle l'Doc i'dit sale mourant sombrant et même
maladie avec assez de fil pour plat, vu les derniers com-
faire grincer une lyre acide promis
« des jours » « de vert »
[...]
Rachel Blau Duplessis, Brouillons, traduction de l'anglais et présentation par Auxeméry, avec la collaboration de Chris Tysh, Corti, 2013, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rachel blau duplessis, brouillons, traduction auxeméry, mort, maladie | ![]() Facebook |
Facebook |
30/08/2014
Sylvia Plath, Ariel, traduction de Valérie Rouzeau

Mort & Cie
Deux, bien sûr, ils sont deux.
Ça paraît tout à fait évident maintenant —
Il y a celui qui ne lève jamais la tête,
L’œil comme une œuvre de Blake,
Et affiche
Les taches de naissance qui sont sa marque de fabrique —
La cicatrice d’eau bouillante,
Le nu
Vert-de-gris du condor.
Je suis un morceau de viande rouge. Son bec
Claque à côté : ce n’est pas cette fois qu’il m’aura.
Il me dit que je ne sais pas photographier.
Il me dit que les bébés sont tellement
Mignons à voir dans leur glacière
D’hôpital : une simple
Collerette,
Et leur habit funèbre
Aux cannelures helléniques,
Et leurs deux petits pieds.
Il ne sourit pas, il ne fume pas.
L’autre si,
Avec sa longue chevelure trompeuse.
Salaud
Qui masturbe un rayon lumineux,
Qui veut qu’on l’aime à tout prix.
Je ne bronche pas.
Le givre crée une fleur,
La rosée une étoile,
La cloche funèbre,
La cloche funèbre.
Quelqu’un quelque part est foutu.
Sylvia Plath, Ariel, présentation et traduction
de Valérie Rouzeau, Poésie / Gallimard, 2011,
p. 45-46.
Death & CO.
Two, of course they are two.
It seems perfectly natural now —
The one who never looks up, whose eyes are lidded
And balled, like Blake’s,
Who exhibits
The birthmarks that are his trademark —
The scald scar of water,
The nude
Verdigris of the condor.
I am red meat. His beak
Claps sidewise : I am not his yet.
He tells me how badly I photograph
He tells me how sweet
The babies look in their hospital
Icebox, a simple
Frill at the neck,
Then the flutings of their Ionian
Death-gowns,
Then two little feet.
He does not smile or smoke.
The other does that,
His hair long and plausive.
Bastard
Masturbating a glitter,
He wants to be loved.
I do not stir,
The frost makes a flower,
The dew makes a star,
The dead bell,
The dead bell.
Somebody’s done for.
Sylvia Plath, Ariel, Faber and Faber, London,
1988 [1965 by Ted Hughes], p. 38-39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, ariel, traduction de valérie rouzeau, mort, surprise | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2014
Christiane Veschambre, Fente de l’amour

au chemin creux
glaise et pierres
demeure
ma demeurée
m’attend
— pas moi
mais celle que la mort lavera
l’amour cherche
une chambre en nous
déambule dans nos appartements meublés
parfois
se fait notre hôte
dans la pièce insoupçonnée mise à jour par le rêve
creuse
entre glaise et pierres
un espace pour mon amour
n’ai que lui
pour osciller
comme la tige à l’avant de l’aube
au respir de l’amour
— la vaste bête
qui tient contre elle
embrassée
la demeurée du chemin creux
Christiane Veschambre, Fente de l’amour, illustrations de
Madlen Herrström, éditions Odile Fix (Bélinay, 15430
Paulhac), 2011, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, fente de l’amour, chemin, mort, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
24/07/2014
Franck Venaille, Chaos

Amères sont nos pensées sur la vie Amè-
Res sont-elles ! Il suffit — ô amertume ! —
D’un instant, tel celui où ce cerf-volant
Échappant à l’enfant se brises sur les gla-
Ciers du vent pour que disparaisse ce
Bonheur d’aller pieds nus sur le sable
Amers de savoir que ce sont sur des éclats
De verre que nous marchons. Que nous
Nous dirigeons, chair à vif, vers la mort —
On naît déjà mort
Ah ! ce mur d’anxiété
qui
peu à peu
m’enserre
ALORS
que
je demande simplement à quitter la scène
fut-ce par la sortie bon secours
Ce sont toujours les mêmes qui pratiquent l’autopsie
De leur propre corps
Cela tient du cheval vapeur ouvert dégoulinant de viscères
noirs.
Rien !
On naît rien.
Vite on recoud vite le cadavre vite !
— déjà fané avant l’heure légale —
Vite !
Franck Venaille, Chaos, Mercure de France, 2006, p. 57 et 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, chaos, amertume, bonheur, vie, scène, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
07/07/2014
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud

E blanc
Scène 1
La mort couche dans mon lit elle a les dents blanches
Patauger dans la nuit appelle-t-on cela
Vivre O dans ma bouche l’ancolie amère
Des jours anciens mon vieux Verlaine rien ne sert
De pleurer au temps des souvenirs la partie
Est déjà perdue tu n’avais pas su le
Retenir il courait plus vite que le vent
Amants de la mort qu’attendiez-vous de la vie
Il n’aurait fallu qu’un mot peut-être à ta lèvre
Dolente et non le chapelet à l’angélus
Ah l’ordre comme un petit serpent fourbe arrive
Toujours quad le clocher sonne douze au clair de
Lune le christ O vieille démangeaison
Pauvre lélian habité par un fantôme à
La jambe de bois l’autre en toi O moulin à
Prières
Scène 2
Que cherchais-tu en franchissant le saint-gothard
À demi enseveli dans la neige quelle
Porte par où t’enfuir encore et toujours
O toi l’ébloui sans sommeil dévoré par
Les mouches du rêve et que l’éclair divise à
Jamais hagard comme le faucon
Scène 3
Elle venait sans que j’y prenne garde à pas
De loup et ce cœur en moi s’usait peu à peu
À battre la chamade je ne l’avais pas
Reconnue tant son visage était pâle et
Ressemblait à s’y méprendre à la blanche nuit
Ses regards enjôleurs me grisaient doucement
O comme elle était tendre lorsqu’elle voulut
Me prendre par surprise au petit matin calme
J’aurais pu te quitter sans avoir baisé ta
Bouche tandis qu’à m’étreindre elle buvait mon
Sang O la camarde ma camarade attends
Encore un peu je n’ai pas fini d’inventer
Pour lui les mots du nouvel amour
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud,
Gallimard, 2009, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, le théâtre du ciel, une lecture de rimbaud, verlaine, mort, ciel, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2014
Aurélie Foglia, Gens de peine

Vies de
I
Souvent on entend froisser
les forêts de Gens
le grand vent
les forêts profondes de Gens
ce sont les Chevrotants les Désolés
aux troncs tordus les Abonnés aux branches
basses qui brament au fond des fossés
« nous ne sommes pas doués
pour la divinitude
apprends-nous comment
nous soustraire arrache-nous
d'entre nos frères la mort »
tordant leurs bras griffus
s'adressant à qui ? au vent absent
ce sont les Bafoués les Enterrés du pied
faune en costume de lichen à cornes
de brume les Passés sous silence
qui végètent sous
des loups de velours dévoré
II
quelques-uns nus d'autres non
Gens derniers
ainsi furent ainsi d'en furent
long loin
leurs notes mal tenues
pas un ne les rappelé
Gens de rien
perdus entre tous
les sons qui les émurent
dont nos noms ne sont pas
parvenus
eurent si peu de fourrure
par si grand froid
qu'ils en moururent
pas un ne les réchauffa
[...]
Aurélie Foglia, Gens de peine, NOUS, 2014, p. 11-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aurélie foglia, gens de peine, rien, mort, solitude, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2014
Anise Koltz, Galaxies intérieures

Le poème
est le regard posé
sur un présent illisible
Des espace se forment
et s'écroulent
devant toi
Le poème
voit sans yeux extérieurs
suspendu
par-dessus le vide des siècles
Il constate :
Tout est dans rien
*
À René
Je te revois en rêve
sombre demeure des morts
où tu vis et travaille
Parfois tu me fais signe
de ta terrasse planétaire
Ton ombre m'approche
jetant à mes pieds
notre monde partagé
*
J'ignore pour qui
pourquoi je vis
J'ignore pour qui
pourquoi je meurs
Anise Koltz, Galaxies intérieures, Arfuyen,
2013, p. 69, 91, 52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, galaxies intérieures, poème, néant, souvenir, rêve, mort, signe | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2014
Les poèmes d'Edgar Poe, traduits par Stéphane Mallarmé

Le lac
Au printemps de mon âge, ce fut mon destin de hanter de tout le vaste monde un lieu, que je ne pouvais moins aimer — si aimable était l'isolement d'un vaste lac, par un roc noir borné, et les hauts pins qui le dominaient alentour.
Mais quand la nuit avait jeté sa draperie sur le lieu comme sur tous, et que le vent mystique allait murmurer sa musique — alors — oh ! alors je m'éveillais toujours à la terreur du lac isolé.
Cette terreur n'était effroi, mais tremblant délice, un sentiment que non ! mine de joyaux ne pouvait m'enseigner ou me porter à définir — ni l'Amour, quoique l'Amour fut le tien !
La mort était sous ce flot empoisonnant, dans son gouffre une tombe bien faite pour celui qui pouvait puiser là un soulas à son imagination isolée — dont l'âme solitaire pouvait faire un Eden de ce lac obscur.
Les poèmes d'Edgar Poe, traduits par Stéphane Mallarmé, Gallimard, 1928, p. 138-139.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les poèmes d'edgar poe, traduits par stéphane mallarmé, lac, terreut, isolement, amour, nuit, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
05/05/2014
Pier Paolo Pasolini, La rage
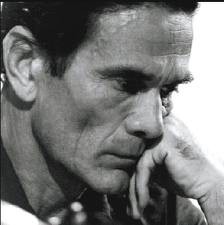
Ainsi tandis que dans un coin la culture de haut niveau devient de plus en plus raffinée et réservée à quelques-uns, ces « quelques-uns » deviennent, fictivement, nombreux : ils deviennent « masse ». C'est le triomphe du « digest », de l'« illustré » et, surtout, de la télévision. Le monde déformé par ces moyens de diffusion, de culture, de propagande, devient de plus en plus irréel : la production en série, y compris des idées, le rend monstrueux.
Le monde des magazines, du lancement à l'échelle mondiale des produits, même humains, est un monde qui tue.
Pauvre, tendre Marilyn, petite sœur obéissante, accablée par sa beauté comme par une fatalité qui réjouit et tue.
Peut-être as-tu pris le bon chemin, nous l'as-tu enseigné. Ton blanc, ton or, ton sourire impudique par politesse, passif par timidité, par respect envers les adultes qui te voulaient ainsi, toi, restée gamine, voilà ce qui nous invite à apaiser la rage dans les pleurs, à tourner le dos à cette réalité maudite, à la fatalité du mal.
Car : tant que l'homme exploitera l'homme, tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves, il n'y aura ni normalité ni paix. Voilà la raison de tout le mal de notre temps.
Et aujourd'hui encore, dans les années soixante, les choses n'ont pas changé : la situation des hommes et de leur société est la même qui a produit les tragédies d'hier.
Vous voyez ceux-là ? Hommes sévères, en veste croisée, élégants, qui montent et descendent des avions, qui roulent dans de puissantes automobiles, s'asseyent à des bureaux grandioses comme des trônes, se réunissent dans des hémicycles solennels, dans des lieux superbes et sévères ces hommes aux visages de chiens ou de saints, de hyènes ou d'aigles, ce sont eux les maîtres.
Et vous voyez ceux-là ? Hommes humbles, vêtus de haillons ou de vêtements produits en série, misérables, qui vont et viennent par des rues grouillantes et sordides, qui passent des heures et des heures à un travail sans espoir, se réunissent humblement dans des stades ou des gargotes, dans des masures misérables ou dans de tragiques gratte-ciels : ces hommes aux visages semblables à ceux des morts, sans traits et sans lumière sinon celle de la vie, ce sont eux les esclaves.
De cette division naissent la tragédie et la mort.
Pier Paolo Pasolini, La rage, traduit de l'italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas, introduction de Roberto Chiesi, NOUS, 2014, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, exploitation, maître, esclave, tragédie, mort, marilyn | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2014
Gerard Manley Hopkins, Reliquae

Printemps et automne
À une jeune enfant
Marguerite, mènes-tu deuil
Sur le Bois-Doré qui s'effeuille ?
Ainsi, de feuilles, comme humaines,
Voici tes frais pensers en peine ?
Ah ! quand le cœur vient à vieillir
C'est, peu à peu, pour s'endurcir
Sans plus gratifier d'un soupir
Un monde effeuillé de bois mort ;
Alors pourtant tu pleureras
Sans laisser de savoir pourquoi.
Mais quelque nom qu'on donne aux peines,
Enfant leurs sources sont les mêmes.
L'âme a deviné, le cœur ouï
Ce qu'esprit ni lèvres n'ont dit :
Si l'homme naît, c'est pour qu'il meure,
C'est Marguerite que tu pleures.
Spring and Fall
To a young child
Margaret, are you grieving
Over Goldengrove unleaving ?
Leaves, like the things of man, you
With your fresh thoughts care for, can you ?
Ah! as the heart grows older
It will come to such sights colder
By and by, not spare a sigh
Though worlds of wanwood leafmeal lie ;
And yet you will weep and know why.
Now, no matter, child, the name :
Sorrow's springs are the same.
Nor mouth had, no nor mind, expressed
What heard heart of, ghost guessed :
It is the blight man was born for,
It is Margaret you mourn for.
Gerard Manley Hopkins, Reliquae, vers proses dessins
réunis et traduits par Pierre Leyris, Seuil, 1957, p. 79 et 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gerard manley hopkins, reliquae, printemps, automne, peine, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2014
Marie Étienne, extraits de Un enfant qui s'endort

Dans l'autobus. Extérieur jour
Une femme corpulente, cheveux décolorés en jaune, s'entretenait sur son portable.
Elle avait commencé, déjà, sur le trottoir, elle continuait, assise, en parlant fort. Ce qui te déplaisait.
Jusqu'au moment où renonçant à te fermer à ses propos, tu écoutais.
Mais je te dis, répétait-elle, de prendre le brillant, moi je m'en fous, prends-le, ce n'est pas important.
Tu imagines, à l'autre bout, une autre femme, dans un appartement silencieux, cherchant, trouvant, et sur le point de s'emparer de la bague au brillant.
L'autre résiste, à ce qu'il semble, fait des manières.
Mais puisque je te dis que je m'en fous, que pour moi, l'important, c'est de l'avoir accompagnée jusqu'à la fin, de lui avoir fermé les yeux, puis d'avoir embrassé ses paupières. Tu comprends ?
Cela durait, durait, cette mort étalée dans le bus, ce chagrin dévoré de tendresse, l'inanité de ce diamant, stupide, énorme, dans un appartement déserté par la mort.
Une chambre. Intérieur. Nuit puis jour.
Un homme grand et beau, pareil à l'homme du café où Jude et toi, la veille, vous êtes arrêtés au retour des jardins de la gare, s'allonge près de ton corps, te touche te caresse sans toutefois entrer dans ton intimité.
Estimant que ses gestes et les circonstances ne sont pas dépourvues d'agrément, tu consens aux hommages.
Le jour venu, c'est presque un drame. Quelque chose de la nuit a filtré, s'est répandu comme un nuage de volcan islandais, les langues vont bon train, le scandale grossit sans pour autant vous désigner.
Tu écoutes la rumeur, pas vraiment concernée. C'est cet état d'esprit qu'il te faudrait examiner.
Marie Étienne, extraits de Un enfant qui s'endort (inédit), dans Les Carnets d'eucharis, 2014, n°2, p. 56 et 57.
L'Olivier d'Argens, Chemin de l'Iscle, BP 44, 83520 Roquebrune-sur-Argens.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie Étienne, un enfant qui s'endort, dans l'autobus, une chambre, mort, scandale | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2014
William Shakespeare, Sonnet 1 (1)

Trois traductions du premier des Sonnets de Shakespeare.
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory ;
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel,
Thou that art now the world's fresh ornament.
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak'st waste in niggarding,
Pity the world, or else theis glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.
The Oxford Shakespeare, The Complete Works, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 751.
Sonnet I
Les êtres les plus beaux, on voudrait qu'ils engendrent
Pour que jamais la Rose de la beauté ne meure ;
Que, lorsque le plus mûr avec le temps succombe,
En son tendre héritier son souvenir survive ;
Mais, n'étant fiancé qu'à tes seuls yeux brillants,
Tu nourris cette flamme, ta vie, de ta substance,
Créant une famine où l'abondance règne,
Trop cruel ennemi envers ton cher toi-même.
Toi, le frais ornement de ce monde aujourd'hui,
Seul héraut du printemps chatoyant, tu enterres
Dans ton propre bourgeon ta sève et ton bonheur,
Et, tendre avare, en lésinant, tu dilapides.
Aie donc pitié du monde, ou bien la tombe et toi,
Glouton ! dévorerez ce qui au monde est dû.
William Shakespeare, Sonnets, texte établi, traduit de l'anglais et présenté par Robert Ellrodt, édition bilingue, Actes Sud, 2007, p. 57.
Des êtres les plus beaux nous voulons qu'ils procréent
Pour que la rose de beauté jamais ne meure
Et, quand tout défleurit, qu'eux restent vifs
Dans l'amour qu'ils auront de leur descendance.
Mais toi, tu t'es fiancé à tes yeux seuls,
Tu nourris de ta seule substance leur lumière,
Et la famine règne en terre d'abondance,
Tu es ton ennemi, injustement cruel.
Toi qui es la fraîcheur du monde, le héraut
Des fastes du printemps, tu scelles ton essence
Dans le germe sans joie d'une fleur absente,
Cher avare, par ladrerie tu te gaspilles.
Ah, aie pitié du monde, au lieu de dévorer
Cette vie qu'en mourant tu devras lui rendre.
William Shakespeare, Les Sonnets, présentés et traduits par Yves Bonnefoy, Poésie / Gallimard, 2007 [1993], p. 159.
Des créatures les plus belles nous désirons des naissances, que les beautés de la rose ne puissent mourir, mais que si la très mûre doit périr à son temps, son frêle héritier puisse en donner mémoire ;
Mais toi, voué à tes seuls yeux resplendissants, tu nourris l'éclat de ta flamme par le brûlement de la substance de toi-même, créant une famine où c'était l'abondance, toi-même ton ennemi et trop cruel envers ton cher toi-même.
Toi qui es aujourd'hui frais ornement du monde, et seul héraut du merveilleux printemps, tu enterres ton bien dans l'unique bourgeon, cher avare, tu fais par lésine la ruine.
Aie pitié pour le monde — ou bien sois ce glouton : mange le dû au monde, par toi, et par la tombe.
Shakespeare, Les Sonnets, dans Pierre Jean Jouve, Œuvre, II, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 2007, p. 2073.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william shakespeare, sonnet, beauté, rose, souvenir, yeux, bonheur, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2014
Raymond Queneau, L'instant fatal, dans Œuvres complètes,I

Je crains pas ça tellment
Je crains pas ça tellment la mort de mes entrailles
et la mort de mon nez et celle de mes os
Je crains pas ça tellment moi cette moustiquaille
qu'on baptise Raymond d'un père dit Queneau
Je crains pas ça tellment où va la bouquinaille
la quais les cabinets la poussière et l'ennui
Je crains pas ça tellment moi qui tant écrivaille
et distille la mort en quelques poésies
Je crains pas ça tellment La nuit se coule douce
entre les bords teigneux des paupières des morts
Elle est douce la nuit caresse d'une rousse
le miel des méridiens des pôles sud et nord
Je crains pas cette nuit Je crains pas le sommeil
absolu Ça doit être aussi lourd que le plomb
aussi sec que la lave aussi noir que le ciel
aussi sourd qu'un mendiant bêlant au coin d'un pont
Je crains bien le malheur le deuil et la souffrance
et l'angoisse et la guigne et l'excès de l'absence
Je crains l'abîme obèse où gît la maladie
et le temps et l'espace et les torts de l'esprit
Mais je crains pas tellment ce lugubre imbécile
qui viendra me cueillir au bout de son curdent
lorsque vaincu j'aurai d'un œil vague et placide
cédé tout mon courage aux rongeurs du présent
Un jour je chanterai Ulysse ou bien Achille
Énée ou bien Didon Quichotte ou bien Pansa
Un jour je chanterai le bonheur des tranquilles
les plaisirs de la pêche ou la paix des villas
Aujourd'hui bien lassé par l'heure qui s'enroule
tournant comme un bourrin tout autour du cadran
permettez mille excuz à ce crâne — une boule —
de susurrer plaintif la chanson du néant
Raymond Queneau, L'instant fatal, dans Œuvres complètes,
I, édition établie par Claude Debon, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, l'instant fatal, mort, nuit, sommeil, deuil, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2014
Andrea Inglese, Mes cahiers de poèmes

Dans ce poème
le delta est surchargé
le carbone de l'antarctique
sera déjà épuisé
mes tasses jadis
avaient des anses
dans cet état où je ne peux voir de hérons
de porcs-épics ni non plus de petites taupes mortes sur le sentier
j'ai face à moi quelques lettres à remplir
je ne dois pas les écrire tout a déjà été écrit
chaque ligne chaque phrase le nom et son adjectif
mais il y a quand même des espaces qui seront remplis
des monogrammes de parafes par les archivistes dans notre dos
ce que je vois eux ne le voient pas
ce que je ne comprends pas eux le comprennent
en face il y a le retard non spécifié de la mort
du coin des rues des personnages
du désastre sur les bords
du rétroviseur
masse de marchandises graduée discontinue
qui glisse qui revient qu'on extrait
mais dans le livre des comptes : en croisant
les anciennes données et celles du millimètre
au fond de la courbe descendante
dans les tracés calculés par défaut
même mon sommeil incolore
le filet effrangé des destinations
prend la forme certaine, apaisée
d'un soulagement statistique
Andrea Inglese, Mes cahiers de poèmes, à la suite de Lettres à la Réinsertion Culturelle du Chômeur, traduit de l'italien par Stéphane Bouquet,
NOUS, 2013, p. 77-78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea inglese, mes cahiers de poèmes, monde défait, mort, désastre | ![]() Facebook |
Facebook |





