02/04/2014
Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou

Sentir le grisou, comme c'est difficile. Le grisou est un gaz inodore et incolore. Comment, alors, le sentir ou le voir, malgré tout ? Autrement dit, comment voir sentir la catastrophe ? Et quels seraient les organes sensoriels d'un tel voir venir, d'un tel regard-temps ? L'infinie cruauté des catastrophes, c'est qu'en général elles deviennent visibles bien trop tard, une fois seulement qu'elles ont eu lieu. Les catastrophes les plus visibles — les plus évidentes, les plus étudiées, les plus consensuelles —, les catastrophes auxquelles on a spontanément recours pour justifier ce qu'est une catastrophe, ce sont les catastrophes du passé, celles que d'autres, selon nous, n'ont pas su ou pas voulu voir venir, celle que d'autres n'ont pas su empêcher. Nous les reconnaissons d'autant plus facilement que nous n'en sommes pas — ou plus — comptables aujourd'hui.
Une catastrophe s'annonce bien rarement comme telle. Il est facile de dire, dans l'absolu du passé, « ce fut une catastrophe » lorsque tout a explosé, lorsque beaucoup sont déjà morts. Il est aussi facile de dire, dans l'absolu du futur, « ce sera une catastrophe » pour tout et n'importe quoi, puisque tout et n'importe quoi, c'est l'évidence, un jour disparaîtra par lente ou soudaine destruction. Mais il est bien plus difficile de dire « la voici qui arrive, maintenant, ici, cette catastrophe », la voici qui arrive dans une configuration que l'on était loin d'imaginer si fragile, si offerte au feu de l'histoire. Voir une catastrophe, c'est la voir venir dans sa singularité masquée, dans cette particulière « fêlure silencieuse » [...], cette fêlure qu'elle a creusée mine de rien. Et lorsque tout brûle, lorsque la catastrophe bat son plein sans que nul ne puisse plus l'arrêter, il ne reste, à ceux qui la subissent de plein fouet mais espèrent encore depuis leur souffrance voie leur mort prochaine, que l'énergie d'en appeler au témoignage, à l'archive, à la documentation pour une histoire future de la catastrophe.
Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou, éditions de Minuit, 2014, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, sentir le grisou, catastrophe, voir venir, témoignage, archive | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2014
Marie Étienne, extraits de Un enfant qui s'endort

Dans l'autobus. Extérieur jour
Une femme corpulente, cheveux décolorés en jaune, s'entretenait sur son portable.
Elle avait commencé, déjà, sur le trottoir, elle continuait, assise, en parlant fort. Ce qui te déplaisait.
Jusqu'au moment où renonçant à te fermer à ses propos, tu écoutais.
Mais je te dis, répétait-elle, de prendre le brillant, moi je m'en fous, prends-le, ce n'est pas important.
Tu imagines, à l'autre bout, une autre femme, dans un appartement silencieux, cherchant, trouvant, et sur le point de s'emparer de la bague au brillant.
L'autre résiste, à ce qu'il semble, fait des manières.
Mais puisque je te dis que je m'en fous, que pour moi, l'important, c'est de l'avoir accompagnée jusqu'à la fin, de lui avoir fermé les yeux, puis d'avoir embrassé ses paupières. Tu comprends ?
Cela durait, durait, cette mort étalée dans le bus, ce chagrin dévoré de tendresse, l'inanité de ce diamant, stupide, énorme, dans un appartement déserté par la mort.
Une chambre. Intérieur. Nuit puis jour.
Un homme grand et beau, pareil à l'homme du café où Jude et toi, la veille, vous êtes arrêtés au retour des jardins de la gare, s'allonge près de ton corps, te touche te caresse sans toutefois entrer dans ton intimité.
Estimant que ses gestes et les circonstances ne sont pas dépourvues d'agrément, tu consens aux hommages.
Le jour venu, c'est presque un drame. Quelque chose de la nuit a filtré, s'est répandu comme un nuage de volcan islandais, les langues vont bon train, le scandale grossit sans pour autant vous désigner.
Tu écoutes la rumeur, pas vraiment concernée. C'est cet état d'esprit qu'il te faudrait examiner.
Marie Étienne, extraits de Un enfant qui s'endort (inédit), dans Les Carnets d'eucharis, 2014, n°2, p. 56 et 57.
L'Olivier d'Argens, Chemin de l'Iscle, BP 44, 83520 Roquebrune-sur-Argens.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie Étienne, un enfant qui s'endort, dans l'autobus, une chambre, mort, scandale | ![]() Facebook |
Facebook |
Patrick Beurard-Valdoye, Gadjo-Migrandt
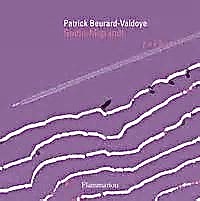
LE VÉLO
penché contre un mur
une ficelle après la selle
une bouillotte en caoutchouc rouge au bout remplie
d'eau
au dos
la coquille
d'un gros escargot
et le tout dans Elsworthy road
juste avant la rencontre avec Dali venu en
quête de saint patron des peintres
— il est fou
les Surréalistes maboules
à 95% c'est comme l'alcool —
il croque au bureau
silence analytique écho
à sa parade de vrai catalan fanatique
crânant
son article
regard sur la paranoïa
il en montre du doigt le titre
L'homme Moïse fini hier serait à l'inverse
« roman historique »
ses yeux
dévorants
ciblent le haut crâne
or Dali dit qu'il vit Freud à la une en photo
l'étape à Paris
sur la terrasse il dégustait
douze petits gris
soudain
l'idée vint
d'un secret morphique
un crâne allure d'escargot
cerveau spiralé
stream en front voûte de rivière
au bord du maelström
tête freudienne en tourbillon
avec roue
de petit vélo
Patrick Beurard-Valdoye, Gadjo-Migrandt, Flammarion, 2014, p. 211-212.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick beurard-valdoye, gadjo-migrandt, freud, dali, vélo, escargot, catalan, spirale | ![]() Facebook |
Facebook |
31/03/2014
Shakespeare, Sonnet 1 (2)

Deux traductions du premier des Sonnets de Shakespeare.
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory ;
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel,
Thou that art now the world's fresh ornament.
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak'st waste in niggarding,
Pity the world, or else theis glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.
The Oxford Shakespeare, The Complete Works, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 751.
Des plus beaux êtres, nous voulons croissance
et que par eux la rose point ne meure,
qu'ils laissent dans leur tendre descendance
la richesse qu'ils eurent à leur heure ;
mais toi fasciné par tes propres yeux,
tu te nourris toi-même de ta flamme,
empêchant que le lit de tes aïeux
se perpétue en fécondant la femme.
Ô toi, du monde si bel ornement
mais seul héraut de tes années superbes,
hélas ! ton bourgeon meurt en enterrant
ce que tu devrais nous offrir en gerbes
car tu ne peux permettre qu'au tombeau
tu donnes tout entier ton corps si beau.
Shakespeare, Sonnets, édition bilingue, traduits par William Cliff, Les éditions du Hasard, 2010, p. 9.
Les êtres les plus beaux on voudrait qu'ils s'accroissent
et que jamais leur splendeur n'en vienne à mourir
mais puisque avec le temps ce qui mûtit périt
qu'en soit mémoire au moins quelque tendre héritier.
Mais toi tu ne te voues qu'à l'éclat de tes yeux,
tu en nourris le feu par ta propre substance,
tu crées de la famine en un lieu d'abondance,
ennemi de toi-même et cruel à ton charme.
Toi qui es aujourd'hui le chatoiement du monde
et le seul messager du triomphal printemps,
dans ton propre bourgeon tu enterres ta sève
et par économie, cher faraud, tu gaspilles.
Ô prends pitié du monde ou sinon dévores
toi et la tombe, ce qu'au monde vous deviez.
Shakespeare, dans Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés, 1947-2004, édition de Jacques Réda, préface de J.M.G. Le Clézio, 2012, p. 232.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnet, william cliff, jean grosjean | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2014
William Shakespeare, Sonnet 1 (1)

Trois traductions du premier des Sonnets de Shakespeare.
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory ;
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel,
Thou that art now the world's fresh ornament.
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak'st waste in niggarding,
Pity the world, or else theis glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.
The Oxford Shakespeare, The Complete Works, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 751.
Sonnet I
Les êtres les plus beaux, on voudrait qu'ils engendrent
Pour que jamais la Rose de la beauté ne meure ;
Que, lorsque le plus mûr avec le temps succombe,
En son tendre héritier son souvenir survive ;
Mais, n'étant fiancé qu'à tes seuls yeux brillants,
Tu nourris cette flamme, ta vie, de ta substance,
Créant une famine où l'abondance règne,
Trop cruel ennemi envers ton cher toi-même.
Toi, le frais ornement de ce monde aujourd'hui,
Seul héraut du printemps chatoyant, tu enterres
Dans ton propre bourgeon ta sève et ton bonheur,
Et, tendre avare, en lésinant, tu dilapides.
Aie donc pitié du monde, ou bien la tombe et toi,
Glouton ! dévorerez ce qui au monde est dû.
William Shakespeare, Sonnets, texte établi, traduit de l'anglais et présenté par Robert Ellrodt, édition bilingue, Actes Sud, 2007, p. 57.
Des êtres les plus beaux nous voulons qu'ils procréent
Pour que la rose de beauté jamais ne meure
Et, quand tout défleurit, qu'eux restent vifs
Dans l'amour qu'ils auront de leur descendance.
Mais toi, tu t'es fiancé à tes yeux seuls,
Tu nourris de ta seule substance leur lumière,
Et la famine règne en terre d'abondance,
Tu es ton ennemi, injustement cruel.
Toi qui es la fraîcheur du monde, le héraut
Des fastes du printemps, tu scelles ton essence
Dans le germe sans joie d'une fleur absente,
Cher avare, par ladrerie tu te gaspilles.
Ah, aie pitié du monde, au lieu de dévorer
Cette vie qu'en mourant tu devras lui rendre.
William Shakespeare, Les Sonnets, présentés et traduits par Yves Bonnefoy, Poésie / Gallimard, 2007 [1993], p. 159.
Des créatures les plus belles nous désirons des naissances, que les beautés de la rose ne puissent mourir, mais que si la très mûre doit périr à son temps, son frêle héritier puisse en donner mémoire ;
Mais toi, voué à tes seuls yeux resplendissants, tu nourris l'éclat de ta flamme par le brûlement de la substance de toi-même, créant une famine où c'était l'abondance, toi-même ton ennemi et trop cruel envers ton cher toi-même.
Toi qui es aujourd'hui frais ornement du monde, et seul héraut du merveilleux printemps, tu enterres ton bien dans l'unique bourgeon, cher avare, tu fais par lésine la ruine.
Aie pitié pour le monde — ou bien sois ce glouton : mange le dû au monde, par toi, et par la tombe.
Shakespeare, Les Sonnets, dans Pierre Jean Jouve, Œuvre, II, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 2007, p. 2073.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william shakespeare, sonnet, beauté, rose, souvenir, yeux, bonheur, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
29/03/2014
Albert Camus, Carnets II, janvier 1942-mars 1951

1947
Misère de ce siècle. Il n'y a pas si longtemps, c'étaient les mauvaises actions qui demandaient à être justifiées, aujourd'hui ce sont les bonnes.
La solitude parfaite. Dans l'urinoir d'une grande gare à 1 heure du matin.
Comment faire comprendre qu'un enfant pauvre peut avoir honte sans avoir d'envie.
Forme et révolte. Donner une forme à ce qui n'en a pas, c'est le but de toute œuvre. Il n'y a donc pas seulement création, mais correction. D'où importance de la forme. D'où nécessité d'un style pour chaque sujet non tout à fait différent parce que la langue de l'auteur est à lui. Mais justement elle fera éclater non pas l'unité de tel ou tel livre mais celle d e l'œuvre tout entière.
La paix serait d'aimer en silence. Mais il y a la conscience et la personne : il faut parler. Aimer devient l'enfer.
Albert Camus, Carnets II, janvier 1942-mars 1951, éditions établie et annotée par Raymond Gay-Crosier, Folio- Gallimard, 2013, p. 214, 216, 222, 241, 243.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, carnets ii, solitude, pauvreté, écrire, forme, aimer, enfer | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2014
Pierre de Marbeuf (1596-1645), Le miracle d'amour

L'innocence d'amour
Tu me dis que l'amour est toujours en enfance,
Qu'il se plaît, comme enfant, à mille petits jeux,
Et s'il blesse quelqu'un se jouant de ses feux,
Que le mal qu'il lui fait vient de son ignorance.
Qu'aveugle est cet archer qui n'a pas connaissance
Où frapperont ses traits qui sont si dangereux :
Et si pour son sujet quelqu'un est malheureux,
Tu m'assures que c'est une pure innocence.
S'il est vrai que l'amour ne t'est pas inconnu,
Qu'il est un imbécile, et qu'il va toujours nu,
Innocent, dépouillé de malice et de ruse
N'ai-je point de raison, quand le mal que je sens
Me fait dire, qu'Hérode aurait eu quelque excuse,
S'il eut tué l'amour avec les Innocents.
Pierre de Marbeuf (1596-1645), Le miracle d'amour, préface de Jean Tortel, Obsidiane, 1983, p. 137.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre de marbeuf, le miracle d'amour, innocence, ignorance, enfance, hérode | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2014
Paul de Roux, Une double absence
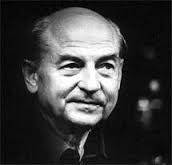
Vous ne me regardez même pas. Et cela me donne beaucoup de liberté. Je ne sais pas ce que vous pensez. Cela peut être douloureux, en face de vous c'est une chose douce. Vous ne vous approchez pas, vous ne vous éloignez pas non plus. Vous me permettez de rester avec vous. Je sais que le temps que je peux passer ainsi ne dépend que de moi. Vous ne vous enfuirez pas. C'est moi qui, bientôt, ne serai plus en état de rester là. Je m'éloignerai. Je penserai à autre chose. Je prendrai le métro, j'irai au cinéma ou je travaillerai. Il faut faire tout cela, on ne peut pas s'en dispenser. J'ai toujours su que je ne pourrais que vous entrevoir. Que je ne pourrais pas rester longtemps avec vous. Non, cela n'a rien de pénible. C'est dans votre nature et la nature de notre relation. J'allais dire : « vous ne me ferez pas souffrir, vous », mais aussitôt j'ai pensé : « qui sait ? » Je vous quitte.
Paul de Roux, Une double absence, Gallimard, 2000, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, une double absence, couple, silence, monologue | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2014
Yves di Manno, Terre ni ciel

L'autobus finit par s'arrêter comme tous les matins à l'angle de deux artères, non loin de l'entrée du lycée. Que se passe-t-il dans l'esprit de l'enfant après avoir pris pied sur le trottoir, lorsque au lieu de rejoindre le portail où s'agglutinent les élèves il s'immobilise soudain, le cœur serré, et lève les yeux vers le ciel ? Le jour tarde à percer dans la pénombre de l'automne, la ville hésite encore à émerger des ténèbres où elle se calfeutre, on ne distingue même pas la ligne des montagnes au-dessus des immeubles. Pourtant, une lueur d'un bleu moins sombre est en train de gagner l'autre versant de la vallée, modelant des formes grotesques dans le volume des nuages. Sont-ce ces silhouettes traversant furtivement le ciel — ou les ombres inquiètes qu'elles répandent dans les rues engourdies ? Le froid qui l'étreint tout à coup comme en écho d'une autre scène, et vient engourdir ses phalanges ? Ou le bleu qui s'étend entre le métal et l'encre, donnant un relief étrange et une beauté fugace aux façades accablées des maisons ? Qui le saurait... D'ailleurs le cours du temps pourrait reprendre — et de l'existence ordinaire — effaçant cet instant suspendu comme un chiffon l'écriture de la veille sur le tableau du maître. C'est à cet instant pourtant que l'enfant va s'écarter pour la première fois, et s'engager sans le savoir dans le chemin qui finira par devenir el sien.
Au lieu de traverser la rue et de rejoindre l'établissement, il fait en effet demi-tour, son cartable à la main, et part dans le sens opposé.
Yves di Manno, Terre ni ciel, "en lisant en écrivant", éditions Corti, 2014, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, terre ni ciel, enfance, école, automne, ville | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2014
E. E. Cummings, Paris, traduction Jacques Demarcq

le long des traîtres rues fragiles et éclatantes
du souvenir avance mon cœur chantonnant comme
un idot murmurant comme un ivrogne
qui (à un certain angle, soudain) aperçoit
le haut gendarme de mon esprit
être éveillé
n'étant dormir, ailleurs ont débuté nos rêves
à présent repliés : mais cette année achève
son existence tel un prisonnier oublié
- « Ici ? » - « Ah non, mon chéri ; il fait trop froid » -
Ils sont partis dans ces jardins passe un vent porteur
de pluie et de feuilles, emplissant l'ai de peur
et de douceur.... s'arrête ... (Mi-murmurant...mi-chantant
agite les toujours souriants chevaux de bois)
when you were in Paris on se retrouvait là
*
along the brittle treacherous bright sreets
of memory comes my heart,singing like
an idiot,whispering like a drunken man
who(at a certain corner, suddenly) meets
the tall policeman of my mind
awake
being not asleep,elsewhere our dreams began
which now are folded :but the year completes
his life as a forgotten prisoner
-"Ici ?" - "Ah non, mon chéri ; il fait trop froid"-
they are gone along these gardens moves a wind bringing
rain and leaves, filling the air with fear
and sweetness... pauses...(Halfwhispering...halfsinging
stirs the always smiling chevaux de bois)
when you were in Paris we meet here
E. E. Cummings, Paris, traduit de l'anglais et présenté par Jacques Demarcq, édition bilingue, Seghers, 2014, p. 95 et 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, paris, jacques demarcq, rue, jardin, rencontre | ![]() Facebook |
Facebook |
24/03/2014
Ossip Mandelstam, Simple promesse, choix de poèmes 1908-1937

Je ne suis pas encore mort, encore seul,
Tant qu'avec ma compagne mendiante
Je profite de la majesté des plaines,
De la brume, des tempêtes de neige, de la faim.
Dans la beauté, dans le faste de la misère,
Je vis seul, tranquille et consolé,
Ces jours et ces nuits sont bénis
Et le travail mélodieux est sans péché.
Malheureux celui qu'un aboiement effraie
Comme son ombre et que le vent fauche,
Et misérable celui qi, à demi-mort,
Demande à son ombre l'aumône.
Janvier 1937, Voronèje
Ossip Mandelstam, Simple promesse, choix de poèmes 1908-1937, traduction Philippe Jaccottet de ce poème, postface de Florian Rodari, La Dogana, 2011 [1994], p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, choix de poèmes, compagne, philippe jacottet, beauté, misère, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
22/03/2014
Yves di Manno, Champs (2)

L'été, I
Qu'une fenêtre s'ouvre, que le vent
S'y engouffre et déjà, immobile
La main s'élance, voudrait suspendre
Tel mouvement de branche. Une plume
Tombe du corps d'un oiseau. Un enfant
La ramasse. Les paniers sont emplis
De fruits. Le long des routes, des
Noyers inclinés par des siècles de
Bourrasque désignant un Sud hypothétique
Hors d'atteinte. Le temps n'y est pour
Rien.
Un fauteuil immuable tend ses bras
Dans le vide. La soucoupe est pleine
De mégots où les lèvres de femme ont
Laissé une empreinte étonnée. Près
d'elle un journal aux pages effeuillées
Par le vent : une main posée sur l'angle
D'un buffet : une clef que l'on hésite à
Tourner.
Yves di Manno, Champs, Poésie / Flammarion,
2014, p. 101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, l'été, oiseau, enfant, quotidien, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
21/03/2014
Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes

Dissolution d'octobre
Un mois de pénurie. Un mois sans qu'on s'
Entende (rire, pleurer) — un mois d'échecs.
Pièces sur le damier : les jours aux jours
Pareils. Et qui s'insurge ? Si
La main revient au papier, le corps à la
Charrue : bourbiers : charniers : abstraits.
Un pas de plus, un mot de trop sans doute
Et nous n'y verrons rien. (La nuit tombée ?
Le froid, glacial ?) Ah quel tort de nous
Croire ! (EUX, rires.) Et la jambe pliée, le
Vers ancien — l'absinthe — la mouche sur la
Plinthe : plainte écartée, plaie rejetée.
L'usure (de l'inversion ?) qui nous conduit
À prendre de leurs mots une mesure neuve.
(interférence)
Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985,
Flammarion, 2014, p. 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, un livre de poèmes, échec, mots, octobre, vers | ![]() Facebook |
Facebook |
20/03/2014
Maurice Scève, Délie

CLXXXIII
Voy ce papier de tous costez noircy,
Du mortel dueil de mes justes querelles ;
Et, comme moy, en ses marges transy,
Craingnant les mains piteusement cruelles.
Voy, que douleurs en moy continuelles
Pour te servir croissent journellement,
Qui te debvroient, par pitié seulement,
A les avoir agreables constraindre,
Si le souffrir doibt supplir amplement,
Ou le merite oncques n'a peu attaindre.
Maurice Scève, Délie, dans Œuvres poétiques,
Librairie Garnier Frères, 1927, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice scève, délie, écrit, poème, douleur, souffrir | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2014
Gustave Roud, Les fleurs et les saisons
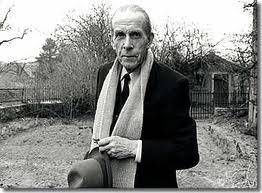
Le bois-gentil
Un petit arbuste aux lisières des forêts, aux pentes des ravins, parmi les broussailles des clairières, dans les jeunes plantations de hêtres et de sapins. Mais pour le promeneur d'avant-printemps, qui se repose sur la souche humide et ronde, couleur d'orange, des fûts fraîchement sciés, ce n'est tout d'abord qu'une gorgée d'odeur aussi puissante qu'un appel. Il se retourne : là, parmi le réseau de ramilles, à la hauteur de son genou, ces deux ou trois taches roses, d'un rose vineux, le bois-gentil en fleur ! Qu'il défasse délicatement les branches enchevêtrées, qu'il se penche sur l'arbrisseau sans en tirer à lui les tiges, car un geste brusque ferait choir les fleurs rangées en épi lâche, par petits bouquets irréguliers à même l'écorce lisse d'un gris touché de beige. Chacune, à l'extrémité d'une gorge tubulaire, épanouit une croix de quatre pétales charnus, modelés dans une cire grenue et translucide, dont les étamines aiguisent le rose, au centre de la croix, d'un imperceptible pointillé d'or. Et de chacune coule goutte à goutte ce parfum épais et sucré comme un miel où chancelante encore de l'interminable hiver s'englue irrésistiblement la pensée.
Gustave Roud, Les fleurs et les saisons, La Dogana, 2003, p. 29-30.
On appelle aussi cet arbrisseau Bois-joli, Daphné.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, les fleurs et les saisons, bois-gentl, daphné, forêt, arbuste, parfum, rose | ![]() Facebook |
Facebook |





