16/12/2015
Emmanuèle Jawad, Faire le mur

Huit plans
double portrait, positif-négatif, diptyque
onirique, saisie d’un mur, dans le cadre, mains coupées aux poignets, retenues à l’arête du mur, superposées, en repos, dans la montée, se hissant, tête de dos, nuque courte, en plongée, autour, foule en ronde, circulation de couleurs vives, floues, mouvements arrêtés à la lisière de l’angle de vue, l’arête, un mur, point d’appui, d’où repose, s’attache, à considérer l’ancrage éphémère, l’assise des mains, en prise avec, terre crue, la foule dans la danse, un poste d’observation, à hauteur d’homme, un camp
[...]
Emmanuèle Jawad, Faire le mur, Lanskine, 2015, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuèle jawad, faire le mur, portrait, main, foule, danse | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2015
Hilda Doolittle, Pour l'amour de Freud

[...] Le choc réel que m’avait personnellement infligé la guerre de 1914-1919 n’avait pas une chance de guérir. Mes séances avec le Professeur [= Freud] étaient à peine commencées que déjà apparaissaient les signes avant-coureurs et les symboles de l’épreuve qui approchait. Et la chose que je voulais essentiellement combattre à découvert, la guerre, ses causes et effets, avec ses inévitables répercussions de dépressions nerveuses et de désordres neurologiques, fut réactivée en profondeur. Devant la tête de mort de la croix gammée marquée à la craie sur le trottoir et menant à la porte même du Professeur, je dois, en toute décence, calmer aussi bien que je puis ma phobie personnelle, et même avec le peu de pouvoir dont je pourrais disposer, lui ordonner, pour le temps présent en tout cas, de retourner dans sa caverne souterraine.
Là il grandit et mordit ses chaînes et se détacha seulement à la fin, quand les terreurs pleinement apocryphes du feu et du soufre, de la trombe et du déluge et de la tempête, du Jour biblique du Jugement et de la Dernière Trompette, cessèrent d’être des abstractions, de mortelles terreurs inconcevables, mais devinrent des choses qui arrivaient chaque jour, chaque nuit, et pendant un moment à chaque heure du jour et de la nuit, à moi-même et à mes amis, à tout le merveilleux comme à tout le terne et ordinaire peuple de Londres.
Hilda Doolittle, Pour l’amour de Freud, traduit de l’anglais par Nicole Casanova, préface d’Elisabeth Roudinesco, Des femmes, 2009, p. 140-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilda doolittle, pour l’amour de freud, analyse, guerre, nazi, croix gammée | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2015
Louis Wolfson, Le Schizo et les langues

La mère de l’étudiant schizophrénique avait l’habitude de griffonner d’une grande écriture un petit nombre de mots sur toute une feuille de papier pour se souvenir de n’importe quoi et de la fixer ensuite pour qu’elle lui soit bien perceptible : par exemple, à un mur ou à une porte de placard ou d’armoire ; tout cela comme si elle ne pouvait guère se souvenir de rien, et même elle disait souvent, comme à part elle, qu’elle ne pouvait guère se souvenir de rien car son esprit était si rempli de troubles. Bien qu’elle dit cela d’habitude en yiddish, en employant pour troubles un mot emprunté à l’hébreu, son fils aliéné trouvait toujours agaçante cette déclaration sombre.
D’ailleurs, elle laissait des notes dans le vestibule avertissant n’importe qui de ne pas sonner (car elle serait sortie entre telle et telle heure), comme si elle ne voulait pas qu’on dérangeât son fils schizophrénique, seul à la maison, ou comme si elle craignait qu’il n’ouvrît la porte d’entrée, ce que, du reste, il ne ferait guère, ayant entre autres choses, une telle répugnance à l’idiome de la plupart de ses concitoyens. Ou elle utiliserait, presque en entier, une feuille de papier pour écrire un seul numéro de téléphone.
Par conséquent, elle achetait fréquemment des blocs de papier, mais pas assez fréquemment selon son fils schizophrénique. Étant de retour après avoir acheté au coin un nouveau bloc, elle ne prenait le plus souvent qu’une moitié pour elle-même et alors, en bonne mère, elle en offrait à son fils l’autre moitié, la plus forte, quoiqu’en lui demandant en anglais et d’une voix haute et perçante : « Veux-tu un bloc de papier ? » Il pensait, il se sentait à peu près certain qu’elle eût très bien su qu’il se fâcherait presque à coup sûr à cause de cette question si elle était posée en anglais ; et de plus, sa voix semblait au jeune homme aliéné exprimer un quelque chose de taquinant, ce qui ajoutait beaucoup à la détresse causée à lui par cette question.
Louis Wolfson, Le Schizo et les langues, préface de Gilles Deleuze, Bibliothèque de l’inconscient, Gallimard, 1970, p. 164-165.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis wolfson, le schizo et les langues, gilles deleuze, mère, oubli, langue maternelle | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2015
Jacques Roubaud, C et autre poésie (1962-2012)

sonnet 183
identité
n’avoir pas une identité de nom, mais d’adverbe
en appendice à chacun de mes pas
à propos de façades et d’herbe
dans une rue qui ne se définit pas
un autour-monde de ciel sans réserve
propulse vers l’avant les journées
arrêts-nuits non dénombrés
modèle fait de variables sans termes
que serait un cela qui bouge un cela qui blanc
le support de la mêmeté d’un continuant
qui serait le vecteur d’un change impersistant
et serait cela blanc un cela noir noir éteint
serait cela bougé d’un immuable plein
cela ?
Jacques Roubaud, C et autre poésie, éditions NOUS,
2015, p. 334.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2015
John Ashbery, Vague

Tu l’as dit, petit
Comme tu es courageux ! Parfois. Et l’injonction
Demeure, mur blanc tout simple. Encore un affaire en cours.
Mais n’est-ce pas là précisément la nature des affaires, dit
quelqu’un d’autre, l’air dégagé.
Tu ne peux pas tout laisser en plan au beau milieu, et puis filer.
Et si tu y prêtais incessamment l’oreille, jusqu’à
Ce qu’elle s’intègre à ton âme, corps étranger bien à sa place ?
Je te demande si souvent de réfléchir à la rupture que tu es en train
D’accomplir, cette révolution. Le temps se drape encore, pourtant,
Sur tes épaules. Le bulletin météo
N’a pas parlé de pluie, mais tu as le cul qui baigne dedans, alors ?
Trouve-toi d’autres prévisions. Celles-ci sont bonnes à jeter.
Les journaux d’hier, et ceux des semaines précédentes couvrent
Le temps écoulé, de plus en plus lointain, dans un ordre quasi parfait.
Ça ne sert
Qu’à te couper la parole. Le passé ne sert à rien d’autre.
Jusqu’au moment où, ton auto sortant brutalement d’une route
Pour tomber dans un champ, tu demeures assis à évoquer les heures.
C’était pour cela le baratin, les mensonges
Que nos murmures répétaient jusqu’à leur donner un parfum de vérité ?
Mais maintenant, comme quand on mord une monnaie dévaluée,
ils se font possessions
Alors que montent les étoiles. Et la ridicule machine
Continue à égrener ses slogans : « Encore bourré... », « de chez nous
À chez toi... » « On les a portés un certain temps, ils faisaient partie de
nous »
Chaque jour semble imbu de lui-même, il n’est pourtant
Fait que de quelques haricots colorés et d’un peu de paille sur la terre
battue
Dans le rai de lumière où danse la poussière. Il y a eu de la place, c’est vrai ;
Et c’est toi qui l’a ménagée en t’en allant. Quelque part, quelqu’un
Écoute ton rire, l’avale comme un verre d’eau fraîche,
Ni heureux, ni horrifié. Et cette posture, ce poteau fiché là, c’est toi.
John Ashbery, Vague, Traduit de l’américain par Marc Chénetier,
Joca Seria, 2015, p. 44-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ashbery, vague, passé, rupture, parole, slogan, posture | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2015
Jacques Josse, Au célibataire retour des champs
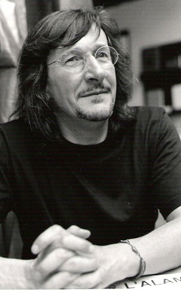
novembre, décembre,
debout sur la pas de la porte,
scrute le ciel bas,
tire sur la laisse du passé,
entend rire ses morts
(ils sont dans le ruisseau d’à-côté
et descendent à la rivière),
regarde le rideau des pluies
qui dilue la clarté
et ramène l’horizon
à hauteur des talus.
(22.12.2013)
Jacques Josse, Au célibataire retour des
champs, le phare du cousseix, 2015, p. 8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques josse, au célibataire retour des champs, hiver, passé, pluie, horizon | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2015
Daniil Harms, Le Samovar

Les chats
Un jour, d’un joyeux pas,
Je revenais chez moi.
Soudain, je vois des chats,
Qui m’tournent le dos, ma foi.
Je crie : hé-ho, les chats !
Ne restez pas comme ça,
Suivez-moi de ce pas,
Je vous amène chez moi.
Suivez-moi donc, les chats,
Je vais vous mitonner
De suite un fameux plat,
Il y aura du soufflé.
Mais non ! répondent les chats,
On préfère rester là !
Les voilà donc assis,
Aucun ne m’a suivi.
Daniil Harms, Le Samovar, édition bilingue,
traduit du russe par Eva Antonnikov, Héros
Limite, 2015, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniil harms, le samovar, les chats, repas, liberté | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2015
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie
c'est refuser la vie — partie par partie —
pour l'accepter tout entière —
que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.
La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile
*
Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,
ne se réveille pas —
*
le poème sort avec sa lie
hors de sa gangue d'angoisse
et de toute la boue qui le charrie
*
la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,
de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière
il y a cette révélation de l'insipide
— de cette clarté
qui court en avant d'elle-même
ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité
qui n'est suscité que pour être incinéré
l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.
Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.
Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.
on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle
le vent dont nous sommes affublés
le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —
l'image n'est suscitée que pour être incinérée.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie, image, banalité, angoisse | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2015
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

La pipe au poète
Je suis la Pipe d’un poète,
Sa nourrice et : j’endors sa Bête.
Quand ses chimères éborgnées
Viennent se heurter à son front,
Je fume... et lui, dans son plafond,
Ne peut plus voir les araignées.
... Je lui fais un ciel, des nuages,
La mer, le désert, des mirages ;
— Il laisse errer là son œil mort...
Et, quand lourde devient la nue,
Il croit voir une ombre connue,
— Et je sens mon tuyau qu’il mord...
— Un autre tourbillon délie
Son âme, son carcan, sa vie !
... Et je me sens m’éteindre... — Il dort —
.............................................................
— Dors encor : la Bête est calmée,
File ton rêve jusqu’au bout...
Mon pauvre !... la fumée est tout.
— S’il est vrai que tout est fumée...
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros,
T. C., Œuvres complètes, édition Pierre-Olivier-Walzer pour T. C., Pléiade / Gallimard, 1970, p. 734.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, poète, pipe, fumée, sommeil, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2015
Michel Deguy, Biefs

J’ai connu un vieux couple qui se déchirait de procès à dessein — peu conscient — de remettre en question son propre passé : féroce anamnèse, jusqu’au premier regard de fiancés, déjà truqué.
O salves du cœur, fantasia des yeux, l’état sauvage, l’impatience de toute conséquence ( j’ai connu un fervent cavalier peut-être à cause d’une image des Huns tôt imposée). Gestes perdus, balles perdues, enfant perdu, si perdu que pas une théorie du lapsus n’y retrouvera ce qui fut sien.
Et qu’elle y retrouve une trace, elle entendra l’éclat de rire du gitan ! Liberté brisée brisante, vague incalculable sur le corail errant, torrent jeune.
Michel Deguy, Biefs, Gallimard, 1964, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, biefs, couple, mensonge, cavalier, gitan, lapsus, liberté, anamnèse | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2015
Rainer Maria Rilke, Pour te fêter (Pour Lou Andreas Salomé)

Rilke avec Lou Andreas Salomé en Russie, 1897
Pour Lou Andreas Salomé
Lorsque parfois dans mon souvenir
je compare une rencontre à l’autre :
tu es toujours la femme riche qui donne
tandis que je suis le mendiant indigent.
Lorsque tu viens à ma rencontre doucement,
et, à peine souriante, lèves soudain,
de tes vêtements, ta main,
belle, brillante, fine... ;
dans la sébile tendue de mes mains,
tu la déposes gracieusement
comme un présent.
*
Je continue de marcher, solitaire. Au-dessus de moi,
je sens le printemps frémir dans les branches.
Un jour, je viendrai, avec des sandales sans poussière,
attendre aux grilles du jardin.
Et tu viendras quand j’aurai besoin de toi,
et tu prendras mon hésitation pour un signe,
et silencieusement tu me tendras les roses épanouies de l’été
des tout derniers buissons.
Rainer Maria Rilke, Pour te fêter, traduction Marc de Launay, dans Œuvres poétiques et théâtrales, sous la direction de Gérald Stieg, Pléiade / Gallimard, 1997, p. 647-648, 650.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, pour te fêter, lou andreas salomé, souvenir, rencontre, solitaude, printemps, signe, rose | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2015
Pierre Silvain, Assise devant la mer

Maintenant qu’il se soulève au-dessus du lit, il voit sa mère debout devant la table de toilette, en combinaison légère, ses épaules dénudées, et dans le miroir incliné son visage de profil tandis que par petites touches, d’une houppette en cygne, elle se poudre les joues, le front. Quand son regard rencontre soudain le sien qu’un reflet lumineux parmi les piqûres couleur de rouille lui renvoie, elle s’arrête, interdite, honteuse peut-être d’avoir oublié la présence de l’enfant, ou bien troublée par l’interrogation qu’elle découvre dans les yeux sombres qui ne se détournent pas. Elle va prendre aussitôt sur le dos d’une chaise sa robe bleue imprimée de pois blancs qu’elle-même a coupée et cousue, droite, sans plis, décolleté en pointe, la revêt, la lisse doucement du plat de la main sur les hanches, le ventre. Il observe chacun de ses gestes sans un cillement et lorsqu’elle vient s’asseoir au bord du lit, il sent la poudre de riz l’envelopper d’un faible nuage de rose, mais il reste aussi tendu que s’il se défendait de respirer un parfum interdit. Un instant indécise ou désarmée devant l’enfant transi par une crainte puérile, la mère ouvre ses bras, l’attire contre elle, contre ses seins qui s’écartent sous la pression de la tête de plus en plus pesante, abandonnée. Pourtant, il ne dort pas, il est tout entier ce corps sans défense qu’il laisse retourner au corps maternel dont le même mouvement berceur qu’autrefois, quand il ne savait rien du monde autour de lui, rien d’autre que l’effleurement d’un souffle ou le duvet d’un baiser de lèvres sur ses lèvres, l’endort, tandis qu’il entend les paroles d’une chanson — un peu triste — s’éloigner, se brouiller et enfin mourir là-bas où sa mère l’attend.
Pierre Silvain, Assise devant la mer, Verdier, 2009, p. 37-38. © Photo Marina Poole.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, assise devant la mer, enfant, mère, so, parfum, affection, sommeil | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2015
Jean Bollack, Au jour le jour

En hommage à Jean Bollack, disparu le 4 décembre 2012.
En dépit de toutes ses origines rituelles, la poésie comporte une tendance libératrice, due à sa puissance d’arrachement, qui peut la conduire à des mises en questions radicales, et à souvent contester des croyances établies. Elle est athée. Le dieu tient son pouvoir de la langue.
La fonction et la finalité d’une création littéraire (le terme n’est peut-être pas anachronique, ni pour Homère ni pour Sophocle) ne peuvent être saisies qu’au terme de l’analyse d’un projet qui relève de l’intervention d’un sujet ; ce « moi »-là s’affirme avant de pouvoir être rapporté à la situation historique d’un champ social dont la configuration préexiste à l’œuvre, mais s’y trouve également analysée et transformée.
Le plus souvent les textes recensés par les auteurs d’articles critiques servent de prétexte ou de support. Leurs développements s’en inspirent L’analyse du sens et le déchiffrement systématique des textes auraient dû précéder et faire l’objet d’une discussion critique. Les opérations se tiennent mais demandent à être distinguées.
Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F, 2013, p. 763, 167 et 191.
© Photo Tristan Hordé, 2012.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, poésie, libérateur, athéisme, création littéraire, histoire, article critique, analyse | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2015
Paul Celan, Enclos du temps, traduction Martine Broda

Viens, explique le monde à ton aune,
viens, laisse-moi vous combler
de toute opinion,
je ne fais qu’un avec toi,
pour nous capturer,
même maintenant.
Komm, leg die Welt aus mit dir,
komm, laß mich euch zuschütten mit
allem Meinen,
Eins mit dir bin ich,
uns zu erbeuten,
auch jezt.
Paul Celan, Enclos du temps, traduit par
Martine Broda, Clivages, 1985, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, enclos du temps, martine broda, union, présent, explication | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2015
Eugène Guillevic, Autres, poèmes 1969-1979

Contes et nouvelles
37
Il n’allait jamais bien loin.
Il avait découvert à l’orée de la forêt
Cette cabane abandonnée
Et il y revenait très vite,
Quand il avait de quoi
Pour quelques jours.
Sans doute n’y avait-il que là
Un arrêt, c’est presque sûr, du soleil
À la tombée du jour, un bon moment,
Comme pour le regarder,
Alors qu’il était
Sur le seuil de la cabane
À savourer, solitaire,
Son gros morceau de pain
Et son vin rouge.
Eugène Guillevic, Autres, poèmes 1969-1979,
Gallimard, 1980, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène guillevic, autres, poèmes, solitaire, cabane, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |





