28/09/2019
Camille Loivier, Une voix qui mue : recension
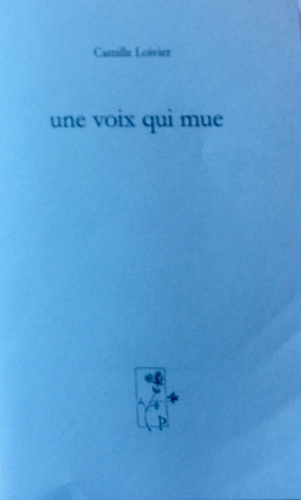
Une voix qui mue est le premier d’une nouvelle série de plaquettes et de livres des éditions Potentille : une couverture différente avec un rabat dans lequel les pages sont insérées et avec une nouvelle vignette. Camille Loivier a déjà publié aux mêmes éditions Joubarbe (2015) ; elle enseigne la littérature de langue chinoise et la traduit — récemment un livre de Hong-Ya Yan, écrivain et réalisateur taïwanais (Le passe muraille, 2018). Son long poème est consacré à la difficulté d’être dans une langue, c’est-à-dire de construire sa relation au monde — peut-être à être soi avec les autres.
Le poème s’ouvre comme un aparté, avec des vers entre parenthèses qui portent sur le désir d’un lieu, de sa nécessité pour vivre ; le rejoindre, c’est retrouver « derrière (…) la rupture / ce qui lie ». Qu’est-ce que le lieu peut apporter ? ce qui est essentiel pour l’identité de la narratrice, la « trace de soi », au point que l’on puisse y vivre sans craindre sa nudité. Ce lieu est nommé plus loin, il s’agit de Taipei, capitale de Taïwan, et il est désigné par « bercail », où, explicitement (sens de "bercail"), elle dit être « comme dans [s]a ville natale » — « c’est donc [s]a ville natale » —, et, fortement, « née une seconde fois », et « j’y suis née ». Vivre à Taipei, c’est connaître la plénitude, toutes fissures de la vie éloignées, et cette certitude d’un accomplissement est restitué dans quelques vers où la seconde naissance dans la ville s’apparente à la fois à la présence du corps dans le ventre maternel et à sa sortie dans le monde. L’ensemble de vers débute par « naître ; » et est immédiatement suivi par « retourner à la chaleur moite et poisseuse » et, plus avant, « on est à l’intérieur d’une serre chaude », puis
soudain on est libre, amphibie
on respire dans l’eau, on est là
dans le monde partie rattachée
au reste
on n’est plus séparée
Cet attachement à la ville chinoise ne peut être dissocié de la langue de Taipei, de Taïwan. Camille Loivier précise que la langue maternelle, celle de Nankin, qui « remonte » et diffère de la langue commune, a été perçue comme une sorte de « patois » et que le changement de langue, à Taipei, a été senti comme une mue de la voix. La langue chinoise, lors de son apprentissage, a été éprouvée comme « une langue / qui ne se parle pas », donc qui ne nécessitait pas d’interlocuteur. Langue pour soi, qu’il n’est pas indispensable de parler, sinon « à soi-même à voix basse ». S’il y a « silence des mots » pour qui la pratique, la langue, alors, conduit à une « complète solitude », ce qui ne semblait pas gêner la narratrice. Le bouleversement semble être survenu quand la langue chinoise a été parlée autrement, ce qui a permis la mue, la transformation ; alors, la langue peut être parlée, et non plus dans la solitude, et est « entendue (…) / telle qu’elle devait me délivrer » : il n’y a plus simplement des signes écrits mais la possibilité d’un tu, d’échanges. Le sentiment d’avoir découvert sa voix (et, évidemment, une voie) est tel que, chaque année, revenir à Taïwan, est à la fois « naître et mourir », perte d’une langue et (re)naissance d’une autre. Sans qu’il y ait croisement de l’une et l’autre, d’où peut-être toujours un manque.
Une voix qui mue, seul texte de Camille Loivier, sauf erreur, qui présente des éléments biographiques, évoque l’enfance où l’« on vit au ralenti » et où se décide pour longtemps une relation à la langue, aux langues, relation au fondement ensuite de ce qu’est le je-tu : rupture du silence, apprentissage du monde. Dans La rivière aux amoures, Camille Loivier écrit, « A-t-on vraiment envie de devenir adulte ? », elle répond sans ambiguïté dans Une voix qui mue, oui, en sachant qu’il faut parfois accepter de perdre ce qu’on pensait être indispensable pour mieux, beaucoup mieux, le retrouver. `
Camille Loivier, Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019, 32 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 août 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, taïwan taipei, enfance, langue maternelle | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2015
Louis Wolfson, Le Schizo et les langues

La mère de l’étudiant schizophrénique avait l’habitude de griffonner d’une grande écriture un petit nombre de mots sur toute une feuille de papier pour se souvenir de n’importe quoi et de la fixer ensuite pour qu’elle lui soit bien perceptible : par exemple, à un mur ou à une porte de placard ou d’armoire ; tout cela comme si elle ne pouvait guère se souvenir de rien, et même elle disait souvent, comme à part elle, qu’elle ne pouvait guère se souvenir de rien car son esprit était si rempli de troubles. Bien qu’elle dit cela d’habitude en yiddish, en employant pour troubles un mot emprunté à l’hébreu, son fils aliéné trouvait toujours agaçante cette déclaration sombre.
D’ailleurs, elle laissait des notes dans le vestibule avertissant n’importe qui de ne pas sonner (car elle serait sortie entre telle et telle heure), comme si elle ne voulait pas qu’on dérangeât son fils schizophrénique, seul à la maison, ou comme si elle craignait qu’il n’ouvrît la porte d’entrée, ce que, du reste, il ne ferait guère, ayant entre autres choses, une telle répugnance à l’idiome de la plupart de ses concitoyens. Ou elle utiliserait, presque en entier, une feuille de papier pour écrire un seul numéro de téléphone.
Par conséquent, elle achetait fréquemment des blocs de papier, mais pas assez fréquemment selon son fils schizophrénique. Étant de retour après avoir acheté au coin un nouveau bloc, elle ne prenait le plus souvent qu’une moitié pour elle-même et alors, en bonne mère, elle en offrait à son fils l’autre moitié, la plus forte, quoiqu’en lui demandant en anglais et d’une voix haute et perçante : « Veux-tu un bloc de papier ? » Il pensait, il se sentait à peu près certain qu’elle eût très bien su qu’il se fâcherait presque à coup sûr à cause de cette question si elle était posée en anglais ; et de plus, sa voix semblait au jeune homme aliéné exprimer un quelque chose de taquinant, ce qui ajoutait beaucoup à la détresse causée à lui par cette question.
Louis Wolfson, Le Schizo et les langues, préface de Gilles Deleuze, Bibliothèque de l’inconscient, Gallimard, 1970, p. 164-165.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis wolfson, le schizo et les langues, gilles deleuze, mère, oubli, langue maternelle | ![]() Facebook |
Facebook |





