02/01/2013
Eugène Delacroix, Journal

Pourquoi commencer la rédaction d'un Journal quand on a 26 ans et que l'on se voue à la peinture ? Dès les première lignes écrites en 1822, Delacroix se fixait un objectif : « Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul ; je serai donc vrai, je l'espère ; j'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. ». Le projet de se contrôler, de s'éloigner du monde extérieur pour réfléchir sur le moi, échouera relativement vite puisque la rédaction sera interrompue après trois années et ne sera reprise qu'en 1847. Ce n'est plus alors le même Delacroix qui prend des notes dans des carnets. Il a une œuvre de peintre derrière lui, il a voyagé notamment au Maroc et en Andalousie, il a beaucoup lu, il est devenu selon Baudelaire (Salon de 1846) un « grand artiste, érudit et penseur » et son souci n'est plus de s'interroger sur son identité. Baudelaire encore, rendant compte de l'exposition universelle de 1855, le définissait ainsi : « Il est essentiellement littéraire [...] par l'accord profond, complet, entre sa couleur, son sujet, son dessin, et par la dramatique gesticulation de toutes les forces spirituelles vers un point donné ». Ce lien établi entre le littéraire et le pictural est un des motifs récurrents du Journal.
Tourner autour de ce qui distingue la peinture de l'écriture répondait pour Delacroix au projet d'élaborer une écriture de peintre. Michèle Hannoosh analyse précisément en quoi il rompt avec les idées dominantes ; elle résume la théorisation faite au XVIIIe siècle par Lessing, pour qui la « temporalité de la littérature permet la narrativité, la causalité et donc l'unité » alors que la peinture, entière devant le spectateur, ne pourrait engendrer que des impressions confuses et sans ordre. Pour Delacroix, au contraire, le tableau donne en même temps la vue de la réalité et sa représentation expressive, ce qui provoque « une perception unie de la matière et de l'esprit », idée que souligne M. Hannoosh. Ces réflexions de Delacroix ont des rapports avec la manière dont il rédige son Journal. L'éditrice décrit les manuscrits comme un « document complexe, hybride, chaotique, labyrinthique » ; c'est que la construction du Journal donne au lecteur cette liberté qu'il a devant un tableau, sans suivre les règles d'un genre, règles vigoureusement rejetées dans tous les domaines : « Sur la ridicule délimitation des genres. Rétrécit l'esprit. L'homme qui ne fait que le trou d'une aiguille toute sa vie ».
Lisant le Journal, on se repère dans le temps grâce aux dates de rédaction, mais la chronologie est très souvent en défaut dans la mesure où Delacroix laisse parfois plusieurs jours entre ce qu'il a vécu et l'écriture, introduit dans son texte des documents (listes d'adresses, coupures de journaux, billets de chemin de fer, etc.), traces de la vie quotidienne à côté de ses développements sur son travail de peintre, sur ses rencontres, sur les événements. En outre, il renvoie régulièrement à un autre endroit de ses carnets, n'hésite pas à modifier ce qui a été écrit plusieurs mois auparavant et à le commenter.
Ces pratiques brisent la narrativité et construisent une temporalité complexe ; éloignées de l'écriture habituelle du journal intime, elles aboutissent à multiplier les points de vue du lecteur, ce qui répond à l'idéal de Delacroix, qui notait qu'« Un homme d'esprit sain conçoit toutes les possibilités, sait se mettre, ou se met à son insu, à tous les points de vue ». Défendant sans cesse, à l'exemple de Montaigne, le caprice de la pensée, la nécessité de prendre en compte le caractère divers de l'esprit, il affirmait en moraliste « Il y a dix hommes dans un homme, et souvent ils se montrent dans la même heure ». En outre, la réécriture de notes font du passé un matériau qu'il est possible d'utiliser dans le présent. La chronologie devient relative, ce qui importe alors est de penser un temps souple, sujet à variation : la continuité temporelle — c'est-à-dire la croyance au progrès ou à la décadence — est exclue, et Delacroix affirme à diverses reprises « la nécessité du changement. Il faut changer : Nil in codem statu permanent ».
Ce point de vue implique que l'activité intellectuelle occupe une place importante. Certes, Delacroix vivait dans l'institution, fréquentait les cercles officiels, appartenait au Conseil municipal de Paris, mais il allait aussi au concert, à l'opéra, au théâtre, lisait ses contemporains français (Baudelaire, Sand, Balzac) ou non (Dickens, Poe, Tourgueniev), recopiait des extraits, et il écrivait « Je me suis dit et ne puis assez me le redire pour mon repos et pour mon bonheur — l'un et l'autre sont une même chose — que je ne puis et ne dois vivre que par l'esprit ; la nourriture qu'il demande est plus nécessaire à ma vie que celle qu'il faut à mon corps. » Noter ses impressions, c'est en les approfondissant développer ses idées, non pas pour "inventer" du nouveau, mais pour comprendre comment les exprimer de manière nouvelle. Cette vie de l'esprit a parallèlement un autre rôle, souvent souligné dans le Journal, lutter contre l'ennui ; Delacroix vit dans le siècle du chemin de fer, qui réduit les distances et fait "gagner" du temps, ce qui ne change rien au sentiment d'ennui que beaucoup éprouvent. Ces lignes de 1854, « Nous marchons vers cet heureux temps qui aura supprimé l'espace, mais qui n'aura pas supprimé l'ennui », font écho à cet aveu de 1824, « Ce qui fait le tourment de mon âme, c'est la solitude ».
Écrire, c'est retenir ce qui est vite perdu, la mémoire ne pouvant tout emmagasiner ; un tri s'opère et la plus grande partie de ce qui est vécu, éprouvé, sombre dans l'oubli. Delacroix note à plusieurs reprises l'intérêt de pallier la faiblesse de la mémoire — « Il me semble que ces brimborions écrits à la volée, sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu'elle s'écoule ». Ne rien avoir noté, c'est n'avoir pas existé... C'est la mémoire du Journal qui établit une continuité en fixant ce qui est par nature éphémère, l'expérience du temps, notre « passage d'un moment ». Pour le lecteur d'aujourd'hui, le Journal de Delacroix ne fait pas que livrer le visage d'un peintre, il est aussi un tableau varié et complexe, sans doute partial et lacunaire (et intéressant pour cette raison), de la vie de la bourgeoisie et de milieux intellectuels au XIXe siècle. Il est aussi très souvent l'ouvrage d'un moraliste, sans complaisance pour lui-même et sans illusion sur ses contemporains ; même s'il devient plus mesuré avec l'âge, il ne varie guère dans le jugement noté en 1824 : « Le genre humain est une vilaine porcherie ».
Au Journal proprement dit, l'éditrice a ajouté une masse considérable de textes, qui donnent un éclairage indispensable pour la connaissance de Delacroix. Pendant la rupture d'un peu plus de vingt ans — interrompu en 1824, le Journal ne reprend qu'en 1847— sont écrites les pages du "Voyage au Maghreb et en Andalousie" et de très nombreux textes qui prolongent les réflexions du peintre : carnets et notes variées sur des peintres, des voyages, des lectures, des expositions, carnets et notes parallèles ensuite à la rédaction du journal jusqu'à la mort en 1863. Des pages de Pierre Andrieu, principal assistant de Delacroix et qui joua un rôle important dans la conservation du Journal, rapportent des propos du peintre. Outre les variantes du Journal (dont on connaît plusieurs copies), Michèle Hannoosh a préparé une série d'annexes qui font désormais de cette édition un grand ouvrage de référence, avec notamment un imposant répertoire biographique, un index des œuvres de Delacroix, un autre des noms de personnes, une bibliographie qui complète les indications données dans les notes. Les notes, quant à elles, abondantes et précises, apportent toutes les renseignements nécessaires à la compréhension d'une époque.
Eugène Delacroix, Journal, nouvelle édition intégrale établie par Michèle Hannoosh, 2 tomes, José Corti, 2009.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène delacroix, journal, peinture, point de vue, genre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2013
Samuel Beckett, Molloy

I
Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidé. Seul je ne serai pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne n peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela 'a pas d'importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c'est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n'ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles, il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D'ailleurs je ne les relis pas. Quand je n'ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l'argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J'ai pris s aplace. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu'un fils. J'en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C'était une petite boniche. Ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j'ai encore oublié son nom.
Samuel Beckett, Molloy, éditions de Minuit, 1951, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, chambre, oubli, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2012
Claude Dourguin, Les nuits vagabondes
Je ne sais quel incident, retard pris dans le dédale des déviations, de routes secondaires non signalisées, nous fit arriver aux abords d'une petite cité maritime bien après le coucher du soleil. Heure, lassitude, il n'était pas question de poursuivre. Un toit ? Il n'y pensait pas. L'air, très doux, balançait les étoiles pâles au ciel, dans la perspective d'une avenue vaguement industrielle des bâtiments cubistes découpaient l'ombre, côté terre de grands pylônes inscrivaient pour les visiteurs d'autres planètes leurs chiffres cabalistiques. Pour une fois, ils semblaient porteurs d'une beauté — futuriste et, si l'on songeait à l'énergie mystérieuse dont ils supportaient les fils — vaguement mystique. Une petite route transversale prise au hasard permit de s'éloigner un peu, découverte en bout de champ voué à la culture maraîchère une banquette d'herbe, nous nous installâmes ente deux couvertures. Sur l'Ouest, une grande lune rousse s'était levée, hésitante derrière un voile de nuages blancs d'une extrême finesse. Pleine, elle se tenait proche, d'une taille, semblait-il excessive, grand œil distrait ouvert sur la scène. Au ciel gris bleu sans profondeur, éteint par d'imperceptibles nuées en bandes longues, errantes, on ne distinguait plus que quelques étoiles, discrètes. La nuit se tenait coite dans l'air humide et tiède, nul indice ne permettait de se situer, campagne indéterminée, incertaine peut-être même, ville campagne pour Alphonse Allais ? L'étrangeté venait de cette indéfinition tranquille, de ce suspens sous l'œil chassieux de la lune et de l'absence sans traces de ce pourquoi nous nous étions mis en route.
Un sommeil bref fut le lot de ce que j'éprouvai comme une traversée les yeux bandés. Vers cinq heures, un gigantesque bruit de ferraille à quoi se superposa puis se mêla, chaos tonitruant, celui de moteurs — automobiles, camions, dont on entendait passer les vitesses, accélérations, l'une derrière l'autre, moulinettes aiguës, ou, courtes saccades de gros transporteurs ; décélérations brèves, diminuendo, il devait y avoir un feu rouge proche —, ce vacarme secoua l'aube, très vite s'intensifia puis finit, à la manière d'un gaz, par occuper la totalité de l'espace.
Claude Dourguin, Les nuits vagabondes, éditions Isolato, 2008, p. 27-29.
© Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, les nuits vagabondes, voyage, sommeil, bruit | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2012
Pierre Michon, Les Onze

Je vous prie, Monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci : que savoir le latin quand on est Monseigneur le Dauphin de la Maison de France et le fils de Corentin la Marche, ne sont pas une seule et même chose ; ce sont même deux choses diamétralement opposées : car quand l'un, le dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être, dont il fait lui-même partie, et que levant les yeux par ailleurs entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des Tuileries le grand jet d'eau du grand bassin et derrière le grand bassin sur les chevaux de Marly la Renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de cave gorgée de vin, l'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent, à la fois le triomphe magistral de ce qui est, et la négation de lui-même, qui n'est pas : il y voit que ce qui est, même et surtout si ce qui est paraît beau, l'écrase comme du talon on écrase une taupe.
De cela , Monsieur — et surtout de ce que Corentin le père bien sûr ne savait pas lire, mais encore à peine parler, et seulement patois, excellait seulement dans le savant mélange de vins violets et d'alcools blancs ; de ce que sa présence, sa vie, était à elle seule pour qui lit Virgile, une honte inexpiable (ce qui bien sûr quand on lit Virgile, quand vraiment on le lit avec le cœur, et non pas à la façon déboussolée d'un écolier limousin, est un solécisme inexpiable, mais ceci est une autre affaire) ; de ce que, privé de langage, le père l'était aussi de ce qu'on appelle l'esprit ; que d'ailleurs s'il s'était avisé d'avoir de l'esprit et de jurer lui aussi que Dieu est un chien cela aurait donné quelque chose d'informe qu'on peut transcrire à peu près par Diàu ei ùn tchi, une sorte d'éternuement — de cela tout découle, tout ce qui nous intéresse : la curiosité intellectuelle, la volonté, l'âpreté littéraire, et pour finir l'impeccable réversion de l'injure patoise en petits sonnets anacréontiques ; le grand couteau limousin tout à fait dissimulé dans des bouquets de fleurs versifiables [...]
Pierre Michon, Les Onze, Verdier, 2009, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, les onze, le latin, virgile, dividion sociale | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2012
Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde
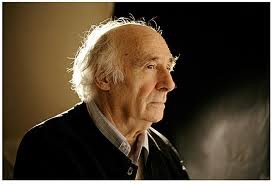
La vache : description
La
Vache
Est
Un
Animal
Qui
A
Environ
Quatre
Pattes
Qui
Descendent
Jusqu'
À terre.
L'escargot
Il passe comme un paquebot
dans l'herbe tremblante de pluie
quand les araignées essuient
leurs toiles car il fait beau
J'ai toujours aimé l'escargot
son pas frais luisant et sans bruit
sa navigation dans la nuit
le long des murs, vivant cargo
on en retrouve le sillage
le matin, brillant au soleil
Où va l'escargot, qui voyage
dans le noir cornes en éveil ?
En haut du fenouil, en équilibre
il médite sur les étoiles libres.
Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde,
poèmes illustrés, Seghers, 1990, p. 74, 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, les animaux de tout le monde, la vache, l'escargot, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2012
Andreï Voznessenski, La poire triangulaire

Je m'exile en moi...
Je m'exile en moi
je suis mon faubourg
flambent mes sapins refermés
sur mon visage trouble comme un miroir
sombrent les élans et les pergolas
je suis le fleuve et je suis l'univers
qui passe encore au-delà de mon horizon
trois soleils rouges saignent parmi
trois bosquets tremblants comme des vitraux
trois femmes luisent en une seule
comme des cubes l'un dans l'autre
l'une m'aime et rit aux éclats
l'autre en elle bat des ailes
et la troisième dans un coin
hérissée comme un charbon ardent
ne me pardonne pas
et veut encore se venger
et son regard s'illumine comme une pièce
au fonds d'un puits.
Andreï Voznessenski, La poire triangulaire, poèmes traduits
du russe par Jean-Jacques Marie, Denoël/Les Lettres
Nouvelles, 1971, p. 49-50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andreï voznessenski, la poire triangulaire, exil, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2012
Isabelle Sbrissa, Travaux d'Italie

Bagno
Nuvenia si adatta Neuvaine il s'assit à dada
Perfattemente — Perds cette amante ! Hé !? —
Al tuo corpo Elle le tue au corps ! Peau
Davanti e dietro D'amant tiédit trop
Seguendoti Sa couenne d'ôtée
In ogni movimento — un honni mauvais manteau
Indirizzi
Eduardo Laudizi Un doigt ardent m'ôte d'ici
Piazza Fossatello puise et s'enfonce, ah ! ciel oh !
Genova gêne au vent !
Ivo La Manna Lui fol, à mon nez
64, via Sturla sexe entra, écarta, vrillé à cet ourlet
Genova d'hygiène en vain
Paolo Secchi Il me lime la lélé
Via Lemerele, 21 il me lune la méré
Voltri la lélelle
la marelle
la lunelle
j'en suis toute illuinée
ma lunule brille comme une muline
enfilée
il me mémet sa lumune embuée
embavée
ô Paolo
lumine-moi la lune
scie-moi la quèche
assèque-la
atrique-la
détraque-moi
détache-la
laisse-la liniller au loin là-bas
lyrer
triller
spiriller
esprier
ô abrille mon ciel noir
élunis-moi sans frein
[...]
Isabelle Sbrissa, Travaux d'Italie, dans Grumeaux, "Violence", n° 3, 2012, éditions NOUS, p. 8, 9, 10, 13, 14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle sbrissa, travaux d'italie, jeux de langue | ![]() Facebook |
Facebook |
26/12/2012
Catherine Pozzi, Très haut amour

Chanson sans gestes
Sur la planète de douleurs
Les roses vont jusqu'au ciel même.
Devant le mur d'azur tu meurs
Du mal qui vient d'ailleurs.
Soleil, soleil fleur de souci
Touche un cœur de ta pointe extrême
Le rayon jeté sans merci
Du passé jusqu'ici.
Mon cœur est une rose aussi
Il est plein de rois et de reines
Ils ont vécu ils ont fini
Ils souffrent où je suis.
Ils ont dormi ils ont péri
Ils s'éveilleront si je t'aime.
Un trait les touche sans merci
L'amour n'est pas l'ami.
Ô prisonniers ! dormez ainsi
Ne quittez les ombres suprêmes
La caresse est blessure ainsi
Le soleil passe aussi.
Catherine Pozzi, Très haut amour, édition de
Claire Paulhan et Laurence Joseph,
Poésie/Gallimard, 2002, p. 63-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, très haut amour, rose, amour, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
25/12/2012
André Frénaud, Hæres

Scène de théâtre sur la place
Deux ou trois filles à califourchon au sommet de l'escalier à double rampe, sur la tribune baroque adossée à la façade, d'où partaient autrefois les proclamations. Elles sont là qui jabotent, elles tapotent la vieille pierre de leurs jambes gainées de cuir.. Et l'on dirait qu'elles tiennent la dragée haute à un petit groupe confus en bas des marches, de soldats et quelques civils qui marmonnent parmi l'obscurité... Ils ne cherchent as à grimper. Tout au plus, entre les niveaux, des bouts de phrase viennent, vont... Se relient-ils... Se relaient-elles ? Allusions blagueuses, effronterie, apeurement... C'est ainsi qu'ils s'entretiennent.
Puis, arrivent des motocyclistes, paradant, pétaradant... qui s'arrêtent, abrupts, chuchotent quelques mots, déjà repartent avec en croupe parfois une fille où un garçon.
Du menu peuple passe, qui rentre chez soi.
C'est à la nuit tombante, sur une place autrefois glorieuse, devant la vieille église qui s'encrasse, le train-train de cette scène recommencée chaque jour pour faire patienter et pour divertir de l'inépuisable, de l'inutile foisonnement...
Ont-ils le sentiment d'amorcer un spectacle ? Il n'y a pas de pièce déjà écrite. Il ne s'en improvisera pas. On pourrait imaginer qu'une fois ou l'autre : sédition massive, affrontements entre quartiers, viols...
Mais cette sorte d'événement saurait-elle résoudre le vide, l'attente interminable ?
André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1882.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, scène de théâtre, l'attente, le vide | ![]() Facebook |
Facebook |
24/12/2012
Paul Claudel, Accompagnements

Du côté de chez Ramuz
III
Le français parlé est beaucoup trop oublié aujourd'hui au profit du français écrit, qui est un français écrit artificiel et desséché et qui a apporté une contrainte détestable à notre "parlure" vivante, matière infiniment délectable.
La grammaire ne devrait pas être autre chose qu'une recommandation prudente du meilleur usage et le musée des formes les plus délicates de l'idiome. Rien ne lui donne le droit de s'arroger l'autorité d'un code.
Le grammairien a des principes ridicules : celui-ci entre autres, qu'une forme n'est légitime que quand elle est analysable rationnellement.
Il proscrira donc ces formes charmantes "écoutez voir", nous deux lui", parce qu'elles ne sont pas analysables grammaticalement. Émile Faguet condamne "nous deux li", mais il n'hésite pas à écrire "en en enlevant".
La plus grande mauvaise foi règne dans toutes ces questions. Toutes les grammaires à partir de Vaugelas indiquent que la règle du bon parler français est l'usage, mais en réalité on ne tient aucun compte de cet usage né des nécessités du français tel qu'il est fait pour nos poumons et notre boîte sonore. J'ai fait l'éducation de mes cinq enfants. Tous ont dit naturellement "pareil que" au lieu de "pareil à". N'importe, les millions de petits Français qui ont employé cette locution depuis les Serments de Strasbourg ont tort et c'est une demi-douzaine de pédants sans contact avec la vie et la réalité qui a raison. On dit "va-t-en", mais on ne peut dire "il va-à-Paris". "Je pars à Paris" est la véritable forme phonétique. "Je pars pour Paris" est une bouillie imprononçable. "Malgré que" est phonétiquement excellent. "Quoique", "bien que", au contraire, sont des freins usés et claqués.
Aussi il ne faut pas être surpris de constater que grammairiens, pédants et néo-classiques aient fait la conspiration du silence autour du très grand romancier C.-F. Ramuz qui a apporté tant de nouveauté : vocabulaire, syntaxe, tant d'invention dans les tours, les dessins, et l'emploi de "tous" les temps au lieu de l'éternel imparfait.
Paul Claudel, Accompagnements, dans Œuvres en prose, textes établis et annotés par Jacques Petit et Charles Galpérine, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 585.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, accompagnements, ramuz, norme, grammaire, français parlé | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2012
Guillevic, Du domaine
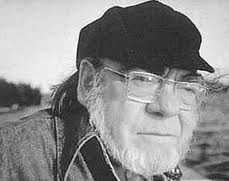
La bonne chaleur
Que les talus
Cajolent.
°
Une lumière
A goût d'humus
Où le temps
Se préparerait.
°
Dans le domaine
Tout peut faire peur
À qui ne l'invente pas.
°
L'étang
N'éclatera pas.
°
L'horizon
Nous condamne au cercle.
°
Et ces pigeons
Qui revenaient
Nous étaler
Leurs mouvements
Trop réussis.
Guillevic, Du domaine, Gallimard,
1977, p. 68-69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, du domaine, lumière, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2012
Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia

À main droite,
ma manie de manipuler,
démantibuler,
désaxer et malaxer les mots,
pour moi mamelles imméoriales,
que je tète en ahanant.
Murmure barbare, en ma Babel,
tu me tiens saoul sous ta tutelle
et, bavard balourd, je balbutie.
À ma in gauche,
mes machins,
mes zinzins,
mes zizanies,
les soucis (chichis et chinoiseries) qui me cherchent noise,
mes singeries, momeries et moraleries.
Ô gagâchis qu'agacé j'ai vaguement jaugé et tout de go gommé,
jugeant superfétatoirement enquiquinant son chuchotis !
Au milieu,
le mal mou qui me moud,
me mord,
me lime, m'annule,
m'humilie
et que, miel amer, je mettrais méli-mélo à mille lieues
mijoter,
mariner,
macérer.
M'at-il dit que ce monde dément demande un démenti,
le démon qui m'enmantèle, m'emmêle et me démantèle ?
Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia, Gallimard,
1981, p. 176-177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d'olympia, jeu des sons, allitération | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2012
Chloé Bressan, le chant de le femme d'argile

Par un scintillant un rayon de jour brodé sur le temps, chiffre un, étoilé, recommence janvier. Grise étendue de ciel, grisance paradis éternel par un scintillant un rayon de jour brodé sur le temps, chiffre deux, glissant sourire parallèle par un scintillant un rayon de jour brodé sur le temps, chiffre un, étoilé, recommence par un scintillant, un rayon de jour brodé par un scintillant un ...
À son rêve
elle oppose un sourire
muet
des lézardes le long de l'échine
elle est
immobile
vision opaline, regard pierreux
sans refuge
son beau visage mais de peur
effraie le passant qui
de regard
s'arcboute
se rétracte
s'abîme au soir transi
[...]
Chloé Bressan, le chant de le femme d'argile, éditions
isabelle sauvage, 2012, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chloé bressan, le chant de le femme d'argile, visage, regard, le temps | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2012
François Bon, Sortie d'usine

[...]
Bruits désordonnés, des sons extorqués par le viol de l'usage, les choses disséquées par la distension extrême en elles des résonances. Comme règle : faire du bruit sans règle, et la dissonance même n'aurait pu advenir deux fois consécutives, qu'on savait toujours briser en lui extorquant plus encore de dissonnement. Quant à la destruction de la chose si l'on n'en tirait pas l'apothéose dans la douleur sursaturée qui excluait par sa surdité sifflante le bruit même, le lendemain on réparerait.
Tout : l'outil, l'acier, le cri, moteurs, air comprimé, tout ce qui ici était susceptible de manifestation bruyante, dans cette seule condition de libérer une sonorité qui ne soit pas en deçà du bruit général mais atteigne l'intenable où cela commence vraiment à faire mal. Non pas un instrument de plus dans le tohu-bohu général, mais un bris du son même dont la règle n'était que de l'en faire jaillir à l'excès dans la provocation sans limite des choses.
Les choses : tout, ici où se mettaient en œuvre des puissances amplifiant la main de l'homme, faisait au choc réponse sonore, puissances qu'il suffisait d'exciter pour que la réponse outrepasse les possibilités auditives de l'homme qui en était pourtant l'origine et la cause, en fasse le catalyseur seulement de ce qui lui était devenu à lui-même insoutenable. Il n'y avait qu'à. Et frotter, forcer, battre, racler. On tapait et cognait, cela sifflait et craquait. Une barre de fer, un marteau, contre l'établi, le bâti de machine, le poteau de charpente, et quelque force encore humaine qui les jetât contre dans la luminosité violente du choc elles demeuraient, les choses, par-delà les résonances, identiques à elles-mêmes, bosselées peut-être, éraillées, tordues, mais intactes dans leur fonctionnalité, et provocantes dans leur puissance figée à plus bruit, pire encore.
François Bon, Sortie d'usine, éditions de Minuit, "mdouble", 2011 [1982], p. 80-81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois bon, sortie d'usine, bruit, dissonance | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2012
Gabrielle Althen, Vie saxifrage

Sur la place
Le jour commençait une rose
La rose était transparente et amène
La patience ne serait plus nécessaire
Les routes auraient des jeux ardents
Tu serais défeuillé de tes hésitations
Nu contre la paroi de verre noir de ton vœu
L'orient en est à blanc et la simplicité totale
*
Mais il y eut des jours de pleurs sans indigence
Des vagues émanaient du profond du mystère
En soutenant le gris de la lumière
Les enfants interdits qui cessaient de jouer
Penchés en rond sur le moment
Oubliaient en riant de poser leurs questions
Et l'on se chérissait dans les anneaux du paysage
Gabrielle Althen, Vie saxifrage, Al Manar / Alain
Gorius, 2012, p. 47 et 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabrielle althen, vie saxifrage, rose, mystère | ![]() Facebook |
Facebook |






