12/01/2021
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette
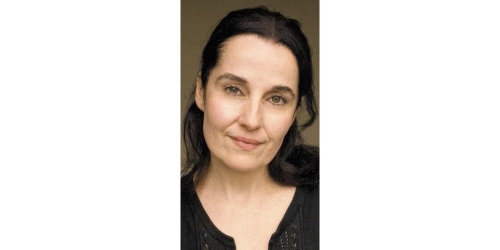
Reflet 1
Lèvres dévastées, le rouge vif déborde, les yeux sans fin au contour aguicheur, elle s’accroupit (pagne mauve lèvres offertes tee-shirt près du corps), regarde au loin, les traces noires autour des yeux, sourcils maladroitement repeints de la main d’une enfant, la lumière opaque, moue d’une fillette, rayons roses sur le corps, secret de la paille autour de ses cuisses refermées, elle s’imagine de l’autre côté du miroir.
Reflet 2
Les draps noirs sur les seins, dessein caché de l’autre monde. La dentelle d’une bretelle soutient la gorge dorée, dorure éternelle, les cheveux blonds, délavés par temps orageux, embroussaillés, sa bouche enflammée, le rouge dévie, regard docile presque doux (les pleurs ou le discours indicible d’une nuit blanche) elle tient au cœur du corps le drap froissé, elle, blonde à gémir, l’œil glauque et langoureux, désir tiède de l’autre corps, luxure des lumières, l’éclat de sa peau, en plein jour, émaillée.
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion, 1997, p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, reflet | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2021
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Tu m’aimas dans la fausseté
Du vrai — dans le droit au mensonge,
Tu m’aimas — plus loin : c’eût été
Nulle part ! Au-delà ! Hors songe !
Tu m’aimas longtemps et bien plus
Que le temps. — La main haut jetée ! —
Désormais :
-
-
-
-
-
-
- Tu ne m’aimes plus ! —
-
-
-
-
-
C’est en cinq mots la vérité.
12 décembre 1923
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de Tentative
de jalousie, traduction Pierre Léon et Ève Malleret,
Poésie / Gallimard,1999, p.119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, suivi de tentative de jalousie | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2021
Raymond Queneau, Fendre les flots

La moule de l’estuaire
Collée au pilotis sapeur sachant saper
se balançant aux sons de l’orchestre tzigane
la bestiole paisible aime la société
les remous de la mer et le contact des algues
et la caresse des vagues inextinguibles
elle dort bien tranquille étant incomestible
longtemps longtemps longtemps elle pourra bercer
sa placide nature au flonflons des violons
Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,
1969, p. 116.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, la moule de l'estuaire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2021
Raymond Queneau, Battre la campagne

Le citadin aux champs
Abuser du temps qui passe
soustraire l’air d’une souris
piocher dans le beurre en motte
atteindre l’eau d’un coup de scie
piétiner l’or de la crotte
étreindre le blé sans épis
insulter mouche qui trotte
sermonner les poux des brebis
abuser du temps qui passe
voilà tout ce qu’à la campagne
fait le monsieur de Paris
Raymond Queneau, Battre la campagne,
Gallimard, 1968, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2021
Raymond Queneau, Courir les rues

Tous les parfums de l’Arabie
Il y avait un passage Waterloo
on l’a démoli
c’est qu’on est patriote à Paris
alors pourquoi une rue Jules César
l‘ennemi juré des Gaulois
ces ancêtres
elle se musse non loin de la gare de Lyon
et quel air banal
soudain cette odeur
plantes aromates épices tropiques
effluves fragrances botaniques
garrigues de Provence jardins d’Ispahan
je fonce et flaire
le CPM fondé en 1901 m’attire
le CPM c’est-à-dire
l’omptoir harmaceutique oderne
mais non ce n’est pas là
je fonce et flaire et découvre
Les Bons Producteurs
vente en gros
herboristeries de toute provenance
Les Bons Producteurs
ont la bonne odeur
mais elle ne va pas plus loin que le boulevard de la Bastille
en face de l’autre côté du canal
s’assirent sur un banc Bouvard et Pécuchet
comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés
Raymond Queneau, Courir les rues, Gallimard, 1967, p. 155-156.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, courir les rues, tous les parfums de el'arabie | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2021
Bernard Noël, L'été langue morte
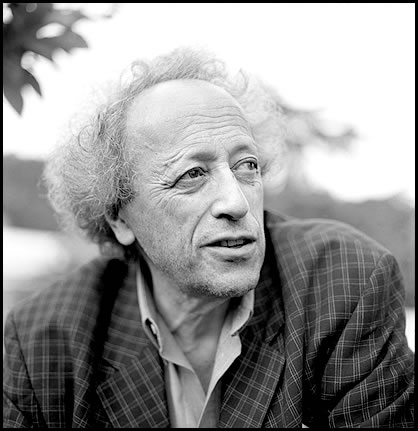
L’été langue morte
Chant I
le monde n’est pas fini
et quand le vent se ève
notre visage est différent
l’amour défait l’amour
pour devenir plus que lui-même
qui va mourir
sait que la beauté est inexorable
je regarde ton souffle
tu t’évapores
l’obscur du temps est un ongle
derrière l’œil
il faudrait tenir sa langue
jusqu’au commencement du monde
la lumière est terrible
la mer ressasse
tu cherches un point parmi le jour
le présent est sans but
sans contour
et le sommet des pierres
ne connaît pas leur ombre
(...)
Bernard Noël, L’été langue morte, dans
Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P.O.L, 2010, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, l’été langue morte, les plumes d’Éros | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2021
Pierre Reverdy, Sable mouvant

Clair mystère
Par-dessus le portique où s’enroule la treille et ou chante l’oiseau — À la fenêtre où se dressent une tête et un buste immobile. Derrière le mur qui penche et l’air qui s’éblouit, un œil à demi clos qui attend le signal.
Pierre Reverdy, Sable mouvant, Poésie / Gallimard, 2003, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, sable mouvant, clair mystère | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2021
Jules Renard, Journal, 1887-1910
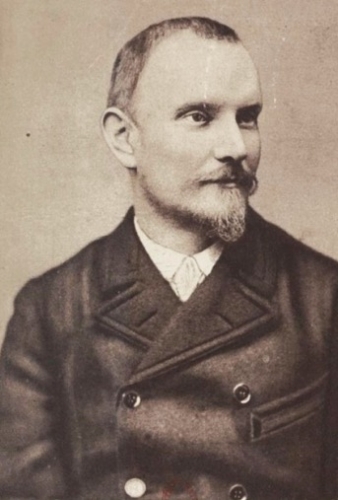
Prononcer vingt-cinq aphorismes par jour et ajouter à chacun d’eux : « Tout est là ! »
La mélancolie soudaine de celui à qui l’on dit : « Vous savez que je pars en voyage ? »
Les enfants devraient être des apparitions facultatives.
J’aime lire comme une poule boit, en relevant fréquemment la tête pour faire couler.
Si vous pensez du bien de moi il faut le dire le plus vite possible, parce que, vous savez, ça se passera.
Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 202, 203, 203, 205, 206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, aphorisme, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2021
Jules Renard, Journal, 1887-1910
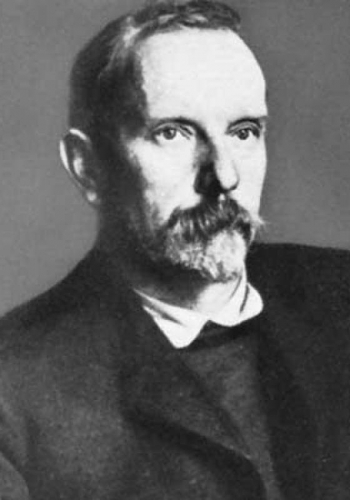
Il a chassé le naturel : le naturel n’est pas revenu.
Soyez tranquilles ! nous qui avons peur de la mort, nus mettrons toute notre coquetterie à bien mourir.
Vivre et juger sa vie : quel est l’homme capable des deux ?
Il n’y a pas d’amis : il y a des moments d’amitié.
À sa pièce, on lui serra la main comme pour l’enterrement d’un être cher.
Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 195, 196, 196, 197,198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, naturel, amitié | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2021
Georges Lambrichs (1917-1992), Les Rapports absolus

C’est le geste qui coûte
Une grande froideur fait le jeu de l’histoire, notre destin s’y trouve mêlé et, hâtivement, nous adoptons par mimétisme, un souci logique, vulgaire, bien étranger à notre être qui est composé de fluides et d’humeurs. Je n’en veux, ici, ni à la morale, ni à l’immoralisme tapageur (dont on a pu voir les éclats déjà anciens, divulgués, les réussites esthétiques). Je dis seulement que l’être, notre nature, ne répondent pas à la parole, aux commandements graves, et que l’usage de la parole qui est essentiellement calculateur et médiateur ne véhicule pas la passion, mais qu’il la cogne. Si la vérité est un sens, la passion doit être mise en théorie, et le malheur est donné par surcroît.
(...)
Georges Lambrichs, Les Rapports absolus, collection Métamorphoses, Gallimard, 1949, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, les rapports absolus, geste, maheur, réussite | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2021
Wislawa Szymborska (1923-2012), De la mort sans exagérer

Photo Anna Kaczmarz
Buffo
D’abord notre amour passera,
puis un siècle, un autre siècle,
puis, nous serons réunis :
comédienne et comédien,
favoris du grand public,
au théâtre on nous jouera.
Petite farce avec couplets :
quelques danses, éclats de rire,
Bien saisies, les mœurs de l’époque,
sous vos applaudissements.
Tu seras irrésistible
sur scène, avec ta cravate
et tes crises de jalousie.
Ma tête toute retournée,
ma tête, mon cœur couronnés,
cœur stupide qui se brise,
couronne qui roule par terre.
Nous quitterons, nous retrouverons,
toute la salle rire nous ferons,
sept rivières, sept montagnes
entre nous érigerons.
Comme si nous n’avions pas assez
de douleurs, et de défaites
— de paroles nous achèverons.
À la fin nous saluerons
et la farce sera finie.
Et les gens iront dormir
contents d’avoir bien ri.
Eux, vivront comme des images,
dompteront l’amour. Le tigre
dans la main leur mangera.
Et nous toujours Dieu sait quoi,
bouffons de clochettes coiffés,
écoutant d’oreille barbare
leur tintamarre.
Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer,
Poèmes 1957-2009, traduction du polonais
Piotr Kaminski, Poésie/Gallimard, 2018, p. 13-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wislawa szymborska, de la mort sans exagérer, jalousie, bouffon | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2020
Georges Perros, Poèmes bleus
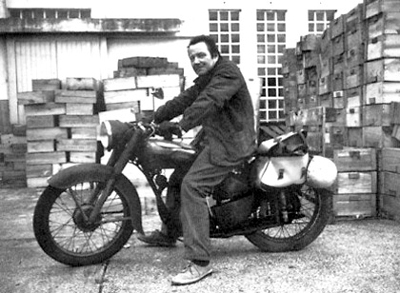
Entre nous
Alors quoi de neuf cher ami ?
Ça va ça va ça va merci.
Et le prochain livre il s’annonce
Bien ? Non ? — Maizoui, maizoui, maizoui.
J’ai relu par temps clair, le tome
Premier de l’œuvre de cet homme,
Ah son nom dites-moi son nom
Ma mémoire est comme un poisson
Elle saute vole et replonge
Allez-y voir. Mais quand j’y songe
Vous écrivez. C’était fort bien
Votre article, oh pas moins que rien.
Vous donnez là votre mesure
On s’entend mieux quand on rassure
L’amour-propre de son prochain
À bientôt cher ami machin
Mais les noms vraiment je m’y perds
Bast rien ne sert à rien. J’espère
Que nous reverrons bientôt
Botzaris 22-cigalo...
La solitude est éphémère
Comme le coq de ce clocher
Elle s’en va s’en vient. Ma mère
Aurait dû me laisser plié
Dans son ventre. J’aurais poussé
Jusqu’à ne plus me reconnaître
Elle non plus. C’en est assez
Pour aujourd’hui. À d’main peut-être.
Gorges Perros, Poèmes bleus, Le Chemin /
Gallimard, 1962, p. 100-101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gorges perros, poèmes bleus, nom | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2020
Serguei Essenine, Journal d'un poète
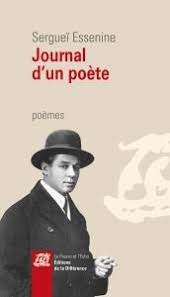
Caravelles-haridelles
I
Si le loup hurle à l’étoile, c’est
que les mers ont englouti le ciel.
Haridelles éventrées,
noires voilures des corbeaux.
Des hoquets nauséabonds du blizzard
l’azur ne sortira pas ses serres ; il plane
sur un jardin de crânes jonché d’aiguilles d’or,
sous le hennissement des tempêtes.
Entendez-vous ? entendez-vous ce cliquetis ?
Ce sont les râteaux de l’aube dans les bosquets.
Avec des rames de mains coupées
vous souquez vers le futur.
Voguez, voguez vers les hauteurs !
De l’arc-en-ciel craillez corneilles !
L’heure vient où la feuillée jaune de ma tête
va se muer en arbre blanc.
(...)
Serguei Essenine, Journal d’un poète, traduction
Christiane Pighetti, éditions de la Différence,
2014, p. 183.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serguei essenine, journal d’un poète, caravelles, haridelles, corbeaux | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2020
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À UNE ROSE
Rose, rose-d’amour vannée,
Jamais fanée,
Le rouge-fin est ta couleur,
Ô fausse-fleur !
Feuille où pondent les journalistes
Un fait-divers,
Papier-Joseph, croquis d’artistes :
— Chiffres ou vers —
Cœur de parfum, montant arôme
Qui nous embaume…
Et ferait même avec succès,
Après décès ;
Grise l’amour de ton haleine,
Vapeur malsaine,
Vent de pastille-du-sérail,
Hanté par l’ail !
Ton épingle, épine-postiche,
Chaque nuit fiche
Le hanneton-d’or, ton amant…
Sensitive ouverte, arrosée
De fausses-perles de rosée,
En diamant !
Chaque jour palpite à la colle
De la corolle
Un papillon-coquelicot,
Pur calicot.
Rose-thé !… — Dans le grog, peut-être ! —
Tu dois renaître
Jaune, sous le fard du tampon,
Rose-pompon !
Vénus-Coton, née en pelote,
Un soir-matin,
Parmi l’écume… que culotte
Le clan rapin !
Rose-mousseuse, sur toi pousse
Souvent la mousse
De l’Aï..... Du BOCK plus souvent
— À 30 Cent.
— Un coup-de-soleil de la rampe !
Qui te retrempe ;
Un coup de pouce à ton grand air
Sur fil-de-fer !…
Va, gommeuse et gommée, ô rose
De couperose,
Fleurir les faux-cols et les cœurs,
Gilets vainqueurs !
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
Gladys frères, 1873, p. 47-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, à une rose | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2020
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À MON CHIEN POPE
— GENTLEMAN-DOG FROM NEW-LAND —
mort d’une balle.
Toi : ne pas suivre en domestique,
Ni lécher en fille publique !
— Maître-philosophe cynique :
N’être pas traité comme un chien,
Chien ! tu le veux — et tu fais bien.
— Toi : rester toi ; ne pas connaître
Ton écuelle ni ton maître.
Ne jamais marcher sur les mains,
Chien ! — c’est bon pour les humains.
… Pour l’amour — qu’à cela ne tienne :
Viole des chiens — Gare la Chienne !
Mords — Chien — et nul ne te mordra.
Emporte le morceau — Hurrah ! —
Mais après, ne fais pas la bête ;
S’il faut payer — paye — Et fais tête
Aux fouets qu’on te montrera.
— Pur ton sang ! pur ton chic sauvage !
— Hurler, nager —
Et, si l’on te fait enrager…
Enrage !
Île de Batz. — Octobre.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Gladys frères,
1873, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, chien, domestique | ![]() Facebook |
Facebook |





