29/09/2020
Philippe Jaccottet, Airs

Monde
Poids des pierres, des pensées.
Songes et montagnes
n’ont pas même balance
Nous habitons encore un autre monde
Peut-être l’intervalle
Fleurs couleur bleue
bouches endormies
sommeil des profondeurs
Vous pervenches en foule
parlant d’absence au passant
Sérénité
L’ombre qui est dans la lumière
pareille à une fumée bleue
Philippe Jaccottet, Airs, dans Œuvres,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard,
2014, p. 438.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, airs, monde, ombre, lumière, sérénité | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2020
Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa
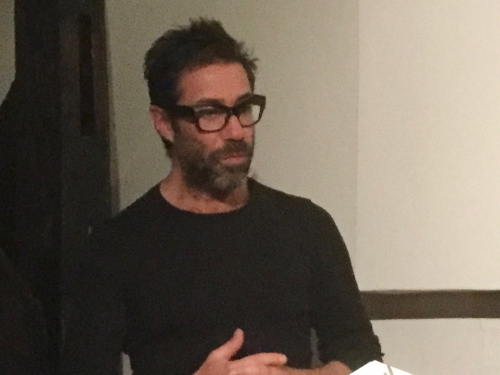
La mer
Immense large d’huile âtre
À l’infini scintillante d’adamantines constellations déchues
Ainsi la découvrit-elle au réveil
Ramenant sur elle le plaid sable dont la marée l’avait dévêtue à son insu
Mais
Sans affecter ses fleurs ni leur tige
(Ainsi
Si n’eût été son effroi
Non le vent mais la marée bel et bien)
Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa,
La tête à l’envers, 2018, p. 40.
Photo Tristan Hordé, novembre 2017
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, elle avait sur le sein des fleurs de mimosa, mer, marée | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2020
Julien Bosc, Le verso des miroirs

je sortis à l’heure des chouettes et cortèges
où une lune orange tout à portée de main
à moi sans lieu un chien mourant ouvrit un chemin vers des rives
et s’étende à mes côtés sur des racines émergées
témoins savants des cécités et des noyades
à l’aube
contre la dépouille du chien
un jeune cheval couvert de gui
or sur le tain étoilé deux nénuphars éclos
l’un blanc l’autre diaphane
Julien Bosc, Le verso des miroirs, Atelier de
Villemonge, 2018, p. 5.
Photo Chantal Tanet, août 2017
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le verso des miroirs, nuit, aube | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2020
Julien Bosc, Je n'ai pas le droit d'en parler

Les mascarets crevèrent les brise-lames et les digues. Le vent laissa les bois chablis jusque par-delà la brande des contreforts.
Mais les champs où faucher le seigle et le blé ? Mais la retraite où fraser le doute et la douleur ?
Des entrelacs de ronces et de genêts ; un amas de lauzes et de pierres.
Et la route ?
Un puits.
Et le chemin ?
Une rigole.
Et la sente qui n’allait nulle part, n’en finissait jamais de revenir au même point ?
Une faille désormais.
Julien Bosc, Je n’ai pas le droit d’en parler, Atelier La Feugraie, 2008, p. 31.
Photo Tristan Hordé, août 2017
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, je n’ai pas le droit d’en parler, faille | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2020
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur
En hommage à Julien Bosc, disparu le 23 septembre 2018
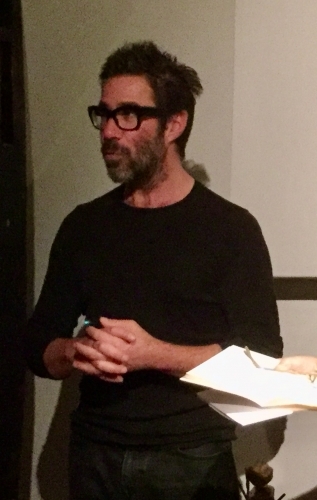
Tout fut oublié
Tout fut à réapprendre
S’endormir se réveiller
Se lever marcher
Boire mâcher
Semer récolter engranger
Lutter contre le froid
Inventer l’ombre
Recréer une langue
L’apprendre l’écrire
S’y perdre et en revenir
Les silhouettes rescapées s’extirpèrent du brouillard
Parler épousa l’innommable
Tout fut tenté pour dire
Rien ou peu fut entendu
Puis tout fut tu
Tué une seconde fois
Les années passèrent
Des voix se levèrent
Il fallait témoigner
Outre les chiens les mots avaient enfin trouvé leur voie
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur,
Le Réalgar, 2020, p. 15.
Photo Tristan Hordé, novembre 2017
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le coucou chante contre mon cœur, camps de concentration, silence, innommable | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2020
Jacques Réda, Retour au calme

La boulangerie
Souvent assez tard en hiver cette boulangerie
En face reste ouverte, et l’on peut voir le pain
Nimber d’or les cheveux frisés de la boulangère
Qui, bien qu’à tant d’égards ordinaire, nourrit
Des desseins obliques de femme et s’ennuie. Et parfois
La boutique à cette heure est vide ; elle ne brille
Qu’à la gloire exclusive du pain.
Il suffit bien je crois de sa lumière au coin
De la rue assez tard en hiver pour que l’on remercie.
Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 92.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, boulangerie, ennui, pain | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2020
Jacques Réda, La course

Gitans à Montreuil
Dans les vergers à l’abandon qui dominent Montreuil,
Les filles des Gitans fument près des roulottes.
Sous des cordes à linge où sèchent leurs culottes,
Elles rodent avec la grâce du chevreuil.
On n'ose jeter en passant qu’un rapide coup d’œil :
Des vieilles à l’affût suspendent leurs parlottes
(Les hommes sont allés vendre des camelotes
Dans le grand déballage, en bas). Pourquoi ce deuil
Au fond de la lumière alors qu’elle irradie,
Et dans l’air vif ce goût fade de maladie ?
Les filles des Gitans ont beau se déhancher,
L’espace fourbu gît sous ses propres décombres :
Cabanes à lapins, potagers à concombres
Sous la fumée inerte et sans feu d’un pêcher
Rose.
Jacques Réda, La course, Gallimard, 1999, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques redescend, la course, gitans à montreuil, fllles, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2020
Jacques Réda, L'incorrigible

Ulysses
Des pas sertis dans le bitume ont un éclat de cuivre :
Ce sont les traces du héros de ce fameux roman
Qui circule à travers Dublin, l’agite, et la délivre
De son destin provincial — étrange moment
Où tous les récits ont trouvé leur aboutissement
Convulsif dans une Odyssée convulsivement ivre.
Quand on accompagne ces pas, il arrive un moment
Où l’on se demande où l’on va : dans la ville, ou le livre ?
On s’y perd à la longue. Mais un circuit personnel
Se dessine, qui vous ramène aux abords d’O’Connell
Bridge ou devant la poste à l’imposante colonnade.
On y discerne des éclats de balle ou de grenade,
Et c’est dans l’histoire vraie, et ses héros de sang
Qui mêlés à l’imaginaire arrête le passant.
Jacques Réda, L’incorrigible, Gallimard, 1996, p. 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’incorrigible, ulysses, dublin, james joyce, traces | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2020
Jacques Réda, L'adoption du sytème métrique

L’insaisissable
Le matin et le soir, quand la foule s’active
Entre les carrefours, déserts après midi
Comme au fond d’un miroir où l’heure s’engourdit,
J’ai vu dans les faubourgs la beauté fugitive.
Je reconnais de loin la teinte un peu trop vive
De sa robe trop courte et le geste arrondi
Qu’elle a vers ses cheveux dont la flamme assourdit
L’éclat des bijoux faux des vitrines.
J’arrive
Parfois à m’approcher d’elle, mais c’est toujours
Quand de nouveau midi submerge ces faubourgs
Dont le silence augmente avec leur étendue.
Elle m’appelle alors, et – joueuse –
M’échappe quand j’allais l’atteindre : dans l’instant,
Plus personne – un couloir sordide l’a happée,
Puis ce miroir au fond duquel, en écoutant
Mon pas elle se tient droite comme une épée.
Jacques Réda, L’adoption du système métrique,
Gallimard, 2011, p. 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’adoption du système métrique, l'insaisissable, beauté, fuite | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2020
Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes

Sombre
Quand j’en aurai assez de moi
je me jetterai dans le soleil doré,
l’aile bruissante je revêtirai,
je mêlerai le vice et le sacré.
Je suis mort, je suis mort et le sang a coulé
sur l’armure en large torrent.
Je reviens à moi, différent, vous toisant
à nouveau du regard de guerrier.
Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes,
Traduction Luda Schnitzer, édition
Pierre Jean Oswald, 1967, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vélimir khlebnikov, choix de poèmes, vice, sacré | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2020
Jacques Réda, Du rythme — revue Catastrophes

Lettre parue dans la revue en ligne Catastrophes le 15 septembre 2020
Du rythme
Hyères, le 13 juillet 2020
.
Cher Laurent Albarracin,
Chers Catastrophés,
merci de me convier une fois encore dans votre cénacle dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux circonstances.
Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, d’ailleurs, concerne divers aspects du rapport qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie.
Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne connais aucune définition communément acceptable du terme poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui relèvent de l’artifice typographique.
Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme parfait.
Mais il me semble que nous devons remonter à une époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en matière de mémorisation, mais aussi des ressources de mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément particulier que nous appelons vaguement poésie.
Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage : l’un qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie courante ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage (voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant (de l’inerte aussi) avec le rythme.
L’invention progressive de l’écrit a tout changé. Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle curieusement la Renaissance.
Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre structure susceptible de replacer le vers dans le continu rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en changeant profondément elle-même, comme les divers latins en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français.
Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé comme dans l’écrit.
Le français écrit se présente actuellement sous deux formes : une forme relativement stable de prose qui est en somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et innombrables contorsions qu’on veut lui imposer.
C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection dont la poésie est l’objet : on ne comprend plus la langue qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos typographique.
Écrire comme on parle ? Mais l’on ne parle déjà plus aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple maintien.
Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.)
La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au besoin avec une très constante intention de contribuer à la ruine qui le menaçait de toute manière.
Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, « on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...
Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de vrais lecteurs.
.
Avec ma sympathie la plus sincère,
JRéda
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, du rythme, prose, poésie, français, écrit, oral, vers, prose — revue catastrophes | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2020
Laurent Albarracin, Sonnets de contrebande

Prendre une clochette pour de l’argent content
N’est certes pas commettre une bien grande erreur.
Il est parfois plus de vérité dans un leurre
Si l’on prend celui-ci pour midi au cadran,
Car il faut bercer les illusions qui nous bernent,
C’est le meilleur moyen de les circonvenir.
Et dans le but de ne pas trop con devenir,
Vidons nos vessies pour éclairer nos lanternes.
Tomber dans le panneau miraculeusement
Arrive à qui est naïf délibérément.
Cela survient quand le mot fait fourcher la chose
Et que bifide elle se darde et se regarde
En chien de faïence, stupéfaite, hagarde,
Elle correspond quand à soi-même s’oppose.
Laurent Albarracin, Sonnets de contrebande, dans
Place de la Sorbonne, n° 8, mai 2018, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, sonnets de contrebande, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2020
Anne Seidel, Khlebnikov pleure

SARAT II / Origine
le poème commence
nous laissons une image
telle une fumée
de cheminées
monter, un navire
qui sombre
nous regardons les petits
(tristia-)
meurtri
étroit,
silencieux, bourdonnant ou rusé.
soir (avec fin)
étranger
effleurée, la couverture brillante
près
des réseaux électriques
un lambeau de shakespeare
Anne Seidel, Khlebnikov pleure, traduction
(allemand) de Laurent Cassagnau,
éditions Unes, 2020, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne seidel, khlebnikov pleure, origine, shakespeare, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2020
Étienne Faure, Tête en bas

Manger du pain noir fut longtemps craint
de tous ceux que la guerre asséna
sur tous les fronts de part et d’autre,
comme si ce froment allait faire revenir
les années noires de frêle constitution
quand il fallait à défaut de croître
escompter, surseoir, subsister,
rassasié jamais en ces temps rassis,
en appelant aux mots, ces ersatz
dont la bouche et les os, les corps dans l’attente
étaient devenus friands, même à l‘école,
à délier gravement à l’encre de sureau
sur des cahiers les lettres mauves, resserrées
— je déguste, il savoure, nous nous régalons — l
longeant les jours de guerre en courant
dans des vêtements hérités des grands,
inaptes, pendant longtemps, à les remplir.
aux mangeurs de pain noir
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard,
2018, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2020
Étienne Faure, Ciné-plage

Logeaient-ils dans la grandiloquence,
le bruit sec bien réel des chaussures
les ramenait, comédiens jour et nuit
sur les planches — presque des étagères —,
à se déplacer lentement, parole et gestes,
dans une jeune ou vieille chair bientôt carne,
mince à passer les portes du décor,
ou tonitruante et tremblante
sous le trouble du verbe en mouvement,
experts à déclamer jusqu’à leur mort
tout ce qu’une cervelle encore recèle
— ce n’est pas là qu’il faut applaudir —
la voix reprenant le dessus,
les mots leur envol déployé
jusqu’aux battements d’ailes imprécis
à la fin qui se joignent
— et le reste est silence.
parole et gestes
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon,
2015, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, comédien, parole, geste, silence | ![]() Facebook |
Facebook |





