09/10/2021
Philippe Jaccottet, Ponge, pâturages, prairies

En se rejoignant
elles deviennent silencieuses
les eaux de montagne
Qu’a donc voulu dire Buson en écrivant ce haïku, sinon, apparemment, ceci : qu’au moment où confluent au fond de la vallée les torrents descendus des montagnes, on cesse d’entendre le bruit de leurs eaux ? Belle découverte !
Il se trouve toutefois que l’extrême concision du haïku, en ne laissant passer dans les mots que quatre éléments : la montagne, les eaux, leur confluence et le silence qui s’ensuit, en les associant comme elle le fait dans un mouvement et une sorte de métamorphose, permet au poète de susciter, autour de ce presque rien, un espace ouvert où la rencontre de ces éléments, dont chacun est lié pour nous à un nombre très élevé de correspondances intérieures, de souvenirs et de rêves peut prendre sa plus large et plus profonde résonance. En cela, de surcroît, sans avoir l’air d »’y toucher, sans que cette notation qui serait, formulée autrement, à la limite de l’insignifiance, soit aucunement montée en épingle.
Philippe Jaccottet, Ponge, pâturages, prairies, le bruit du temps, 2015, p. 47-48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, ponge, pâturages, prairies, haïku, buson, correspondances | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2021
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre

8 mai 1995
Le mot « élucubration » : « veille, travail qu’un ouvrage a coûté », « ouvrage composé à force de veilles et de travail » ; le mot souvent entendu comme synonyme de pensées plus ou moins laborieusement extravagantes. Il pourrait me servir de titre pour certain ensemble de textes, avec cette note : « Élucubrations : travaux accomplis à la lueur de la lampe, souvent entendus comme laborieux sinon extravagants ; quoi qu’il en soit, accomplis pendant les heures nocturnes, dans les ténèbres et contre les ténèbres ; dans ce cas-ci, avant qu’elles ne l’emportent définitivement, sans que l’on puisse mesurer qu’elle avance on garde encore sur elles. »
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d’ombre, le bruit du temps, 2013, p. 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, taches de soleil, ou d’ombre, élucubration, ténèbres | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2021
Philippe Jaccottet, Le bol du pélerin (Morandi)

(Une récente nuit, je me suis rappelé une halte marocaine, à Ouarzazate : des sables roses et des sables jaunes, des rafales de vent de sable, au loin, comme des drapeaux, et ces espèces de forteresses qui tremblaient dans l’excès de lumière sans être des mirages, mais à peine distinctes du sol où elles avaient été bâties, brève entrevision, un matin, pourquoi si poignante ? Je me trouvais dans un endroit du monde où je n’avais même pas désiré passionnément me rendre, et sans qu’aucune aventure personnelle n’y fût mêlée (car enfin bien sûr, s’il y avait eu dans un de ces palais ou forteresses entrevus — comme au cinéma ! — une femme captive, ou pas, que je serais allé rejoindre — délivrer !— mon émotion fût allée de soi et personne ne s’en fût étonné — sinon du fait que c’était moi le héros ! — mais non) ; et ce que j’avais entrevu ainsi à quelque distance n’était même pas un site imprégné par la présence, ou l’absence de dieux, comme l’Égypte ou la Grèce m’en avaient offert en d’autres occasions.
Philippe Jaccottet, Le bol du pèlerin (Morandi), La Dogana, 2006, p. 63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le bol du pélerin (morandi), sable, héros | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2021
Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer

Éloge de la mauvaise opinion de soi
Le busard n’a vraiment rien à se reprocher.
Les scrupules sont étrangers à la panthère.
Les piranhas ne doutent jamais de leurs actions.
Le serpent à sonnette s’approuve sans réserve.
Personne n’a jamais vu un chacal repenti.
La sauterelle, l’alligator, la trichine et le taon
Vivent bien comme ils vivent, et en sont très contents.
Un cœur d’orque pèse bien cent kilogrammes, maIS
Sous tpout autre aspect demeure fort léger.
Non, rien de plus bestial
que la conscience tranquille
sur la troisième planète diu Soleil.
Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer, traduction Piotr Kaminski, 2018, p. 173.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : szymborska, de la mort sans exagérer, mauvaise opinion, éloge | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2021
Théophile de Viau, Après m'avoir fait tant mourir

Sonnet
D’un sommeil plus tranquille à mes amours rêvant,
J’éveille avant le jour mes yeux et ma pensée,
Et cette longue nuit si durement passée,
Je me trouve étonné de quoi je suis vivant.
Demi désespéré je jure en me levant
D’arracher cet objet à mon âme insensée,
Et soudain de ses vœux ma raison offensée
Se dédit et me laisse aussi fol que devant.
Je sais bien que la mort suit de près ma folie,
Mais je vois tant d’appas en ma mélancolie
Que mon esprit ne peut souffrir sa guérison.
Chacun à son plaisir doit gouverner son âme,
Mithridate autrefois a vécu de poison,
Les Lestrigons de sang et moi de je vis de flamme.
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir,
Poésie/Gallimard, 2002, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théophile de viau, après m’avoir fait tant mourir, vivant, désespoir | ![]() Facebook |
Facebook |
01/10/2021
Christian Viguié, Fusain

Cherche l’ombre
comme une lanterne
ou un papillon.
Le vent
autour du puits
s’étonne qu’aucune parole
n’en sorte.
Un oiseau
s’envole
avant toute parole.
C’est à l’intérieur de toi
que les roses
ferment les yeux.
Le brouillard
ne nous demande pas
de voir les choses
mais l’attente des choses.
Christian Viguié, Fusain, le cadran ligné,
2021, p. 19, 20, 23, 24, 32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié, fusain, ombre, vent, brouillard | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2021
Marie de Quatrebarbes, Les vivres
Décembre 13
Images indistinctes démêlées du fond. Lieux communs mille fois traversés. Idiomes intacts. On voudrait s’assécher, former autour d’elles un pur esprit de mailles. On laisse les portes entrebâillées. Elles ne changent pas d’aspect avec le temps. Autre découverte : si vous êtes le cœur, il faut rêver les membres. La marque d’une fiction change, un rien superficiel. Maintenant avance, charge ta viande. Travaille-la soigneusement, fût-elle avariée. Avec un papier plié dans la bouche pour dévier ton souffle, tu ne peux pas faire de bruit.
Marie de Quatrebarbes, Les vivres, P.O.L, 2021, p. 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2021
Étienne Faure, Légèrement frôlée

Le cœur serré sans préavis
entre les murs du bâtiment gris public
d’où les cris fusent, on croirait une enfance
à cause des barreaux qui restreignent
la vue du ciel
les origines restituées
comme on s’en trouve à même les livres
enracinés dans la mémoire
avec l’ennui et les récitations
— craie, encrier, cire d’abeille —
la cour d’école au gravier jaune où crisse
une espèce de véracité française,
racines, à force d’être lues, plausibles
et crues finalement, oui, avec effet rétroactif
tant le désir de croître est commun aux souvenirs
d’une enfance implantée au hasard des sols,
l’autre en papier relue, comme apprise.
Papier relu
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 88.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, école, enfance, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2021
Étienne Faure, Ciné-plage

Sous d’apatrides vêtements aux couleurs
perdues dans la bataille
ils arrivaient par l’Europe en neige,
alors champ équivoque où germaient les victoires défaites,
puis repartaient pour cause de guerre en sens inverse,
pour les beaux yeux d’une patrie disant des mots d’adieu
dans une langue occasionnelle,
n’importe quoi qui comblât l’écart
en train de se creuser depuis l’arrière
jusqu’à l’amovible première ligne
approchée la nuit dans l’éclat d’armes blanches,
la lutte acharnée des chairs pour quelques mètres,
ici ressortissants drapés dans la boue
des gisants d’avant-hier autre époque,
en d’identiques raideurs nationales.
quelques mètres
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015, p. 126.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, ciné-plage, bataille, guerre, patrie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2021
Étienne Faure, Tête en bas,
Sur les tombeaux d’Europe autrefois de l’Est
éclairés d’une mèche en flamme
les morts réclamaient la mémoire
alerte et vacillante
de ceux demeurés en surface, et des pensées profondes
gravées au burin dans la pierre
qui rappelleraient l’objet perdu de leur combat,
explicitant leur vie au fond du marbre
en quelques mots, numéros, ceux qu’on marque
ordinairement sur la peau pour ne pas
oublier ce qu’on devait faire
ce jour-là de sa vie, de son temps
— passer la frontière, défendre un pays —
sous la répétition des oies dans le ciel
avant l’énième migration en V
ou WW selon la langue.
vacille la mèche
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 132.
Photo Chantal Tanet.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, tombrazu, objet perdu, migration | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2021
Étienne Faure, Et puis prendre l'air

L’ennui léger à la fenêtre enduré dès l’enfance, à regarder passer dans le ciel quelque chose, attendre un événement venu des nues, infime : un nuage effilé par le vent, la vitesse de l’avion disparu par l’embrasure des arbres, un V d’oiseaux très haut en solitude rebroussant leur chemin et lançant des signaux aux autres animaux restés au sol, cet ennui lentement scruté derrière la vitre avait changé progressivement de sens, glissé par la force des ans — nouveaux cirrus, autre altitude — parmi les nuages qui commençaient à s’amonceler, non plus singuliers mais pluriels — les ennuis. Et de loin le rire clair qui tout balaie au ciel de mars, à nouveau en mouvement.
Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, p. 103.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, ennui, ciel, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2021
Cioran, Aveux et anathèmes

Il m’est impossible de savoir si je me prends ou non au sérieux. Le drame du détachement, c’est qu’on ne peut en mesurer le progrès. On avance dans un désert et on ne sait jamais où on en est.
La profondeur d’une passion se mesure aux sentiments bas qu’elle enferme et qui en garantissent l’intensité et la durée.
De tout ce qui nous fait souffrir, rien, autant que la déception, ne nous donne la sensation de toucher enfin au Vrai.
Un rien de pitié entre dans toute forme d’attachement, dans l’amour et même dans l’amitié, sauf toutefois dans l’admiration.
J’espérais de mon vivant assister à la disparition de notre espèce. Mais les dieux m’ont été contraires.
Cioran, Aveux et anathèmes, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1068, 1070, 1071, 1072, 1073.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, aveux et anathèmes, passion, attachement, vrai, disparition | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2021
Cioran, Aveux et anathèmes

Chaque fois que je vois un clochard ivre, sale, halluciné, puant, affalé avec sa bouteille sur le bord du trottoir, je songe à l’homme de demain s’essayant à sa fin et y parvenant.
C’est sous l’effet d’une humeur suicidaire qu’on s’entiche généralement d’un être ou d’une idée. Quelle lumière sur l’essence de l’amour et du fanatisme !
Ce qui date le plus, c’est la révolte, c’est-à-dire la plus vivante de nos réactions.
J’aimerais mieux offrir ma vie en sacrifice que d’être nécessaire à qui que ce soit.
Les nuits où l’on se persuade que tous ont évacué cet univers, même les morts, et qu’on y est le dernier vivant, le dernier fantôme.
Cioran, Aveux et anathèmes, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 2011, p. 1060, 1062, 1063, 1063, 1064.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, aveux et anathèmes, clochard, suicide, eévolte, sacrifice | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2021
Cioran, Syllogismes de l'amertume

Vitalité de l’amour : on se saurait médire sans injustice d’un sentiment qui a survécu au romantisme et au bidet.
Deux victimes besogneuses, émerveillées de leur supplice, de leur sudation sonore. À quel cérémonial nous astreignent la gravité des sens et le sérieux des corps !
Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l’amour le frappe, de réagir en midinette.
Les événements tumeur du Temps.
L’insomnie est la seule forme d’héroïsme compatible avec le lit.
Cioran, Les syllogismes de l’amertume, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, p. 235, 237, 238, 242, 255.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, les syllogismes de l’amertume, amour, événement, insomnie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2021
Cioran, Syllogismes de l'amertume
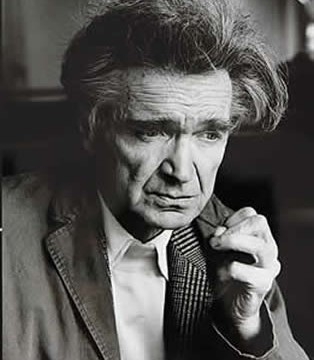
Il est aisé d’être « profond » : on n’a qu’à se laisser submerger par ses propres tares.
Modèles de style : le juron, le télégramme et l’épitaphe.
Les « sources » d’un écrivain, ce sont ses hontes, celui qui n’en découvre pas en lui, ou s’y dérobe, est voué au plagiat ou à la critique.
Le public se précipite sur les auteurs dits « humains » ; il sait qu’il n’a rien à en craindre : arrêtés, comme lui, à mi-chemin, ils lui proposeront un arrangement avec l’Impossible, une vision cohérente du Chaos.
La peur de la sénilité conduit l’écrivain à produire au-delà de ses ressources et à ajouter aux mensonges vécus tant d’autres qu’il emprunte ou forge. Sous des « Œuvres complètes » gît un imposteur.
Cioran, Les syllogismes de l’amertume, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 2011, p. 173, 173, 174, 175, 176.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, les syllogismes de l’amertume, tare, style, chaos, sénilité | ![]() Facebook |
Facebook |






