12/06/2021
Marie de Quatrebarbes, Les vivres

22
Si je conjugue ces moments hors de moi passés si loin de toi avec ce loin qui est « je vois » et toi qui est « si loin de moi », plus ces moments-)là sont lointains plus ils existent en dehors de moi, mieux je les sens. Comme parfois je te sens vivante, je te cueille et j’en ai plein les poches. Ce serait une belle idée de remplir nos poches de toutes les présences qu’on aurait connues pour les retrouver. Et quand je marche avec au-devant, toi, quand je marche aveuglément, empéguée dans mon ombre qui est mon projet, aveugle et aveuglée, les papiers collent à ma marche et crépitent au fond de mes poches. Mais moi, ça ne me dérange pas, tu sais, quand quelque chose s’échappe de mes poches avec ton rire qui vient vers moi.
Marie de Quatrebarbes, Les vivres, PO.L, 2021, p. 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les vivres, moment, poche, marche | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2021
Bashô, Friches (2)

À l’ombre des fleurs
la nuit passée en voyage
évoque le chant
D’herbes l’appuie-tête
trempé par l’averse un chien
hurle dans la nuit
En voyage donc
j’aurai vu de ce bas monde
le grand nettoyage
De mes père et mère
le souvenir m’envahit
au cri du faisan
Ah le pays natal
sur mon cordon ombilical je pleure
au déclin de l’an
Bashô, Friches (2), traduction René Sieffert, Presses orientalistes de France, 1992, p. 51, 61, 65, 67, 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, friches, chant, averse, souvenir, voyage, pays natal | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2021
Bashô, Jours d'hiver

De notre malheur
ne résoudra le mystère
le chant du coucou
Jusqu’aux fleurs des champs
butine le papillon
aux ailes froissées
De la creuse cigale
d’automne le cri sans voix
s’élève en silence
Ne pouvant la couvrit
elle fait tomber la lune
l’averse d’hiver
Joyeusement
gazouille l’alouette
tire-lire-li
Bashô, Jours d’hiver, traduction
René Sieffert, Presses orientalistes
de France, 1987, p. 21, 25, 33, 37, 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, jours d’hiver, lune, papillon, coucou, cigale | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2021
Bashô, Friches (2)

La bise un instant
retient son souffle et c’est
le petit printemps
Le soleil couchant
qui tremble à l’horizon
fait mal à la tête
Quand souffle la bise
ramasseur d’aiguilles de pin
lui tient compagnie
Au vent du printemps
la ceinture relâchée
visage ensommeillé
Moustiques de la chambre
à la fumée des offrandes
tous s’en sont allés
Bashô, Friches (2), traduction René Sieffert,
presses orientalistes de France, 1992, p. 21, 23, 25, 27, 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, friches (2), bisse, soleil, vent, offrandes | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2021
Matsuo Bashô, Cent cinq haïkaï

Un court moment
S’attarde sur les fleurs
Le clair de lune
Bruit d’étourneaux
Du micocoulier tombent des fruits
Tempête du matin
Viens me voir ici
De sous la magnanerie
Une voix de crapaud
Dans la nuit sombre
À la recherche de son nid
Le pluvier pleure
Les rossignols
De derrière les saules
De devant les broussailles
Matsuo Bashô, Cent cinq haïkaï,
traduction Koumiko Muraoka et
Fouad El-Etr, La Délirante, 1979, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matsuo bashô, cent cinq haïkaï, lune, tempête, rossignol | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2021
Esther Tellermann, Un versant l'autre

(...)
Jadis très loin
furent
des voilures
des myrtilles
et le câprier
même crête du monde
qu’un été brûle
même ambre
qui vous enferme
Poème creusait
chaque interstice
où vinrent
la lettre
et la blessure
(...)
Esrher Tellermann, Un versant
l’autre, Flammarion, 2019, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, un versant l'autre, lettre, blessure | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2021
Mariella Mehr, Arrivée, mais où ?

Arrivée, mais où ?
Aucun phare ne signale l’endroit.
De loin l’appel des marées rengaine
rythmée, tels des feux de joie
salamandrins dans la nuit.
Un poisson me happe,
écorche ce qui me restait du jour.
Le déchiquète, mâche
et le recrache intact dans le vent,
comme si j’étais le cœur de Prométhée
et lui, l’aigle éternel des Dieux.
Devant la mort je passe,
trop hardiment me semble-t-il,
car la voici qui rit, qui rit
en jouant sur sa flûte
la mélodie de mort.
Et toi, époque démontée,
où me fais-tu échouer ?
Quelques instants
fatals plus tôt,
tu la sais, la vie
m’attend encore et
un lumineux bourgeon soleil.
Mariella Mehr, traduction de l’allemand
Camille Luscher, dans la revue de belles-lettres
2020, 1-2, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mariella mehr, arrivée, mais où ? | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2021
Christine Lavant, « Terre, si tu avais deux lèvres »

« Terre, si tu avais deux lèvres »
Terre, si tu avais deux lèvres
et une langue, et une heure amicale,
voudrais-tu parler avec moi
même quand je piétine avec colère
mon chicot de raison parmi les flocons de n eige ?
Terre, pourrais-tu rire ?
Je me suis vantée des ton amitié,
Racontant que j’aime habiter près des racines,
Que je parle du temps avec les pierres
Et que, ton sang, je peux l’interpeller.
Mentir était comme ces maladies
qu’on attrape souvent avant les grandes pestes,
et mon cœur a toujours tout gobé de moi.
Maintenant le voilà pestiféré
qui ne sait plus rien que crier vers toi,
il ne veut pas mourir, ni dire à personne d’autre
ce qu’il mijote, ce qui le tourmente,
ni qui il voudrait bénir encore à la fin.
Terre, accepte ma langue,
de grâce, terre et mes deux lèvres !
Viens me parler sous les flocons de neige
de la chaleur fidèle de l’amour.
Christine Lavant, traduction de l’allemand
Philippe Jaccottet, dans la revue de belles-lettres, 2020, 1-2, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christine lavant, « terre, si tu avais deux lèvres », colère, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2021
Franck Delorieux, Quercus suivi de Le séminaire des nuits

Une ombre rêvant des dieux
Ô jour je soupire il n’est pas assez d’alléluias
De baisers au monde qui éclot blanc
Comme un cyclamen sauvage parlez-moi
Des jonquilles qui annoncent le printemps
La marche dans les prés est fleurie la luzerne
Mauve le crépuscule des coquelicots l’aube
Des pâquerettes et les blés agités de vent
Me font avancer en souriant je pose mes pas
Sur la terre pour louanger Cérès et Flore
Je rêve de leur carnet de bal suis-je le fiancé
D’une danse mes membres seront pétales
Pour les déesses et les dieux je vais pleurer
Des larmes de pollen doré comme la pisse
De Zeus qui féconde Danaé des gouttes
Perlent de mes sourcils l’ombre des chênes
Les parfums des sous-bois animent mes jambes
Mes bras les paroles de l’Olympe piquent le tain
Sombre de mes yeux ô miroirs adorés où se reflètent
L’argent des mots et l’alambic des espoirs raffinés
Je suis une ombre rêvant des dieux
Franck Delorieux, Quercus suivi de Le séminaire des nuits,
Gallimard, 2021, p. 31
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck delorieux, quercus suivi de le séminaire des nuits, une ombre rêvanrt des dieux | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2021
Daniel Kay, Tombeau de Jorge Luis Borges, suivi de Autres stèles

Georges Perros à Douarnenez
Papiers collés, décollés, rapiécés
avec du scotch, de la colle, papiers
mâchés, rongés, érodés, échancrés,
cousus paresseusement, tout cela finit
par faire un beau livre, Monsieur Perros,
un livre qu’on tient comme un galet
avec une main fraternelle.
Daniel Kay, Tombeau de Jorge Luis Borges,
suivi de Autres stèles, Gallimard, 2021, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel kay, tombeau de jorge luis borges, suivi de autres stèles, georges perros, papiers collés | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2021
Olivier Domerg, Le Manscrit
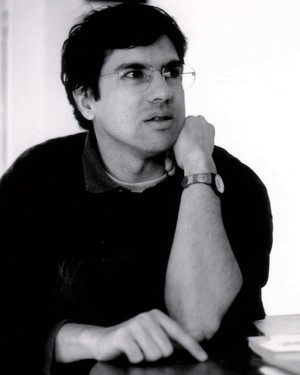
Curieusement, repartant de mes notes, que je mets au propre dans l’ordre où elles ont été prises, je revois et revis nos différents séjours ici et aux alentours du Puy. C’est une sensation curieuse, quelques années ou mois après, de se replonger dans le quotidien, les menus faits et gestes, les questionnements, les déplacements, les découvertes, de remettre ses pas dans ses pas ; de voir comment les éléments, presque fortuitement et parfois instinctivement, se mettent en place et se complètent ; d’assister aux avancées et reculs de ce qui prend souvent la forme d’un parcours ou d’une enquête.
Olivier Domerg, Le Manscrit, le corridor bleu, 2021, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, le manscrit, note, parcours, enquête | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2021
Étienne Faure, Jours de repos
D’une ville arasée naguère, ce qui reste au sol,
toute hauteur perdue, c’est le socle,
fondation arrachée jamais
à la terre, empirique emprise
où la cité embryonnaire, aboutie, détruite
endure à présent la tracé des fleurs rudérales
au lieu des pas qui résonnèrent
sur la place herbue du théâtre — y jouaient
d’antiques tragédiens avançant pour dire
je suis ici ô dieu du temps qui fait tomber les pluies
désormais sur nos bras dressés pour quérir le ciel,
relier cette parole diluvienne à nos gestes
et trouver un terrain d’entente
pour nos vies, nos corps tandis que l’herbe
sous nos pieds repousse, herbe à chats,
vieux acteurs au soleil qui éloignent
tout ce qui ronge, les idées noires
entre les gradins.
rêves de chats dans les gradins
Étienne Faure, Jours de repos, dans Europe, n° 1106-1107-1108, Juin-juillet-août 2021, p. 279.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, jours de repos, rêves de chats dans les gradins, tragédien, théâtre | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2021
Cole Swensen, Poèmes à pied

Une promenade le 17 mai
C’est une rue tranquille, étroite, une rue où s’alignent les boutiques et peu de monde pour le moment, une nuit où traîne encore une douce lumière et tout est calme.
Je marche vers l’est dans une rue tranquille, 21 h., et un jeune homme extrêmement bien habillé, et même élégant et très beau — à peine 40 ans, souriant, m’arrête, pensé-je, pour me demander son chemin, et me demande un peu d’argent.
La rue est calme. La nuit est encore douce, et il ne fait pas encore noir. 22h15 un homme promène son chat. Improbable je sais. Il le sait aussi. Mais ça semble une routine bien établie. L’homme va d’un côté. Le chat reste au coin ; l’homme revient, chuchote des « ici, ici », le chat va de l’autre côté, l’homme aussi. La rue est calme.
Cole Swensen, Poèmes à pied, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, Cofrti, 2021, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, poèmes à pied, promenade, nuit, chat | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2021
Alexander Dickow, Déblais

Écrire deux versions en deux langues d’un même poème, c’est donner à voir le désir, impossible à assouvir, de se rejoindre — de coïncider avec soi-même. Ou encore celui tout aussi hors de portée de se sentir définitivement à distance.
L’idée que la poésie doit exclure le narratif est aussi absurde que d’exclure l’exposition discursive du roman. Mallarmé rejette le narratif sous prétexte qu’il présente quelque chose comme un simulacre du réel. Mais la virtualité domine autant le narratif que les autres types de discours. La narration est un tissu de lacunes mouvantes ; c’est par ce jeu du vide est du plein qu’elle rejoint à la fois la poésie et le réel et il s’ensuit que la poésie est simulacre au même titre que la narration.
Alexander Dickow, Déblais, louise bottu, 2021, p. 23, 24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dickow, déblais, langue, narration, réel, simulacre | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2021
Alexan der Dickow, Déblais

À ses débuts l’œuvre se fait aux dépens de la théorie et malgré elle. Avant l’écriture, la théorie n’est qu’une voix généralisante fausse, que l’œuvre a pour tâche (entre autres choses) de démentir. La théorie d’avant l’œuvre, c’est l’idée toute faite et déjà faite : et l’œuvre, si elle se fonde sur des idées constituées et entières, meurt en naissant.
Le sens saisi d’abord correspond généralement à du connu, tandis que le sens neuf dépasse les routines programmées qui constituent la majorité de nos échanges sociaux et de nos réflexions de surface. D’habitude, nous suivons des saynètes déjà écrites, dans la vie comme en lisant. Il faut pourtant lire plus loin et vivre plus haut.
Alexander Dickow, Déblais, louise bottu, 2021, p. 9, 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dickow, déblais, œuvre, théorie, sens | ![]() Facebook |
Facebook |





