28/11/2021
Robert Desnos, Domaine public

Les gorges froides
À la poste d’hier tu télégraphieras
que nous sommes bien morts avec les hirondelles
Facteur, triste facteur, un cercueil sous ton bras
va-t’en porter ma lettre aux fleurs à tire d’elle.
La boussole est en os, mon cœur tu t’y fieras.
Quelque tibia marque le pôle et les marelles
pour amputés ont un sinistre aspect d’opéras.
Que pour mon épitaphe un dieu taille ses grêles !
C’est ce soir que je meurs, ma chère Tombe-Issoire,
ton regard le plus beau ne fut qu’un accessoire
de la machinerie étrange du bonjour.
Adieu ! je vous aimai sans scrupule et sans ruse,
ma Folie-Méricourt, ma silencieuse intruse.
Boussole à flèche torse annonce le retour.
Robert Desnos, Domaine public, Le point du
jour/Gallimard, 1953, p. 343.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, les gorges froides | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2021
Emily Dickinson, Je cherche l'obscurité

Un grand Espoir est tombé
Tu n’as rien entendu
La Ruine était intérieure
Oh Naufrage rusé
Qui n’a conté aucune Histoire
Et n’a admis aucun Témoin
L’esprit fut bâti pour de lourdes Charges
Planifié pour de terribles occasions
Si souvent sombrant en Mer
Soi disant, sur Terre
Emily Dickinson, Je cherche l’obscurité, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2021, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, je cherche l’obscurité, espoir, ruine | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2021
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous

sursis d’été à
l’heure d’hiver roux
trois rouges-gorges
jouent à la guéguerre
avant l’aurore
écrire toute une vie
sans autre connaissance
que — la perte —
des chants et des fleurs)
*
Puis la mousse se gorge quand le tilleul lâ
che tout
Toute la forêt détone entre les sabots
des bêtes
Une langue se tend du plexus à leurs yeux
mi-clos
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous,
éditions Héros-Limite, 2021, p. 27-28.
©Photo Ianna Andréadis
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, été, hiver, rouge-gorge, bête | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2021
Pierre Chappuis, En bref, paysage

Les arbres et leurs ombres : imbriqués mais droits
— des sapins —, rangs serrés, à gagner, regagner du
terrain sur la neige.
À la nuit reprendra ses positions avancées.
Ciel bas, assombri, lourd à nos épaules — si tant est
que... —
Me tient captif, de si loin, cette prairie enneigée
resserrée sur elle-même, si haut juchée à flanc de
coteau.
Pierre Chappuis, En bref, paysage, Corti, 2021, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, en bref, paysage, neige, sapin | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2021
Pierre Chappuis, La nuit moins profonde
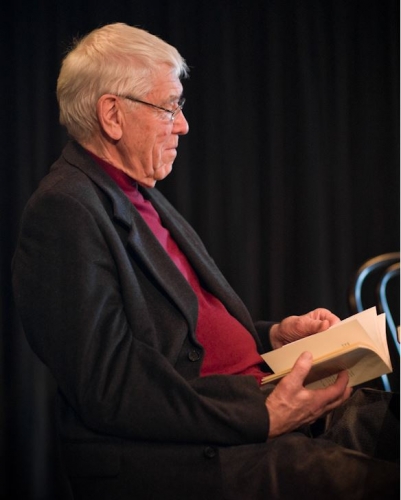
L’ombre
L’ombre des chênes (son épaisseur), là (y fûmes-nous ?), serrés, solidaires (à poings fermés), cœur même de la plénitude de l’été.
Y fûmes-nous vraiment ?
Que ne nous sépare pas...
Que ne nous sépare pas, insensible abîme, le moindre écart.
Ce que nous étions ; ce que nous sommes. N’ayant point souvenir des massifs d’ombre côtoyés, mouvants, dont les senteurs portaient à la tête.
Un courant de transparence insensiblement nous porte : aurore, démarcation nulle.
Pierre Chappuis, La nuit moins profonde, éditions Empreintes, 2021, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la nuit moins profonde, ombre, séparation | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2021
Pierre Chappuis, La nuit moins profonde

Une photographie
Retour sur image, celle, panoramique, accrochée au mur depuis bien des années, à l’écart.
La mer, basse, a laissé le fond de l’anse à nu. Partout une lumière égale, riante, plane. Bonheur ! Il n’est que de céder, insoucieux, au sentiment d’immensité sans rencontrer d’autre obstacle que, moindre éminence, celui de l’îlot voisin vers lequel tu t’avances dans la tiédeur d’une fin d’après-midi de juillet, minuscule tache rouge et blanche (jupe et corsage) à quoi un œil non averti ne prêterait aucune attention.
Tu ne te retourneras pas. Le temps, inexorablement, est au beau fixe.
Pierre Chappuis, L’espace que rien ne borne, dans La nuit moins profonde, éditions Empreintes, 2021, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la nuit moins profonde, espace, photographie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2021
Aragon, Les Poètes

Le discours à la première personne
3
J’entends j’entends le monde est là
Il passe des gens sur la route
Plus que mon cœur je les écoute
Le monde est mal fait mon cœur las
Faute de vaillance ou d’audace
Tout va son train rien n’a changé
On s’arrange avec le danger
L’âge vient sans que rien se passe
Au printemps de quoi rêvais-tu
On prend la main de qui l’on croise
Ah mettez les mots sur l’ardoise
Compte qui peut le temps perdu
Tous ces visages ces visages
J’en ai tant vu des malheureux
Et qu’est-ce que j’ai fait pour eux
Sinon gaspiller mon courage
Sinon chanter chanter chanter
Pour que l’ombre se fasse humaine
Comme un dimanche à la semaine
Et l’espoir à la vérité
J’en ai tant vu qui s’en allèrent
Ils ne demandaient que du feu
Ils se contentaient de si peu
Et avaient si peu de colère
J’entends leurs pas j’entends leurs voix
Qui disent des choses banales
Comme on en lit sur le journal
Comme on en dit le soit chez soi
[...]
Aragon, Lex Poètes, dans Œuvres poétiques
complètes, II, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 451-452.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, lex poètes, le discours à la première personne, chanter | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2021
Aragon, Les Chambres

VI
Toutes les chambres de ma vie
M’auront étranglé de leurs murs
Ici les murmures s’étouffent
Les cris se cassent
Celles où j’ai vécu seul
À grands pas vides
Celles
Qui gardaient leurs spectres anciens
Les chambres d’indifférence
Les chambres de la fièvre et celle que
Que j’avais installée afin d’y froidement mourir
Le plaisir loué Les nuits étrangères
Il y a des chambres plus belles que blessures
Il y a des chambres qui vous paraîtront banales
Il y a des chambres de supplications
Des chambres de lumière basse des
Chambres prêtes à tout sauf au bonheur
Il y a des chambres à jamais pour moi de mon sang
Éclaboussées
Toutes les chambres un jour vient que l'homme s'y
Écorche vif
Qu'il y tombe à genoux qu'il demande pitié
Qu'il balbutie et se renverse comme un verre
Et subit le supplice épouvantable du temps
Derviche lent le temps est rond qui tourne sur lui-même
Qui regarde d'un œil circuklaire
L'écartèlement de son destin
Et le petit bruit d'angoisse avant les
Heures les demies
Je ne sais jamais si cela va sonner ma mort
Toutes les chambres sont chambres de justice
Ici je connais ma mesure et le miroir
Ne me pardonne pas
Toutes les chambres quand enfin je m'endormis
Ont été sur moi la punition des rêves
Car je ne sais des deux le pis rêver ou vivre
Aragon, Les Chambres, dans Œuvres poétiques complètes, II, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 1113-1114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, les chambres, rêver, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2021
Aragon, La Grande Gaîté

Fillette
Je voudrais lécher son masque ô masque
Saphir blanc
Tes cheveux carrés
Fourrure
Ô sacré nom de dieu de rouge aux lèvres
Murmure
Esquisse enfant bleu pâle
Je voudrais
Léchere
Ton casque
Ô tutu
Aragon, La Grande Gaîté, dans Œuvres poétiques
complètes, I, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 413.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaîté, fillette, masque | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2021
Aragon, Persécuté persécuteur

Front rouge
Une douceur pour mon chien
Un doigt de champagne Bien Madame
Nous sommes chez Maxim’s l’an mil
neuf cent trente
On met des tapis sous les bouteilles
pour que leur cul d’aristocrate
ne se heurte pas aux difficultés de la vie
des tapis pour cacher la terre
des tapis pour éteindre
le bruit de la semelle des chaussures des garçons
Les boissons se prennent avec des pailles
Délicatesse
Il y a les fume-cigarette entre la cigarette et l’homme
des silencieux aux voitures
des escaliers de service pour ceux
qui portent les paquets
et du papier de soie autour des paquets
et du papier autour du papier de soie
du papier tant qu’on veut Cela ne coûte
rien le papier ni le papier de soie ni les pailles
ni le champagne ou si peu
ni le cendrier réclame ni le buvard
réclame ni le calendrier
réclame ni les lumières
réclame ni les images sur les murs
réclame ni les fourrures sur Madame
réclame réclame les cure-dents
réclame l’éventail et réclame le vent
rien ne coûte rien et pour rien
des serviteurs vivants tendent dans la rue des prospectus
(...)
Aragon, Persécuté persécuteur, dans Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 493-494.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, persécuté persécuteur, front rouge | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2021
Aragon, Le paysan de Paris

Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont
Par ces temps magnifiques et sordides, préférant presque toujours ses préoccupations aux occupations de mon cœur, je vivais au hasard, à la poursuite du hasard, qui seul parmi les divinités avait su garder son prestige. Personne n’en avait instruit le procès, et quelques-uns lui restituaient un grand charme absurde, lui confiant jusqu’au soin des décisions infimes. Je m’abandonnais donc. Les jours coulaient à cette sorte de baccara tournant. Une idée de moi-même était tout ce que j’avais en tête. Une idée qui naissait doucement, qui écartait doucement les ramures. Un mot oublié, un air. On le sent lié à tout soi-même, et comme une forme qui en recherche une autre avec sa lanterne au milieu de la nuit, la voyez-vous qui va et vient, ou prend le moindre pli de terrain pour un homme, l’arbuste ou quelque ver luisant. Dans ce calme et cette inquiétude alternés qui formaient alors tout mon ciel, je pensais comme d’autres du sommeil, que les religions sont des crises de la personnalité, les mythes des rêves véritables. J’avais lu dans un gros livre allemand l’histoire de ces songeries, de ces séduisantes erreurs.
Aragon, Le paysan de Paris, dans Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 226.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le paysan de paris, le sentiment de la nature aux buttes-chaumont | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2021
Shakespeare, Sonnets

81
Soit je vivrai pour composer ton épitaphe,
Soit tu me survivras, moi pourrissant en terre,
La mort ne peut d’ici dérober ta mémoire,
Même quand je serai tout entier oublié
Ton nom grâce à mes vers aura vie immortelle,
Si je dois (disparu) mourir au monde entier,
La terre m’offrira une tombe ordinaire
Quand tu reposeras au fond des yeux des hommes.
Tu auras pour tombeau mes doux et nobles vers
Que reliront sans fin des yeux encore à naître
Et des langues à venir rediront ton être,
Quand tout ce qui respire au monde expireras ;
Toi tu vivras toujours (ma plume a cette force)
Où le souffle prend souffle, dans la bouche des hommes.
Shakespeare, Sonnets et autres poèmes, traduction Jean-Michel Déprats, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, jean-michel déprats, épitaphe, immortalité, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2021
Shakespeare, Sonnets

5
Ces heures, dont l’œuvre raffinée a créé
Ce regard merveilleux où tous les yeux s’attachent,
Seront plus tyranniques envers leur propre ouvrage,
Détruisant tout ce qui excellait en beauté.
Car, jamais en repos, le temps mène l’été
Jusqu’au hideux hiver et l’anéantit,
Sève toute glacée, feuilles vertes en allées,
Beauté vêtue de neige et partout nudité,
Alors s’il ne restait de l’été un parfum,
Liquide emprisonné entre des murs de verre,
La beauté et sa puissance d’engendrer mourraient
Sans même laisser un souvenir de ce qu’elles furent.
Mais les fleurs distillées, confrontées à l’hiver,
Perdent leur apparence, leur essence survit.
Shakespeare, Sonnets et autres poèmes, traduction Jean-Michel Déprats, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 257.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, jean-michel déprats, beauté, hiver, été | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2021
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous

Il était une fois
un trille dans la forêt
l’air ouvert devant moi
s’était déjà re
fermé un chevreuil me
surprit comme une
pensée soudaine
derrière l’écran
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous,
Héros-Limite, 2021, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, trille, chevreuil | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2021
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Berger dans les boues, bête déchirée, mise
en pièces, en lambeaux jetée, brûlée, de tige
visitée et peinte, traversée, à l’étang mise
sous la glace et touchée par la main , montrant
les entrailles dans la maison, les quartiers, les fleurs,
poitrine vide, fontaine coulée, fontaine fondue,
qui, au milieu des champs, lève le bras de plomb
et dévore le mouton et le veau, ouvrant une bouche
profonde où tombe le jour, du ciel au jardin, et pue,
pue, pauvre.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,
1986, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |





