14/12/2021
Stacy Doris, Mue

Je tombe car j’aime Si conscientiser
une crête est tout est mon ordinaire,
ce qui tue chez soi. motus prédis comble
Les pins lient ce qui moi d’autres possibles
ne salit. Tiens ma chaque aile affranchie.
main debout. L’espace La mite est réglisse
explicite il donne je la sauve, souple
à se battre et perdre, enquête de langue
le « creux » me dévore
quand je vois ta danse.
Stacy Doris, Mue, P. O. L, traduction Pierre Alferi, 2021, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stacy doris, mue, p. o. l, traduction pierre alferi, paire de poèmes | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2021
Liliane Giraudon, Le travail de la viande

Cadavre Reverdy
Monsieur Reverdy, j’ai passé une partie de cette fin d’été à vous relire.
À dire vrai, il y a plus d’un demi-siècle que je vous lis.
Et parmi ce demi-siècle, il y a bien un quart de siècle où j’essaie d’écrire quelque chose à propos de vous.
De ce que je vous dois.
Si le temps présent et celui qu’on projette ne peuvent s’éclairer et se comprendre qu’en remontant vers le passé (comme si tout était joué initialement), vous avez été, Monsieur Reverdy, par votre énigmatique conversion à la foi catholique, un des rares poètes vivants parcimonieusement dans la bibliothèque des nonnes trinitaires d’Avignon où je me retrouvais enfermée comme pensionnaire après la vie libre d’une petite enfance paysanne.
Longtemps j’ai partagé l’avis de Marguerite Duras qui déclarait que l’acte d’écrire ne sauvait de rien, n’apprend rien si ce n’est à éc rire... Aujourd’hui, où j’ai atteint l’âge où vous êtes mort, je peux, vous citant, faire mienne la formule : « Écrire m’a sauvée. A sauvé mon âme. Je ne peux pas imaginer ce qu’eût été ma vie si je n’avais pas écrit. J’ai écrit comme on s’accroche à une bouée. »
Liliane Giraudon, Le travail de la viande, P. O. L, 2019, p. 107-108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, le travail de la viande, cadavre reverdy, nonne, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2021
Louise Labé, Sonnets

Sonnet XXI
Quelle grandeur rend l’homme venerable ?
Quelle grosseur ? quel poil ? quelle couleur ?
Qui est des yeux le plus emmieleur ?
Qui fait plus tot une playe incurable ?
Quel chant est plus à l’homme convenable ?
Qui plus penetre en chantant sa douleur ?
Qui un doux lut fait encore meilleur ?
Quel naturel est le plus amiable ?
Je ne voudrois le dire assurément,
Ayant Amour forcé mon jugement ;
Mais je sais bien et de tant je m’assure,
Que tout le beau que l’on pourroit choisir,
Et que tout l’art qui ayde la Nature,
Ne me sauroient accroitre mon desir.
Louise Labé, Sonnets, dans Œuvres complètes,
Pléiade/Gallimard, 2021, p.107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnets, blason du corps masculin | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2021
Louise Labé, Sonnets

Sonnet XIV
Tant que mes yeux pourront larmes espandre,
À l’heur passé avec toy regretter :
Et qu’aux sanglots et soupirs resister
Pourra ma voix, et un peu faire entendre ;
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du mignart Lut, pour ses graces chanter ;
Tant que l’esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien fors que toy comprendre ;
Je ne souhaite encore point mourir.
Mais quand mes yeux je sentirai tarir
Ma voix cassée, et ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel sejour
Ne pouvant plus montrer signe d’amante :
Prirey la mort noircir mon plus cler jour.
Louise Labé, Sonnets, dans Œuvres complètes,
Pléiade/Gallimard, 2021, p. 100.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnets, larme, voix, luth | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2021
Camille Loivier, éparpillements

je suis dans la maison des rêves tant
de gens rêvent d’une maison de s’y maintenir
ils passent des années à la réparer à
l’aménager parfois toute une vie si bien
qu’à la fin chaque pièce est pleine à craquer
et le jardin laisse à peine plus de liberté
alors à ce moment-là on s’arrête
(la maison explose)
la main exposée
l’araignée à longues pattes qui grimpe sur le mur
en plein milieu n’est pas craintive elle est
chez elle sans nul doute fine et jeune
la maison file au bout de ses pattes
il n’y a personne à l’intérieur
Camille Loivier, éparpillements, isabelle sauvage,
2017, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, éparpillements, maison, araignée | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2021
Camille Loivier, Swifts

III. La langue du sanglier
Les animaux sont entrés dans ma vie
ils me poursuivent de leurs yeux agrandis
par l’incapacité de parler avec la bouche
tandis que leur langue multiple passe
par tout le corps dans un courant ininterrompu
mais les yeux parfois en disent plus long
— tu ouvres la bouche mais aucun son ne sort
les swifts crient dans le ciel
alors je viens avec mon père dans le silence
(...)
Camille Loivier, Swifts, éditions isabelle sauvage,
2021, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, swifts, la langue du sanglier, animal, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2021
Camille Loivier, d'abandon

perdue
au sol
il n’y a plus rien
qu’un aplat sur la terre
(si quelqu’un tendait la main)
passe
un souffle de vent à la surface de la peau
folle patience
on attend de ne plus peser
de ne plus penser, car
penser ne signifie rien
simple comme
un corps qui s’épuise
— remuer ferait mal —
(danse en nous figée)
on est de la pierre
on est
Camille Loivier, d’abandon,
Faï fioc, 2020, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, d’abandon, d'abandon, immobilité | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2021
Georges Didi-Huberman, Niki Giannari, Passer, quoi qu'il en coûte

(...) Après tout, les réfugiés ne font que revenir. Ils ne « débarquent » pas de rien, ni de nulle part. Quand on les considère comme des foules d’envahisseurs venus de contrées hostiles, quand on confond en eux l’ennemi avec l’étranger, cela veut surtout dire que l’on tente de conjurer quelque chose qui, de fait, a déjà eu lieu : quelque chose que l’on refoule de sa propre généalogie. Ce quelque chose, c’est que nous sommes tous des enfants de migrants et que les migrants ne sont que nos parents revenants, fussent-ils « lointains » (comme on parle des cousins). L’autochtonie que vise, aujourd’hui, l’emploi paranoïaque du mot « identité », n’existe tout simplement pas et c’est pourquoi toute nation, toute région, toute ville ou tout village sont habités de peuples au pluriel, de peuples qui coexistent, qui cohabitent, et jamais d’« un peuple » autoproclamé dans son fantasme de « pure ascendance ». Personne en Europe n’est « pur » de quoi que ce soit — comme les nazis en ont rêvé, comme en rêvent aujourd’hui les nouveaux fascistes — et si nous l’étions par le maléfice de quelque parfaite endogamie pendant des siècles, nous serions à coup sûr génétiquement malades, c’est-à-dire « dégénérés ».
Georges Didi-Huberman, Niki Giannari, Passer, quoi qu’il en coûte, éditions de Minuit, 2017, p. 31-32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, niki giannari, passer, quoi qu’il en coûte, migrant, réfugié, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2021
Paul Valéry, Cahiers, II, Littérature
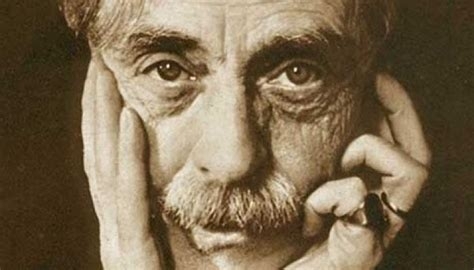
Pour faire des romans, il faut considérer les hommes comme des unités ou éléments bien définis.
Il fit ceci. Elle dit cela.
On oublie aisément que c’est fit et dit, ceci et cela qui définissent et construisent Il et Elle dans tous les cas possibles.
Paul Valéry, Cahiers II, Littérature, Pléiade/Gallimard, 1975, p.1206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers ii, littérature, roman | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2021
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie
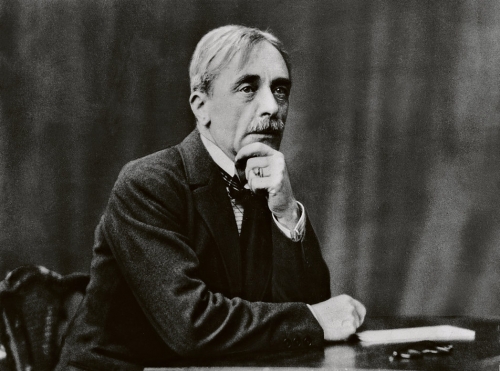
Je ne puis séparer mon idée de la poésie de celle de formations achevées — qui se suffisent, dont le son et les effets psychiques se répondent, avec un certain « indéfiniment ».
Alors, quelque chose est détachée, comme un fruit ou un enfant de sa génération et du possible qui baigne l’esprit — et s’oppose à la mutabilité des pensées et à la liberté du langage fonction.
Ce qui s’est produit et affirmé ainsi n’est plus de quelqu’un mais vomme la manifestation de propriétés intrinsèques, impersonnelles, de la fonction composée. Langage — se dégageant rarement dans des conditions aussi rarement réunies que celles qui font le carbone diamant. (1942)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, -cahiers, ii, poétique, langage, pensée | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2021
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie
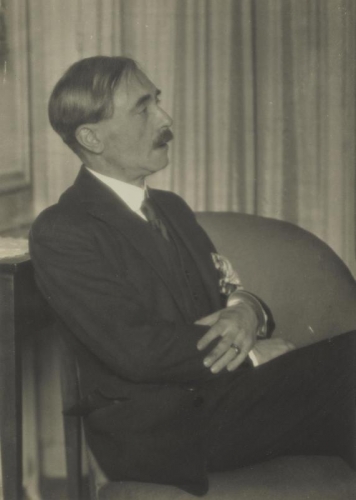
Des vers du poème, les uns furent trouvés, les autres faits.
Les critiques disent des sottises qui parlent sur ce poème comme d’un tout, et qui ne considèrent pas la position de l’auteur : combiner, appareiller les vers de ces deux espèces.
Le travail du poète est de faire disparaître cette inégalité originelle ; d’ailleurs, tout travail intellectuel consiste à mettre d’accord pour un but, ce qu’on trouve, et des conditions données d’autre part.
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie, Pléiade/Gallimard, 1974, p. 1066.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, trouver, faire | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2021
Marie-Laure Zoss, D'ici qu'à sa perte

hors du crâne avant peu, la sciure des chiffres, tel au plancher le bois moulu, taraudeurs, capricornes bouffeurs d’aubier, et on n’y peut pas grand-chose, on le sait bien, dans la pelle de fer on a beau en ramasser de cette farine, poignée d’or pâle à peine mesurable dans la poussière de charbon, la balayer sur les ardoises, échancrée la raison laisse filer pêle-mêle des syllabes clouées sans ordre ; coques vides et nom des chemins ;
nous les rafistolés, les trébuchants, on épelle nos morts devant la cave — lequel le premier, un mort pour un autre, on les distribue tous azimuts — à pleurer ce cafouillis sans queue ni tête, et s’enchevêtre l’alphabet des heures, de la sorte on les enfile dans le courant d’un matin de mai.
Marie-Laure Zoss, D’ici qu’à sa perte, Faï fioc, 2021, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, d’ici qu’à sa perte | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2021
Robert Desnos, Choix de Poèmes

Le veilleur du Pont-au-Change
Je suis le veilleur de la rue de Flandre,
Je veille tandis que dort Paris.
Vers le nord un incendie lointain rougeoie dans la nuit.
J’entends passer des avions au-dessus de la ville.
Je suis le veilleur du Point du Jour.
La Seine se love dans l’ombre, derrière le viaduc d’Auteuil,
Sous vingt-trois ponts à travers Paris.
Vers l’ouest, j’entends des explosions.
Je suis le veilleur de la Porte Dorée.
Autour du donjon le bois de Vincennes épaissit ses ténèbres.
J’ai entendu des cris dans la direction de Créteil
Et des trains roulent vers l’est avec un sillage de chants de révolte.
Je suis le veilleur de la Poterne des Peupliers.
Le vent du sud m’apporte une fumée âcre,
Des rumeurs incertaines et des râles
Qui se dissolvent quelque part, entre Plaisance et Vaugirard.
Au sud, au nord, à l’est, à l’ouest,
Ce ne sont que fracas de guerre convergeant vers Paris.
Je suis le veilleur du Pont-au-Change
Veillant au cœur de Paris, dans la rumeur grandissante
Où je reconnais les cauchemars paniques de l’ennemi,
Les cris de victoire de nos amis et ceux des Français,
Les cris de souffrance de nos frères torturés par les Allemands d’Hitler.
Je suis le veilleur du Pont-au-Change
Ne veillant pas seulement cette nuit sur Paris ,
Cette nuit de tempête sur Paris seulement dans sa fièvre et sa fatigue,
Mais sur le monde entier qui nous environne et nous presse.
Dans l’air froid tous les fracas de la guerre
Cheminent jusqu’à ce lieu où, depuis si longtemps, vivent les hommes.
(...)
Robert Desnos, Choix de poèmes, collection L’Honneur des Poètes (dirigée par Paul Éluard, éditions de Minuit, 1946, p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, choix de poèmes, le veilleur du pont-au-change | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2021
Robert Desnos, Domaine public

Les sources de la nuit
Les sources de la nuit sont baignées de lumière.
C’est un fleuve où constamment
boivent des chevaux et des juments de pierre
en hennissant.
Tant de siècles de dur labeur
aboutiront-ils enfin à la fatigue qui amollit les pierres ?
Tant de larmes, tant de sueur,
justifieront-ils le sommeil sur la digue ?
Sur la digue où vient se briser
le fleuve qui va vers la nuit,
où le rêve abolit la pensée.
À rebrousse-poil, à rebrousse-chemin,
Étoile, suivez-nous, docile, `
et venez manger dans notre main,
Maîtresse enfin de son destin
et de quatre éléments hostiles.
Robert Desnos, Domaine public, Le point
du jour/Gallimard, 1953, p. 307.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, les souces de la nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2021
Robert Desnos, Domaine public

Comme une main à l’instant de la mort
Comme une main à l’instant de la mort et du naufrage se dresse comme les rayons du soleil couchant, ainsi de toutes parts jaillissent tes regards.
Il n’est plus temps, il n’est plus temps peut-être de me voir,
Mais la feuille qui tombe et la roue qui tourne te diront que rien n’est perpétuel sur terre,
Sauf l’amour,
Et je veux m’en persuader.
Des bateaux de sauvetage peints de rougeâtres couleurs,
Des orages qui s’enfuient,
Une valse surannée qu’emportent le temps et le vent durant les longs espaces du ciel.
Paysages.
Moi je n’en veux pas d’autres que l’étreinte à laquelle j’aspire,
Et meure le chant du coq.
Comme une main à l’instant de la mort se crispe, mon cœur se serre.
Je n’ai jamais pleuré depuis que je te connais.
J’aime trop mon amour pour pleurer.
Tu pleureras sur mon tombeau,
Ou moi sur le tien.
Il ne sera pas trop tard.
Je mentirai. Je dirai que tu fus ma maîtresse
Et puis vraiment c’est tellement inutile,
Toi et moi nous mourrons bientôt.
Robert Desnos, Domaine public, Le point du jour/ Gallimard,
1953, p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, amour, mort, étreinte, paysage | ![]() Facebook |
Facebook |





