07/02/2022
Charles Pennequin, Dehors Jésus

Petit Jésus est nostalgique des premiers instants qu’il vit mais qu’il ne connaît pas. Il st nostalgique de la vie qui pousse sans s’arrêter. La vie pousse devant lui et autour de lui, partout la vie elle pousse et elle ne s’arrête jamais et pourtant il lui semble qu’elle n’est que mort. La vie elle ne s’arrête jamais pour échapper à la mort, mais en réalité c’est parce qu’elle continue qu’elle est dans la mort, c’est ce que petit Jésus pense, car petit Jésus pense que la vie c’est la nostalgie, c’est-à-dire le moment où tout s’arrête. La vie, c’est le moment où l’on voudrait tout noter de la vie et qu’on ne peut pas, on ne peut pas noter la vie qu’on vit pense alors petit Jésus, et petit Jésus voudrait accrocher la vie pour pouvoir tout goûter des moments qu’il est en train de vivre, ce qu’il vit file à toute allure, elle file de partout tout autour du petit Jésus la vie.
Charles Pennequin, Dehors Jésus, P. O. L, 2022, p. 113-114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles pennequin, dehors jésus, nostalgie, vie, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
06/02/2022
Guillaume Apollinaire, Poèmes de guerre

Pluie
La pluie argente mes beaux rêves
Ce long après-midi d’hiver
Le soleil darde ses petits glaives
Dont le reflet est gris et vert
Nîmes aux ruelles dormantes
Qu’entourent de longs boulevards
Les cafés y sont pleins de tantes
Et de vieux officiers bavards
Soupé de la Maison Carrée
Mais la Fontaine est de mon goût
J’aime la pierre à teinte ambrée
Lorsque le soleil luit partout
Mais c’est au temple de Diane
— Ô liberté de mes rognons
Faites qu’enfin mon cul se tanne —
Que je relis des compagnons
Les inscriptions anciennes
Je les aime mon cher André*
Engravant ces pierres romaines
Roses dans le jour gris cendré
ton Guil Apollinaire
* André Billy
Guillaume Apollinaire, Poèmes de guerre, édition
Claude Debon, Les Presses du réel, 2018, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaumle apollinaire, pluie, hiver, gujerre | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2022
Jacques Lèbre, Le poète est sous l'escalier
Un (...) thème qui me fait remarquer facilement des correspondances, c’est celui de la répétition. À vrai dire, je n’ai jamais senti de répétition dans la répétition, car elle est toujours peuplée d’infimes ou d’infinies variations. Entre un paysage familier aux états d’âme changeants et soi-même aux états d’âme tout aussi changeants il ne saurait y avoir de répétition. Cela pourrait commencer par Paul Valéry d’une façon aussi radicale que laconique : L’habitude est un excitant. Cela pourrait se poursuivre avec Georges Borgeaud dans Le soleil sur Aubiac : À me pencher sur la répétition, je ne ressens ni lassitude ni ennui et quand parfois mon enthousiasme s’amincit, j’en souffre comme le mystique qui se croit privé de la présence de Dieu. Mais c’est un livre plus récent qui m’a fait rouvrir celui de Borgeaud et chercher dans les Cahiers de Paul Valéry. Joël Cornuault, l’un de nos meilleurs écrivains buissonniers, écrit dans Liberté belle : Quoi qu’ils soient familiers , aucune usure ne semble pouvoir nous gâcher les formes ou l’atmosphère de nos tours rituels ; l’aspect général nous étant désormais bien connu, nous savons acclamer sur la route le plus petit fait nouveau, à nous seul perceptible : nous aimons entrer dans les détails sur ce chemin sans inquiétude, propice à la réflexion. Voilà une promenade qui est toujours la même et toujours une autre. Mais n’en irait-il pas de même dans la deuxième ou troisième relecture d’un livre ?
Jacques Lèbre, Le poète est sous l’escalier, Corti, 2021, p. 34-35.
Photo T. H., 2018
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, le poète est sous l'escalier, répétition, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2022
Charles Pennequin, Dehors Jésus

(...) Malgré tous les beaux discours, l’humain n’a jamais fait autant de bruit. Il jouit dans les déflagrations et les explosions. Il jouit plus que jamais de la guerre quotidienne faite à la nature et à lui-même, et du coup il produit de l’art. L’art c’est jouir dans l’impensable. L’art c’est se fondre dans ce qui est presque inhumain et le bruit fait écho à ce qui est inaudible en fin de compte. Et ce qui est inaudible encore maintenant, c’est la passion seule pour le bruit. La violence est inaudible pour les contemplateurs de l’art mort, pour ceux qui ne veulent pas de l’impensable, ni même de l’impensé, pour celui ou celle qui feint toujours de ne pas jouir du bruit de la vie présente. Et la vie présente n’est qu’inhumaine pour les humains. Il n’y a pas d’autre vie possible puisque la vie pour l’inconscient humain n’est pas dans la nature. Bien sûr il contemple et aime la nature l’humain, mais pour son art mort. C’est une passion hypocrite. C’est pour se faire croire qu’il est proche de la nature, alors qu’au fond il a quitté le naturel depuis qu’il parle.
Charles Pennequin, Dehors Jésus, P. O. L, 2022, p. 159.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles pennequi, dehors jésus, humain, bruit, impensable, art | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2022
Michel Deguy, Figurations

Haïku du visible
Un L'équidistant Lui le lucide
L'impartial quand la terre dormeuse
Se retourne vers lui
Deux La coque azur
Incrustés d'arbres sous la ligne de pendaison
L'air qui cède à l'oiseau
Qui s'efface
Trois Le treillis le réseau le tamis
Le nid d'intervalles
Un feu de paille aussi longtemps que le soleil
Et ces murs une piste de plantigrades
Murs tracés à coups de griffe
Et debout comme un moulage de combat
Quatre L'eau bien épaisse bien ajointée
L'eau remplie remplissant
L'eau sans jour sur le poisson mouillé
Et la terre comme fonds la recouverte la patiente
L'implicite
Michel Deguy, Figurations, Poème-proposition-études,
"Le Chemin", Gallimard, 1969, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, figurations, haïku du visible | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2022
John Donne, Poésie

Maléfices par un portrait
Fixant ton œil, je m’apitoie
Sur mon portrait, qu’y vois brûler ;
Le vois en un pleur qui se noie,
Plus bas venant à regarder.
Ayant l’art maléfique
De me tuer par ma réplique,
Que de fois pourrai-tu combler tes vœux iniques ?
J’ai bu ta douce-amère larme :
Si tu pleures encor, je pars ;
Le portrait n’est plus, ni l’alarme
Qui me puisse navrer ton art.
S’il me reste une image
De moi, elle sera, je gage,
Se trouvant dans ton cœur, sauve de tout dommage.
John Donne, Poésie, bilingue, traduction Jean Fuzier,
Poésie/Gallimard, 1991, p. 157.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, maléfices par un portrait | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2022
John Donne, Poésie

Adieu : sur mon nom gravé sur un verre
I
Mon nom gravé sur cette vitre
Communique ma fermeté au verre même
Rendu par ce charme aussi dur
Que l’instrument qui l’a gravé.
Ton œil lui donnera plus de prix qu’aux diamants
Extraits de l’une et l’autre roche.
II
Pour le verre, tout confesser
Et être autant que moi transparent, c’est beaucoup ;
Plus encore, te montrer à toi-même,
Offrant à l’œil l’image claire ;
Mais la magie d’amour abolit toute règle :
Là tu me vois et je suis toi.
III
De même que nul point, nul trait
(De ce nom pourtant les simples accessoires),
Averses ou tempêtes n’effacent,
Tous les temps me verront de même :
Mais tu peux mieux encore intègre demeurer,
Ayant près de toi ce modèle.
[...]
John Donne, Poésie, traduction Robert Ellrodt,
Imprimerie nationale, 1994, p. 161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, nom, transparence, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
28/01/2022
Pascal Quignard, Mourir de penser

La mort d’Ariane
Thésée, sa pelote de fil dans la main, ne la prévint pas et suivit le rivage.
Il a suivi le bord du rivage qui venait toucher l’eau comme si c’était un fil.
Il a rejoint son bateau. Il est monté à bord. Il a saisi le cordage à deux mains. Il a brusquement tiré sur la corde. Il a hissé la voile. Il est parti.
C’est ainsi que sans rien lui dire, sans regarder derrière lui, Thésée abandonne Ariane entre les phoques et les loups, cramponnée à son récif isolé. Elle lève les yeux ; elle est survolée par les faucons de mer. C’est l’île de Dia, en face de Gnose. Là, sur son rocher, alors qu’elle crie de plus en plus vainement, qu’elle articule de moins en moins fort le nom de Thésée qui vient de la délaisser, alors qu’elle meurt au lieu où elle fut délaissée, alors qu’elle gémit, tout bas de façon douloureuse et lancinante, ce nom aimé, alors que peu à peu ce nom se fait chant et qu’il cesse de désigner un être, tandis qu’elle module et accentue son thrène dans la douleur, c’est Liber qui vient la prendre dans ses bras, ouvre ses ailes, et la transfère dans le ciel.
Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 78-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, la mort d'ariane, thésée, abandon, yhrène | ![]() Facebook |
Facebook |
27/01/2022
Pascal Quignard, Mourir de penser
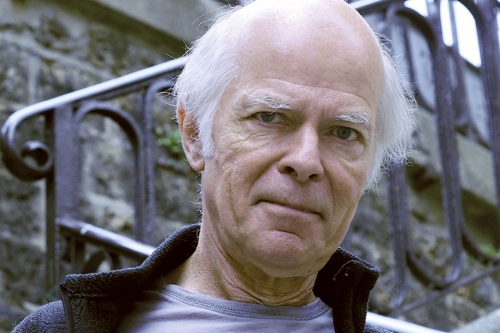
Il est des aspects du réel auxquels on ne peut accéder que si et seulement si on en manque d’autres.
On ne peut jouir en ouvrant les yeux.
Toute vision x est un aveuglement y.
Toute audition y est une surdité x .
Qui flaire ne goûte pas.
Qui écoute ne saute pas.
On ne dort pas debout.
On n’aime pas quelqu’un si on songe à soi.
Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 178.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, manque | ![]() Facebook |
Facebook |
26/01/2022
Pascal Quignard, Sur le jadis
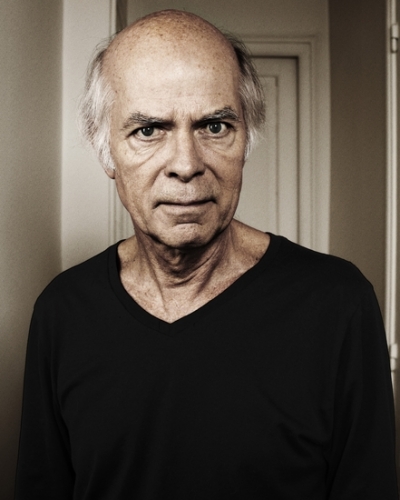
La formulation archaïsante des proverbes soudain surgissant dans le discours actuel renvoie à un passé sans détermination et de ce fait dont l’autorité peut passer pour absolue.
Cette absence de détermination dans le passé linguistique rend la phrase abyssale.
Ce langage coalescent se concrétionne peu à peu sous la voûte du crâne et s'y suspend.
Petites voix hallucinogènes qui, glissant goutte à goutte, creusent petit à petit des chemins sur la pente vide du temps que le langage découvre.
Cette mise hors du temps du temps est un placement dans le temps des contes.
Le proverbe est de l’Il était une fois à l’instant où il se fragmente.
Pascal Quignard, Sur le jadis, Folio/Gallimard, 2004, p. 180.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, sur le jadis, proverbe, temps, conte | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2022
Pascal Quignard, Abîmes

Le malheur est distinct du désespoir.
Le malheur consiste en la croyance au présent. Le malheureux est le corps qui exclut que tout passé puisse l’affecter. La dépression, l’acedia redoutent de façon panique le passé ressurgissant ici comme un fauve qui dévore. Le déprimé prétend vivre dans l’instant. Tout souvenir doit être évité. Il émeut trop. Toute rétrospection est fuie.
Le signe de la déréliction est l’impossibilité de souffrir le passé parce que la possibilité du bonheur tisse un lien puissant avec jadis.
Pascal Quignard, Abîmes, Folio/Gallimard, 2004, p. 168.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, malheur, présenrt, passé | ![]() Facebook |
Facebook |
24/01/2022
Pascal Quignard, Les Paradisiaques
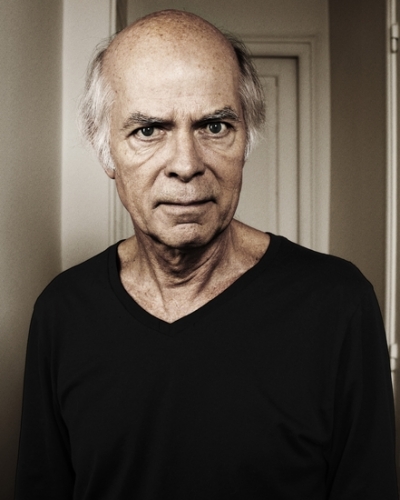
Le nez
Dans le petit tiroir en bois de buis — ou plutôt dans son ombre quand on le repoussait — là était située la jouvence.
Le nez est le seul guide au paradis.
C’est le seul Virgile.
Il conduit aux grains de café brun foncé dans le moulin à manivelle.
Alors les yeux se portent sur la poudre extrêmement fine et odorante et noire dans le petit tiroir en bois que la main maigre et nerveuse de ma grand-mère tirait doucement,
versait doucement.
Moins d’eau chaude dans la chaussette,
meunier de café d’un autre temps,
vie divine.
Pascal Quignard, Les Paradisiaques, Folio/Gallimard, 2007, p. 204.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les paradisiaques, nez, café | ![]() Facebook |
Facebook |
23/01/2022
Pascal Quignard, Sordidissimes
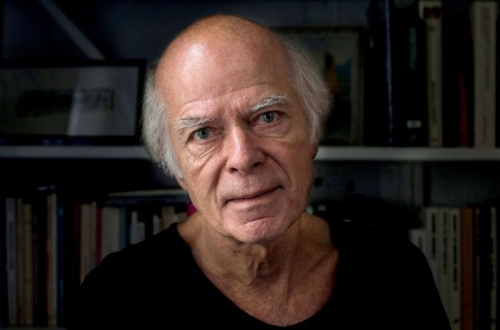
Chapitre XXXIV
Lieu perdu. Objet perdu. Océan perdu. Cité perdue. Errant sans retour.
Comme Dante allait de petites cours en petites cours.
Navire sans voiles, sans but, sans astres sous les nuages,
avançant à l’aveugle dans la nuit de sa langue.
Homme qui même dans la nuit de sa langue ne s’avançant que dans le souvenir d’une nuit qui précède la nuit.
Car ils se souviennent d’une nuit d’avant la nuit, tous les hommes, poissons perdus, eau perdue, chaleur perdue, pénombre perdue.
Au gouvernail non pas un ni deux ni trois
rois
un amas de pilotes morts
les uns sur les autres, le ventre nu.
Car ils ont tous le ventre nu pour qu’ils se succèdent ceux qui se suivent dans le temps.
Pascal Quignard, Sordidissimes, Golio/Gallimard, 2007, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, sordidissimes, perte, nudité | ![]() Facebook |
Facebook |
22/01/2022
Ludovic Degroote, La Digue

On a tous des soucis et tous une tête à mettre autour, on dit qu’on se sent mieux au chaud de l’impasse, le vent est coupé, l’ombre portée, on y fait des images — dans ce mouvement constant par lequel la vie nous traverse, les impasses bougent, reculent, paisiblement, jusqu’à ce qu’elles soient au bout d’elles-mêmes.
Ludovic Degroote, La Digue, éditions Unes, 2017, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, la digue, impasse | ![]() Facebook |
Facebook |
20/01/2022
Ludovic Degroote, Pensées des morts

les morts meurent encore, c’est comme une habitude, faut toujours continuer d’être un peu vivant pour terminer de mourir.
pas très pratique à vérifier, on prend la main et on la laisse tomber, on travaille sur la mâchoire, on examine l’œil en surface, on n’a pas chaque fois un miroir sous le coude.
pas très pratique, gestes empêtrés et approximatifs, poisseux, avec ce mort qui colle aux doigts, déjà devenu aussi encombrant que son corps, comme si plus comment le prendre soudain, et quoi en foutre
décidément
on n’est pas des endroits bien pour mourir
Ludovic Degroote, Pensées des morts, Tarabuste, 2002, p. 42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensées des morts, habitude | ![]() Facebook |
Facebook |






