08/11/2020
Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo

Septième jour
À quel point jamais on ne dira
à quel point de silence et de nord
l’hiver ému m’a restaurée de gelée blanche
N’ayant plus de peau je choisissais la pierre
et la vérité qui fait de nous
des plongeurs essoufflés
une bouchée d’aurore
Mais un mot à la fin celui qu’on voit s’affaisser
et l’autre qui se redresse et crie
ont grignoté les mêmes baies de chaque côté du ciel
entrevu le mystère qui est comme les orvets
sur les roches, par toute approche empêché
de prendre racine
Mais le soleil, pour eux, ne revient plus
Le monde est dur comme des crics d’étal
épais comme des saules au bord de leur naissance
Il donne à note chant
sa profondeur de granges
Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo,
Arcane 17, 1985, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, une semaine dans la vie de mona grembo, le septième jour, mystère | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2020
Giorgio Manganelli, Centuries

Quatre vingt-six
Il se demande souvent si la question du rapport à la sphère n'est pas, de par sa nature même, insoluble. La sphère n'est pas présente en permanence devant ses yeux, cependant, même lorsqu'elle s'éloigne, même lorsqu'elle se retire ou se cache, la sphère agit, et il croit comprendre que si le monde présente cette forme qu'on connaît, c'est précisément parce qu'il doit accueillir la sphère. Parfois, alors qu'il vient de se réveiller, dans la chambre plongée dans une semi-obscurité — le jour a déjà commencé pour tout le monde, et ce n'est pas ce qu'il aime se lever tard, mais en retard — la sphère se tient en équilibre au milieu de la chambre ; il l'examine avec attention car, telle une question, la sphère exige de l'attention. La sphère n'est pas toujours de la même couleur, elle passe par toutes les nuances du gris au noir : parfois, et ce sont les moments les plus intéressants, la sphère bascule, laissant place à une cavité sphérique, à un vide entièrement privé de lumière. Il arrive que la sphère s'absente quelque temps, mais rarement plus d'une dizaine de jours. Elle réapparaît à l'improviste, à n'importe quelle heure, sans raison compréhensible, comme si elle revenait de voyage, comme après une absence légèrement coupable quoique convenue. Il a l'impression que la sphère fait semblant de présenter ses excuses, mais qu'elle est en réalité ironique et, même innocemment, maligne. Il fut un temps où, par la violence, il tenta d'effacer de sa vie cette présence révulsive ; mais la sphère est taciturne, insaisissable, à moins qu'elle ne décide elle-même de frapper ; elle provoque alors dans la partie du corps qu'elle atteint, une douleur opaque, sombre, déchirante. Quoi qu'il en soit, la manifestation typique de l'hostilité de la sphère consiste à s'interposer entre lui et quelque chose qu'il essaie de voir ; dans ce cas, la sphère est susceptible de devenir minuscule, une bille turbulente qui danse et s'esquive devant ses yeux. Il est une fois de plus tenté d'affronter la sphère avec une soudaine brutalité, comme s'il ignorait que, de par sa constitution il est impossible de l'atteindre ; ou bien il envisage de s'enfuir, de recommencer sa vie en un lieu que la sphère ne connaît pas. Mais il ne croit pas que cela soit possible ; il pense qu'il doit convaincre la sphère de ne pas exister, et il sait que pour la conduire à cette progressive séduction du néant, il lui faut emprunter une voie lente, patiente, labyrinthique, et faire preuve d'ingéniosité et de minutie.
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves), prologue de Italo Calvino, traduction Jean-Baptiste Para, éditions W, 1985, p. 183-184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, centurie (cent petits romans fleuves), italo calvino, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |
31/10/2019
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de fra Angelico
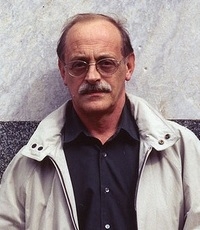
Message de la pénombre
La tombée de la nuit est soudaine sous ces latitudes ; le crépuscule éphémère ne dure que le temps d'un soupir, puis laisse place à l'obscurité. Je ne dois vivre que pendant ce bref intervalle ; pour le reste, je n'existe pas. Ou plutôt je suis ici, mais comme sans y être, car je suis ailleurs, même là, en ce lieu où je t'ai quittée, et partout dans le monde, sur les mers, dans le vent qui gonfle les voiles des voiliers, dans les voyageurs qui traversent les plaines, sur les places des villes, avec leurs vendeurs et leurs voix et le flux anonyme de la foule. Il est difficile de dire de quoi est faite ma pénombre, et ce qu'elle signifie. C'est comme un rêve dont tu sais que tu le rêves, et c'est en cela que réside sa vérité : être réel en dehors du réel. Sa morphologie est celle de l'iris, ou plutôt des gradations labiles qui s'effacent déjà au moment d'exister, tout comme le temps de notre vie. Il m'est donné de le parcourir à nouveau, ce temps qui n'est plus mien et qui fut nôtre, et à toute vitesse il court au fond de mes yeux : il est si rapide que j'y aperçois des paysages et des endroits où nous avons habité, des moments que nous avons partagés, et même les propos que nous tenions autrefois, t'en souviens-tu ? Nous parlions des jardins de Madrid et d'une maison de pêcheurs où nous aurions voulu vivre, nous parlions des moulins à vent, des récifs à pic sur la mer par cette nuit d'hiver où nous avons mangé de la panade, et nous parlions de la chapelle avec les ex-voto des pêcheurs : les madones avaient le visage des femmes du peuple et les naufragés pareils à des marionnettes se sauvaient des flots en s'agrippant au rai d'une lumière venue du ciel.
[...]
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de fra Angelico, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para, Christian Bourgois, 1989, p. 44-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio tabucchi, les oiseaux de fra angelico, message, pénombre, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2019
Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo

Sommeil du temps, de l’espace. Des entailles de corde, des cordes de poussière. Si loin déjà le soir, où gorge et couteau face à face se cabrent.
Oiseau, l’oiseau des cahiers d’enfance. Les ailes étaient une accolade. Mais aucun vol ne se bâtit dans le regret.
Si je dois dédier mon vol, est-ce aux hommes nus, poings fermés, qui cherchent des poches dans leurs flancs ?
Mieux que les poings, le vent s’engouffre.
Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo, Arcane 17, 1985, p. 50, 51, 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, une semaine dans la vie de mona grembo, sommeil, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2018
Giorgio Manganelli, Amour

[L’Amour]
A. Ainsi deviserons-nous de l’amour.
B. Et d’opportune manière, puisque discourant sur la vertu, la mort, la fuite, l’abolition de l’être, nus avons toujours et uniquement parlé de solitudes, d’abstractions et, même en dialoguant, nous ne sommes en fait jamais sortis du monologue.
A. Tandis que l’amour est mouvement de l’âme, qui exige un destinataire
B. C’est aussi mon avis.
A. Bref, en amour nous aurons un amant et un aimé.
B. Qui aime doit aimer quelque chose.
A. Quelque chose qui existe ? Ou d’aventure serait-il possible d’aimer ce qui n’existe pas ?
B. Quelque chose qui existe, je présume.
A. Une chose aimée, existante, mais aussi, puis-je supposer, distincte, jamais confondue avec qui aime.
B. Bien entendu, constamment distincte.
A. Dans tous les cas ?
B. Assurément, dans tous les cas.
A. Et, à ton avis, la dignité de l’amour réside davantage en celui qui aime, ou en celui qui est aimé ?
B. En celui qui aime, je crois ; ce dernier souffre, médite, s’acharne, s’agite, s’inquiète, il est noctambule et insomniaque, se méprend et ne voit pas ; bref, s’il n’était là pour aimer, quelle condition pourrait bien échoir à l’objet d’amour ? Si l’amour ne le touchait, ce ne serait que pauvre chose, à tous égards semblable à d’autres possibles objets d’amour, qui en aucun cas n’échappent à leur solitude.
A. Ainsi affirmes-tu que le dignité de l’amour, voire l’amour lui-même, sont privilège de l’amant.
B. Tout à fait.
A. Mais penses-tu que l’amant puisse destiner son amour à n’importe quel objet ? J’entends : est-il indifférent à la beauté, la sagesse, la grâce et le gloire ? Peut-il aimer toute chose, même minuscule et inanimée ?
B. Certes non ; l’amant aimera une chose non dénuée de grâce, pourvue d’un je-ne-sais-quoi, une parfaite douceur, de la noblesse.
A. Donc, l’objet aimé n’est pas étranger ou indifférent à ce mouvement de l’âme que nous appelons « amour ».
B. Non, assurément.
A. Et si l’amant aimait une chose d’une totale inconvenance, un homme de lettres mettons, un mathématicien épris d’un singe, un hérisson, une lame rouillée, verrions-nous encore en lui le dépositaire de la dignité de l’amour.
B. Il pourrait l’être, mais sa dignité serait profondément frustrée par le choix malheureux de son amour.
A. Donc, si je comprends bien, qui aime doit aimer un objet convenable ; s’il lui échoit au contraire d’aimer une chose inconvenante, il est alors dépossédé de la la dignité de l’amour.
[…]
Giorgio Manganelli, Amour, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Denoël, 1986, p. 103-105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, jean-baptiste para, dignité, beauté, convenance, dialogue | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2017
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de Fra Angelico

Dernière invitation
Au voyageur solitaire — l’espèce est rare, mais il s’en trouve encore — qui ne se résigne pas aux formes tièdes et standardisées de la mort à l’hôpital telle que la garantissent les États modernes, à celui-là qui, plus encore, est terrorisé à l’idée du sort expéditif et impersonnel auquel sera voué son corps au moment des obsèques, Lisbonne continue d’offrir une appréciable variété de choix pour un noble suicide. Cette ville dispose en outre des infrastructures es plus décentes, les plus raffinées, les plus diligentes et surtout les plus économiques pour le traitement de ce qui subsiste après un suicide bien réussi : l’inévitable cadavre.
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de Fra Angelico, traduction Jean-Baptiste Para, Christian Bourgois, 1989, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio tabucchi, les oiseaux de fra angelico, jean-baptiste para, dernière invitation, suicide, lisbonne | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2014
Lucio Mariani, Restes du jour, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para

Testament du joueur de cartes et poète
Quand s'éteindra
ma lanterne brumeuse, intermittente
et que j'aurai quitté le grand réfectoire
si l'un des fennecs
qui fouillent les urnes funéraires
avait la lubie —quia absurdum —
de relier mes papiers
avec une aiguille et des baguettes de bois
pour observer mes reliques sous verre
et expliquer qui je fus,
qu'il se garde de tirer des conclusions,
sous peine d'expier à coup de verges
sa contrefaçon de l'histoire.
Car mon œuvre ne fut que travaux en cours,
règles à polir, baumes volatils,
sources et issues accidentelles
voix précaires et tentatives d'homme orchestre,
rien d'autre en somme
que les stations transitoires d'une vie à grands traits.
Tout le jeu consistant à changer
corps et pensée
sous la tignasse bleue des hêtres.
Lucio Mariani, Restes du jour, traduit de l'italien par
Jean-Baptiste Para, Cheyne, 2012, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucio mariani, restes du jour, jean-baptiste para, joueur de cartes, poète, vie, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2014
Jean-Baptiste Para, Laromira

Laromira
Pardonne-moi si je te dis à l'oreille des choses tristes
Quand j'entends le bruit de mes pas dans mes os
Un silence m'a sauvée du mot
Un autre silence sauvera le mot
Et le vent sera ma demeure
J'ai vu nager les étoiles et j'ai vu les beaux reins du lièvre
J'ai appris qu'en allant de rivière en rivière
Rien n'était véritablement loin
J'ai longtemps tourné une bague à mon doigt
J'ai appris que l'on pensait autrement dans le froid
Et le vent sera ma demeure
Il pouvait neiger dans toute l'étendue de mes veines
La patience était en moi comme le pain sur la table
Mes pouces façonnaient des visages d'argile
De la main gauche je savais aérer le lait
Il y avait dans mes yeux un peu d'ambre
Un peu de vert de nos marais
Et le vent sera ma demeure
Comme le merle et l'abeille sauvage
J'étais l'amie du sureau noir
J'aimais la nonchalante fierté
Des hommes et des tournesols
Le rire où rebondit
La petite perle d'un collier défait
Et le vent sera ma demeure
[...
Jean-Baptiste Para, Laromira dans Rehauts, n°32,
second semestre 2013, p. 39-32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, laromira, rehauts, vent, demeure, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2013
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves)

Quatre vingt-six
Il se demande souvent si la question du rapport à la sphère n'est pas, de par sa nature même, insoluble. La sphère n'est pas présente en permanence devant ses yeux, cependant, même lorsqu'elle s'éloigne, même lorsqu'elle se retire ou se cache, la sphère agit, et il croit comprendre que si le monde présente cette forme qu'on connaît, c'est précisément parce qu'il doit accueillir la sphère. Parfois, alors qu'il vient de se réveiller, dans la chambre plongée dans une semi-obscurité — le jour a déjà commencé pour tout le monde, et ce n'est pas ce qu'il aime se lever tard, mais en retard — la sphère se tient en équilibre au milieu de la chambre ; il l'examine avec attention car, telle une question, la sphère exige de l'attention. La sphère n'est pas toujours de la même couleur, elle passe par toutes les nuances du gris au noir : parfois, et ce sont les moments les plus intéressants, la sphère bascule, laissant place à une cavité sphérique, à une vide entièrement privé de lumière. Il arrive que la sphère s'absente quelque temps, mais rarement plus d'une dizaine de jours. Elle réapparaît à l'improviste, à n'importe quelle heure, sans raison compréhensible, comme si elle revenait de voyage, comme après une absence légèrement coupable quoique convenue. Il a l'impression que la sphère fait semblant de présenter ses excuses, mais qu'elle est en réalité ironique et, même innocemment, maligne. Il fut un temps où, par la violence, il tenta d'effacer de sa vie cette présence révulsive ; mais la sphère est taciturne, insaisissable, à moins qu'elle ne décide elle-même de frapper ; elle provoque alors dans la partie du corps qu'elle atteint, une douleur opaque, sombre, déchirante. Quoi qu'il en soit, la manifestation typique de l'hostilité de la sphère consiste à s'interposer entre lui et quelque chose qu'il essaie de voir ; dans ce cas, la sphère est susceptible de devenir minuscule, une bille turbulente qui danse et s'esquive devant ses yeux. Il est une fois de plus tenté d'affronter la sphère avec une soudaine brutalité, comme s'il ignorait que, de par sa constitution il est impossible de l'atteindre ; ou bien il envisage de s'enfuir, de recommencer sa vie en un lieu que la sphère ne connaît pas. Mais il ne croit pas que cela soit possible ; il pense qu'il doit convaincre la sphère de ne pas exister, et il sait que pour la conduire à cette progressive séduction du néant, il lui faut emprunter une voie lente, patiente, labyrinthique, et faire preuve d'ingéniosité et de minutie.
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves), prologue de Italo Calvino, traduction Jean-Baptiste Para, éditions W, 1985, p. 183-184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, centurie (cent petits romans fleuves), jean-baptiste para, fantastique, humour, labyrinthe | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2013
Lucio Mariani, Restes du jour
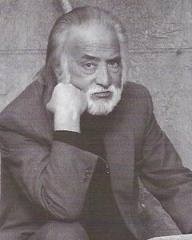
Mort de chien
Saignant, ensanglanté
il pousse de l'épaule la porte entrebâillée :
vieux chien blanc
ses yeux demandent qu'on l'excuse
d'avoir perdu pour la dernière fois
l'allégresse et la guerre.
Il convient à des crocs d'aventurier
comme à la nature du libre bâtard
de s'abattre sur le flanc au bord de la commode
et fixant le regard sur un angle lointain
de s'en aller muet, pudique.
Morte de cane
Sanguinando, sanguendo
entra di spalla dalla porta socchiusa
vecchio cane bianco
gli occhi chiedono scusa
di avere perso proprio l'ultima volta
allegria e guerra.
Conviene a zanne di ventura
alla natura di libero bastardo
atterare sul fianco ai bordi del comò
e muto guardando l'angolo lontano
andarsene pudico.
Lucio Mariani, Restes du jour, traduit de l'italien
par Jean-Baptiste Para, préface de Dominique
Grandmont, Cheyne, 2012, p. 57 et 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucio mariani, restes du jour, jean-baptiste para, dominique grandmont, mort de chien, pudeur | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2013
Vera Pavlova, Immortalité, dans "Europe"

Immortalité
Éternise-moi juste un peu :
Prends de la neige et sculpte-moi
Puis de tes mains chaudes et nues
Frotte-moi jusqu'à ce que je brille...
*
Immortelle : ni vivante ni morte.
L'immortalité est un désastre.
Embrassons-nous. Tes bras sont
Les manches d'une camisole de force.
Embrassons-nous. Tes bras sont
Des bouées de sauvetage.
Telle est la damnation des poètes lyriques :
Une caresse est toujours de première main
Un mot — rarement.
*
Qui passera avec moi l'hiver de mon immortalité ?
Qui décongèlera avec moi ?
Quoi qu'il advienne, je n'échangerai pas
L'amour terrestre pour l'amour souterrain.
J'ai encore le temps de devenir fleur, argile,
Mémoire aux yeux blancs...
Et tant que nous sommes mortels, mon aimé,
Rien ne te sera refusé.
*
Les plus beaux vers sont ceux que j'écris
sur des surfaces tendres
avec la pointe souple de la langue : calligraphie
sur ta bouche, ton tronc, ton ventre...
Ô mon aimé, sagement, j'ai tracé mes lettres.
Veux-tu voir s'effacer entre mes lèvres
ton point d'exclamation ?
*
Nous sommes riches — nous n'avons rien à perdre.
Nous sommes vieux — rien ne nous presse d'aller nulle part.
Il nous faut battre les coussins du passé,
Remuer les braises de l'avenir,
Dire ce qui importe le plus
Tandis que décline le jour indolent
Et porter en terre nos immortels :
À moi de t'inhumer,
À toi ensuite de m'ensevelir.
Vera Pavlova, traduit du russe par Jean-Baptiste Para,
dans Europe, "Abécédaire", n° 1000-1001, août-septembre
2012, p. 109-110.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vra pavlova, immortalité, europe, jean-baptiste para, amour, vers | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2011
Giorgo Manganelli, Centuries, cent petits romans-fleuves
Trente neuf
 Rapide, une ombre court le long des barbelés, à travers les tranchées, près des silhouettes des armes qui se découpent dans la nuit : le messager est pris d'une grande hâte, une furie heureuse le guide, une impatience sans répit. Il porte un pli qu'il doit remettre à l'officier responsable de la place forte, lieu de morts nombreuses et de quantité de clameurs, de lamentations, d'imprécations. Le messager agile traverse les grands méats de la longue guerre. Ça y est, il a rejoint le commandant : un homme taciturne, attentif aux bruits nocturnes, aux fracas lointains, aux éclairs rapides et insaisissables. Le messager salue, le commandant — un homme d'un certain âge déjà, au visage rugueux — déplie le message, l'ouvre et lit. Ses yeux relisent, attentifs. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demande-t-il curieusement au messager, étant donné que le texte de la dépêche est écrit noir sur blanc, et que clairs et communs sont les mots employés. « La guerre est finie, mon commandant », confirme le messager. Il consulte sa montre : « Elle est finie depuis trois minutes.» Le commandant relève la tête, et c'est avec une infinie stupeur que le messager aperçoit sur ce visage quelque chose d'incompréhensible : une impression d'horreur, d'effroi, de fureur. Le commandant tremble, il tremble de colère, de rancœur, de désespoir.
Rapide, une ombre court le long des barbelés, à travers les tranchées, près des silhouettes des armes qui se découpent dans la nuit : le messager est pris d'une grande hâte, une furie heureuse le guide, une impatience sans répit. Il porte un pli qu'il doit remettre à l'officier responsable de la place forte, lieu de morts nombreuses et de quantité de clameurs, de lamentations, d'imprécations. Le messager agile traverse les grands méats de la longue guerre. Ça y est, il a rejoint le commandant : un homme taciturne, attentif aux bruits nocturnes, aux fracas lointains, aux éclairs rapides et insaisissables. Le messager salue, le commandant — un homme d'un certain âge déjà, au visage rugueux — déplie le message, l'ouvre et lit. Ses yeux relisent, attentifs. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demande-t-il curieusement au messager, étant donné que le texte de la dépêche est écrit noir sur blanc, et que clairs et communs sont les mots employés. « La guerre est finie, mon commandant », confirme le messager. Il consulte sa montre : « Elle est finie depuis trois minutes.» Le commandant relève la tête, et c'est avec une infinie stupeur que le messager aperçoit sur ce visage quelque chose d'incompréhensible : une impression d'horreur, d'effroi, de fureur. Le commandant tremble, il tremble de colère, de rancœur, de désespoir.
« Fiche-moi le camp, charogne !» ordonne-t-il au messager ; celui-ci ne comprend pas, le commandant se lève et, de la main, il le frappe au visage. « Décampe ou je te tue ! » Le messager s'enfuit les yeux pleins de larmes, d'angoisse, comme si l'effroi du commandant s'était emparé de lui. Donc, pense le commandant, la guerre est finie. On en revient à la mort naturelle. Les lumières vont s'allumer. Il entend des voix lui parvenir des positions ennemies ; on crie, on pleure, on chante. Quelqu'un allume une lanterne. Partout la guerre est finie, il ne subsiste aucune trace de guerre, les armes précises et rouillées sont définitivement inutiles. Combien de fois l'ont-ils pris en mire pour le tuer, ces hommes qui chantent. Combien d'hommes a-t-il tué et fait tuer dans la légitimité de la guerre ? Car la guerre légitime la mort violente. Mais à présent ? Le visage du commandant est inondé de larmes. Ce n'est pas possible : il faut que l'on comprenne immédiatement, une fois pour toutes que la guerre ne peut pas finir. Lentement, péniblement, il soulève son arme et vise les hommes qui chantent, là-bas, qui rient et s'embrassent, les ennemis pacifiés. Aucune hésitation, il commence à tirer.
Giorgio Manganelli, Centurie, cent petits romans-fleuves, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para, prologue de Italo Calvino, éditions W, 1985, p. 89-90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giogio manganelli, jean-baptiste para, centurie, roman-fleuve | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2011
Giuseppe Conte, L'Océan et l'Enfant

Il y a le verre, le sable et le vide
le vase, l'entonnoir, la jonction
le miroir, la pluie, les dunes
en cônes de velours clivés par l'éclipse
Il y a la mer à sec, la grève
le soleil fluet d'un asphodèle
le froissement d'or de tout brocart
l'intime déroute des choses
la chute, le long déclin, la naissance
la cime renversée en plaine
et la digue des astres, scintillante
clepsydre*, sonnet baroque, structure
du luth et de l'ombre, paraphe de sel
pour quelle mort est ta mesure ? Pour quelle mort ?
(26. XII. 1980, entre 1 heure et 2 heures du matin)
C'è il vetro, la sabbia, ed il vuoto
l'ampolla, l'incontro, l'imbuto
le specchio, la pioggia, le dune
e coni di velluto sfaldati dal topo
eclisse, c'è il mare prosciugato, il
greto, il flebile sole della plumosa
l'oro gualcito di ogni broccato
l'essere sgominato di una cosa
la caduta, il lungo assottigliamento, la
nascita, la vetta ribaltata in pianura
e gli astri, diga di scintillamento
clessidra, sonetto barocco, struttura
del liuto e dell'ombra, sigla di sale
per quale morte è la tua misura, per quale morte ?
(26. XII. 1980, tra l'una e le due di notte)
* En italien, clessidra désigne à la fois l'horloge à eau et le sablier. En dépit de son impropriété, le maintien du mot clepsydre en français nous a semblé nécessaire (N.d.T.)
Giuseppe Conte, L'Océan et l'Enfant, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para, Arcane 17, 1989, p. 113 et 112.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe conte, jean-baptiste para, l'océan et l'enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2011
Jean-Baptiste Para, Le dit de l'oiseau

Le dit de l’oiseau
Le soir promet une étrange abondance. Le soleil décret silencieux.
Anges, rentrez chez vous, votre journée est faite.
Je suis l’oiseau qui passe, mon bec est long comme la mort.
*
Aux troncs frais coupés, que disent les sèves ?
Nous étions là pour le triomphe du matin.
Une question se désolait entre les mains des meurtriers.
*
Ce qui reste de ciel, comment le supporter ?
La marche longue des racines, les moitiés d’yeux, les tympans déchirés.
Tu élis pour séjour les villes qu’on assiège.
*
Langues que l’ombre gagne. Les étoiles ne sont plus que plomb de chasse.
Sombrer apprend-il comment l’on sombre ?
*
[…]
Une nuit dans la nuit , et l’aurore n’est pas même conçue, rien qu’un mot, sans nulle tentation. La mort, ta propre mort, un souvenir honteux. Ou peut-être vers la lumière — l’interminable étreinte de la cécité.
*
Oiseau, l’oiseau des cahiers d’enfants.
Les ailes étaient une accolade. Mais aucun vol ne se bâtit dans le regret.
Jean-Baptiste Para, Le dit de l’oiseau, dans Une semaine dans la vie de Mona Grembo, Arcane 17, 1995, p. 47, 48, 50 et 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, le dit de l'oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2011
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts
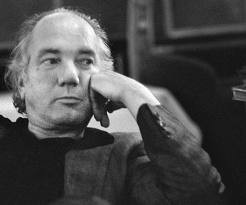 Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
De toute ma vie je ne me suis jamais libéré par l’écriture. Si tel avait été le cas, il ne resterait rien. Et que ferais-je de la liberté que j’aurais obtenue ? Je ne suis pas du tout partisan de la délivrance. Du cimetière peut-être. Mais non, je ne crois pas à cela non plus, parce qu’alors il n’y aurait rien.
Je n’ai pas besoin d’inventer quoi que ce soit. La réalité est bien pire. Par le biais de mes relations avec les gens de ce village, je sais ce qu’ils endurent, je sais à quelle heure ils dorment, ce qu’ils mangent, et quand leur cancer se déclare. Il y a beaucoup de fabriques de papier dans ce secteur, et un bon nombre d’estropiés auxquels les machines ont coupé les doigts, les bras ou un bout d’oreille. Peu à peu les machines leur coupent tout. Ou bien vous roulez à motocyclette sur les rails. Et vous y laissez une jambe. C’est ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire de cette ferme. C’était un travailleur posté. J’ai chauffé la maison avec des jambes de bois. Lui en avait fait une grande consommation.
L’être humain refuse d’admettre que la nature est plus grandiose qu’un battement de cœur. Une prairie en fleurs est une chose si prodigieusement fondamentale que la gorge se serre rien qu’à y penser. Mais tout sera perdu, hormis pour quelques créatures un peu demeurées. Peut-être verra-t-on naître alors quelque chose de véritablement nouveau.
Pour que ça vienne avec fraîcheur, j’alterne toujours : après la prose, une pièce de théâtre. Le principal attrait du théâtre, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Lorsque vous écrivez de la prose, vous êtes seul. Vous envoyez le manuscrit à l’éditeur, vous recevez bientôt de sa part une lettre stupide, puis vous n’avez plus aucune nouvelle, jusqu’à ce que vous parvienne un livre imprimé à la va-comme-je-te-pousse, truffé de ces fautes que vous vous étiez escrimé à corriger, ensuite, après un long silence, les critiques entrent en scène, le cauchemar, et en plus vous ne gagnez presque rien. En revanche, travailler pour le théâtre, c’est du stress. Au bout de quelques semaines, ça me tape sur les nerfs, tous ces acteurs effroyables. Je suis alors content quand une nouvelle prose démarre pendant ce temps-là. Et je supporte de traverser des mois en solitaire.
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts, traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n° 959, mars 2009, p. 19, 19, 19-20, 21, 21-22.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prose et théâtre, écrire, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |





