16/05/2013
Bartolo Cattafi, L'alouette d'octobre

Rêve d'hiver
Ce foisonnement estival
tournoiement de mouches
dans une pièce hivernale...
La pensée est une opaque
matière tressaillante
dans ce bourdonnement
il dort barricadé
au sein des lois de l'heure
tel un poulpe cramponné
à son rêve d'hiver
il ouvre parfois un œil
si soleil et braise brillent vaguement
mais il ne voit pas.
Sogno d'inverno
Questo rigurgito estivo
mulinello di mosche
in una stanza invernale...
Il pensiero è un'opaca
materia trasalita
al ronzìo
egli dorme rinchiuso
tra le leggi del momento
come un polipo aggrappato
al suo sogno d'inverno
apre un occhio talvolta
se sole e brace balùginano
ma non vede.
Bartolo Cattafi, L'alouette d'octobre, traduction de
l'italien par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie,
2010, p. 57 et 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bartolo cattafi, l'alouette d'octobre, philippe di meo, reve d'hiver | ![]() Facebook |
Facebook |
15/05/2013
Guy Goffette, Solo d'ombres

La femme infranchissable
1
La femme qui s'inverse dans
l'azur
sur l'ordre d'un invisible amant
que dit-elle
qu'on ne peut entendre
qui cependant creuse
un chemin dans mes yeux
2
Croise et décroise tes
jambes sanguine image du
désir
j'attendrai ce qu'il faudra je
grandirai avec
les marges
3
À chacun suffit
le jour à venir
le soleil après la pluie
l'air bleu de la femme
au bout du champ
L'enfant seul griffonne
l'envers des images
4
Debout la nuit
j'invente
la femme à sa place
les mots qu'elle prononce
dans ma bouche
me tiennent à merci
[...]
Guy Goffette, Solo d'ombres, Ipomée, 1983,
p. 129-132.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy goffette, solo d'ombres, la femem infranchissable, le jour, la nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
14/05/2013
Seamus Heaney, L'étrange et le connu

M.
Le phonéticien sourd en étendant la main
Sur le dôme crânien d'un locuteur
Pouvait distinguer diphtongues et voyelles
Aux seules vibrations de l'os.
Un globe cesse de tourner. Appliquant la paume
Sur le relief glacé d'une banquise
J'imagine le chant d'un essieu et le russe
Solide d'Ossip Mandelstam.
M.
When the deaf phonetician spread his hand
Over the dome of a speaker's skull
He could tell which diphtong and which vowel
By the bone vibrating to the sound.
A globe stops spinning. I set my palm
On a contour cold as permafrost
And imagine axle-hum and the steadfast
Russian of Osip Mandelstam.
Seamus Heaney, L'étrange et le connu, édition bilingue, traduit de l'anglais (Irlande) par Patrick Hersant, "Du monde entier", Gallimard, 2005, p. 133 et 132.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : seamus heaney, l'étrange et le connu, ossip mandelstam, chant, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
13/05/2013
Matthieu Gosztola, Visage vive

[...]
Notre visage prend le temps
De nous arracher à chaque
Pierre
Du chemin ombragé avec
Qui jouent les branches des
Arbres
Comme s'il s'agissait de dire je
Reviens pardon
Je te rattraperai oui je te
Rattraperai
J'ai couru de plus en plus
Vire avec mon espoir
En tenant ton corps déjà roide
Contre moi
Nos visages ce pourrait être la
Respiration
La douleur est une histoire
Qui écha
ppe totalement
Et dans laquelle on se re
trouve
Est-ce que je peux faire
Certains gestes
Ou certaines paroles
Pour te sauver de la douleur ?
Matthieu Gosztola, Visage vive, Gros textes, 2011, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matthieu gosztola, visage vive, douleur, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2013
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

1 sonnet
avec la manière de s'en servir
Réglons notre papier et formons bien nos lettres :
Vers filés à la main et d'un pied uniforme,
Emboîtant bien le pas, par quatre en peloton ;
Qu'en marquant la césure, un des quatre s'endorme...
Ça peut dormir debout comme soldats de plomb.
Sur le railway du Pinde est la ligne, la forme ;
Aux fils du télégraphe : — on en suit quatre, en long ;
À chaque pieu, la rime — exemple : chloroforme,
— Chaque vers est un fil, et la rime un jalon.
— Télégramme sacré — 20 mots — Vite à mon aide...
(Sonnet — c'est un sonnet —) ô muse d'Archimède !
— La preuve d'un sonnet est par l'addition :
— Je pose 4 et 4 — 8 ! Alors je procède,
En posant 3 et 3 ! — Tenons Pégase raide :
« Ô lyre ! Ô délire ! Ô...» — Sonnet — Attention !
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes, édition établie par Pierre-Olivier Walzer pour T. C., Bibliothèque de la Pléiade, 1970, p. 718.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, sonnet, rime, césure, hmour | ![]() Facebook |
Facebook |
10/05/2013
Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Dans La Clé des champs, André Breton invite à voir dans la place Dauphine, qui forme triangle à la proue de l'île de la Cité, « le sexe de Paris », le pubis de la Ville Lumière. Le poète, dont la vie croisa brièvement celle de Proust en 1920 — Jacques Rivière lui avait confié la relecture des épreuves du Côté de Guermantes —, a pu admirer — Rivière l'affirme — l'œuvre, si subtilement attentive au monde des rêves, du romancier. Il n'en demeure pas moins que jamais il n'a rien écrit qui puisse accréditer un tel sentiment et que la Recherche figure parmi les œuvres dans lesquelles le surréalisme a reconnu des emblèmes de ce qu'il récuse : l'art supposé mensonger du roman, avec son primat moraliste de la psychologie, la façon qui lui est propre de désenchanter le monde, de dégrader le mystère en effets de continuité et de vraisemblance. Et pourtant, c'est bien à Breton que j'ai pensé, à Nadja, aux lèvres entrouvertes, accueillantes à la fougue du Vert Galant de la place Dauphine, en découvrant que la maison de tante Léonie présente ceci de commun avec le jardin étagé à flanc de coteau du Pré Catelan, qu'elle s'évase en triangle, à partir de la porte étroite, génésique, qui s'entrouvre à son sommet.
Le rapprochement vient sans doute d'autant plus volontiers à l'esprit que le lecteur de la Recherche sait bien que « Combray », la première partie de Du Côté de chez Swann, pour être le livre lumineux de l'enfance, n'en est pas moins inquiété par le mystère de la séparation des sexes, par l'évidence nocturne de l'attraction des corps. Le visiteur qui entrebâille le portail et pénètre dans le jardinet, lorsqu'il s'avance épousant tla courbure de l'allée, vers la façade secrète de la maison, vers ces liserés de faïence d'inspiration ottomane qui, fantaisie « orientaliste » de l'oncle Amiot, rehausse d'azur l'encadrement des fenêtres, chemine dans une nuit matricielle, près qu'il est de s'introduire, comme par effraction, sur le théâtre d'une scène primitive.
Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 45-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, andré breton, roman, scène primitive, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2013
Benoît Casas, L'ordre du jour
[...]
1er juin
il est quatre heures
et l'aube luit.
le rêve a toute la valeur
d'une déclaration.
j'étais devenu quelqu'un
de nulle part.
séparé de ses amours
et de ses paysages.
fusain de Sakhaline
virgilier à bois jaune.
ce que nous gardons
de l'expérience d'apprendre :
idée sur la façon d'enseigner.
l'élucidation parlée
est le ressort du progrès.
moments de l'évaporation.
la violence le désarroi des gestes
carambolage.
temps perdu.
ne pouvait pas
s'abandonner
à de l'absence
intégrale.
2 juin
si vite nous
nous sommes dit
tant de choses.
je reste dehors
le plus longtemps possible.
le monde ici
ne semble pas disposé à
se réduire à un seul
mot.
3 juin
au matin soleil déjà vif
jour d'été précoce.
paysages destructifs.
renoncement.
regards remontent sa jupe.
et de suite,
chaque terme
est à sa place logique.
les grandes villes
spécialisent les plaisirs.
lieu de conflit entre
hasard et coup.
Benoît Casas, L'ordre du jour, "Fiction & Cie", Seuil, 2013, p. 116-117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l'ordre du jour, journal, juin, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2013
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre, Notes sauvegardées

Les iris poussent au hasard dans un enclos d'herbes hautes — couleur mauve ou violet sombre — sortis de leurs papiers de soie parmi leurs dures lames vertes. Ou ceux, de couleur jaune, qui poussent dans les marais et les canaux. Et ces toutes petites fleurs basses — jaunes ou roses — qui s'accrochent aux pierres, aux rochers, qui leur tiennent lieu de pelage, doux, gras et chaud, modeste et tenace.
*
Le parfum des iris, très doux, sucré, presque suave, évoquant, me semble-t-il, l'idée qu'on a pu se faire, adolescent, du féminin : de quoi vous tourner la tête... Avec cette espèce de chenille d'un jaune éclatant, solaire, mais si bien cachée sous les pétales bleu pâle comme sous des langues d'eau. Mais le mot "chenille" gêne, et "brosse" tout autant. Une réserve de poudre d'or, un pelage d'or, une toison peut-être, cachée dans la soie de la robe ?
Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre, Notes sauvegardées, 1952-2005, Le Bruit du temps, 2013, p. 47, 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, taches de soleil, ou d'ombre, notes sauvegardées, iris, parfum, féminin, couleurs | ![]() Facebook |
Facebook |
07/05/2013
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
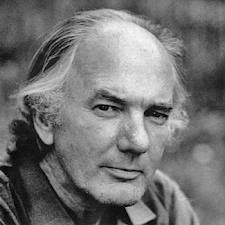
Personne ne te connaît
Du festin de joie ne resta que la cruche du tourment
Chidiock Tichborne
Personne ne te connaît
et quand tu meurs,
ils se glissent dans les manteaux,
pour t'ensevelir.
N'oublie jamais ça !
Personne n'a besoin de toi
et quand tu meurs,
ils battent le tambour
et tiennent leur langue.
N'oublie jamais ça !
Personne ne t'aime
et quand tu meurs,
ils enfoncent ton mal du pays
et le rentrent dans la terre.
N'oublie jamais ça !
Personne ne te tue
et quand tu meurs,
ils te crachent dans ta chope de bière
et tu dois payer.
Dich kennt keiner
Von Freudenmahl blieb mir der Knug der Pein
Chidiock Tichborne
Dich kennt keiner
und wenn du stirbst,
schlüpfen sie in die Mäntel,
um dich zu verscharren.
Vergiß das nie !
Dich braucht keiner
und wenn du stirbst,
schlagen sie auf die Trommel
und halten den Mund.
Vergiß das nie !
Dich mag keiner
und wenn du stirbst,
treten sie dein Heimweh
zurück in die Erde.
Vergiß das nie !
Dich tötet keiner,
doch wenn du stirbst,
spucken sie dir in den Bierkrug
und du mußt zahlen.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer [édition bilingue],
traduit de l'allemand et présenté par Susanne Hommel, Orphée / La Différence, 2012, p. 105 et 104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
06/05/2013
Frédéric Forte, 33 sonnets plats

j'ai quelque chose à dire • mais quoi • qu'est-ce qui aboie • sous la douche / quelle couche • de dessous l'activité • vient jouer de la corde à léviter • et tout raidir / une pause et je pense • à un contraire possible de la scène • je pense à de la laine / et pourquoi pas s'il vous plaît • tricoter du sens • camoufler
avec toi je m'en vais par intermittence • c'est étonnant • comme dans une petite danse • toute pleine de blancs / toute pleine de gris • puisque l'au-jour-le-jour • ne peut être décrit • si impeccablement en chacun de ses tours / toi tu pars très loin • retenu par un élastique • et tu me reviens toujours au coin • de l'œil comme ça doit être pratique / d'être toi • d'être un poème qui sait quoi
dans un monde parallèle je / conçois des sonnets de tailles différentes
Frédéric Forte, 33 sonnets plats, éditons de l'Attente, 2012, p. 27, 9 et 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric forte, 33 sonnets plats, sens, poème, oulipo | ![]() Facebook |
Facebook |
05/05/2013
Marie Étienne, L'Aigrette, dans Le Livre des recels

Tu m'appel
les l'Aigrette
dit l'Aigrette
mais tu i
gnores que je suis
l'Oiseau
qui vient de cette Nuit Là-bas
au cœur de la Forêt
ce n'est pas la Noirceur
mais souvenir de la Noirceur
ce n'est pas la Lumière
mais souvenir de la Lumière
qui entretient et remercie
j'ai regagné le Fleuve
je m'y tiens à présent
comme une pierre en plein midi
une prière sur son socle
ô Ciel
ap
proche ta joue
et vous un Dieu
combien au fond d'un Dieu
l'Amour est long
à être mus
elé
approche et sens
[...]
Marie Étienne, L'Aigrette [2008], dans Le Livre des recels, Poésie / Flammarion, 2011, p. 317-318.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie Étienne, l'aigrette, dans le livre des recels, oiseau, lumière, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
04/05/2013
Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes

Des caresses
de seins parmi l'herbe,
vous, tout entière, souffle de chaudes sécheresses,
vous étiez debout, près de l'arbre
et les tresses
tordaient la torsade des torts atroces en toron.
Et les heures bleues
vous enlaçaient de tresses de cuivre.
Leur coulée cuivrée se tord, torride.
Et ton regard — c'est une chaumière
où tournent le rouet deux marâtres — fileuses.
Je vous ai bue à plein verre
durant les heures bleues
lorsque vous regardiez le lointain de fer.
Les pins frappent le bouclier
de leurs aiguilles murmurantes,
clos, les yeux des vieilles ;
et maintenant
m'enserrent, me brûlent les tresses de cuivre.
Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes, traduit du russe et présenté par Luda Schnitzer, Pierre Jean Oswald, 1967, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vélimir khlebnikov, choix de poèmes, amour, caresses, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2013
Virginie Poitrasson, Journal d'une disparition — mai 2008

6 mai
présence du vélo sous mes pieds, les pédales qui tournent sous la poussée, l'essoufflement prend forme
première annonce de ta disparition
7 mai
retour aux bases, première gestuelle de survie, avec peut-être de l'agitation, et la matière, la matière si forte à cet instant
ta chambre vide de ta présence
8 mai
en recherche, en action, à tourner en rond, avec les scénarios les plus probants, échafaudages accrochés aux émotions
et ta trace comme s'évaporant au soleil
9 mai
statique, tendue, arrêtée dans le salon, du salon au jardin, du jardin au salon, périmètre du raisonnement mental
quand tu commences à te livrer virtuellement
10 mai
le début de la liste, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, parce que faire des listes fait tenir (faire des listes pour ne pas devenir fou)
et tu es ressenti comme une perte — mais pas totale
11 mai
une pause suspendue, bulle de patience, oreilles et bouches multiples, tout dans la gravité, suspendue en l'air, gravitation qui s'incite et s'insinue en moi
toi, ton odeur, ta musique, tes objets, ta souffrance encore présents dans la pièce
[...]
Virginie Poitrasson, Journal d'une disparition — mai 2008—, Ink, 2009, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginie poitrasson, journal d'une disparition — mai 2008, vide, trace, perte, chambre | ![]() Facebook |
Facebook |
02/05/2013
Jacques Demarcq, Les Zozios

le vieux merle
Sous la fenêtre de la chambre une pergola. Où magnifique une vigne se mordore au soleil du matin. À chaque grappe, huit ou dix gouttes gorgées de transparence — on dirait du Caravage —
entre des chicots noircis.
Les clients ont l'air d'habitués. Deux sansonnets, jeunes plumes à pointes blanches, s'attablent joyeusement face à face. En rien dérangés par la présence de trois merles — aussi ventrus que des bourgeois. De ci de là, entre deux goulées, chacun vole faire un tour dans le potager. Jusqu'au moment où, coïncidence ? tous
ensemble ils se dispersent.
Un vieux merle alors, clopin-voletant, d'atterrir sur une patte : l'autre ratatinée dans les fripes en désordre de son plumage. Reprend pied sur la poutre ; un temps ; hoquetant du crâne au milieu des feuilles roussoyantes. Puis tente à tâtons de picorer, picoler un raisin de son bec bouffi de roses porosités — comme
un nez qui aurait trop vécu.
Couple et trio restent à l'écart. Perchés sur un toit ou le sapin, ils le laissent vaquer à ses souvenirs fanés. De l'autre côté de la fenêtre ma tante, qui a 89 ans, devient aveugle. De plus en plus
seule dans sa maison.
Compiègne, octobre 1994
Jacques Demarcq, Les Zozios, NOUS, 2008, p. 40.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, les zozios, le vieux merle, sansonnet, vigne, automne | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2013
Laurine Rousselet, journal de l'attente

l'hiver grandit
il touche à la maison des morts
entre les froids l'ardeur emporte la résistance
les familiers invoquent les doigts à remuer
sous la neige écrire redouble le secret
l'incendie troue l'enfance
les mitaines assurent au sang de fendre la peur
s'endormir poème le crayon dans
tout crie au dehors souffre monde
à l'intérieur du lit pousse le sombre
qui écoute ?
le songe dévore l'inconnu
il faudra désormais tout rebâtir
toujours
la lune monte
et marche du sourire en silence
la petite seule voit la dissipation
le noir en vie est à l'aube du jour qui
le présent vit devant
attends
m'avancer dans l'énormité du ciel
Laurine Rousselet, journal de l'attente, éditions isabelle sauvage,
2013, p. 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurine rousselet, journal de l'attente, hiver, enfance, rêve, nuit, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |






