30/11/2015
Paysages d'hiver



Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'hiver, neige, merle | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2015
James Sacré, Dans l'œil de l'oubli, suivi de Rougigogne

J’ai bien conscience souvent que j’écris en mêlant les temps verbaux comme si je voulais mettre ensemble dans un temps présent aussi bien le passé que ce qui ressemble à du futur quand on se prend à rêver, à dire les mots « demain », « plus tard » : le désir d’un présent qui serait aussi bien l’infini que l’éternité dans le plus fugitif arrêt du temps qu’on s’imagine pouvoir vivre. Ce présent, qui ne peut exister pour nous qui n’en finissons pas de vieillir, n’est-il pas la pupille de cet œil de l’oubli dans laquelle je n’ai jamais rien vu pour la bonne raison que n’existant sans doute pas je ne peux que penser ce présent comme une tache aveugle de mon existence, un trou noir dans lequel toute celle-ci s’engouffre lentement jusqu’à la mort.
James Sacré, Dans l’œil de l’oubli suivi de Rougigogne, Obsidiane, 2015, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans l’œil de l’oubli, présent, passé, écriture, temps, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2015
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure — Le retour au livre

L’étranger
La coquetterie des choses
à paraître ce qu’elles sont
Le monde est une coterie
L’étranger a du mal à s’y faire entendre
On lui reproche gestes et langue
Et pour sa patiente courtoisie
récolte injures et menaces
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure, Poèmes
1943-1957, Gallimard, 1959, p. 265.
Chanson
Sur le bord de la route,
il y a des feuilles
si fatiguées d’être feuilles,
qu’elles sont tombées.
Sur le bord de la route,
il y a des Juifs
si fatigués d’être juifs,
Qu’ils sont tombés.
Balayez les feuilles.
Balayez les Juifs.
Les mêmes feuilles repoussent-elles au printemps ?
Y a-t-il un printemps pour les Juifs piétinés ?
Edmond Jabès, Le Livre des questions, III : Le retour au livre, Gallimard, 1965, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, le retour au livre, étranger, juif, feuille | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2015
Franz Kafka, Lettres à Felice

À Grete Bloch
8.VI.14
(…)
En juillet j’irai m’installer dans une forêt quelconque afin d’améliorer en moi ce qui pourra l’être en hâte. Chez nous les parents ont coutume de dire que les enfants vous font sentir à quel point on vieillit. Quand on n’a pas d’enfants, ce sont vos propres fantômes qui vous le font sentir, et ils le font d’autant plus radicalement. Je me souviens que dans ma jeunesse je les attirais hors de leur trou, ils ne venaient guère, je les attirais avec plus de force, je m’ennuyais sans eux, ils ne venaient pas et je commençais à croire qu’ils ne viendraient jamais. À cause de cela j’ai déjà souvent été bien près de maudire mon existence. Par la suite ils sont quand même venus, de temps à autre seulement, c’était toujours du beau monde, il fallait leur faire des courbettes bien qu’ils fussent entre tout petits, souvent ce n’était nullement eux, ils avaient seulement l’air de l’être ou bien ils le donnaient seulement à entendre. Cependant lorsqu’ils venaient pour de bon, ils se montraient rarement féroces, on n’avait pas lieu d’être très fier d’eux, ils vous sautaient dessus tout au plus comme le lionceau saute sur la chienne, ils mordaient, mais on ne s’en apercevait qu’en maintenant l’endroit mordu avec le doigt et en y appuyant l’ongle. Plus tard il est vrai, ayant grandi, ils sont venus et sont restés à leur guise, de tendres dos d’oiseaux sont devenus des dos de géants comme on voit sur les monuments, ils sont entrés par toutes les portes, enfonçant celles qui étaient fermées, c’étaient de grands fantômes fortement charpentés, une foule anonyme, on pouvait se battre avec l’un d’eux, mais non pas avec tous ceux qui formaient cercle autour de vous. Écrivait-on, ce n’étaient rien que des bons génies, sinon c’étaient des démons dans la foule desquels on pouvait tout juste encore lever le bras pour montrer où on était. Quant à la façon dont on se disloquait la main en haut, de cela sans doute on n’était pas responsable.
Franz Kafka, Lettres à Felice II, traduit de l’allemand par Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 683.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice ii, marthe robert | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2015
Raymond Queneau, Une trouille verte, dans Contes et propos

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours redouté ce qui pourrait me causer quelque ennui, aussi ai-je eu peur successivement de Croquemitaine, des figures de cire des Musées Dupuytren, des places trop fréquentées par les véhicules, des voyous, des pots de fleurs qui tombent sur la tête, des échelles, de la chaude-pisse, de la vérole, de la Gestapo, des V2. La paix n’a bien sûr, en aucune façon, calmé ces alarmes : ainsi, l’autre soir, je mange de la purée de marrons et je me mets à rêver que je suis dans une djip et que le conducteur ne parvient pas à éviter une épaisse colonne, je la vois venir, je me dis qu’on rentre dedans, ça y est, on est rentré dedans, tout noircit ; dans le noir, je me dis : je suis mort, je me dis : c’est comme ça quand on est mort, et puis je me réveille, l’estomac gros et le cœur battant. J’allume, je regarde la montre, il est deux heures, deux heures du matin, bien tôt encore, et je me lève pour aller pisser. Comme je ne pratique pas le pot de chambre, il faut que je me rende aux vécés. Il y a un long couloir. Je le traverse en disant : si ceci, si cela. J’arrive à me faire peur et je pénètre dans les chiottes bien heureux de pouvoir fermer la porte derrière moi, pour couper court, et se sentir chez soi, et non seulement fermer la porte, mais aussi tourner le verrou.
Je pisse.
Je tire sur la chasse d’eau.
Quand l’hygiénique glouglou se fut tu, je perçus dans le couloir la présence de néants, sans ambiance d’existence, ce qui me fit chaud dans les dents, froid sous les ongles, horripilation générale. Une frousse abjecte s’empara de mon âme et, prenant ma tête à deux mains, je m’assis sur le siège des vatères en gémissant sur mon sort immonde.
[...]
Raymond Queneau, Une trouille verte, dans Contes et propos, Gallimard, 1981, p. 157-158.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, une trouille verte, contes et propos, peur, rêve, insomnie, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2015
Dictionnaire Char, sous la direction de Danièle Leclair et Patrick Née : recension
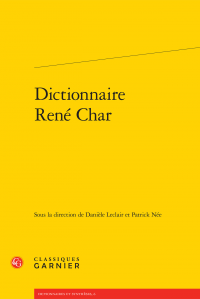
À côté des dictionnaires de langue proprement dits, qui ont pour objet la description du lexique d’une langue parlée (le français, le russe, etc.) ou non (le latin), de la langue d’un milieu (l’argot) ou de certains aspects de la langue, aujourd’hui (les synonymes) ou selon une perspective historique (le français du Moyen Âge, l’étymologie), se sont développés des livres qui, par ordre alphabétique, répertorient ce qui concerne, par exemple, un écrivain et son œuvre, ici René Char. On souhaiterait que soient préparés pour d’autres poètes un ensemble de cette qualité. Le lecteur ne s’y perd jamais tant les responsables de l’édition, Danièle Leclair et Patrick Née, qui ont signé de nombreuses notices, ont apporté de soin pour que la lecture soit aisée ; il le fallait : plus de 600 pages sur deux colonnes, écrites par 26 collaborateurs, et une série d’annexes.
Quels choix ont été faits pour l’écriture ? Un vocabulaire toujours simple — c’est-à-dire sans les termes techniques dont regorgent parfois des ouvrages consacrés à un écrivain ; des articles de dimension raisonnable, qui ne dépassent les 6 colonnes que pour des sujets complexes (par exemple, "La Résistance") ; le souci de toujours donner un contexte : un article à propos d’un peintre qui a illustré des poèmes de Char commence toujours par des précisions sur le travail de ce peintre ; le parti-pris de proposer des outils pour prolonger la lecture, en faisant suivre chaque article de la mention des ouvrages consultés avec leur pagination. Il était difficile d’éviter des redites, tel article demandant pour être lisible la reprise de données déjà partiellement exposées, mais elles sont rares (sauf erreur) et, au fond, importent peu : on ne lit pas l’ouvrage comme un roman.
Quels articles lit-on ? Commençons par l’œuvre : chaque recueil, chaque plaquette sont scrupuleusement décrits. Les développements pour Feuillets d’Hypnos sont plus importants parce que cet ensemble, admiré à sa sortie par Gracq et Camus, est encore le plus connu de Char. Des précisions sont apportées sur les circonstances de son élaboration pendant la guerre, sur sa réécriture et son édition, s’ajoutent des données sur les manuscrits, sur les notes manuscrites dans un exemplaire, enfin une étude précise des contenus. L’article, comme tous ceux concernant l’œuvre, est complété par une bibliographie et des mots qui renvoient à d’autres entrées.
On découvrira toutes les revues dans lesquelles Char a publié des textes, poèmes ou proses. Chacune — Argile, Cahiers du Sud, Fontaine, Cahiers d’Art, etc. — donne lieu à une brève monographie (création de la revue, fréquence, etc.), Botteghe Oscure, la revue de Marguerite Caetani, princesse de Bassiano ayant droit à quelques développements : Char en a été le représentant en France et sollicitait des contributions. Une description des expositions qui lui ont été consacrées apporte une foule de renseignements sur ses liens avec les peintres, chacun des peintres avec qui il a travaillé faisant par ailleurs l’objet d’un article (Braque, Nicolas de Staël, Vieira da Silva, Miró, Luis Fernández, Giacometti, etc.). Ne sont pas oubliées les anthologies qui contiennent des textes de Char, les très nombreuses traductions de ses recueils, effectuées par exemple en italien par des poètes comme Giorgio Caproni et Vittorio Sereni.
Certains éditeurs ont tenu une place particulière dans la vie de Char, de Guy Lévis Mano, dont les livres portaient le sigle GLM, à Pierre André Benoit, éditeur d’art sous le nom de PAB ; ils sont présents dans le dictionnaire, tout comme des libraires d’éditions originales comme Pierre Berès ou Jean Hugues et, par ailleurs, des critiques qui ont rendu compte de l’œuvre.
De nombreuses notices concernent aussi les figures importantes de la poésie de Char, mythologiques (Dionysos, Hypnos, Orion, Diane, etc.) ou non (le forgeron, le berger), et les éléments de la nature, abondants (la flore, les insectes, les pierres, les oiseaux). D’autres développements sont voués aux lieux qui l’ont largement inspiré : les villages du Luberon, le Ventoux et, d’une autre manière, Lascaux, perçu « dans la continuité d’un romantisme fasciné par la question de l’origine. »
Les responsables de cette somme ne se sont donc pas limités à l’exploration de l’œuvre. En outre, ils ont pensé que les écrits de Char ne pouvaient être dissociés de sa vie et ont donné des articles sur les membres de sa famille, ses deux épouses et les femmes qu’il aimées, ainsi que sur les contemporains qui furent ses proches (Camus, Gilbert Lely par exemple). À cette occasion, le lecteur rencontre un Char pour le moins peu sympathique, qui séduit l’épouse de ses amis ou qui rompt avec un proche sans jamais se justifier. Ainsi, alors qu’il était lié à Dominique Fourcade, « leur amitié s’acheva en 1974 sur un silence définitif, comme ce sera le cas peu après avec Jacques Dupin. » D’autres connurent un désagrément analogue, et « rares furent les amitiés anciennes qui résistèrent au temps. »
Plusieurs bibliographies, une filmographie et une webographie, un index des œuvres et un autre des noms de personnes, complètent l’important ensemble qui constitue désormais un outil indispensable pour toute recherche sur l’œuvre de Char.
Dictionnaire Char, sous la direction de Danièle Leclair et Patrick Née, éditions Garnier, 2015, 716 p.
Cette recension a été publiée dans remue.net le 10 novembre 2015.
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2015
Georg Trakl, Poèmes, traduits par Guillevic —— Écrire après ?

Dans un vieil album
Tu reviens toujours, mélancolie,
O douceur de l’âme solitaire.
Pour sa fin s’embrase un jour doré.
Humblement devant la douleur
S’incline celui qui s’est fait patience.
Résonnant d’harmonie et de tendre folie.
Vois ! Il va faire noir déjà.
La nuit revient, quelque chose de mortel se plaint
Et quelque autre souffre avec elle.
Tremblant sous les étoiles d’automne
Chaque année la tête penche davantage.
Georg Trakl, Poèmes, traduits et présentés
par Guillevic, Obsidiane, 1981, p. 11.
Écrire après ?
Face à des innocents lâchement assassinés par d'infâmes fanatiques, la poésie peut peu, pour le dire à la façon de Christian Prigent. Ça, le moderne ? Quoi, la modernité ? Cois, les Modernes… Face à l'innommable, seul le silence fait le poids ; comme à chaque hic de la contemporaine mécanique hystérique, ironie de l'histoire, l'écrivain devient de facto celui qui n'a rien à dire. Réduit au silence, anéanti par son impuissance, son illégitimité. Son être-là devient illico être-avec les victimes et leurs familles.Nous tous qui écrivons ne pouvons ainsi qu'être révoltés par l'injustifiable et nous joindre humblement à tous ceux qui condamnent les attentats du 13 novembre. Et tous de nous poser beaucoup de questions.
Surtout à l'écoute des discours extrémistes, qu'ils soient bellicistes, sécuritaires, islamophobes ou antisémites sous des apparences antisionistes. C'est ici que ceux dont l'activité – et non pas la vocation – est de mettre en crise la langue comme la pensée, de passer les préjugés et les idéologies au crible de la raison critique, se ressaisissent : le peu poétique ne vaut-il pas d’être entendu autant que le popolitique ? Plutôt que de subir le bruit médiatico-politique, le spectacle pseudo-démocratique, les mises en scène scandaculaires – si l'on peut dire -, ne faut-il pas approfondir la brèche qu'a ouverte dans le Réel cet innommable, ne faut-il pas appréhender dans le symbolique cette atteinte à l'entendement, ce chaos qui nous laisse KO ? Allons-nous nous en laisser conter, en rester aux réactions immédiates, aux faux-semblants ? Une seule chose est sûre, nous CONTINUERONS tous à faire ce que nous croyons devoir faire. Sans cesser de nous poser des questions.
Ce communiqué, signé de Pierre Le Pillouër et Fabrice Thumerel, est publié simultanément sur les sites :
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, guillevic, poème, album, mélancolie, solitude, nuit, automne | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2015
Emily Jane Brontë, Poèmes, traduction Pierre Leyris —— Écrire après ?

Il devrait n’être point de désespoir pour toi
Il devrait n’être point de désespoir pour toi
Tant que brûlent la nuit les étoiles,
Tant que le soir répand sa rosée silencieuse,
Que le soleil dore le matin.
Il devrait n’être point de désespoir, même si les larmes
Ruissellent comme une rivière :
Les plus chère de tes années ne sont-elles pas
Autour de ton cœur à jamais ?
Ceux-ci pleures, tu pleures, il doit en être ainsi ;
Les vents soupirent comme tu soupires,
Et l’Hiver en flocons déverse son chagrin
Là où gisent les feuilles d’automne
Pourtant elles revivent, et de leur sort ton sort
Ne saurait être séparé :
Poursuis donc ton voyage, sinon ravi de joie,
Du moins jamais le cœur brisé.
[Novembre 1839]
Emily Jane Brontë, Poèmes, traduction de Pierre Leyris,
Poésie / Gallimard, 1983, p. 87.
Écrire après ?
Face à des innocents lâchement assassinés par d'infâmes fanatiques, la poésie peut peu, pour le dire à la façon de Christian Prigent. Ça, le moderne ? Quoi, la modernité ? Cois, les Modernes… Face à l'innommable, seul le silence fait le poids ; comme à chaque hic de la contemporaine mécanique hystérique, ironie de l'histoire, l'écrivain devient de facto celui qui n'a rien à dire. Réduit au silence, anéanti par son impuissance, son illégitimité. Son être-là devient illico être-avec les victimes et leurs familles.Nous tous qui écrivons ne pouvons ainsi qu'être révoltés par l'injustifiable et nous joindre humblement à tous ceux qui condamnent les attentats du 13 novembre. Et tous de nous poser beaucoup de questions.
Surtout à l'écoute des discours extrémistes, qu'ils soient bellicistes, sécuritaires, islamophobes ou antisémites sous des apparences antisionistes. C'est ici que ceux dont l'activité – et non pas la vocation – est de mettre en crise la langue comme la pensée, de passer les préjugés et les idéologies au crible de la raison critique, se ressaisissent : le peu poétique ne vaut-il pas d’être entendu autant que le popolitique ? Plutôt que de subir le bruit médiatico-politique, le spectacle pseudo-démocratique, les mises en scène scandaculaires – si l'on peut dire -, ne faut-il pas approfondir la brèche qu'a ouverte dans le Réel cet innommable, ne faut-il pas appréhender dans le symbolique cette atteinte à l'entendement, ce chaos qui nous laisse KO ? Allons-nous nous en laisser conter, en rester aux réactions immédiates, aux faux-semblants ? Une seule chose est sûre, nous CONTINUERONS tous à faire ce que nous croyons devoir faire. Sans cesser de nous poser des questions.
Ce communiqué, signé de Pierre Le Pillouër et Fabrice Thumerel, est publié simultanément sur les sites :
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, poèmes, pierre leyris, désespoir, pleur, larme, hiver, vent, joie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2015
Pierre Reverdy, Sable mouvant

Le bonheur des mots
Je n’attendais plus rien quand tout est revenu, la fraîcheur des réponses, les anges du cortège, les ombres du passé, les ponts de l’avenir, surtout la joie de voir se tendre la distance. J’aurais toujours voulu aller plus loin, plus haut et plus profond et me défaire du filet qui m’emprisonnait dans ses mailles. Mais quoi, au bout de tous mes mouvements, le temps me ramenait toujours devant la même porte. Sous les feuilles de la forêt, sous les gouttières de la ville, dans les mirages du désert ou dans la campagne immobile, toujours cette porte fermée – ce portrait d’homme au masque moulé sur la mort, l’impasse de toute entreprise. C’est alors que s’est élevé le chant magique dans les méandres des allées.
Les hommes parlent. Les hommes se sont mis à parler et le bonheur s’épanouit à l’aisselle de chaque feuille, au creux de chaque main pleine de dons et d’espérance folle. Si ces hommes parlent d’amour, sur la face du ciel on doit apercevoir des mouvements de traits qui ressemblent à un sourire.
Les chaises sont tombées, tout est clair, tout est blanc — les nuits lourdes sont soulevées de souffles embaumés, balayées par d’immenses vagues de lumières.
L’avenir est plus près, plus souple, plus tentant.
Et sur le boulevard qui le lie au présent, un long, un lourd collier de cœurs ardents comme ces fruits de peur qui balisent la nuit à la cime des lampadaires.
Pierre Reverdy, Sable Mouvant : Au soleil du plafond, La Liberté des mers, suivi de Cette émotion appelée poésie, édition d’Étienne-Alain Hubert, Poésie / Gallimard, 2003, p. 51-52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, sable mouvant, le bonheur des mots arole, mirage, portrait | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2015
Marie Cosnay, Sanza lettere (road movie)

on avait perdu un mot dans les sous-sols, impossible de traverser, le couloir retient toute une généalogie, les uns piétinent les autres dans un espace qui ne s’élargit pas sous la pression des corps, prenant appui sur les genoux et les fesses on cherche l’air en surface cogne au plafond et de corps en corps va jusqu’à ma mort Elle est venue ma mort je ne dis pas ça à cause d’un printemps mais d’un trop plein de printemps, de saisons, après une impression sordide, un changement de genre et de cap Transformons les corps entassés dans le hall en lettres Évaporons-nous en récits disais-je Passons par le trou de la serrure mais personne n’y arrivait
d’autant que le désir de liberté lui-même mourait ; m’agrippant je cherchais dans le hall une idée pour survivre ; il semblait plus que tout autre chose dégueulasse mon élan de survivre ; je m’agrippais à la dégueulasserie c’est-à-dire que malgré la mort qui me fonçait dessus je tenais les rênes
Marie Cosnay, Sanza lettere (road movie), éditions de l’Attente, 2015, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, sanza lettere (road movie), corpd, mort, printemps, liberté, survivre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2015
Angela Lugrin, En-dehors : recension
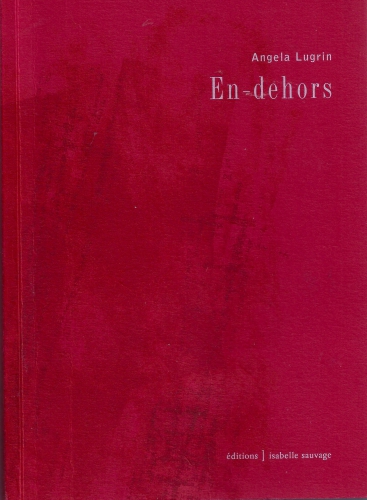
Les prisons ne sont plus des lieux où ceux qui ont été mis à l’écart de la société après jugement sont totalement abandonnés à eux-mêmes ; même si le nombre de prisonniers qui souhaitent suivre un enseignement reste faible, il est en progression. Angela Lugrin a enseigné la littérature à la prison de la Santé pour les épreuves de français du baccalauréat, avec au programme Le Cid et Les Liaisons dangereuses, et c’est ce travail d’un an qui est l’objet de En-dehors. On ne lira pourtant pas un compte rendu des difficultés à enseigner en milieu carcéral : elles ne sont pas plus importantes qu’au collège ; on apprendra plus sur sa manière de faire lire des textes ‘’classiques’’ à des détenus qui, dans leur vie présente, sont fort loin des subtilités de la littérature — l’un d’eux écrit d’ailleurs fort justement : « Mon état actuel ne me permet pas d’avoir les idées claires ». La professeure abandonne les schémas scolaires, fondant la lecture des textes sur les réactions de ces lecteurs particuliers, quitte à longuement argumenter pour mettre en cause des propositions pour le moins conventionnelles vis-à-vis des femmes et de la société. Ainsi, quand ils voient en Chimène le modèle négatif de toutes les femmes, elle explique que les mots sont les seules armes de la jeune femme ; sachant cependant que pour les prisonniers Chimène, comme elle l’écrit, « c’est un peu moi et mes papiers ». Cependant, le fait d’insister sur la validité de toute « lecture libre » qui s’appuie sur le texte, de rejeter la lecture d’autorité finit par avoir des effets : au fur et à mesure que l’étude des Liaisons dangereuses progresse, « on avance [...] dans le texte avec une vérité que je ne connais plus dans les écoles au-dehors des murs. » L’année s’achève avec le succès de plusieurs à l’examen, mais le récit d’Angela Lugrin, d’une certaine manière, relate moins ce qu’a été sa pratique d’enseignante que sa vision des prisonniers et ses propres rapports au monde.
Dans En-dehors, le lieu ‘’prison’’ est ambigu ; pour ceux qui y sont enfermés, ce n’est pas un lieu « où la langue interroge sans fin l’aurore et les ruines » — la littérature — mais où seule la question de la libération a un sens. Angela Lugrin, elle, revient régulièrement à cette idée qu’elle abandonne à la porte de la prison « la précipitation de la vie », et qu’elle entre chaque fois « dans un espace à l’abri, une terre de l’enfance, un lac noir de chagrins d’adultes ». On comprend alors qu’elle écrive, quand elle en sort : « la porte qui s’ouvre sur la rue de la Santé, sur Paris [...], on ne peut pas dire que ce soit un retour à la réalité. Ce serait plutôt le retour à nos enfermements respectifs. » L’enfance qu’elle évoque, c’est d’abord la sienne, quand elle rencontrait les malades que soignait son père dans un hôpital psychiatrique, quand elle se souvient aussi d’un « vieux rêve, un rêve de l’enfance, un rêve de prison », quand elle s’imagine à l’écart de toute institution, un peu « brigand ».
C’est pourquoi elle ne se demande pas pourquoi ses étudiants ont été jugés et enfermés, et ce n’est pas seulement parce que ce savoir risquerait alors de gêner sa pratique d’enseignante : pour elle, ce qu’elle cherche à retenir des prisonniers, c’est « ce qui leur reste, lorsque même le crime les a désertés » ; voyant par exemple dans un rêve deux jeunes détenus, ce qui la frappe c’est que « leur visage est celui d’enfants ». Cette enfance, elle est constamment présente, dans la « fragilité d’un regard », dans une voix, dans la lecture d’un texte ou quand un détenu tombe de sa chaise : sa chute provoque un rire général et « ils sont comme des enfants et j’ai encore le rôle de la maîtresse ». Parallèlement, dépouillés de leur passé, de leur échec à vivre au dehors, tous lui apparaissent beaux ; son frère, médecin, peut lui reprocher d’en faire des « portraits angéliques », elle les voit cependant « comme des pauvres, ou des seigneurs d’un autre âge » et, devant des initiales tatouées (VMI), elle écrit « je trouve ça beau » quand on lui en donne le sens, ‘’vaincu mais indompté’’.
Si l’on ne retenait que ces passages du livre, on parlerait de fascination pour le monde carcéral. Les choses ne sont pas si simples. Angela Lugrin n’ignore pas du tout la violence qui règne dans la prison, pas plus que celle qui y a conduit ses étudiants ; elle observe aussi que l’enfermement marque les corps jusque dans la démarche et elle a en tête cette remarque d’un détenu, « Vous ne pouvez rien pour nous ». Plus encore, elle a vite compris qu’il lui fallait être « en-dehors », refuser toute ambiguïté dans sa relation avec les uns et les autres, pas au nom d’on ne sait quel principe mais pour conserver le regard particulier qu’elle porte sur les détenus, et il faut bien entendre ce qu’elle définit comme ‘’distance’’ ; « La distance comme une pudeur, une prudence face au réel de la douleur. Si la distance est trahie, la beauté disparaît, l’impensable peut surgir. »
Angela Lugrin, En-dehors, éditions isabelle sauvage, 160 p., 18 €.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : angela lugrin, en-dehors, prison, littérature, enseignement, distance | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2015
Jacques Lèbre, Onze propositions pour un vertige

I
Sur le terrain instable de ta mémoire,
suivait-tu des lignes de faille ?
Vérifiais-tu parfois la solidité
de tel ou tel souvenir
avant qu’il ne s’effondre sous tes pas ?
Tu marchais sur des gravats.
Les pas n’y font pas le même bruit.
Mais de cela, quelle image s’en approcherait ?
Poème.
Comme passe
l’ombre d’un nuage sur le sol.
II
À l’heure du rendez-vous
(c’était pour déjeuner)
il fallait te chercher
dans les restaurants du quartier.
« Attends, je note.
Attends, je prends un crayon.
C’est bien le dix-sept à midi ? »
Tu oubliais que tu avais noté.
Tu n’avais plus rendez-vous, avec personne.
Jacques Lèbre, Onze propositions pour un vertige,
le phare du cousseix, 2013, p. 5-6.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, onze propositions pour un vertige, mémoire, image, rendez-vous, personne | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2015
Yasmina Reza, Dans la luge d'Arthur Schopenhauer

Serge Othon Weil à Ariel Chipman
On vit dans un système compassionnel où il faut du drame partout. Tu peux me dire pourquoi on n’a pas organisé une fête nationale pour la fermeture du dernier puits de mine ? On a du charbon sous nos pieds et on n’a plus besoin d’envoyer des pauvres gars à six cents mètres sous terre pour essayer de l’extraire en chopant la silicose et en loupant le coup de grisou. Au lieu de quoi on a eu droit à un discours larmoyant sur le registre c’est une partie de l’histoire ouvrière qui disparaît. Mais merde, tant mieux ! Tu voudrais toi avoir tes enfants au fond de la mine, c’est extraordinaire de vivre dans un pays qui a du charbon sous ses pieds et qui peut se passer d’aller le chercher, qui n’a plus besoin d’envoyer des gens se glisser comme des rats dans des galeries pour donner des coups de marteau-piqueur dans un truc dégueulasse. Le monde s’améliore, qu’on le veuille ou non.
Yasmina Reza, Dans la luge d’Arthur Schopenhauer, Folio Gallimard, 2015 (Albin Michel, 2003), p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yasmina reza, dans la luge d’arthur schopenhauer, mine, ouvrier, monde, progrès | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2015
Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, II

Nous y [le laboratoire] étions bien parce que nous pouvions nous laver, avoir des robes propres, travailler à l’abri. La culture du kok-saghyz* ne donnerait pas de résultat avant 1948, la guerre serait finie. Nous étions loin du camp, nous n’en sentions plus l’odeur. Nous ne voyions que la fumée qui montait des fours crématoires. Quelquefois le feu était si fort que les flammes jaillissaient des cheminées, immenses, jusqu’au ciel. Le soir, cela faisait à l’horizon un rougeoiement de hauts fourneaux. Nous savions que ce n’étaient pas des hauts fourneaux. C’étaient les cheminées des fours crématoires, c’étaient des gens qu’on brûlait. Il était difficile d’être bien et de ne pas penser jour et nuit à tous ces gens qu’on brûlait jour et nuit — par milliers.
Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, II, éditions de Minuit, 1970, p. 74-75.
* variété de pissenlit dont la racine pouvait servir à fabriquer du caoutchouc.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlotte delbo, une connaissance inutile, ii, camp de concentration, crématoire, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2015
Jean Tardieu, Margeries
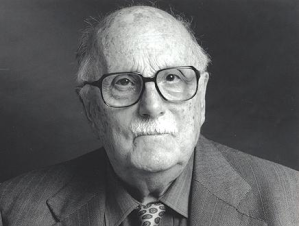
Un oiseau loin de moi
Un oiseau loin de moi
Une fleur sous la neige
Une maison qui brûle
Un noir mourant de soif
Un blanc mourant de faim
Un enfant qui appelle
Le vent dans le désert
La ville abandonnée
L’étoile solitaire
En voilà bien assez
Pour que je vous ignore
Beaux jours de mon été.
Jean Tardieu, Margeries,
Gallimard, 1986, p. 167.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, poème, oiseau, été, solitude, fleur | ![]() Facebook |
Facebook |





