14/04/2016
Hervé Piekarski, L'état d'enfance, II

Une fable
On a retrouvé le corps du vieillard dans le fossé, on a déclaré la fin des recherches mais le corps du vieillard continuait de pourrir dans le fossé. On a interrogé la femme dont le fils n’était pas rentré puis la femme s’est mise à pleurer, on a libéré les chevaux mais c’était là chose absurde car les chevaux étaient déjà en liberté. Le lendemain le fils est rentré puis il s’est assis dans le café et il a demandé où était la femme. On avait emporté le corps du vieillard à la morgue et certains auraient voulu qu’on le brûle. Le fils a pensé que la femme était pour quelque chose dans la disparition du corps. Les messieurs de la ville ont dit qu’ils reviendraient et la femme s’est rendu compte qu’un dernier appui avait cédé dans son cœur et qu’il lui faudrait tomber et ensuite se relever.
Hervé Piekarski, L’état d’enfance, II, Flammarion, 2016, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé piekarski, l'état d'enfance, ii, fable, vieillard, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
13/04/2016
Italo Svevo (1861-1928), Court voyage sentimental

La mère
En une vallée close par des collines boisées, souriante, sous les couleurs du printemps, deux vastes maisons à l’aspect sévère, pierre et chaux, se dressaient l’une à côté de l’autre. On les eût dites bâties de la même main, et les jardins mêmes, enclos par des haies vives, situés devant chacune d’elle, présentaient une dimension et une forme identiques. Pourtant, qui les habitait n’avait pas le même destin.
Dans l’un des jardins, tandis que le chien enchaîné dormait et que la paysan s’affairait au verger, en un recoin, à l’écart, des poussins parlaient de leurs grandes expériences. Il s’en trouvait d’autres dans le jardin, leurs aînés, mais les plus petits, dont le corps gardait encore la forme de l’œuf d’où ils étaient sortis, se plaisaient à examiner entre eux la vie qui leur était échue : ils n’en avaient pas une telle habitude qu’ils ne pussent la voir. Ils avaient déjà éprouvé joies et souffrances car la vie de quelques jours est plus longue qu’elle ne paraît à ceux qui la subirent des années durant ; et ils en savaient long, vu qu’une part de cette grande expérience, ils l’apportaient avec eux au sortir de l’œuf. En effet, à peine avaient-ils ouvert les yeux à la lumière qu’ils avaient su qu’on devait examiner attentivement les choses, d’abord avec un œil, puis avec l’autre pour voir si on pouvait les manger ou si l’on devait s’en méfier.
[...]
Italo Svevo, Court voyage sentimental et autres récits, traduction de l’italien par Jean-Noël Schifano pour cette nouvelle, Gallimard, 1978, p. 83-84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo svevo, court voyage sentimental, printemps, poussin, fantaisie, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/04/2016
Peter Altenberg (1859-1919), Esquisses viennoises

Comme vont les choses
Elle était une toute petite comédienne du théâtre d’été, elle avait des yeux célestes, elle avait faim.
« J’aimerais vous jouer une fois Jane Eyre », dit-elle à un jeune écrivain.
« Venez me voir ! », dit-il.
« Oh ! vous me le permettez ? ! »
Elle joua devant lui.
Il la félicita, fit en sorte qu’elle se sentit heureuse.
Puis il l’embrassa, la serra contre lui — — —.
« Dieu me garde ! », dit-elle, s’abandonnant au destin.
Elle garda ses yeux célestes, sa faim, et déclamait Jane Eyre, son grand rôle — — —.
Peter Altenberg, Esquisses viennoises, traduction de l’allemand de Miguel Couffon, Pandora / Textes, 1982, p. 58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eter altenberg, esquisses viennoises, comédienne, jane eyre, écrivain, jeu, destin | ![]() Facebook |
Facebook |
11/04/2016
Camille Loivier, Poèmes, dans Rehauts

Photo Michel Durigneux
chacun a une maison vide abandonnée
dans un coin de la mémoire chacun a
cette forme au fond de la tête dont il se
sauve où il rentre la nuit
(expecta la mano de nieve
tu sors par la fenêtre sur les toits blancs
car cette main blanche se tend vers toi
tu vois cette main de neige qui te dit viens
sauve toi saute sur le toit car bientôt
tout aura disparu et tu seras survivant
- - - expecta la mano de nieve)
mais derrière la maison il y a quelque chose
une présence
entre dans une maison comme un voleur
un inconnu sans repère qui ne sait pas
où il va
va vite entre les murs
oiseau se tape aux fenêtres
— je regarde dehors le monde est maison
dans le chèvrefeuille je trouve un nid abandonné
dans le chèvrefeuille qui gonfle le mur la maison devenue
végétale s’envole ramifiée au monde
un chevreuil entre pour se protéger
dans le chèvrefeuille chevreuil
Camille Loivier, Poèmes, dans Rehauts, n° 37, printemps
été 2016, p. 78-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maison, rêve, chèvrefeuille, chevreuil, camille loivier | ![]() Facebook |
Facebook |
10/04/2016
Frank Venaille, Noord

Noord
La poésie, les démunis du langage et la plaine flamande. Un après-midi, dans un train entre Gand et Bruges, je me suis rendu compte que, dans les prés, les chevaux, immobiles regardaient tous en direction de la mer. Et cela a été une véritable révélation. J’ai pensé qu’ils étaient habités par ce qu’il faur bien nommer un charme et surtout qu’ils avaient tous quelque chose à la fois de primitif et de très savant à m’apprendre, en fait qu’ils détenaient en eux une sorte de connaissance échappant totalement aux humains. Je ne sais pas donner un nom à cette intuition. Mais je suis certain qu’elle est en rapport avec cette pensée qui, désormais, m’habite : ce sont les démunis du langage qui nous apprennent le plus sur la parole ! À un certain moment d’écriture on est à la fois le cheval et son cavalier. Le premier crée une forme de beauté fondée sur la vitesse, l’élégance, l’énergie et, en même temps, accepte le poids, la lourdeur du cavalier. C’est cet assemblage hétéroclite, de cette sorte d’affrontement que naît, pour moi, véritablement la poésie. Il existe un acharnement dans l’écriture qui évoque l’effort de celui qui peine à extraire des mottes de terre de l’immensité de ces champs du Nord, afin de créer, avec la glaise un personnage, un corps anonyme. Cet homme sème-t-il quelque chose ? Se contente-t-il de marcher d’un point à un autre ? Est-il le prisonnier des songes et des rêveries qui l’animent ?
Frank Venaille, Noord, dans La revue de belles-lettres, 2015, 2, p. 109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frank venaille, nord, cheval, intuition, démunis, plaine, poésie, parole | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2016
Marie Cosnay, Vie de HB : recension
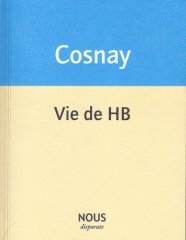
Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.
Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.
Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».
N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »
Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.
Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.
__________________________________________________
- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).
- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
Marie Cosnay, Vie de HB : recension
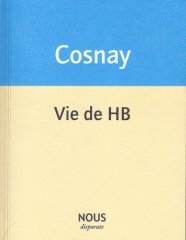
Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.
Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.
Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».
N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »
Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.
Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.
__________________________________________________
- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).
- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
08/04/2016
Henry James, Carnets, dans Un portrait de femme et autres romans

( ...) je ne parlerai pas d’Ivan Tourguéniev, le plus délicieux et le plus aimable des hommes, ni de Gustave Flaubert, que je serai toujours si heureux d’avoir connu ; nature puissante, grave, mélancolique, virile, profondément corrompue mais non corruptrice. Quelque chose en lui me plut beaucoup et il se montra fort bienveillant envers moi. Il dominait de la tête et des épaules tous les autres, ceux que je rencontrais chez lui le dimanche après-midi — Zola, Goncourt, Daudet, etc. (Je veux dire en tant qu’homme — non comme causeur, etc.). Je me rappelle en particulier certain après-midi — en semaine — où j’allai le voir et le trouvai seul. Je suis resté longtemps assis en sa compagnie. Une impulsion soudaine le poussa à me réciter un petit poème de Théophile Gautier, « Les Vieux Portraits » (ce qui déclencha l’impulsion, c’est que nous venions de parler des poètes français, et il avait exprimé sa prédilection pour Théophile Gautier plutôt qu’Alfred de Musset ; il était plus français, etc.
Henry James, I. Carnets, traduction Louise Servicen, revue par Évelyne Labbé, dans Un portrait de femme, et autres romans, Gallimard / Pléiade, 2016, p. 1339.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henry james, carnets, flaubert, tourguéniev, rencontre, lecture, théophile gautier | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2016
Cesare Pavese, Le métier de vivre

Un homme qui souffre, on le traite comme un ivrogne. « Allons, allons, ça sffit, secoue-toi, allons, ça suffit... »
Quand un jeune homme — dix-huit, vingt ans — s’arrête pour contempler son tumulte, tente de saisir la réalité et serre les poings, c’est beau. Mais il est moins beau de le faire à trente ans, comme si rien n’était arrivé. Et cela ne te fait pas froid dans le dos de penser que tu le feras à quarante ans et puis encore ?
Avec les enfants, on ne plaisante pas , ma chère. J’ai été un enfant moi aussi (premier mois).
Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 81, 83, 89.
Publié sur Sitaudis (http://www.sitaudis.fr) le 6 avril 2016 :
NUIT DEBOUT, C'EST MAINTENANT
J'étais place de la République samedi et dimanche dernier - les 32 et 33 mars, donc, selon le calendrier en vigueur sur la place et pour ceux qui souhaitent que les temps changent. Je ne suis pas jeune, et bien évidemment, je n'ai jamais vu ça.
Il est tout à fait possible que quelque chose d'approchant se soit passé en 68, par exemple. Sauf qu'en 68, il n'y avait pas les Sans-Papiers, il n'y avait pas les Rroms et les réfugiés dans les rues de Paris, il n'y avait pas les plans « sociaux » ni la fin envisagée des services publics. L'enjeu était qu'ouvriers et étudiants se rejoignent - pas qu'ouvriers, précaires, chômeurs, intermittents, étudiants, lycéens, émigrés de la deuxième, troisième génération, professeurs, infirmiers et médecins des hôpitaux, magistrats, lesbiennes, gays, be et trans, etc, fassent la jonction, de sorte que leurs luttent convergent enfin.
Il est tout à fait possible aussi que quelque chose d'approchant ait eu lieu à Madrid, Puerta del Sol, en 2011. Mais ce qui me fait penser cela, au fond, c'est juste la présence d'un jeune Espagnol samedi 32, assis en cercle, par terre, avec les autres, à discuter longuement de la pertinence, ou non, de compter les abstentions lors des votes. Les discussions auxquelles j'ai assisté (et participé) étaient en effet plutôt « techniques ».
La raison pour laquelle je publie ce compte-rendu sur sitaudis plutôt qu'ailleurs, c'est qu'il était tout le temps question de vocabulaire ; du choix des mots, de la forme des phrases, de leurs conséquences. Qu'on écartait systématiquement les noms propres (rares à venir, d'ailleurs - ni Debord, ni Deleuze, ni Badiou, ni Agamben ou autres au programme, par exemple) et les grands mots (à l'un qui disait Communisme et à l'autre qui disait Commune, on signifia gentiment de reporter le débat sur leur usage à une date ultérieure).
Pourtant, la plupart des participants à ces commissions ne semblaient pas des novices en terme de politique, d'histoire, et des discours qui se sont historiquement tenus. Simplement, le moment de fixer quelque chose d'une situation en mouvement constant était sans cesse repoussé, de manière à ce qu'il advienne le plus tard possible - voire pas.
Ne pas être ramené à un parti, à une cause, à une revendication, à un « bord politique » quel qu'il soit et aussi amical soit-il, a été en effet énoncé clairement, et répété, par Nuit Debout. Là-dessus - sur quelque chose qui ne cherche pas à être identifié et n'est pas identifiable, réductible -, divers impétrants sont venus, et viennent, régulièrement se casser les dents, laissant flotter au-dessus de la place et se poser dans les gazettes et les sites des phrases bienveillantes et définitives. Ils sont tous à côté de la plaque. Ce n'est pas vraiment drôle. Juste curieux, de voir le vieux monde passer sans rien saisir d'une chose qui, peut-être, tombera demain, mais qui ne se sera jamais fait prendre - du moins l'espère-t-on.
Les photos prises et qui paraissent pourraient nous faire croire qu'il y a là essentiellement des jeunes, étudiants et lycéens parisiens. C'est faux. Il y a des salariés, des chômeurs, des retraités, etc, de tous les sexes et tous les âges. Il y a peut-être encore trop peu de secouristes, de juristes, d'avocats, de militaires et de policiers ayant changé de camp ou désireux d'en changer. Il n'est jamais trop tard. Les employés des commerces de la place peuvent aussi venir, après le boulot. Celles et ceux qui vivent en banlieue et qui ne sont pas encore arrivé.e.s. Vous qui lisez ce texte, allez-y aussi : ce sera une action poétique.
Le commentaire de sitaudis.fr
L'auteur ne signe pas son texte, non par peur mais par respect pour le mouvement en cours.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, souffrance, réalité, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
06/04/2016
Robert Desnos, Complainte de Fantômas, dans Domaine public

Complainte de Fantômas
1
Écoutez... Faites silence...
La triste énumération
De tous les forfaits sans nom,
Des tortures, des violences
Toujours impunis, hélas !
Du criminel Fantômas.
2
Lady Beltham, sa maîtresse,
Le vit tuer son mari
Car il les avait surpris
Au milieu de leurs caresses.
Il coula le paquebot
Lancaster au fond des flots.
3
Cent personnes il assassine.
Mais Juve aidé de Fandor
Va lui faire subir son sort
Enfin sur la guillotine...
Mais un acteur, très bien grimé,
À sa place est exécuté.
4
Un phare dans la tempête
Croule, et les pauvres bateaux
Font naufrage au fond de l’eau.
Mais surgissent quatre têtes :
Lady Beltham, aux yeux d’or,
Fantômas, Juve et Fandor.
5
Le monstre avait une fille
Aussi jolie qu’une fleur.
La douce Hélène au grand cœur
Ne tenait pas de sa famille,
Car elle sauva Fandor
Qu’était condamné à mort.
6
En consigne d’une gare
Un colis ensanglanté !
Un escroc est arrêté !
Qu’est devenu le cadavre ?
Le cadavre est bien vivant,
C’est Fantômas, mes enfants !
.....................
25
Pour ceux du peuple et du monde,
J’ai écrit cette chanson
Sur Fantômas, dont le nom
Fait trembler à la ronde.
Maintenant, vivez longtemps
Je le souhaite en partant.
Final
Allongeant son ombre immense
Sur le monde et sur Paris,
Quel est ce spectre aux yeux gris
Qui surgit dans le silence ?
Fantômas, serait-ce toi
Qui te dresse sur les toits ?
Robert Desnos, Complainte de Fantômas,
(1933, musique de Kurt Weil), dans
Domaine public, Gallimard, 1953, p. 279-
280 et 286.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, complainte de fantômes, domaine public, chanson, fantaisie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2016
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Aborder la terra incognita.
Celle de voir l’écriture nous quitter — qui est celle de la destruction du désir en relation avec un corps qui cesse lui aussi d’avoir envie, comment cette souffrance peut-elle traverser une forme pour dire son effondrement ?
Défi qui serait spécifiquement un combat de poésie : inventer l’expression de la disparition du désir de dire. Situation à la fois simple et extrême, dont la limite est peut-être la banalité même de cette cessation comparable à l’inconnu de la mort.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, terra incognito, désir, écriture, corps, disparition, poésie, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2016
Antoine Emaz, Planche

Tel qu’il est, et compte tenu de l’histoire, ce monde paraît sans issue. À partir de là, on peut commencer le travail vers quelle résistance ou quel espoir, même malingre. Poésie, une charpie de mots pour soigner, accompagner un peu cette blessure du négatif. Chanter quoi dans ce tohu-bohu de misères et d’impasses ? Chanter. Le peu possible. À bouche fermée, si nécessaire.
Je revois le visage de cette élève de 2e me demandant pourquoi ce que j’écris est « si sombre ». Dans son ton, ce n’était pas une critique, plutôt une lassitude. Je comprends très bien ce désir d’échappatoire que mes poèmes ne permettent guère. « Nous ne sortirons pas du sort des condamnés » écrivait déjà Reverdy. Le poète n’est pas un enchanteur, même « pourrissant ». Mais il ne confond jamais peu et rien.
Antoine Emaz, Planche, Rehauts, 2016, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plance, monde sans issue, négatif, échappatoire, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2016
Jean-Claude Caër, Alaska

Photo Michèle Le Braz
Il est troublant de vivre dans un espace-temps différent
Tout en restant connectés
De rencontrer des gens assis devant leurs ordinateurs
Comme s’ils n’allaient jamais mourir.
Je rencontre Steve, spécialiste du cerveau,
Qui me raconte s’être trompé de direction.
Il voulait aller au zoo voir des ours polaires
Mais passa son après-midi dans un café à boire bière sur bière.
Tout à l’heure, il prendra l’avion pour Seattle
Et disparaîtra définitivement de mon univers.
Il en est ainsi à chaque instant pour chacun de nous
Et le sachant cela devient extraordinaire
Tous ces gens qui apparaissent quelques secondes dans notre vie
Tels des drapeaux piqués sur une carte du monde
Puis s’éclipsent définitivement de notre vue
Nous préparent peut-être à notre propre disparition.
Jean-Claude Caër, Alaska, Le bruit du temps, 2016, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude caër, alaska, espace-temps, voyage, disparition | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2016
Sarah Plimpton, extrait de Single Skies

Extraits de Single Skies
ombre brusque du soleil
froissée derrière l’arbre
le bleu du ciel
qui mène le vent
hors de la nuit
la porte
claque
le ciel
au sein de l’orage
a sudden shadow from the sun
upset behind the tree
the blue of the sky
driving the wind
off the night
the door
slams
the sky
inside the storm
Sarah Plimpton, traduit par Mathieu
Nuss, dans L’Étrangère, n° 40-41, p. 239 et 238.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sarah plimpton, single skies, nuit, orage, ombre, arbre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2016
Autour de l'eau, images



© Photos Chantal Tanet, mars 2016
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |





