12/12/2015
John Ashbery, Vague

Tu l’as dit, petit
Comme tu es courageux ! Parfois. Et l’injonction
Demeure, mur blanc tout simple. Encore un affaire en cours.
Mais n’est-ce pas là précisément la nature des affaires, dit
quelqu’un d’autre, l’air dégagé.
Tu ne peux pas tout laisser en plan au beau milieu, et puis filer.
Et si tu y prêtais incessamment l’oreille, jusqu’à
Ce qu’elle s’intègre à ton âme, corps étranger bien à sa place ?
Je te demande si souvent de réfléchir à la rupture que tu es en train
D’accomplir, cette révolution. Le temps se drape encore, pourtant,
Sur tes épaules. Le bulletin météo
N’a pas parlé de pluie, mais tu as le cul qui baigne dedans, alors ?
Trouve-toi d’autres prévisions. Celles-ci sont bonnes à jeter.
Les journaux d’hier, et ceux des semaines précédentes couvrent
Le temps écoulé, de plus en plus lointain, dans un ordre quasi parfait.
Ça ne sert
Qu’à te couper la parole. Le passé ne sert à rien d’autre.
Jusqu’au moment où, ton auto sortant brutalement d’une route
Pour tomber dans un champ, tu demeures assis à évoquer les heures.
C’était pour cela le baratin, les mensonges
Que nos murmures répétaient jusqu’à leur donner un parfum de vérité ?
Mais maintenant, comme quand on mord une monnaie dévaluée,
ils se font possessions
Alors que montent les étoiles. Et la ridicule machine
Continue à égrener ses slogans : « Encore bourré... », « de chez nous
À chez toi... » « On les a portés un certain temps, ils faisaient partie de
nous »
Chaque jour semble imbu de lui-même, il n’est pourtant
Fait que de quelques haricots colorés et d’un peu de paille sur la terre
battue
Dans le rai de lumière où danse la poussière. Il y a eu de la place, c’est vrai ;
Et c’est toi qui l’a ménagée en t’en allant. Quelque part, quelqu’un
Écoute ton rire, l’avale comme un verre d’eau fraîche,
Ni heureux, ni horrifié. Et cette posture, ce poteau fiché là, c’est toi.
John Ashbery, Vague, Traduit de l’américain par Marc Chénetier,
Joca Seria, 2015, p. 44-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ashbery, vague, passé, rupture, parole, slogan, posture | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2015
Jacques Josse, Au célibataire retour des champs
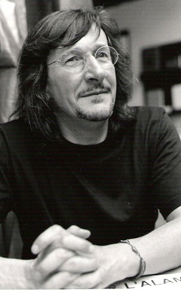
novembre, décembre,
debout sur la pas de la porte,
scrute le ciel bas,
tire sur la laisse du passé,
entend rire ses morts
(ils sont dans le ruisseau d’à-côté
et descendent à la rivière),
regarde le rideau des pluies
qui dilue la clarté
et ramène l’horizon
à hauteur des talus.
(22.12.2013)
Jacques Josse, Au célibataire retour des
champs, le phare du cousseix, 2015, p. 8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques josse, au célibataire retour des champs, hiver, passé, pluie, horizon | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2015
Daniil Harms, Le Samovar

Les chats
Un jour, d’un joyeux pas,
Je revenais chez moi.
Soudain, je vois des chats,
Qui m’tournent le dos, ma foi.
Je crie : hé-ho, les chats !
Ne restez pas comme ça,
Suivez-moi de ce pas,
Je vous amène chez moi.
Suivez-moi donc, les chats,
Je vais vous mitonner
De suite un fameux plat,
Il y aura du soufflé.
Mais non ! répondent les chats,
On préfère rester là !
Les voilà donc assis,
Aucun ne m’a suivi.
Daniil Harms, Le Samovar, édition bilingue,
traduit du russe par Eva Antonnikov, Héros
Limite, 2015, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniil harms, le samovar, les chats, repas, liberté | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2015
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride
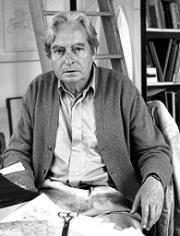
La poésie
c'est refuser la vie — partie par partie —
pour l'accepter tout entière —
que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.
La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile
*
Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,
ne se réveille pas —
*
le poème sort avec sa lie
hors de sa gangue d'angoisse
et de toute la boue qui le charrie
*
la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,
de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière
il y a cette révélation de l'insipide
— de cette clarté
qui court en avant d'elle-même
ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité
qui n'est suscité que pour être incinéré
l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.
Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.
Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.
on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle
le vent dont nous sommes affublés
le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —
l'image n'est suscitée que pour être incinérée.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie, image, banalité, angoisse | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2015
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

La pipe au poète
Je suis la Pipe d’un poète,
Sa nourrice et : j’endors sa Bête.
Quand ses chimères éborgnées
Viennent se heurter à son front,
Je fume... et lui, dans son plafond,
Ne peut plus voir les araignées.
... Je lui fais un ciel, des nuages,
La mer, le désert, des mirages ;
— Il laisse errer là son œil mort...
Et, quand lourde devient la nue,
Il croit voir une ombre connue,
— Et je sens mon tuyau qu’il mord...
— Un autre tourbillon délie
Son âme, son carcan, sa vie !
... Et je me sens m’éteindre... — Il dort —
.............................................................
— Dors encor : la Bête est calmée,
File ton rêve jusqu’au bout...
Mon pauvre !... la fumée est tout.
— S’il est vrai que tout est fumée...
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros,
T. C., Œuvres complètes, édition Pierre-Olivier-Walzer pour T. C., Pléiade / Gallimard, 1970, p. 734.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, poète, pipe, fumée, sommeil, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2015
Michel Deguy, Biefs

J’ai connu un vieux couple qui se déchirait de procès à dessein — peu conscient — de remettre en question son propre passé : féroce anamnèse, jusqu’au premier regard de fiancés, déjà truqué.
O salves du cœur, fantasia des yeux, l’état sauvage, l’impatience de toute conséquence ( j’ai connu un fervent cavalier peut-être à cause d’une image des Huns tôt imposée). Gestes perdus, balles perdues, enfant perdu, si perdu que pas une théorie du lapsus n’y retrouvera ce qui fut sien.
Et qu’elle y retrouve une trace, elle entendra l’éclat de rire du gitan ! Liberté brisée brisante, vague incalculable sur le corail errant, torrent jeune.
Michel Deguy, Biefs, Gallimard, 1964, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, biefs, couple, mensonge, cavalier, gitan, lapsus, liberté, anamnèse | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2015
Rainer Maria Rilke, Pour te fêter (Pour Lou Andreas Salomé)

Rilke avec Lou Andreas Salomé en Russie, 1897
Pour Lou Andreas Salomé
Lorsque parfois dans mon souvenir
je compare une rencontre à l’autre :
tu es toujours la femme riche qui donne
tandis que je suis le mendiant indigent.
Lorsque tu viens à ma rencontre doucement,
et, à peine souriante, lèves soudain,
de tes vêtements, ta main,
belle, brillante, fine... ;
dans la sébile tendue de mes mains,
tu la déposes gracieusement
comme un présent.
*
Je continue de marcher, solitaire. Au-dessus de moi,
je sens le printemps frémir dans les branches.
Un jour, je viendrai, avec des sandales sans poussière,
attendre aux grilles du jardin.
Et tu viendras quand j’aurai besoin de toi,
et tu prendras mon hésitation pour un signe,
et silencieusement tu me tendras les roses épanouies de l’été
des tout derniers buissons.
Rainer Maria Rilke, Pour te fêter, traduction Marc de Launay, dans Œuvres poétiques et théâtrales, sous la direction de Gérald Stieg, Pléiade / Gallimard, 1997, p. 647-648, 650.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, pour te fêter, lou andreas salomé, souvenir, rencontre, solitaude, printemps, signe, rose | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2015
Pierre Silvain, Assise devant la mer
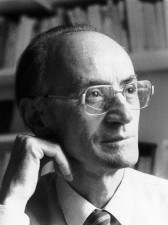
Maintenant qu’il se soulève au-dessus du lit, il voit sa mère debout devant la table de toilette, en combinaison légère, ses épaules dénudées, et dans le miroir incliné son visage de profil tandis que par petites touches, d’une houppette en cygne, elle se poudre les joues, le front. Quand son regard rencontre soudain le sien qu’un reflet lumineux parmi les piqûres couleur de rouille lui renvoie, elle s’arrête, interdite, honteuse peut-être d’avoir oublié la présence de l’enfant, ou bien troublée par l’interrogation qu’elle découvre dans les yeux sombres qui ne se détournent pas. Elle va prendre aussitôt sur le dos d’une chaise sa robe bleue imprimée de pois blancs qu’elle-même a coupée et cousue, droite, sans plis, décolleté en pointe, la revêt, la lisse doucement du plat de la main sur les hanches, le ventre. Il observe chacun de ses gestes sans un cillement et lorsqu’elle vient s’asseoir au bord du lit, il sent la poudre de riz l’envelopper d’un faible nuage de rose, mais il reste aussi tendu que s’il se défendait de respirer un parfum interdit. Un instant indécise ou désarmée devant l’enfant transi par une crainte puérile, la mère ouvre ses bras, l’attire contre elle, contre ses seins qui s’écartent sous la pression de la tête de plus en plus pesante, abandonnée. Pourtant, il ne dort pas, il est tout entier ce corps sans défense qu’il laisse retourner au corps maternel dont le même mouvement berceur qu’autrefois, quand il ne savait rien du monde autour de lui, rien d’autre que l’effleurement d’un souffle ou le duvet d’un baiser de lèvres sur ses lèvres, l’endort, tandis qu’il entend les paroles d’une chanson — un peu triste — s’éloigner, se brouiller et enfin mourir là-bas où sa mère l’attend.
Pierre Silvain, Assise devant la mer, Verdier, 2009, p. 37-38. © Photo Marina Poole.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, assise devant la mer, enfant, mère, so, parfum, affection, sommeil | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2015
Jean Bollack, Au jour le jour

En hommage à Jean Bollack, disparu le 4 décembre 2012.
En dépit de toutes ses origines rituelles, la poésie comporte une tendance libératrice, due à sa puissance d’arrachement, qui peut la conduire à des mises en questions radicales, et à souvent contester des croyances établies. Elle est athée. Le dieu tient son pouvoir de la langue.
La fonction et la finalité d’une création littéraire (le terme n’est peut-être pas anachronique, ni pour Homère ni pour Sophocle) ne peuvent être saisies qu’au terme de l’analyse d’un projet qui relève de l’intervention d’un sujet ; ce « moi »-là s’affirme avant de pouvoir être rapporté à la situation historique d’un champ social dont la configuration préexiste à l’œuvre, mais s’y trouve également analysée et transformée.
Le plus souvent les textes recensés par les auteurs d’articles critiques servent de prétexte ou de support. Leurs développements s’en inspirent L’analyse du sens et le déchiffrement systématique des textes auraient dû précéder et faire l’objet d’une discussion critique. Les opérations se tiennent mais demandent à être distinguées.
Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F, 2013, p. 763, 167 et 191.
© Photo Tristan Hordé, 2012.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, poésie, libérateur, athéisme, création littéraire, histoire, article critique, analyse | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2015
Paul Celan, Enclos du temps, traduction Martine Broda
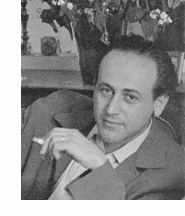
Viens, explique le monde à ton aune,
viens, laisse-moi vous combler
de toute opinion,
je ne fais qu’un avec toi,
pour nous capturer,
même maintenant.
Komm, leg die Welt aus mit dir,
komm, laß mich euch zuschütten mit
allem Meinen,
Eins mit dir bin ich,
uns zu erbeuten,
auch jezt.
Paul Celan, Enclos du temps, traduit par
Martine Broda, Clivages, 1985, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, enclos du temps, martine broda, union, présent, explication | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2015
Eugène Guillevic, Autres, poèmes 1969-1979
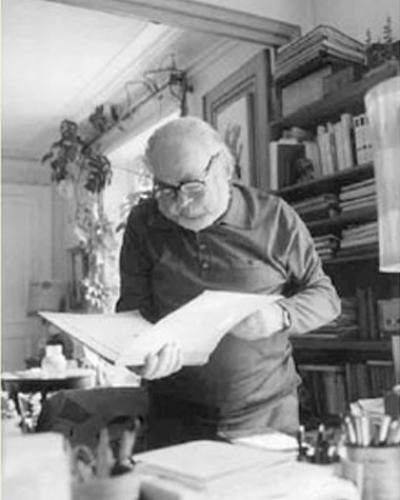
Contes et nouvelles
37
Il n’allait jamais bien loin.
Il avait découvert à l’orée de la forêt
Cette cabane abandonnée
Et il y revenait très vite,
Quand il avait de quoi
Pour quelques jours.
Sans doute n’y avait-il que là
Un arrêt, c’est presque sûr, du soleil
À la tombée du jour, un bon moment,
Comme pour le regarder,
Alors qu’il était
Sur le seuil de la cabane
À savourer, solitaire,
Son gros morceau de pain
Et son vin rouge.
Eugène Guillevic, Autres, poèmes 1969-1979,
Gallimard, 1980, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène guillevic, autres, poèmes, solitaire, cabane, forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2015
Étienne Faure, Ciné-plage
T’as perdu ta langue
T’as perdu ta langue — effroyablement seule
et soudain exacte est la phrase
entendue quand on se sait plus — stupeur —
lire, écrire, ni rêver dans la langue
qu’on avait crue acquise de longue date,
à cet instant frappé d’hébétude
de n’avoir su garder racine en elle,
mots précaires, locutions locales
qui s’immisçaient vaguement jusqu’à l’âme,
et que noué jusqu’à la glotte par l’émotion
de la perte on revit le mutisme
de l’enfant d’alors qui savait à peine
la langue qu’on lui parlait quand l’autre,
la maternelle, était déjà en voie de partance
sans plus d’espoir de la retrouver, enfouie,
t’as perdu ta langue.
perdue
***
Entrée, sortie
Qui est là — et voilà, debout
après les trois coups pour entrer dans l’histoire
à dormir sur les planches, il déclame
face aux assis en rang sur les fauteuils
qui attendront la fin, cramoisis, pour éclater,
ou transis regardent dans leurs lorgnettes
l’avenir de loin,
entrer le vieil acteur au teint farineux,
un crâne en plastique à la main pour dire,
mis en branle par le corps, son texte
appris par cœur, lui donner le souffle
que la langue et la voix fusionnent
dans l’illusion qui se fait attendre
jusqu’à l’applaudissement, premier rappel
quand, se dit-il, revenu à pas caverneux pour saluer,
le tour est joué.
ceci est du théâtre
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015,
- 103 et 118.
Rencontre avec Étienne Faure et lecture, le mercredi
9 décembre, à partir de 19h à la librairie "Libralire",
116, rue St-Maur, Paris, 75011.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, langue, perte, théâtre, rôle, spectateur, acteur | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2015
Paysages d'hiver



Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'hiver, neige, merle | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2015
James Sacré, Dans l'œil de l'oubli, suivi de Rougigogne
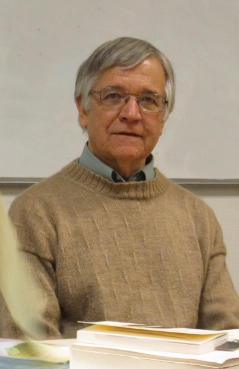
J’ai bien conscience souvent que j’écris en mêlant les temps verbaux comme si je voulais mettre ensemble dans un temps présent aussi bien le passé que ce qui ressemble à du futur quand on se prend à rêver, à dire les mots « demain », « plus tard » : le désir d’un présent qui serait aussi bien l’infini que l’éternité dans le plus fugitif arrêt du temps qu’on s’imagine pouvoir vivre. Ce présent, qui ne peut exister pour nous qui n’en finissons pas de vieillir, n’est-il pas la pupille de cet œil de l’oubli dans laquelle je n’ai jamais rien vu pour la bonne raison que n’existant sans doute pas je ne peux que penser ce présent comme une tache aveugle de mon existence, un trou noir dans lequel toute celle-ci s’engouffre lentement jusqu’à la mort.
James Sacré, Dans l’œil de l’oubli suivi de Rougigogne, Obsidiane, 2015, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans l’œil de l’oubli, présent, passé, écriture, temps, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2015
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure — Le retour au livre
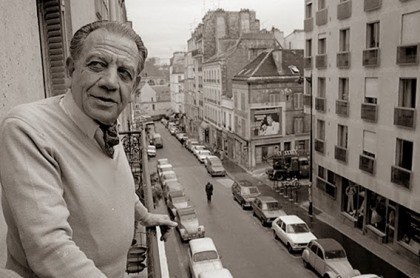
L’étranger
La coquetterie des choses
à paraître ce qu’elles sont
Le monde est une coterie
L’étranger a du mal à s’y faire entendre
On lui reproche gestes et langue
Et pour sa patiente courtoisie
récolte injures et menaces
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure, Poèmes
1943-1957, Gallimard, 1959, p. 265.
Chanson
Sur le bord de la route,
il y a des feuilles
si fatiguées d’être feuilles,
qu’elles sont tombées.
Sur le bord de la route,
il y a des Juifs
si fatigués d’être juifs,
Qu’ils sont tombés.
Balayez les feuilles.
Balayez les Juifs.
Les mêmes feuilles repoussent-elles au printemps ?
Y a-t-il un printemps pour les Juifs piétinés ?
Edmond Jabès, Le Livre des questions, III : Le retour au livre, Gallimard, 1965, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, le retour au livre, étranger, juif, feuille | ![]() Facebook |
Facebook |






