07/06/2018
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit
Le sous-sol de la mémoire
Oh, caveau de la mémoire
Khlebnikov
Ainsi donc je vivrais affligée,
Rongée de souvenirs ? Sottises !
Je ne rends pas souvent visite à ma mémoire,
Du reste, elle me joue toujours des tours.
Dès qu'avec ma lanterne, je descends à la cave,
Je crois entendre un éboulement sourd
Gronder dans l'étroit escalier,
Ma lampe fume, je ne peux reculer,
Pourtant je vais droit à l'ennemi, je le sais.
Et comme une faveur, j'implore... Mais
Il fait nuit, pas un bruit. Finie la fête !
Trente ans déjà qu'on a raccompagné ces dames,
Et l'espiègle d'antan, il est mort de vieillesse.
Trop tard. Misère !
Où aller ?
Je touche les murs peints,
Me chauffe au coin du feu. Miracle !
Dans ce moisi, cette fumée, et toute cette pourriture,
Deux émeraudes scintillent, vivantes.
Puis un chat miaule... Allons, il faut rentrer !
Mais où est ma maison, où, ma raison ?
18 janvier 1940
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, traduits par Marion Graf et José-Flore Tappy, La Dogana, 2010, p. 125.
Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2018
Aurélie Foglia, Grand-Monde : recension
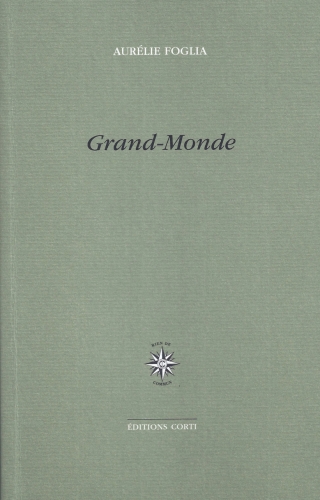
Bien des poètes ont célébré les arbres, de Ronsard à Supervielle, mais un livre entier déborde l’idée même d’éloge. Il ne s’agit pas seulement des arbres et de la manière dont les humains les utilisent, mais du lien étroit, intime que la narratrice entretient avec eux ; elle est surtout présente à partir de la troisième des six parties de Grand-Monde(le néologisme désigne le monde des arbres) et, ensuite, c’est ce lien qui engage sa vie qui occupe une place prépondérante.
C’est essentiellement dans la première partie, titrée "Les Longtemps", la plus développée, que la narratrice précise la manière dont elle perçoit les arbres ; non pas vision de botaniste : ce qu’ils sont au-delà de leur apparence physique. Le nom "Les Longtemps", « au visage vert tendre », leur est donné parce que le temps ne semble pas avoir de prise sur eux — caractéristique classique de la symbolique des arbres, régulièrement reprise (par exemple par Verhaeren, « [l’arbre] voit les mêmes champs depuis cent et cent ans / Les mêmes labours et les mêmes semailles »), mais qui, ici, n’est pas dissociée d’autres aspects qui font des arbres des êtres singuliers. Leur singularité est dite d’entrée : « Ils n’ont pas bougé », notation dans un contexte qui renvoie à des éléments mobiles ; l’absence de mouvement est suggérée comme un choix, répété ensuite avec l’insistance de l’allitération, ils « miment mal le maigre / exploit de marcher ». La majuscule de "Ils" et leurs traits spécifiques les distinguent des humains ; ils forment une communauté, sans qu’il soit question de telle ou telle espèce, dont l’organisation a exclu toute distinction entre les membres : aucun des éléments n’a de prise sur un autre. Sans doute ne parlent-ils pas, ce qui n’empêche pas qu’ils s’expriment de manière non articulée (« un arbre à l’oral est un raclement qui s’éclaircit »), qu’ils peuvent crier (« leurs cris de joie d’oiseaux ») et, quand ils ont perdu leurs feuilles, de faire entendre « des soupirs d’insectes ». En somme, les arbres cumulent ce qui appartient à l’humain, à l’oiseau et à l’insecte ; en outre, s’ils se multiplient grâce aux oiseaux, existent cependant « les femmes des arbres ».
L’arbre serait à sa manière un être complet, opposé en cela à la narratrice qui, par comparaison, se vit comme inachevée, ce que souligne la coupure des mots :
je ne devrais pas avoir droit
à la nudit
é me
réduire à une cuir
rasse casque barbe
lé
[etc.]
Êtres complets également parce qu’ils sont intégrés à un ensemble plus vaste qui comprend, outre les insectes et les oiseaux, l’eau où ils se reflètent « comme peints par Apelle », le ciel puisque par leur position ils vont « vers la lumière dont se faire verts », le ciel et la terre qui ont des qualités complémentaires : les arbres « ont tressé la terre avec l’instable // en brassant le ciel immeuble », le vent avec qui ils ont un rapport de complicité — il les fait « ré / fléchir » — et grâce auquel ils adoptent parfois la figure de la mer — ce qu’appuie l’assonance dans :
tel ancrage de mer vague
sous l’élan caressant du vent cassant
l’ombre
de falaises frémissantes de temps
en temps frénétiques
[etc]
Aurélie Foglia construit une symbolique de l’arbre en inversant un discours dominant à propos des forêts, encore perçues comme des espaces opaques, à l’écart du civilisé, pour l’essentiel ayant une fonction utile : elles sont, d’abord, lieux à exploiter, ce qui les fait disparaître ; les arbres deviennent manches de haches, meubles, etc., ils sont à la disposition des hommes qui y installent une balançoire et laissent leurs chiens uriner contre eux. Que dire d’autre ? Les arbres « sont animaux / qui ne craignant pas l’homme / sauvages / ils ont tort ». Contrairement à lui, ils ignorent ce qu’est la mort et, est-ce bienveillance ?, ils l’aident à se pendre.
Dans la construction de Grand-Monde, les arbres sont étroitement liés à la narratrice, et d’abord par le jeu des mots, "feuille" ne renvoyant pas qu’au végétal, par exemple dans « des mains froissent des feuilles déchirées », et l’arbre pouvant devenir papier : « il paraît / que je viens d’un long voyage de papier » — on ne peut pas ignorer que fogliasignifie « feuille » en italien. Le je, dans la quatrième partie titrée "Hors lieu", déclare « je n’ai pas lieu / la banlieue aveugle », constatant sa rupture avec arbres et terre, se souvenant d’un lieu perdu, le clos des rosiers de la grand-mère, pour ensuite entrer dans une fiction, celle de devenir arbre, ce qui s’opposerait à « je n’ai nulle part ». Entrer dans l’imaginaire, écrire que l’on souhaiterait devenir ce qui dans une grande partie du livre a été présenté comme une forme accomplie, pleine, sans aspérités, cela n’implique pas que l’on quitte la réalité, seulement qu’il faut penser l’impossible — on sait bien que « représenter est théâtral est tuant ». Il y a dans le désir (donc dans ce qui ne peut s’accomplir sans cesser d’être désir) de devenir arbre (« on se demandera // je ne sais pas vous// ce que ça fait d’être / arbre » ; etc.) une aspiration à abandonner les oripeaux du quotidien pour rejoindre le silence des arbres et de l’herbe, confondus en un mot valise : « sous les berces et les ombelles j’ai / jeté mon corps et l’ai laissé / là roulé dans l’harbre à la merci / du soleil et des mouches ».
Aurélie Foglia, Grand-Monde, Corti, 2018, 144 p., 18 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 15 mai 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aurélie foglia, grand-monde, arbre, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2018
Nadia Porcar, Une décision

Une décision
J’avons décidé de surprendre les futurs hommes de ma vie au petit déjeuner. Adieu, petits pains aux quatre figues destinés à des délicats qui bien souvent se contentaient d’un thé sucré. Basta, les confitures aux trois pêches plus une poire confites par les soins de mains chères et provinciales. Désormais, ce sera frites, œufs brouillés, café et pas de discussion. Après le café, je proposerai une lampée de porto. Il sera alors temps d’inviter les futurs hommes de ma vie qui n’auront pas déguerpi à aller pêcher la truite. Ceux qui se croient malins songeront à un petit revenez-y sur mon lit-banquette dur comme pierre. — là aussi j’aurons mis le holà au duvet de cygne et autres foutaises — mais non, de ceux-là il ne sera point question. Je parle pour les littéraux à ma taille, ceux qui iront jeter un coup d’œil dans le jardin, y découvrir le bassin et s’exclamer en se frottant les mains Bon, elles sont où les cannes à pêche ?
[…]
Nadia Porcar, Une décision, dans Rehauts, n° 41, printemps 2018, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nadia porcar, une décision, hommes de ma vie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2018
Édith Azam, Oiseau-moi

Il y a des centaines de bancs,
et là encore je me grave
écris des mots d’amour
et des envols d’oiseaux.
Je sais
je sais
elle ne sait pas :
je résiste
et vais me dire
qu’Hannah est là
parce que tout simplement :
elle y est.
Ça ne tient pas debout ?
Peu importe
je rêve à m’y méprendre
au-delà de
toute expression.
No sens no sens
j’ai peur Hannah.
J’avale un peu de nuit
pour me calmer
cailloux noirs ronds glacés
et cest si triste alors.
Ce serait bien parfois
que la fatigue
se repose.
Ce serait bien :
diminuer…
No sens no sens…
Édith Azam, Oiseau-moi, Lanskine, 2018, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, oiseau-moi, rêve, nuit, fatigue | ![]() Facebook |
Facebook |
Édith Azam, Oiseau-moi

Il y a des centaines de bancs,
et là encore je me grave
écris des mots d’amour
et des envols d’oiseaux.
Je sais
je sais
elle ne sait pas :
je résiste
et vais me dire
qu’Hannah est là
parce que tout simplement :
elle y est.
Ça ne tient pas debout ?
Peu importe
je rêve à m’y méprendre
au-delà de
toute expression.
No sens no sens
j’ai peur Hannah.
J’avale un peu de nuit
pour me calmer
cailloux noirs ronds glacés
et cest si triste alors.
Ce serait bien parfois
que la fatigue
se repose.
Ce serait bien :
diminuer…
No sens no sens…
Édith Azam, Oiseau-moi, Lanskine, 2018, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, oiseau-moi, rêve, nuit, fatigue | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2018
Pierre Vinclair, La honte de la nation
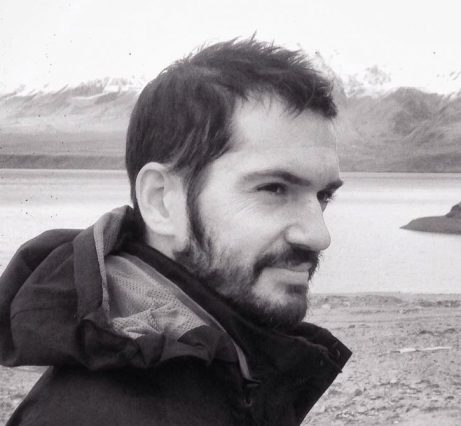
La honte de la nation
Il n’y a pas si longtemps, en France, on était poète de cour. Marot faisait mousser François Ier, Ronsard célébrait Henri II et Charles IX.
La tradition du poète officiel se perpétue d’ailleurs, dans bien des pays anglo-saxons, et (contrairement à ce que notre inconscient sans-culotte nous inciterait à penser) pas toujours au détriment du bon goût : William Wordsworth ou Ted Hughes en Angleterre, Elizabeth Bishop ou William Carlos Williams aux États-Unis, ne furent pas seulement des « poètes officiels ». Ils le furent aussi.
Il en va différemment en France : depuis le XIXème siècle c’est plutôt la figure du poète maudit (bohème, désargenté, mal reconnu, contestataire, et même geignard) que celle du poète lauréat à laquelle elle s’oppose, qui prévaut comme critère de valeur poétique. Le mirliton adolescent se rêve écorché vif, plutôt que tête poudrée et perruquée. Moi poète, se dit-il devant le miroir en soignant ses boutons d’acné, je serai Antonin Artaud. Et aujourd’hui, l’Académie Française pour compter des poètes dans ses rangs est obligée de faire appel à des plumes francophones venues de l’étranger : Dany Lafferière (Haiti, Canada), Michael Edwards (Royaume-Uni).
Exercice : Pensez à un poète français vivant dont vous admirez le travail, et imaginez-le dans l’habit vert. Avec la petite épée au côté droit.
On voit bien, ça ne marche pas du tout.
Vous me direz : il y eut Victor Hugo. C’est vrai, mais le poète de Jersey ne doit-il pas sa respectabilité poétique et morale à son opposition à Napoléon III, et à son exil ? Ses œuvres majeures — Les Châtiments, Les Misérables — sont celles d’un paria. De même, les effusions engagées de la seconde guerre mondiale : c’était d’abord une poésie de résistance. Non d’hymne patriotique. La poésie contre Vichy, au nom de la liberté, — pas de la France. La nation plus jamais ne fait bander du poète français la lyre.
Nation. Ça vient du latin natio qui désigne les petits d’une même portée. On le voit bien, c’est d’abord un objet métaphorique : sauf si tu es mon frère (peu de chances) ou mon cousin (salut Laurent), on n’est pas de la même portée, cher lecteur. Pourtant de la même nation, alors quoi ?
Une nation, dit le dictionnaire, c’est un peuple, constitué en communauté politique et partageant une langue. En refusant la nation, que croit contester le poète ? La langue ? La légitimité de l’État ?
Qu’il partage une langue avec d’autres, que celle-ci soit plus qu’un instrument mais une matière à reconfigurer, enrichir, déplacer ou lacérer, et même un milieu, le poète l’accorde en premier. Le cas échéant, il sait même se contenter de la grammaire et du vocabulaire des manuels. Il ne nie pas non plus l’existence de l’État, qui définit, par l’école, les programmes de quinze années d’initiation à la littérature, qui donne les bourses du CNL, qui encadre de lois publications et performances — et qui parfois est l’employeur du poète-enseignant, documentaliste, gendarme ou diplomate.
En refusant la nation, le poète français ne refuse donc ni la langue, ni l’État — mais plutôt : l’idée que l’une et l’autre se prédiquent d’une même entité, ou soient (comme qui dirait) deux modes d’existence de la même substance « France », par l’intermédiaire de laquelle elles communiqueraient, ou tout du moins, seraient en rapport. Et, partant, que les affaires de langue soient aussi une prérogative de l’État, puisque celui-ci est la volonté de l’entité dont celle-là serait la bouche.
Ce n’est pas tant que le poète, trop conscient de l’empreinte des logiques de pouvoir sur le discours, doive se donner pour mission de les saboter, couper la parole à l’État ou éventrer (avec l’aide du CNL quand même, si possible) ce rêve de congruence de la langue aux enjeux politiques — qu’exprime le concept de nation. Ni que la deuxième guerre mondiale continue, que Vichy guette, No pasaran ! j’écris ton nom.
Non : d’abord, c’est que la nation, ça n’existe pas. Il faut le dire. Il n’y a pas cette substance qui existerait derrière la langue et l’État : la nation n’est qu’un produit imaginaire du discours politique, elle est ce que l’État essaie de faire advenir par une certaine utilisation de la langue, décrets et mythes. Un État, avec son pouvoir bien réel (sa police, ses enseignants, ses diplomates) contrôlant un territoire donné sur lequel vivent diverses populations (elles-mêmes unifiées dans quelque objet imaginaire défendu par des institutions locales plus ou moins puissantes : famille, tribu, 9-3, Bretagne), appelle nation l’objet fantasmatiquement unique sur lequel s’applique son pouvoir. Quelle raison aurait le poète de chanter un objet aussi ridiculement hypothétique ? Et surtout : pourquoi accepterait-il d’identifier sa langue immense à un si pauvre petit territoire ?
Non seulement le poème est rétif à trop de hiérarchie, en effet (il se voudrait bien un lieu où le sens est l’enjeu et où la beauté se partage), mais cette utopie contredit la définition territoriale de la langue, qui est au cœur de l’idée de nation. D’ailleurs, ce n’est pas tant la langue qui est l’objet du poème, que la voix : y bat le projet, sans doute idiot, mais culotté (il faudrait voir comment ça peut marcher), que de la singularité de la voix puissent émerger des figures de sens à la fois immanentes et absolues. Pour le dire autrement : le poète parle, certes dans sa langue (mais une langue s’apprend et se traduit) à tous les hommes de la terre.
Voici la nation : une langue, un territoire. La France au français.
Voilà le poème : une voix, l’être, les hommes.
Pierre Vinclair, édito du n° 9 de Catastrophes, revue en ligne, 31 mai 2018 .
Le numéro 9 de Catastrophesest en ligne : https://revuecatastrophes.wordpress.com/la-honte-de-la-na...
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, la honte de la nation | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2018
Romain Fustier, Terre-Mer

ce sentiment de marcher là où personne
n’a encore marché, je l’éprouve comme
elle sur cette grève à marée basse, à
cet instant – aucune trace de pas qui
soient passés avant nous – une illusion de
sonder une terre-mer inconnue, vide
qui m’habite tout à coup, déambulant
: la plage immense semble naître par nous
qui la découvrons ainsi qu’un continent
infoulé, abrité des foules urbaines
– le vent vif et mordant a renouvelé
la côte, l’a revigorée : sauvagiode
de dunes se formant le long des régions
où nous avançons en sol meuble, mobile
.
*
.
elle fait un bruit fou, la mer – elle avise
que nous ne nous entendons plus quand le flot
se fracasse sur les rochers, au pied du
poste de surveillance fermé en cette
saison – il a déjà vêtu l’estran, di-
géré la plage où nous marchions le soir de
notre arrivée, jouions au ballon là où
de méchantes vagues moussantes se forment
– le boucan aussi est blanc parmi le blanc
qu’elles abattent : nos paroles s’y en-
volent, s’y noient dans le vent fort autour
de nous – la grève a disparu à marée
haute, m’absorbant dans l’observation franche
de la paix qui en découle étonnamment
Romain Fustier, Terre-Mer (extrait d'un travail en cours), dans Catastrophes, revue numérique, 30 mai 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : romain fustier, terre-mer, catastrophes | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2018
Anne Malaprade, parole, personne

Corps publié
« une ancienne et très vague mais jalouse pratique »
touts et toutes reconnaissent, les faunes
à travers le feuillage lisent
et déchirent, ils se nourrissent de ce que
les mots progressent sous la peau
ce cauchemar au cours duquel les fourmis nageaient sur
l’expression sanguine
je consens à coagulation ne donne âme sans corps
tous et toutes évoquent les oiseaux, la glace sur feu
une musique russe module le temps des cerises et je suis
moqueuse
merle noir court sur tes lignes
un corps en soie dont l’odeur entête nos vêtements
les élèves coulent l’ennui fleuve j’y jette ce que le rose doit à la rose
tous les mots pour un corps
tous et toutes jouent leur travail de malice
ma lecture sans aucun doute incapable puis coupable
Anne Malaprade, parole, personne, isabelle sauvage, 2018, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne malaprade, parole, personne, corps publié | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2018
Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, Bréviaire à l'usage des Sœurs Mineures

Photo Clémentine Pace, Diacritik, janvier 2016
Matines
on tombe de vis à mort du côté mort de là puis quand
‘Ce Dit Etant Dit’ comme dieu nous sauve
exprime assez mal ce que je sens . de qui porte les faux .
puis selon quoi selon . tenter le diable à l’unitexte
.
va porte à qui les deux petits pareils . cela croyez-vous c’est dit qu’une fois j’admette . pleuvoir sur mon épaule . qu’ils baisent en superflu
casse caillasse . des choses que j’entaille . je m’achèterai comme on dit . un trait d’esprit pour vestibule
ne sait où donner du casque . sans coït préalable . somme fissurable des comme qui on s’en branle . carapace les rats
sois prompt à la noyade
.
ah . commettre des actes de bavure et saigner large . façon fredon diable . seulement mardi j’ai pleuré
Laudes
un faux pas aux airs de faux soi . dans la pente ce bruit redit . file fillette au pan carré
trace des mains en tas de poudre . grise d’alors trois fois les crie . collant si petite . reprends là tu temporises . un quart de tour culotte serrée
.
‘Dis ceci Salopard Qui n’a jamais vu des yeux Qui n’a fermé les Siens sur l’éphémère ?’
si brève heureuse d’exil et sueur . grille grillons ses clopinettes . désenchantée par mégarde
‘Ne vous a jamais Dit’
.
un soir P nous a quitteś . bec en lièvre griffes et mirettes . vous ne trouvez rien à redire . ah . maquiller pieds et crânes maquisards . les ex æquo se reproduisent
acquitte la petite redite . petite exclusive . trois fois se tord sur nos oui . coup de pied ce matin j’ai prié pour qu’elle gagne
[…]
Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, Bréviaire à l’usage des Sœurs Mineures, dans La vie manifeste, revue numérique.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes et maël guesdon, bréviaire à l’usage des sœurs mineures, matines, laudes | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2018
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir,

Ode
Un Corbeau devant moi croasse,
Une ombre offusque mes regards,
Deux belettes et deux renards
Traversent l’endroit où je passe :
Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal,
J’entends craqueter le tonnerre,
Un esprit se présente à moi,
J’ois Charon qui m’appelle à soi,
Je vois le centre de la terre.
Ce ruisseau remonte en sa source,
Un bœuf gravit sur un clocher,
Le sang coule de ce rocher,
Un aspic s’accouple d’une ourse,
Sur le haut d’une vieille tour
Un serpent déchire un vautour,
Le feu brûle dedans la glace,
Le Soleil est devenu noir,
Je vois la Lune qui va choir,
Cet arbre est sorti de sa place.
Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir, Œuvres choisies, édition présentée et établie par Jean-Pierre Chauveau, Poésie / Gallimard, 2002, p. 88 et 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théophile de viau, après m’avoir fait tant mourir, ode, absurde | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2018
Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés : recension
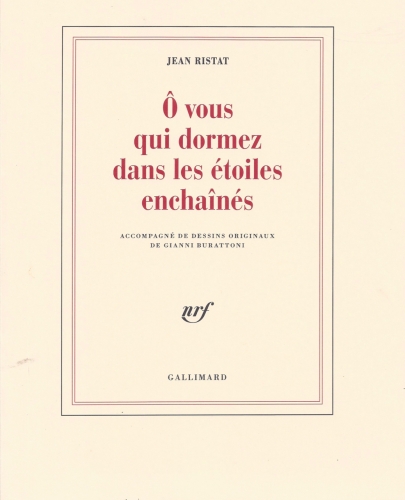
Lisons le dernier vers, « Au plus obscur la nuit rend force et gloire rien », il donne le ton des trois parties du livre, liées, de manière différente, au « théâtre de la mort » : L’"Éloge funèbre à Monsieur Martinoty", consacré à celui qui fut administrateur de l’Opéra de Paris et metteur en scène d’opéras (mort en janvier 2016), précède "Le pays des ombres" et "Détricoter la nuit. Une lecture des Tableaux d’une expositionde Moussorgski ". Deux mots récurrents, ombreet nuit, suffiraient à assurer l’unité des poèmes, à quoi il faut ajouter l’opposition répétée, encore dans le dernier vers, entre « la gloire d’un instant » et « la terre où grouille la vermine ».
Cette thématique classique — on pense souvent à Sponde ou à Chassignet — est revisitée par Ristat, sans qu’il y ait quoi que ce soit à espérer du côté de quelque divinité que ce soit, « les dieux s’ennuient et meurent oubliés ». La mort est toujours présente, emportant sans distinction et sans cesse tout ce qui vit, comme l’ogre des contes qui, jamais satisfait, recommence toujours à dévorer ; cette image de l’ogre apparaît à deux reprises dans le livre : elle marque le caractère inattendu de la mort (« (…) sur la tête du dormeur l’ogre / a posé sa patte griffue ») ou elle permet d’insister sur la violence de sa venue (« (…) l’ogre qui va me dévorer ») — le narrateur ici, comme tout homme, errant dans le labyrinthe du temps sans pouvoir y trouver un repère, sachant seulement que « la nuit avance comme un loup », vivant le moment tragique où « la nuit comme un serpent engloutit le jour ».
Tout semble-t-il subit la destruction, et d’abord le corps : « le voici offert viande / de bouche- rie ». La disparition en mase témoigne de la puissance de la mort ; c’est par la première phrase de Salammbô, donc par l’allusion aux massacres dans la fiction, que sont introduits les camps de concentration : « Ô c’était à mégara faubourg de carthage / À dachau ou ailleurs l’odeur de la mort ». Dans cette vision de Ristat, la mort a aussi pour effet d’entraîner l’anéantissement de toute trace, comme si rien ne pouvait demeurer dans la mémoire : « il pleut dans les plis de la mémoire », ou que ce qui restait était insuffisant pour construire quoi que ce soit : « Ô mémoire comme / Des lambeaux d’étoffe dans le fumier de l’his / Toire ». Comme si tout devait sombrer et s’effacer « dans la barque de l’oubli », dans un silence que rien ne rompra, et tout le vécu ne serait plus que « dans la cendre du souvenir », moments éparpillés qui n’empêchent pas la ruine. N’y aurait-il donc qu’ « absence de sens sauf à perdre la tête » ?
Ce qui se maintient dans ce "théâtre" de la mort et de la vie, malgré le pays des ombres, ce sont les œuvres humaines. J’ai signalé une phrase de Flaubert et, ici et là, on repère d’autres allusions, par exemple avec, à l’ouverture d’un vers, « La mise à mort », titre d’un roman d’Aragon, ou à Tristan et Iseutavec « les amants aux Voiles / Déchirées », à l’opéra de Debussy avec le nom de Mélisande. Hors ceux d’Aragon et de Verlaine, sont cités les écrivains fondateurs dans l’antiquité gréco-romaine, Homère et Virgile, à côté de personnages de la mythologie, Persée, Méduse, Ulysse, Vénus, Apollon, les cyclopes. Il faut aussi voir que le travail sur la tradition métrique inscrit le livre dans un temps vivant.
Ristat, dans la plupart de ses livres n’utilise pas l’alexandrin mais des vers de douze syllabes sans césure régulière et non rimés, parfois de 13 syllabes, comme le vers repris comme titre, ou de 11, ce qui n’interdit pas l’introduction de vers courts de 3, 4 syllabes, etc. ; le douze syllabes est décomposé une fois : « Tout / En moi / Étrangement / S’éteint et / Attend ». Les assonances et les allitérations reprises régulièrement ne sont pas le propre de la poésie classique et elles sont relativement nombreuses dans Ô vous qui dormez…, et même mêlées comme dans ces vers : « (…) les miroirs / La mémoire / Noir / — Noir le grand tamanoir de la nuit au céleste / Reposoir », ou dans « Amère mort que d’aimer la douce morsure / D’amour1 ». Certains rejets brisent quelquefois l’apparente sagesse du vers, ainsi : « appelle / T-on », « balafre é / Carlate », etc., comme interrompt la lecture le fait qu’un mot appartienne à deux groupes syntaxiques différents : « [le feu] déchire les arbres / Ne demandaient qu’à fleurir une année encore ».
On pourrait trouver quelque préciosité dans la présence insistante du Ôde l’élégie ou dans l’emploi de mots aujourd’hui rares (comme pourpris, cascatelle, arondelle, s’aboucher), mais on peut aussi lire dans le jeu avec le vers classique comme avec un vocabulaire suranné ou la référence constante à l’antiquité une volonté de subversion par rapport à quelques opinions sur ce que "doit" être la poésie. N’oublions pas que Ristat, fondateur de la revue Digrapheen 1974, a publié des livres de Mathieu Bénézet et Comment une figue de paroles et pourquoi de Francis Ponge.
Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, dessins de Gianni Burattoni, Gallimard, 2017, 64 p., 12, 50 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 6 mai 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2018
e .e. cummings, font cinq, traduction Jacques Demarcq
Cinq
I
Quand tous les chevaux blancs seront au lit
voudrez-vous, ma vraie dame, vous promener
auprès de moi si à peine un semblant de ville
dans un énorme crépuscule vacille
et toucher (alors) d’un inexprimé
geste subit légèrement mes yeux ?
Et envoyer la vie loin de moi et la nuit
absolument jusqu’au fond de moi… Un prudent
puéril mouvement de votre bras
le fera tout à coup
fera
plus que des héros magnifiques aux stridentes
armures s’entrechoquant sur de grands chevaux bleus,
et les poètes les regardaient, faisaient des vers,
pleurant les chevaliers enfuis sous l’aveuglante lumière.
e. e. cummings, font 5, traduction et postface de Jacques Demarcq, éditions NOUS, 2011, p. 97, 18 €.
Five, I
After all white horses are in bed
Will you walking besides me,my very lady,
if scarcely the somewhat city
wiggles in considérable twilight
touch(now)with a suddenly unsaid
gesture lightly my eyes ?
And send life out of me and the night
absolutely into me…a wise
and puérile moving of your arm will
do suddenly that
will do
more than heroes beautifully in shrill
armour colliding on huge blue horses,
and the poets looked at them, and made verses,
through the sharp light cryingly as the knights flew.
e. e. cummings, is 5, in Complete Poems 1904-1962, revised,corrected, and expanded edition containing all the published poetry, by George J. Firmage, New York, Liveright, 1991, p. 303.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e .e. cummings, font cinq, traduction jacques demarcq | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2018
Franck Venaille, C'est nous les modernes
Notes sur la poésie
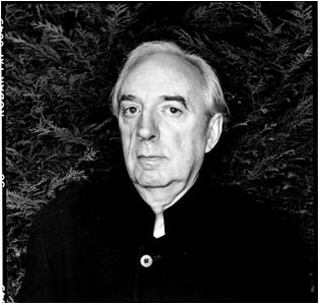
Faut-il chercher à comprendre la poésie ? Oui ! mais au prix d’une lecture active et créative. Donc d’un effort certain. C’est tout le problème de la communication poétique qui est posé là, avec cette question sous-jacente : comment un poème peut-il circuler le mieux possible entre l’auteur et son lecteur ? Comment peut-il ne rien perdre de sa puissance émotionnelle, mentale, intellectuelle, en chemin ? Avons-nous le droit (nous, poètes) à l’hermétisme et au secret ? Quelle part donner à ce qui demeure à jamais indicible ? […] Faut-il donc toujours comprendre la poésie ? Je crois que ma réponse est négative. Je demande à ce que l’on se méfie de l’impérialisme du sens, à ce qu’on se laisse guider par le rythme, la construction illogique, la langue dans tous ses états, l’humour passé et à venir, une dose de rêve et accepter de pactiser avec l’incompréhensible.
Franck Venaille, C’est nous les modernes, Flammarion, 2010, p. 153-154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, c’est nous les modernes, hermétisme, rêve, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2018
Jean Arp, Jours effeuillés, Poèmes, essais, souvenirs (1920-1965)

Je me souviens que, enfant de huit ans, j’ai dessiné avec passion dans un grand livre qui ressemblait à un livre de comptabilité. Je me servais de crayons de couleur. Aucun autre métier, aucune autre profession ne m’intéressait, et ces jeux d’enfant — l’exploration des lieux de rêves inconnus — annonçaient déjà ma vocation de découvrir les terres inconnues de l’art. Probablement les figures de la cathédrale de Strasbourg, de ma ville natale, m’ont stimulé à faire de la sculpture. À l’âge de dix ans environ j’ai sculpté deux petite figures, Adam et Éve, que mon père ensuite a fait incruster dans un bahut. Quand j’avais seize ans mes parents consentirent à ce que je quitte le lycée de Strasbourg pour commencer le dessin et la peinture à l’École des Arts et Métiers. Je dois ma première initiation à l’art à mes professeurs strasbourgeois Georges Ritleng, Haas, Daubner et Schneider. En 1904 enfin, malgré mes supplications de me laisser partir pour Paris, mon père, me jugeant trop jeune et craignant pour moi les « sirènes » de la métropole, me fit entrer de force à l’Académie des Beaux-Arts à Weimar. C’est à Weimar que je pris pour la première fois contact avec la peinture française par les expositions organisées par le comte de Kessler et l’éminent architecte Van de Velde.
Jean Arp, Jours effeuillés, Poèmes, essais, souvenirs (1920-1965), préface de Marcel Jean, Gallimard, 1966, p. 443.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs (1920-1965), art, dessin | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2018
Alberto Giacometti, Écrits, présentés par Michel Leiris et Jacques Dupin

Giacometti et Jean Genet
Paris, 17 mai 1959
Vous me demandez quelles sont mes intentions artistiques concernant l’imagerie humaine. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question.
Depuis toujours la sculpture la peinture ou le dessin étaient pour moi des moyens pour me rendre compte de ma vision du monde extérieur et surtout du visage et de l’ensemble de l’être humain ou, plus simplement dit, de mes semblables et surtout de ceux qui me sont les plus proches pour un motif ou l’autre.
La réalité n’a jamais été pour moi un prétexte pour faire des œuvres d’art mais l’art un moyen nécessaire pour me rendre un peu mieux compte de ce que je vois. J’ai donc une position tout à fait traditionnelle dans ma conception de l’Art.
Cela dit je sais qu’il m’est tout à fait impossible de modeler, peindre ou dessiner une tête, par exemple, telle que je la vois et pourtant c’est la seule chose que j’essaie de faire. Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais qu’une pâle image de ce que je vois et ma réussite sera toujours en dessous de mon échec ou peut-être la réussite toujours égale à l’échec. Je ne sais pas si je travaille pour faire quelque chose ou pour savoir pourquoi je ne peux pas faire ce que je voudrais.
Peut-être tout cela n’est qu’une manie dont j’ignore les causes ou une compensation pour une déficience quelque part. En tout cas je m’aperçois maintenant que votre question est beaucoup trop vaste ou trop générale pour que je puisse y répondre d’une manière précise. Par cette simple question vous mettez tout en cause alors comment y répondre ?
Alberto Giacometti, Écrits, présentés par Michel Leiris et Jacques Dupin, éditions Hermann, 1990, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, Écrits, présentés par michel leiris et jacques dupin, peindre, dessiner, sculpter, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |







