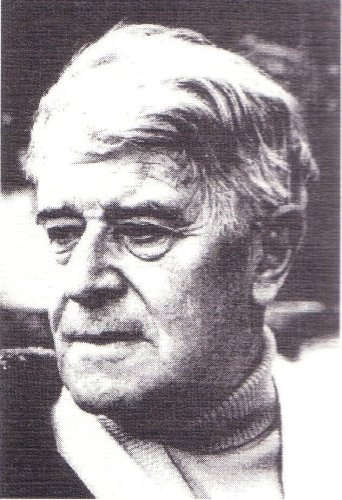22/06/2018
Pascal Quignard, Vie secrète
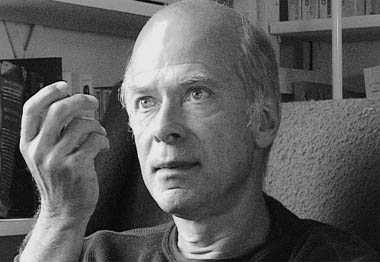
La question que pose l'amour humain — au contraire de l'opportunisme de la violence sexuelle — ne tient pas au choix préférentiel, à la possessivité, à la durée du lieu, à l'exclusivité de ce choix devant tout autre occasion (attachement monogame et fidélité).
Définir ainsi l'amour est préhumain. Cette conjonction se retrouve chez les primates, chez les oiseaux et elle est liée à la fidélisation et au nourrissage.
La question doit porter sur le choix préférentiel (mais préférentiel à l'égard du social, à l'égard de tous les autres liens sociaux qui peuvent se présenter).
L'amour qui naît dans la fascination meurtrière involontaire, meurtrière dans la faim, meurtrière de l'un de ses deux membres, meurtrière de la société du moins dans ses règles d'échange entre les clans et dans l'étagement temporel de la généalogie, désunanimise l'unité commune à chaque famille, décollectivise le groupe. Ce qu'il y a de touchant dans le mythe qui concerne Pâris (qui est le héros grec de ce qu'il en est des choix préférentiels dans l'amour : son jugement est invoqué par les hommes après avoir été mendié par les déesses), c'est que c'est un enfant rejeté, exposé, asocialisé, voué à la mort par la société dont son père est le roi. C'est l'asocialisé qui choisit le lien asocial (à ceci près que la guerre, au contraire de ce que voulaient croire les anciens Grecs, est la plus sociale des activités humaines).
La chasse au congénère jusqu'à la mort est le propre des sociétés humaines.
Les sociétés humaines sont les seules sociétés animales où la mort du congénère ne soit pas inhibée.
Pascal Quignard, Vie secrète, Folio / Gallimard, 1999 [1998], p. 244-245.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, vie secrète, amour humain, social société | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2018
Jules Renard, Journal

Éloge funèbre. La moitié de ça lui aurait suffi de son vivant.
On se fait des ennemis. Avait-on des amis ?
Le monde serait heureux s'il était renversé.
Un homme qui aurait absolument nettela vision du néant se tuerait tout de suite.
À considérer les appétits bourgeois, je me sens capable de me passer de tout.
Je ne tiens pas plus à la qualité qu'à la quantité des lecteurs.
Les hommes naissent égaux. Dès le lendemain, ils ne le sont plus.
Écrire pour quelqu'un, c'est comme écrire à quelqu'un : on se croit tout de suite obligé de mentir.
Il faut vivre pour écrire, et non pas écrire pour vivre.
Mon ignorance et l'aveu de mon ignorance, voilà le plus clair de mon originalité.
Jules Renard, Journal, édition Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 1094, 1114, 1118, 1119, 1124, 1128, 1132, 1151, 1164.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, critique, bourgeoisie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2018
Brigitte Mouchet, et qui hante

ici ne repose pas
Il arrive parfois, traversant la campagne, qu’un appel – mais – rien – le silence, un vague crissement, il s’est passé quelque chose. On marche dans les bois. Le soir on rentre.
On peut les rencontrer — d’abord quelques-uns, compagnons — et des enfants — ils sont partis — à qui on a tranché la langue — parfois une ombre arpente la campagne, semble se pencher pour passer — mais rien.
Les odeurs des ronces. Quelque chose s’agrippe, serre les poings. Quelque chose — ils ont tenté de passer. Ils se sont abîmés avec les pierres, les genêts au soleil. Et la nuit des lumières balaient — quelqu’un ? — un bosquet hérissé, accroché, quelqu’un reste immobile, quelque chose.
[…]
Brigitte Mouchet, Et qui hante, isabelle sauvage, 2018, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brigitte mouchet, et qui hante, rien ne repose, appel, silence, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2018
Paul Celan, La rose de personne

Kolon
Dans la lumière des vigiles
des mots aucune main
gagnée par errance
Mais toi, gagnée par sommeil, toujours,
vraie de langue dans chacune
des pauses ;
à quel prix
de divorcé d’ensemble
le prépares-tu pour un nouveau départ :
le lit mémoire !
Sens, nous gisons
blancs d’une multi-
couleur, mille-
bouches à force de
vent-du-temos, souffle-année, cœur-jamais.
Paul Celan, La rose de personne, traduction Martine Broda, Le Nouveau Commerce, 1979, p. 107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne, kolon, langue, sens, martine broda | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2018
Norge, Le stupéfait
Tout tout
Je voulais tout et quand j’eus tout,
– Mais savez-vous planter des choux ?
J’eus tout et je ne sus qu’en faire
– À la mode de chez nous
Ce tout-là, ce n’était qu’enfer.
T’en as déjà trop dit, Prosper,
Tu ferais mieux de nous servir
Quelque chose qui désaltère
Au lieu de pousser des soupirs.
… Mais savez-vous planter des choux ?
T’en as déjà trop dit, Prosper,
Et t’aurais mieux fait de te taire
Et de boire encore un bon coup
Au lieu de pousser des glouglous
À la mode de chez nous !
Norge, Le stupéfait, Gallimard, 1988, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, le stupéfait, tout, chanson, enfer soupir, se taire | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2018
Lionel Ray, Les métamorphoses du biographe

la dernière nuit
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La dernière nuit on disait encore « c’est tout simple »
sans protester on poussait sa charrette sur un
carreau où l’œil nu s’effondre brusquement on sait
pour quelques instants s’appuyer à tous les zincs
avec la faune des écaillers et ça plaisante
hors du domaine public sans habillement
les maraudeuses entre les cageots déracinées
de l’Étoile avaient le visage en sang
Les marginaux assis n’étaient plus sûrs de rien
Toutefois les pieds énormes feront plus loin des rondes
On verra tout est prêt la rue de Carpentras
L’allée de la Cossonnerie neuf bâtiments
Pour les fruits et légumes sans aucune tradition
Mais les camions du négoce ne quitteront pas
La rue Rambuteau sans la grosse Germaine qui
« Travaille pas nous autres seul’ment sur les touristes »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lionel Ray, Les métamorphoses du biographe, Gallimard, 1971, p. 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lionel ray, les métamorphoses du biographe, la dernière nuit, les halles | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2018
Wislawa Szymborska (1923-2012), De la mort sans exagérer

Photographie de la foule
Sur la photo de la foule
ma tête septième à droite,
ou alors quatrième à gauche,
ou alors vingtième en partant du bas.
ma tête, je ne sais laquelle,
plus toute seule, plus unique,
déjà pareille aux semblables,
pas plus mâle que femelle ;
les signes qu’elle m’envoie
pas particuliers du tout ;
si l’Esprit du Temps la voit,
il ne la regarde pas ;
ma tête toute statistique,
consommant acier et câble,
globalement, paisiblement,
sans honte d’être quelconque,
sans chagrin d’être interchangeable ;
comme si je ne l’avais guère
pour moi, et à ma manière ;
comme dans un cimetière antique
plein de crânes anonymes,
tous assez bien conservés
malgré leur mortalité ;
comme si elle y était déjà,
pas à moi, universelle ;
où, si elle peut se souvenir,
c’est de son profond avenir.
Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer,
traduction du polonais Piotr Kaminski,
Poésie / Gallimard, 2018, p. 118-119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wislawa szymborska (1923-2012), de la mort sans exagérer, photographie de la foule | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2018
Pierre Mabille, C'est cadeau : recension
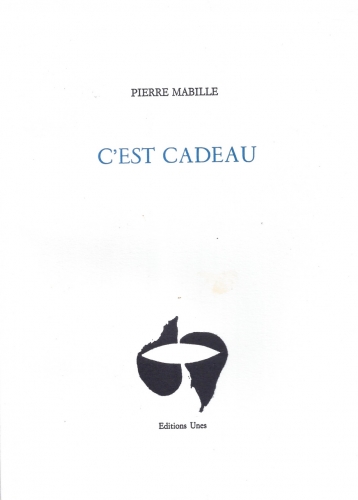
C’est cadeaucomprend deux formes différentes de poèmes, 29 en vers presque toujours courts, 5 beaucoup plus amples écrits, comme le note en avant texte l’éditeur, à partir d’un motif récurrent. Le poème d’ouverture, bref, reprend sous plusieurs formes la séquence « certaines petites choses » : elle se transforme en « certaines / petites choses », puis « certaine / petites / choses ». Les textes plus développés sont construits sur l’énumération, avec une entrée comme « Tout ce qui est à moi » ou « mon poème », ou « mon côté », suivie d’un nom (ou de plusieurs noms, d’un nom qualifié, etc.) ; les noms sont donnés selon l’ordre alphabétique ou l’ordre inverse (de Z à A) comme dans le premier poème de ce type. L’ensemble (donc 26 groupes) s’achève par une formule pour signifier l’abandon des biens désignés — « tout ce qui est à moi / je t’en fais don je te le / donne », « C K DO », etc.
Les listes rassemblent des éléments hétérogènes et un certain humour naît de leur juxtaposition, ainsi : « tout ce qui est à moi mon ordi mon oreiller mon outil mon outillage mon nœud pap mon nuancier mon numéro gagnant ». Pourtant, l’abondance des mots liés à la vie d’aujourd’hui telle que la société consumériste l’impose plus ou moins, oriente parallèlement vers une lecture critique. Ce qui semble n’être qu’un fatras devient en partie un miroir des habitudes courantes, le « mon » renvoie à l’individu qui énumère ce qu’il considère être ses possessions, dans un monde de l’avoir ; on lit au fil d’un poème « mon troisième téléphone mobile », puis « mon quatrième téléphone mobile », avant le premier et le deuxième, puisqu’il faut suivre ici l’ordre Z ®A… Si une partie des objets énumérés distingue une classe sociale restreinte (« mon yacht », « mon avion », par exemple), la plupart est propre au plus grand nombre : sont notés ce que la publicité incite, à un moment donné, à acheter sous peine de "n’être pas de son temps", « t shirt ACDC, t shirt David Bowie t shirt Neil Young, t shirt Virgin Megastore », « Laguiole, Leatherman », etc., sans oublier le zippo.
Il ne faut pas exclure la part de jeu dans ces listes. On y relève notamment des allusions à des chansons (« mon truc en plumes », « mon beau sapin », « mon p’tit quinquin »), à Baudelaire (« mon enfant ma sœur »), à un livre de Michaux (« l’espace du dedans »), et même au premier poème du livre avec « mon poème sur certaines petites choses ». N’oublions pas le jeu culturel avec « mon premier livre de Donald Westlake mon premier livre de Pierre Reverdy ». Plus nombreux sont les jeux avec la langue qui reposent sur l’homophonie (mon nom / mon non), sur la possibilité de construire un mot en ajoutant une syllabe à un autre mot (mou / mouillé ; pass / passeport), en changeant une lettre (vertige, vestige) ou un son (mon blaze/ mon blues ; mon creux / mon cri).
Si les listes sont absentes des poèmes courts, presque tous de forme strophique, on rencontre dans deux poèmes plusieurs vers débutant par un infinitif. Le lien avec les poèmes longs est ailleurs, dans l’attention portée à la vie de l’individu — ici, un "je" — dans la société, notamment à sa solitude. Ainsi, le parcours de la ville dans un bus, le nez collé à une vitre, donne l’illusion d’être derrière une caméra et « personne pour dire / arrête ton cinéma », il n’empêche que, pourtant, « je suis reflet fugitif / éclair doré dans ». Ce qui apparaît souvent, c’est la difficulté d’exprimer des sentiments ; le corps parle dans l’étreinte, sans doute, mais « le mot manque » pour aller au-delà des gestes, « comment te dire / quoi te dire oh ». Même quand la présence de l’autre laisse imaginer une histoire à construire, à raconter — « un récit avec un début / tout le tralala / et une fin » — rien ne se développe, comme si la distance entre désir et réalité était infranchissable, toujours vécue avec un « peut-être ». Quelle issue ?
"Largué", au titre évocateur, reprend un alexandrin d’un poème d’Apollinaire, "Mai", en le transformant : « Le mai le joli mai en barque sur le Rhin » devient « Le mai le joli mai en vélo / bords de marne » ; à l’évocation mélancolique d’un amour ancien fait place le rejet de ce qui symbolise l’intégration dans la société, la connexion permanente et l’argent, avec « le smartphone et le portefeuille ». Les deux objets sont abandonnés dans un fossé avec le vélo, puis c’est le tour du sac, et le narrateur lui-même « se sent largué ce soir » : aucun espoir dans la nuit venue ; alors que les ruines du poème d’Apollinaire étaient parées par le joli mai « De lierre de vigne vierge et de rosiers », ici rien ne peut changer. D’ailleurs plusieurs poèmes reprennent le motif des inégalités sociales (« l’égalité excuse-moi / on l’a pas vu passer ») : elles se maintiennent et restent les images des écrans qui fascinent.
L’amour, quand il est évoqué, semble toujours avoir été connu dans le passé — « ton souvenir en moi / valse dans l’air du soir » ; relisons cependant une déclaration à l’aimée, pudique puisqu’elle passe par une citation
tu es si belle qu’il se met
à pleuvoir écrivait brautigan
Relisons aussi le poème "Aujourd’hui" où le mot « tendre », entre deux strophes, est commenté :
« c’est bien le mot / à isoler afin de / libérer toute sa douceur / et faire voler toutes / ses flèches ». "Aujourd’hui", donc, « n’est pas un poème », mais Pierre Mabille, en isolant un mot chargé de connotations positives, établit un lien avec les poèmes de listes tous présentés comme des dons. Cet avant-dernier poème est suivi d’un adieu au lecteur ; construit avec pour départ la formule finale des lettres administratives, « Je vous prie de », il y a plusieurs essais pour sortir, aucun ne convient parce que la déférence n’est vraiment pas de mise. Alors quel mot final ? « et merde ». Oui, c’est cadeauest à offrir.
Pierre Mabille, C’est cadeau, éditions Unes, 2018, 88 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 mai 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre mabille, c’est cadeau, répétition, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2018
Christiane Veschambre, Ils dorment

Ils dorment.
Leurs corps reposent l’un contre l’autre, l’un dans la présence de l’autre.
Lui ouvre les yeux, tend un bras vers un bracelet montre posé sur la table de chevet.
Il l’approche, avec lui on lit l’heure sur le cadran 6h ¼.
Il lève doucement le drap, il est en tee-chirt et caleçon, il se tourne vers elle qui dort, la regarde, l’effleure, un fable son incertain sort de sa bouche fermée. Il se lève.
Il est à la table de la cuisine. La cuillère prend dans le bol les céréales en forme de petits anneaux. Sa main tient la cuillère. Il voit sur la table la petite boîte d’allumettes.
Il est dehors. Il marche, il est habillé d’une combinaison de travail dont j’ai oublié la couleur. Il tient à la main une sorte de petite mallette semi-sphérique. Il longe des bâtiments de brique. Il tourne à l’angle, sous un porche.
Il est assis au volant d’un autobus à l’arrêt, vide, porte ouverte. Il écrit sur un petit carnet posé sur le volant. On approche de la page et on peut lire ce qu’il y écrit. On le lit aussi en bas à gauche de l’écran. C’est un poème qui dit la petite boîte d’allumettes, le dessin des mots sur son couvercle.
[…]
Christiane Veschambre, Ils dorment, L’Antichambre du Préau, 2017, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, ils dorment, chambre, couple, sommeil, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2018
Inger Christensen, La Vallée des papillons

Éphémères visions des regrettés défunts,
le papillon de l’aubépine qui plane
comme un nuage blanc teinté de traces
de bouquets rouges tissés par la lumière,
grand-mère au jardin qu’enlacent les milliers
de bras des giroflées, asters et gypsophiles,
mon père qui m’enseigna les premiers noms
de ce qui doit ramper avant de disparaître
pénètrent avec moi dans la vallée des papillons
où tout n’existe que de ce côté, où même
les morts entendent le rossignol, son chant
possède une pulsation étrange, mélancolique
qui va de la souffrance à la souffrance,
mon oreille répond d’un tintement secret.
Inger Christense, La Vallée des papillons, traduction du danois Karl et Janine Poulsen, Rehauts, 2018, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inger christense, la vallée des papillons, grand-mère, mélancolie, rossignol | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2018
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau,5
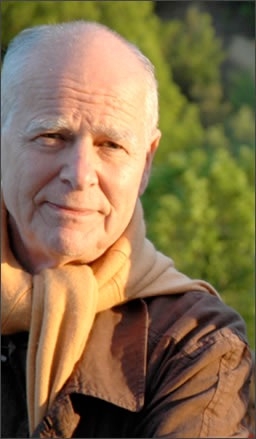
Histoire de la perdrix
Prologue
Les choses ne sont pas ce que les mots produisent. Elles émergent de ce qu'ils séparent. Elles deviennent visibles, visibles et nues, comme elles ne le sont pas elles-mêmes. Visibles après le bain. Issues de l'ombre positive d ela langue, de l'implacable et lumineux glissement de sa négativité.
Cette ombre pour respirer. Cette ombre pour plonger.
Survie phrasique jusque dans l'extrême nuance opaque du poème. Lecture sans le moindre émouvante - ou bien molle, injuste, sans le moindre tranchant.
Voici la découpe où je vis : l'emporte pièce, autant de bandes, brunes jaunes. Adorable limaille.
Et vivable vraiment la présence due aux mots ; sans eux on n'échapperait pas à la chaotique filature du temps ni à la puissance de l'instant laissé à lui-même — seuls les animaux y excellent.
Pierre parmi les pierres. Foin dans le foin, j'écris le maquillage de la perdrix.
Je déracine et brandis son théâtre d'un bloc. Sa brûlure n'est pas extatique, mais douloureuse comme la totalité.
Une précipitation d'apparence.
Une explosion de perdrix pierreuse.
Le théâtre est clos ; à l'intérieur, la ressemblance est infinie.
[...]
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 57-58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, cinq, histoire de la perdrix | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2018
Joseph Joubert, Carnets, I

Le seul moyen d'avoir des amis, c'est de tout jeter par les fenêtres, de n'enfermer rien et de ne jamais savoir où l'on couchera le soir.
On ne devrait écrire ce qu'on sent qu'après un long repos de l'âme. Il ne faut pas s'exprimer comme on sent, mais comme on se souvient.
Enseigner, c'est apprendre deux fois.
Ceux qui n'ont à s'occuper ni de leurs plaisirs ni de leurs besoins sont à plaindre.
Les enfants veulent toujours regarder derrière les miroirs.
Aux médiocres il faut des livres médiocres.
Les uns disent bâton merdeux, les autres fagot d'épines.
L'un aime à dire ce qu'il sait, l'autre à dire ce qu'il pense.
Évitez d'acheter un livre fermé.
Ce monde me paraît un tourbillon habité par un peuple à qui la tête tourne.
Joseph Joubert, Carnets, I, textes recueillis par André Beaunier, Gallimard, 1994 [1938], p. 73, 79, 143, 143, 161, 165, 172, 176, 183, 183, 211.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2018
Geoffrey Squires, Silhouettes

Eau grise
une petite butte d’arbres
à quoi penses-tu on
ne peut pas demander ça
c’est si bien d’être à l’écart de tout le monde
le doux champ de son ventre
fragile chaleur d’été
juste naturel
Grey water
a little spit of trees
what are you thinking
not allowed to sak that
how nice to be away from anywhere
the soft fiel of her belly
frail summer heat
only natural
Geofrey Squires, Silhouettes, traduction
François Heusbourg,Unes, 2018, p. 21 et 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geofrey squires, silhouettes, françois heusbourg, écart, ventre, été | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2018
Anise Koltz, Galaxies intérieures

Dès notre naissance
nous avons flairé le sang
Les images du déluge
tapissent encore
notre mémoire
Nous marchons sans repères
suspendus au monde
par une épingle de sûreté
Anise Koltz, Galaxies intérieures,
Arfuyen, 2013, p. 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, galaxies intérieures, mémoire, déluge, repère | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2018
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme
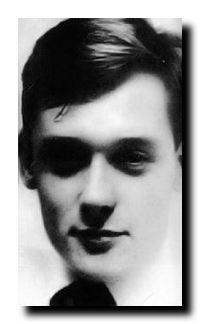
L’heure est dite d’abois
L’heure est dite d’abois dans les arrière-cours
Et de guenilles en sanglots sur les cordes du jour
Par le travers des lampes nues dans l’ombre noire
O reflet malingre d’un vieil été mémoire
D’un soleil en cendres sous les mains dans la nuit
Passé l’orgue de Barbarie où le temps bruit
Le malaise d’un chien la valise d’une âme
Emplie d’herbe lointaine et de cheveux de femme
Accoudé sur la table le ciel venu m’aider
À compte recompter feuilles mortes accoudé
Sur la table tremblante au fond d’auberges vides
Avec autour d émoi pas mal de chopes vides
Eh bien devines-tu j’en ai fini de mon espoir
À jamais je suis seul dans mon amour ce soir
Dans l’aube de la vie les montagnes de lumière
Aspiré par des tourmentes d’étoiles très claires
Au-dessus d’une transparente ornée de vergers bleus
Eclaboussant d’oiseaux qui sont comme tes yeux
Jusqu’à la cime la plus blanche le fol érable
Et ne viens pas me joindre au bord de cette table
Je n’y suis plus je suis parmi les neiges du futur
Pourtant je t’y attends tête tombée fruit mûr
Dans le bois mort de cette table où d’humides années
J’entends la pluie rouler ses renoncules piétinées.
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d’abîme, Le Chemin,
Gallimard, 1965, p. 12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, juste retour d’abîme, l'heure est dite d'abois | ![]() Facebook |
Facebook |