23/02/2018
Giorgio Manganelli, Amour

[L’Amour]
A. Ainsi deviserons-nous de l’amour.
B. Et d’opportune manière, puisque discourant sur la vertu, la mort, la fuite, l’abolition de l’être, nus avons toujours et uniquement parlé de solitudes, d’abstractions et, même en dialoguant, nous ne sommes en fait jamais sortis du monologue.
A. Tandis que l’amour est mouvement de l’âme, qui exige un destinataire
B. C’est aussi mon avis.
A. Bref, en amour nous aurons un amant et un aimé.
B. Qui aime doit aimer quelque chose.
A. Quelque chose qui existe ? Ou d’aventure serait-il possible d’aimer ce qui n’existe pas ?
B. Quelque chose qui existe, je présume.
A. Une chose aimée, existante, mais aussi, puis-je supposer, distincte, jamais confondue avec qui aime.
B. Bien entendu, constamment distincte.
A. Dans tous les cas ?
B. Assurément, dans tous les cas.
A. Et, à ton avis, la dignité de l’amour réside davantage en celui qui aime, ou en celui qui est aimé ?
B. En celui qui aime, je crois ; ce dernier souffre, médite, s’acharne, s’agite, s’inquiète, il est noctambule et insomniaque, se méprend et ne voit pas ; bref, s’il n’était là pour aimer, quelle condition pourrait bien échoir à l’objet d’amour ? Si l’amour ne le touchait, ce ne serait que pauvre chose, à tous égards semblable à d’autres possibles objets d’amour, qui en aucun cas n’échappent à leur solitude.
A. Ainsi affirmes-tu que le dignité de l’amour, voire l’amour lui-même, sont privilège de l’amant.
B. Tout à fait.
A. Mais penses-tu que l’amant puisse destiner son amour à n’importe quel objet ? J’entends : est-il indifférent à la beauté, la sagesse, la grâce et le gloire ? Peut-il aimer toute chose, même minuscule et inanimée ?
B. Certes non ; l’amant aimera une chose non dénuée de grâce, pourvue d’un je-ne-sais-quoi, une parfaite douceur, de la noblesse.
A. Donc, l’objet aimé n’est pas étranger ou indifférent à ce mouvement de l’âme que nous appelons « amour ».
B. Non, assurément.
A. Et si l’amant aimait une chose d’une totale inconvenance, un homme de lettres mettons, un mathématicien épris d’un singe, un hérisson, une lame rouillée, verrions-nous encore en lui le dépositaire de la dignité de l’amour.
B. Il pourrait l’être, mais sa dignité serait profondément frustrée par le choix malheureux de son amour.
A. Donc, si je comprends bien, qui aime doit aimer un objet convenable ; s’il lui échoit au contraire d’aimer une chose inconvenante, il est alors dépossédé de la la dignité de l’amour.
[…]
Giorgio Manganelli, Amour, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Denoël, 1986, p. 103-105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, jean-baptiste para, dignité, beauté, convenance, dialogue | ![]() Facebook |
Facebook |
22/02/2018
Laure, Écrits

Je le sens bien maintenant : « mon devoir m'est remis » lequel exactement ?
C'est parfois si lourd et si dur que je voudrais courir dans la campagne.
Nager dans la rivière
oublier tout ce qui fut, oublier l'enfance sordide et timorée, le vendredi Saint, le mercredi des cendres,
l'enfance tout endeuillée à odeur de crêpe et de naphtaline.
L'adolescence hâve et tourmentée.
Les mains d'anémiée.
Oublier le Sublime et l'infâme
Les gestes hiératiques
Les grimaces démoniaques.
Oublier
Tout élan falsifié
Tout espoir étouffé
Ce goût de cendres
Oublier qu'à vouloir tout
on ne peut rien
Vivre enfin
« Ni tourmentante
Ni tourmentée »
Remonter le cours des fleuves
Retrouver les sources des montagnes
les femmes les vrais hommes travailleurs
qui enfantent
moissonnant
M'étendre dans les prairies
Quitter ce climat
Ses dunes, ses landes sablonneuses, cette grisaille et ses déserts artificiels,
Ce désespoir dont on fait vertu,
Ce désespoir qui se boit
se sirote à la terrasse des cafés
s'édite... et ne demanderait qu'à nourrir très bien son homme
Vivre enfin
Sans s'accuser
ni se justifier
Victime
ou coupable
Comment dire ?
Un tremblement de terre m'a dévastée
On t'a mordu l'âme
Enfant !
Et ces cris et ces plaintes
Et cette faiblesse native
Oui —
Et s'ils ont vu mes larmes
Que ma tête s'enfonce
jusqu'à toucher
le bois
et la terre.
Écrits de Laure, précédé de Ma mère diagonale de Jérôme Peignot, avec une "vie de Laure" par Georges Bataille, Pauvert, 1971, p. 227-229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, jérôme peignot, georges bataille | ![]() Facebook |
Facebook |
21/02/2018
Fabienne Raphoz, Parce que l'oiseau (recension)
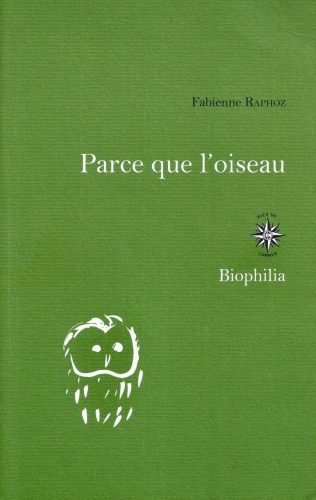
Un exercice de jubilation
Même si Fabienne Raphoz distingue fort bien de nombreuses espèces d’oiseaux par leurs cris ou leur apparence, même si un enregistreur et la paire de jumelles ne la quittent guère dans ses promenades, dans ses voyages en Afrique ou en Amérique, elle ne se voit pas autrement que comme une ornithophile, donc comme « celle qui aime les oiseaux », et la page de titre précise, après Parce que l’oiseau, « Carnets d’été d’une ornithophile » — extension de l’emploi d’un mot qui qualifie des plantes pollinisées par des oiseaux. Amour des oiseaux ? Un mot revient plusieurs fois dans le livre, "jubilation", et c’est cette jubilation que souhaite faire partager l’auteure.
Le livre ressemblerait à un Journal de bord, si l’on ne retenait que quelques dates liées à l’écriture du livre (« Depuis le 29 juin », « 20 juillet »), mais d’autres renvoient à un Journal plus ancien (« 27 février (dans le journal de l’année 2015) » et ce qui est présenté comme « une ballade au bois » ne se limite pas aux faits observés un été. Plusieurs séquences sont consacrées aux oiseaux du lieu de vie, le Colombier, dans le Lot, mais aussi à sa faune, d’autres se rapportent à des lieux éloignés. On lira, par exemple, un développement concernant l’Égypte ancienne et la colonne d’un tombeau qui porte les dessins d’une Pie-grièche, d’un Front-blanc, d’une Huppe fasciée. Avant une brève « coda », où deux motifs sont rappelés, celui de la présence d’une Hulotte près du Colombier et celui des migrations, un conte dont on verra la fonction(1). S’ajoutent un index des individus et espèces cités, et une bibliographie.
La joie profonde, Fabienne Raphoz l’éprouve évidemment grâce à l’observation des oiseaux, de leurs déplacements, de leur nids (celui du tisserin, par exemple), de la relation étroite d’un oiseau (le Pic à face blanche) avec son environnement (le Pin des marais ), de la comparaison des chants (celui de l’Hypolaïs polyglotte avec celui de l’ictérine) : il y a dans l’écoute attentive le plaisir immédiat, notamment, de distinguer des chants très proches, à l’occasion « une grande jubilation d’ajouter un son inconnu à [sa] petite encyclopédie sonore » et, en outre, « tous les espaces sonores ont (…) la force évocatrice d’un souvenir d’enfance ». L’enfance en Bretagne et le lien vécu alors à la nature sont évoqués, et il existe une continuité entre les souvenirs et les sentiments éprouvés lors de certaines observations : « attendre, de nuit, l’éveil du vivant dans une forêt équatoriale d’Afrique (…) expérience originelle unique de tous les sens (…) du paradis (…) premier. »
Un autre motif de joie vient de la relation à la langue. Parlant d’une espèce, le Rouge-queue à front blanc, Fabienne Raphoz passe à la définition de "espèce", ajoutant « Les noms savants sont souvent plaisants », autant que les noms de la langue vernaculaire ; le plaisir de la nomenclature, vif ici, se retrouve dans les poèmes de Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, augures. Le plaisir d’établir des listes (ainsi par exemple la liste des Pouillots) a probablement un rapport avec l’enfance, mais nommer est également une manière d’ « ineffacer ce qui nous entoure » ; c’est encore « naître de concert avec ce qui nous (…) distingue » de ce que nous nommons. L’établissement de la nomenclature importe d’autant plus que certains noms sont prétexte à rêveries étymologiques, que la méthode linnéenne de classification a pour Fabienne Raphoz une « puissance poétique » qui la « fait toujours rêver ».
Rêveries, mais aussi questions insolubles. Il y aurait à comprendre ce que signifie chants et cris ; chacun reconnaît un cri d’alerte pour protéger le nid, par exemple, mais tous les chants sont indéchiffrables. Quant à la perception qu’ont les oiseaux des humains, elle nous est obscure : sans doute savent-ils reconnaître qui les nourrit l’hiver, mais pour le reste ? L’ornithophile, les observant, peut écrire « pour se rapprocher un peu plus d’ « eux », c’est-à-dire de toi », lecteur. C’est bien au lecteur aussi d’aller vers tout ce qui nourrit le livre, textes littéraires cités ou auxquels il est fait allusion (auteurs grecs anciens, Dante, Lewis Carroll, Melville, Paul Louis Rossi, etc.), films (Thelma et Louise, L’homme qui tua Liberty Valance, Soylen Green) et, nombreux, essais des naturalistes.
Les rêveries, comme la jubilation, sont cependant gâchées par la réalité : 20% des 10 000 espèces d’oiseaux sont en voie d’extinction. Au xviiie siècle, le Conure de Caroline, la Colombe voyageuse, comme ailleurs le Dodo, ont été exterminés ; dans une île australasienne, des bateaux débarquent, pour pouvoir ensuite trouver un approvisionnement, des cochons et des chèvres — mais aussi des rats, et une espèce endémique est éradiquée. Le Jabiru et l’Ibis chauve survivent dans des parcs… On multiplierait les exemples : « Notre espèce a peut-être d’autant mieux détruit « son » milieu, qu’il n’était justement pas le sien. »
Il faut donc protéger, certes, les espèces d’oiseaux qui demeurent — et pas seulement les oiseaux —, et apprendre à les observer ; l’amateur, même moins "savant" que Fabienne Raphoz, a sur le spécialiste l’avantage d’être toujours un « éternel débutant » et son peu de savoir l’aide peut-être à rêver. Le conte autour de Jean-Denis le forgeron nous y encourage : installé dans un arbre pour se rapprocher des oiseaux, il s’endort, rêve et disparaît dans leur monde. Toujours éveillé, le lecteur de Parce que l’oiseau suit les voyages de l’ornithophile, voyages autour de sa maison ou dans les forêts lointaines. Avec jubilation.
- La réunion de contes est une des activités de Fabienne Raphoz, qui en a rassemblé (L’aile bleue des contes, l’oiseau) et qui a créé une collection (collection Merveilleux). Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Corti, 2018, 192 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 janvier 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, parce que l’oiseau, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2018
Georges Perros, Œuvres (''Pour remplacer tous les amours...'')

Pour remplacer tous les amours
Que je n’aurai jamais
Et ceux que je pourrais avoir
J’écris
Pour endiguer le flux reflux
D’un temps que sillonne l’absence
Et que mon corps ne peut tromper
J’écris
Pour graver en mémoire courte
Ce qui défait mes jours et nuits
Rêve réel, réel rêvé
J’écris
Georges Perros, Œuvres, édition établie
et présentée par Thierry Gillybœuf,
Quarto/Gallimard, 2017, p. 1074.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, pour remplacer tous les amours, écrire, corps, temps, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2018
Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Caravelles haridelles
4.
Bêtes, venez à moi ! venez bêtes farouches
épancher toute haine dans la coupe de mes mains !
Il est grand temps que la lune là-haut
cesse enfin de laper les nuages.
Sœurs chiennes, frères chiens,
traqué comme vous parmi les hommes
qu’ai-je à faire de caravelles haridelels
ou des voilures de corbeaux.
Si la faim suintant de murs en ruine
vient à s’agripper à ma chevelure,
je mangerai la moitié de ma jambe
et vous offrirai l’autre en pâture.
Je n’irai nulle part avec les gens,
mieux vaut crever ensemble, avec vous
que de ma terre aimée ramasser une pierre
pour la lancer sur mon fou de prochain.
Sergueï Essenine, Journal d’un poète, traduction du
russe Christiane Pighetti, éditions de la Différence,
2014, p. 187.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d’un poète, bêtes, chiens, corbeaux | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2018
Antonio Porchia, Voix abandonnées
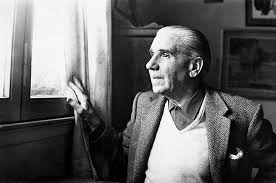
Ce qui naît de ce monde porte dès la naissance la vieillesse de ce monde.
Quand on se met à nous voir comme ceci, comme cela, on ne nous voit pas.
Toute personne anonyme est parfaite.
Un homme est un homme avec les autres : seul il n’est personne.
S’éveiller est toujours une surprise.
Antonio Porchia, Voix abandonnées, traduction de l’espagnol (Argentine) Fernand Verhesen, éditions Unes, 1991, p. 23, 29, 31, 33, 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio porchia, voix abandonnées, vieillesse, anonyme, personne, éveil | ![]() Facebook |
Facebook |
Amelia Rosselli, Document

Rose nettoyée
solitude oubliable
paysan méticuleux
meilleur du monde
se reconnaître réservoir
de nullité profonde
vexation épuisée
mort-solitude
d’autant plus précieuse
si je m’arme subtilement.
Amelia Rosselli, Document, traduction
de l’italien Rodolphe Gauthier, La Barque,
2014, p. 153.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amelia rosselli, document, rose, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2018
Pierre Reverdy, Le Cadran quadrillé

Si on osait entrer
Derrière la porte sans vitres deux têtes s’encadrent avec une douce grimace amicale.
Et par l’autre porte entr’ouverte, celle qui les protège la nuit, on voit le rayon où s’alignent les livres, où se réfugient les rires et les mots des veillées sous la lampe, sous la garde d’un drapeau tricolore et d’un pantin menaçant qui n’a qu’un bras.
Et tout se meurt en attendant la nuit, la vie des lumières et de leurs rêves.
Pierre Reverdy, La Cadran quadrillé, dans Œuvres complètes, I, Flammarion, 2010, p. 842.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le cadran quadrillé, si on osait entrer, rêve, lumière, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2018
Madeleine Lee, Arbres à pluie

Arbres à pluie
arbre à pluie immense
splendeur fière ancienne
bras haut levés vers les cieux
pieds fermement enracinés
toi, un sanctuaire
où les fougères nids-d’oiseaux offrent
des orchidées blanches sauvages — pour la paix
et la fougère cheveux-de-Vénus à tes pieds
se prosterne en remerciements
pour la promesse tenue
tes petites feuilles s’égarent
en travers de mon front
ouvrant mon troisième oeil
massant mon crâne comme le faisait mon père
il y a longtemps dans la mer méditerranée
on éleva une statue colossale
édifiante jusqu’à ce qu’elle tombe en miette sombrant dans les profondeurs de la mer
mais toi tu resteras debout
étant fait de matière des cieux.
Madeleine Lee, Arbres à pluie, traduction de l’anglais (Singapour) Pierre Vinclair, dans Catastrophes, revue numérique, n° 4, janvier 2018, "L’esprit du bas".
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : madeleine lee, arbres à pluie, pierre vinclair, sanctuaire, promesse | ![]() Facebook |
Facebook |
14/02/2018
James Sacré, Dans la parole de l'autre

Un long mur de livres
À Antoine Emaz
1 En deça
On attend
Ça n’est pas forcément un mur
Qu’on a devant soi
Aussi bien
L’indécise couleur d’une glycine (dans un autre livre)
J’ai cru qu’Antoine passait
(« On respire déjà mieux d’écrire » dit-il) passait
À travers le mur. Entre la pierre et quelles fleurs ?
Le bouquet d’iris ou le cerisier.
Là devant.
Et passe-t-il vraiment
D’un titre au suivant dans le livre ?
Poème du mur
Poème de la fatigue
Un long mur de titres
Poème des dunes
Poème d’une énergie contenue (dedans, pâle, hébétude)
La fin, les chiens
On arrive au bout du livre
Un autre sera bientôt là.
Devant. Plus loin.
Tout continue. On écrit toujours
En deçà.
En deçà
Où le présent craint. « les chiens jaunes ». Je me
souviens :
Retour d’école tous les soirs avec la peur
Pour passer devant cette chienne de chez le voisin
Méfiante et méchante. Le petit fauve, l’allure basse.
Si je l’entends encore
Maintenant ! J’ai le dos
Contre un poème d’Antoine Emaz, le mur de son poème
Contre. Et précautions.
James Sacré, Dans la parole de l’autre (livret 1), Rougier V, 2018, p. 4-5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans la parole de l’autre (livret 1), antoine emac, mur, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2018
James Joyce, Brouillons d’un baiser, premiers pas vers Finnegans Wake

Tristan & Iseult
(…) L’amour qu’elle voulait, et le plus gros qu’on puisse obtenir, le vrai amour le nouvel amour aveugle sans fond à fond l’étourdissant amour de titubante humanité et homme des cavernes l’amour coup de foudre, l’universel super joyau, raison pour laquelle elle l’embrassa encore, et lui, un gentleman-né, avec son talent pour rougir comme au backgammon, la contrembrassa parce que c’était une de ses maximes ici bas que si une dame, par exemple, se trouvait avoir un peu de libido pour un morceau de fromage de Stilton et que lui se trouvait, mettons, avoir dans les un quart de livre de gorgonzola vert-de-pied dans la poche eh bien il mettrait tout simplement la main à la poche, vous voyez, et il lui donnerait tout bonnement le fromage, on va pas en faire un, pour qu’elle y croque.
James Joyce, Brouillons d’un baiser, premiers pas vers Finnegans Wake, traduction Marie Darrieussecq, Gallimard, 2014, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, brouillons d’un baiser, premiers pas vers finnegans wake, amour, fromage, marie darrieussecq | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2018
Henry Jean-Marie Levet (1874-1906), Cartes postales

Sonnets torrides —Le voyage (tryptique)
III. Homewards
Au Waterloo-Hôtel* j’ai achevé mon tiffinn
Et mon bill payé, je me dirige vers le wharf
Voici l’indus (des Messageries Maritimes)
Et la tristesse imbécile du « homewards ».
Quelques officiers français, qui reviennent d’Indo-Chine
Passer en Europe un congé de dix mois,
Commentent l’embarquement de quelques misses assez divines,
Avec lesquelles je ne flirterai certes pas !
Sur le pont mes futurs compagnons de voyage
Me dévisagent…
Puis on passe une sommaire visite de santé
(Cette année la peste a fait ici bien des ravages !)
— Enfin voici la cloche du départ qui sonne
Que je ramène, précieusement ouatée,
La fleur de ma mélancolie anglo-saxonne.
* Bombay
Henry Jean-Marie Levet, Cartes postales, Dessins de Daniel
Nadaud, éditions Unes, 2018, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henry jean-marie levet, cartes postales, sonnets torrides, le voyage | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2018
Jacques Lèbre, L'immensité du ciel (recension)
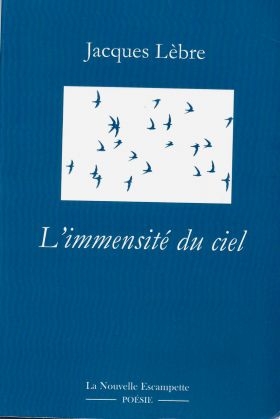
« la succession des jours est une étrange mitraille »
Le livre, en trois ensembles titrés, s’organise autour de quelques thèmes qu’annonce le poème d’ouverture, "Un matin" ; il débute par ce qui ouvre la journée, le lever et la douche, c’est-à-dire un nouveau commencement, moment propice au vagabondage de l’esprit et aux questions. Jacques Lèbre en pose une qui introduit les thèmes de la mort et de ce qui la suit : « Le dernier souffle d’un mourant doit bien partir quelque part / et comme un fétu se poser dans le giron d’une naissance ? ». De là découlent d’autres motifs, celui de l’oubli du passé, de la vie des disparus, celui aussi de la solitude des humains dans la nature, de l’impossible échange avec les autres êtres vivants. Si la métempsychose existait, cela ne changerait rien mais, quitte à ce que l’esprit — « l’âme » — migre, mieux vaudrait pour le poète devenir bouton de fleur pour ne pas « durer ou (…) durcir ».
Ces thèmes lyriques sont revisités en tous sens, fortement à partir de la mort du père, « réduit, désormais, à l’immensité du ciel » — vers qui achèvent la seconde partie et lui donnent son titre. Il est d’autres réductions. Ainsi, le nom du père est suivi de l’année de sa naissance et de sa mort, comme sur une pierre tombale, résumé lapidaire du temps de passage sur la terre. Ce qui reste et est énuméré, ce sont les objets liés au loisir, la canne à pêche, l’établi, l’outillage pour bricoler, mais le jardin qu’il cultivait a disparu. L’urne même du columbarium ne contient pas plus de cendre que n’en fournirait une bûche. Ce qui demeure encore vif et suscite l’émotion, ce sont quelques moments vécus avec lui, quand ils reviennent brusquement à la mémoire un jour, au marché, devant des girolles : le père initiait l’enfant à leur recherche. Mais comment vivre quotidiennement l’absence ?
Un poème ("Mère"), consacré à la vie de la mère, suit immédiatement l’évocation de l’urne cinéraire. Les repères de la journée, comme par exemple l’heure des repas, construits au cours des années avec le compagnon sont perdus, et ne se maintiennent que les gestes qui permettent de continuer à être là, à vivre normalement (« si jamais la vie est une chose normale »). On sait bien que le temps vécu n’est pas celui des horloges, l’absence introduit un dérèglement et rien de concret, comme l’étaient les échanges avec le mari, ne signale maintenant son écoulement. Tout ce qui était partagé, ou pris en charge comme le déplacement d’un meuble, incombe à celle qui reste ; il n’y a plus d’autre temps que celui de la solitude, que les souvenirs ne peuvent rompre.
La mort, en effet, efface tout, le corps pouvant même disparaître totalement comme ce fut le cas avec les fours crématoires des nazis. Au mieux, elle « laisse un cadavre / dont il faut se défaire au plus vite », et il ne demeurera rien non plus de son passage : les noms inscrits dans un cimetière n’apprennent rien de ceux qui les ont portés. On peut éprouver une sorte de vertige à lire ces noms — Jacques Lèbre en recopie —, tout comme à voir exhumer, au cours de fouilles, des ossements d’une nécropole. Une fois le corps voué aux vers, rien ne demeure « de sa vie, de ses pensées, de ses sentiments », et plus l’on remonte dans le temps, moins ce que fut la majorité des hommes garde de traces. Jacques Lèbre remarque que, dans le brouillard du Moyen Âge, seuls semblent subsister la mémoire des conflits qui opposaient les seigneurs pour agrandir leurs domaines : rien n’est conservé des ouvriers qui construisirent les églises romanes. Cependant, ce que l’on retient du passé n’est pas limité à quelques noms de roitelets et leurs luttes d’intérêt, et le texte de L’immensité du ciel en témoigne, avec les citations de fragments de Nelly Sachs, Ossip Mandelstam, Dante, Pierre Morhange, Fernand Deligny, Alfred Gong, Joseph Joubert, W. C. Sebald…
L’art du sculpteur qui représente dans la pierre le chant, les textes des écrivains nourrissent le présent, mais sans pour autant supprimer la solitude des humains ou, plutôt, ils vivent entre eux, coupés définitivement de la nature, donc dans leur silence. Pour les animaux, notre langage n’a pas de sens, pas plus que leurs cris (chant, meuglement, aboiement, etc.) n’en ont pour nous ; quand on croise le regard de telle ou telle bête, « on dirait des appels auxquels nous ne savons pas répondre ». N’y a-t-il pas d’issue, sinon de vivre sans illusion le temps qui nous est alloué, la perspective d’une résurrection étant écartée avec ironie : manque de place pour tous les revenants et chacun « déféquant sur ses talons, se pissant sur les pieds » ? C’est le sort commun, et il faudrait le vivre avec le chant du chardonneret : alors, avec l’oiseau, comme l’écrit Mandelstam, « nous regarderons le monde tous les deux » — réconciliation lyrique, dans ce dernier vers du livre, de l’homme avec la nature, qui suit la demande faite à l’oiseau, « suspends notre dévalement vers la mort » par ton chant.
Jacques Lèbre, L’immensité du ciel, La Nouvelle Escampette, 64 p., 13 €.
Cette note a été publiée sur Sitaudis le 7 janvier 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, l'immensité du ciel (recension) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2018
Pierre Mabille, C'est cadeau

Tout ce qui est à moi mon abandon mon absence
mon activisme mon addiction mon admiration
mon adolescence mon adresse mon affection
mon ailleurs mon allure
mon ambiguïté mon ambition
mon âme mon amitié mon amoralité
mon angélisme mon angle d’attaque
mon animalité mon animosité
mon anti dictionnaire mon anti héroïsme
mon antipathie
mon appartenance
mon après
mon ardeur
Tout ce qui est à moi mon art contemporain
mon attente mon audience mon augmentation
mon autrefois mon avance
mon avant mon avenir
mon aventure mon bégaiement
mon blaze mon blues
mon bon caractère mon bon conseil
mon bordel mon bout du rouleau mon caprice
mon caractère pas facile
mon cauchemar
mon chagrin
mon charisme
mon code mon cosmos mon coach
mon courage mon courroux
mon creux mon cri
mon cv mon cynisme
mon défaut mon dégoût mon délire
(…)
mon vocabulaire mon voile
mon voyage tout ce qui est à moi
tout ce qui est à moi c’est
pour toi tout ce qui est
à moi et toi et moi est à toi
est à tu
et à toi est à toi
Pierre Mabille, c’est cadeau, éditions Unes,
2018, p. 27-28 et 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre mabille, c'est cadeau, énumération, possesso, don | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2018
Art roman : abbaye de Nieul-sur-l'Autise (Vendée)




Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman : abbaye de nieul-sur-l'autise (vendée) | ![]() Facebook |
Facebook |





