22/03/2016
Claude Chambard, Carnet des morts
Les feuilles sont mortes sur votre tombeau,
grand-père que je ne connais,
élevé dans la forêt, la hache dans les deux poings.
Perdu dans les rues des villes,
pleurant le départ des enfants,
& la femme morte trop jeune.
Où serions-nous allés ?
Qu’auriez-vous montré à l’enfants ?
Vous seriez-vous battu avec Grandpère ?
Ou de votre air doux auriez-vous dit :
— Je vais partir, je ne vous gênerai plus.
Longue silhouette de dos
disparaissant après le virage du pont.
À pieds toujours, cinq kilomètres vers l’autre village
où même la ferme ne vous appartient plus,
dévorée par la fratrie infectée.
Car l’adieu c’est la nuit.
La langue, la voix impossible.
Le nom est un silence. On ne peut en compter les syllabes
Ce n’est pas la mort, ce n’est pas la vie.
Un rêve, les mains jointes, près du coffret où s’entassent les lettres perdues.
Une longue marche — toujours vivant —
sans me soucier des murs
ni du tunnel
ni du balancier des heures.
Claude Chambard, Carnet des morts, Le bleu du ciel, 2011, p. 55-56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, carnet des morts, tombeau, mémoire, solitude, adieu | ![]() Facebook |
Facebook |
16/03/2016
Étienne Faure, Vues prenables

Hep, taxi, ce qui nous fuit dans le rétroviseur
déjà n’est plus d’époque,
à vivre ici, voir venir,
dans une amphigourique attente ou merdier d’être né,
l’enfer pavé d’intentions plus ou moins bonnes,
cette envie de disparaître — pas grand chose,
une demi-vie, une heure —
puis l’idée de durer qui persiste
— et rattraper sa nuit dans le train.
Seul et définitivement mortel
— l’était-il moins dans l’ignorance
ou jeune ou endormi dans les mots accrochés aux cimes
avec la même exaltation des hauteurs qui conduit
à bâtir des cathédrales, marcher parmi les épilobes —
l’ennui devenu un ami, c’est le seul qui lui reste
dans le double vitrage où sommeille
un apatride au rêve étrange, qui lui redit
le temps où ils allaient au Terminus
protégés par la chaleur, noir liquide,
finir la nuit.
terminus nuit
Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon, 2009, p. 28.
A l'occasion de la parution de
Ciné-plage
d'Etienne Faure
Alphabet cyrillique
de Jean-Claude Pinson
aux éditions Champ Vallon
la librairie Michèle Ignazi
a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec
Etienne Faure
et Jean-Claude Pinson
le mardi 22 mars 2016
à partir de 19 heures
Librairie Michèle Ignazi
17, rue de Jouy
75004 Paris
0142711700
Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, solitude, disparaître, ennui, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
28/02/2016
James Sacré, Figures qui bougent un peu, et autres poèmes

Figure 9
La nuit la neige ou presque la nuit le soir
les arbres immobiles qui sont dedans, les talus hauts
les maisons ou rien que des vieux hangars sont allongés là contre
j’aimerais penser à d’autres lieux que j’aime
aussi dans un soir d’hiver avec des traces de neige
elle se défait plus vite dans le coin des prés
ça ne change pas grand chose au paysage d’aujourd’hui
c’est à la fin la seule solitude qui vient
la nuit se fait.
Je l’entends venir de très loin je suis debout dedans la nuit
le vent bouge un peu il y a le chaud d’une bête pas loin
autrefois est-ce que c’était pas la solitude qu’on croyait d’aujourd’hui
qui faisait comme du silence et l’illusion d’un espace grand ?
il n’y a presque rien maintenant
la neige est noire on n’entend plus rien.
Bien sûr dans ces limites mal tracées que fait la nuit
avec les prés ceux touchant les derniers toits de la ferme
avec les arbres soudain grands les buissons noirs
on peut laisser se perdre la peur et l’imagination
c’est quand même le cœur battant les fesses
un peu serrées qu’est-ce que j’attends c’est pas
besoin d’en dire la solitude a le sourire
de ce qu’on veut le temps aussi
la nuit continue touche-t-elle vraiment les branches de ce poème ?
James Sacré, Figures qui bougent un peu, et autres poèmes, préface d'Antoine Emaz, Poésie / Gallimard, 2016, p. 42-43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures qui bougent un peu, antoine emaz, nuit, neige, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2016
Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin
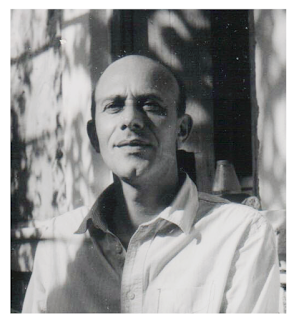
Suite vi
les dieux meurent plus facilement que les hommes
venant après les uns parmi les autres ou dans
la plus absolue des solitudes c’est égal
là où ne s’opposent l’air et le geste
matière engendrée du souffle et de la main
nulle matière avant cette dernière
comme ce que peut la main en traçant
l’unicité d’un dessin que la couleur habite
ou non (un oui toujours en son agilité)
le poème de la main et du souffle en
gendré ne crée pas autre mystère — outre
substituer aux chefs-
d’œuvre toute agitation des organes
investis dans l’acte que l’on nomme
(air ou geste sont communs à chacun
le larynx les membres produisent en
multitude) est crime des tribus
mais le tableau est là écho
de son poème où il s’échappe aux soirs
bruyants de nos angoisses
[...]
Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin, La
Lettre volée, 2016, p. 51-52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe baluchon, suites peintes de martin, solitude, dessin, couleur, poème, angoisse | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2016
Pascal Quignard, Mourir de penser
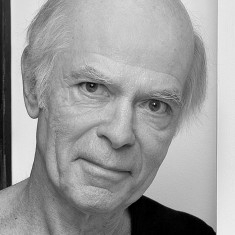
L’origine de l’activité psychique intellectuelle se fait en solo. Elle est, comme la fantasmagorie qui poursuit dans le jour la rêvée, radicalement masturbatoire. Elle est de nature antiparentale autant qu’antiproductricve. C’est pourquoi l’intelligence devient antifamiliale. C’est pourquoi la pensée s’assume d emanière de plus en plus antisociale. Son interrogation s’étend de façon incontrôlable, sur un mode inapaisable. Elle s’arrache à la société orale, à la voix prescriptrice, à la sagesse, aux dieux, aux interdits, aux proverbes, aux oracles.
[...]
Écrire est cet étrange parcours par lequel la masse continue de la langue, une fois rompue dans le silence, s’émiette sous forme de petits signes non liés et dont la provenance se découvre extraordinairement contingente au cours de l’histoire qui précède la naissance. Cet alphabet est déjà en ruine Par cette mutation chaque « sens » se décontextualise. Tout signal devenant signe perd son injonction tout en perdant le son dans le silence. Tout signe se décompose alors et devient littera morte, non coercitive, interprétable, transférable, transférentielle, transportable, ludique.
Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio / Gallimard, 2016, p. 217 et 218.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, intellectuel, solitude, écrire, signe | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2015
Georg Trakl, Poèmes, traduits par Guillevic —— Écrire après ?

Dans un vieil album
Tu reviens toujours, mélancolie,
O douceur de l’âme solitaire.
Pour sa fin s’embrase un jour doré.
Humblement devant la douleur
S’incline celui qui s’est fait patience.
Résonnant d’harmonie et de tendre folie.
Vois ! Il va faire noir déjà.
La nuit revient, quelque chose de mortel se plaint
Et quelque autre souffre avec elle.
Tremblant sous les étoiles d’automne
Chaque année la tête penche davantage.
Georg Trakl, Poèmes, traduits et présentés
par Guillevic, Obsidiane, 1981, p. 11.
Écrire après ?
Face à des innocents lâchement assassinés par d'infâmes fanatiques, la poésie peut peu, pour le dire à la façon de Christian Prigent. Ça, le moderne ? Quoi, la modernité ? Cois, les Modernes… Face à l'innommable, seul le silence fait le poids ; comme à chaque hic de la contemporaine mécanique hystérique, ironie de l'histoire, l'écrivain devient de facto celui qui n'a rien à dire. Réduit au silence, anéanti par son impuissance, son illégitimité. Son être-là devient illico être-avec les victimes et leurs familles.Nous tous qui écrivons ne pouvons ainsi qu'être révoltés par l'injustifiable et nous joindre humblement à tous ceux qui condamnent les attentats du 13 novembre. Et tous de nous poser beaucoup de questions.
Surtout à l'écoute des discours extrémistes, qu'ils soient bellicistes, sécuritaires, islamophobes ou antisémites sous des apparences antisionistes. C'est ici que ceux dont l'activité – et non pas la vocation – est de mettre en crise la langue comme la pensée, de passer les préjugés et les idéologies au crible de la raison critique, se ressaisissent : le peu poétique ne vaut-il pas d’être entendu autant que le popolitique ? Plutôt que de subir le bruit médiatico-politique, le spectacle pseudo-démocratique, les mises en scène scandaculaires – si l'on peut dire -, ne faut-il pas approfondir la brèche qu'a ouverte dans le Réel cet innommable, ne faut-il pas appréhender dans le symbolique cette atteinte à l'entendement, ce chaos qui nous laisse KO ? Allons-nous nous en laisser conter, en rester aux réactions immédiates, aux faux-semblants ? Une seule chose est sûre, nous CONTINUERONS tous à faire ce que nous croyons devoir faire. Sans cesser de nous poser des questions.
Ce communiqué, signé de Pierre Le Pillouër et Fabrice Thumerel, est publié simultanément sur les sites :
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, guillevic, poème, album, mélancolie, solitude, nuit, automne | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2015
Jean Tardieu, Margeries
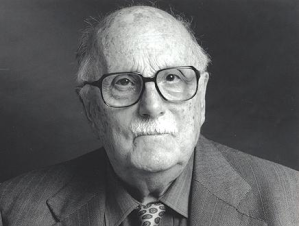
Un oiseau loin de moi
Un oiseau loin de moi
Une fleur sous la neige
Une maison qui brûle
Un noir mourant de soif
Un blanc mourant de faim
Un enfant qui appelle
Le vent dans le désert
La ville abandonnée
L’étoile solitaire
En voilà bien assez
Pour que je vous ignore
Beaux jours de mon été.
Jean Tardieu, Margeries,
Gallimard, 1986, p. 167.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, poème, oiseau, été, solitude, fleur | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2015
Gérard Titus-Carmel, Ici rien n'est présent

L’affût, c’est le nom secret de l’impatience quand le regard se lamine aux fentes de la persienne close. Qu’une grande prairie noire vous brûle le front et que l’ombre monte en vous, aussi rapidement que douleur ou marée.
Ô la violence de ces nuits de guet, la rosée perlant aux tempes de l’enfants posté là, au cœur de l’immensité, dans le silence des choses sans poids ni contours !
(Je restais ainsi des heures, les prunelles gonflées de solitude. Des ronces s’enchevêtraient au bord de mes paupières. Je connaissais la soif, la sauvagerie du corps, la déception.)
Gérard Titus-Carmel, Ici tien n’est présent, Champ Vallon, 2003, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard titus-carmel, ici rien n'est présent, impatience, violence, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2015
Anaïs Bon, François Heusbourg, seul double

j’habite tout l’espace de ma solitude
en songe je conquiers des habitations
qui se dérobent
les livres sont à terre, ma poussière poussée sous les meubles
je ne sais plus qui de moi ou de ma vie regarde l’autre
par la fenêtre
les vêtements retrouvés sont un peu courts
dehors, le jour s’endort
le temps de rêver est le temps d’être seul
ceux que je croyais à mes côtés sont partis
les compagnons véritables se dévoilent
ils portent le masque de l’absent
« qui chuchote mon nom »

Anaïs Bon, François Heusbourg, seul double, éditions isabelle sauvage, 2015, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anaïs bon, françois heusbourg, seul double, solitude, livre, rêve, abandon, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
14/07/2015
Caroline Sagot Duvauroux, 'j : recension

« nous voici séparés mais c’est écrire »(1)
Le titre, imprononçable, annonce l’impossibilité d’articuler "je", comme s’il y avait une disparition du sujet. Une apostrophe après le j implique, appelle un verbe, soit un engagement dans le monde, et c’est ce monde, difficile à vivre maintenant, dont le déplacement symbolique de l’apostrophe garde la trace. C’est que ’j est un poème du deuil, comme le furent Nous deux encore (Henri Michaux, 1948) et Quelque chose noir (Jacques Roubaud, 1986).
Le livre, d’une façon différente dans ses trois séquences, est entièrement construit sur le motif de l’absence, celle de l’aimé. Il s’ouvre par un fragment de phrase, « L’absence peut-elle », avant le premier ensemble où il est répété page de gauche, complété page de droite de sorte qu’une question chaque fois est posée, mais la liminaire les contient toutes, « L’absence peut-elle / ce que la présence, étrange, accomplit ? », et la dernière clôt toute question sur la relation entre présence et absence, une seule réponse, attendue, « L’absence peut-elle / arraisonner la présence ? ».
L’absence ne peut se vivre ici qu’en rappelant la présence, parce que le "je" s’est construit avec elle, dans ce qui est sans cesse mouvement, le lieu "je-tu", maintenant aboli ; il y a nécessité de la « présence étrangère » pour qu’existe en même temps « l’étranje ». Et quand « Tu s’est tu » — "tu sais tu" disparu —, ce qui est survenu devant le "je" peut être dit faille, fracture, seulement si l’on comprend qu’il n’est rien à combler, l’équilibre perdu n’était pas d’être sur l’autre bord mais "je-tu" du même côté.
Sans doute retrouve-t-on le thème de l’élégie, et la douleur s’exprime d’ailleurs aussi par le biais de l’interjection grecque classique, « o popoi ». Mais cette reprise est peut-être aussi une manière de (re)construire une assise, comme les diverses allusions littéraires, de Sophocle et la tragédie grecque à Genet, même si elles ont également une autre fonction dans le texte. Indissolublement lié au motif élégiaque est développé le questionnement sur ce qu’est le "je" par rapport au "tu" dans le passé et aujourd’hui. Hors la difficulté à penser autrement que dans un ici qui ne peut être que remémoré (« Nous n’étions qu’ici »), ce qui revient et s’écrit, c’est l’étreinte, la présence de la chair vivante dite sans détours par les verbes baiser, branler en ouverture de la seconde séquence. C’est là encore savoir, par l’évocation de l’amour des corps, que "je" fut autre, que la question « T’aimer sans toi ? » ne peut faire sens et que le "je" d’aujourd’hui dans une réelle mutilation ne peut se reconnaître. L’équivalence « tu = toujours » peut s’écrire, cependant la mort interdit que puisse se dire maintenant « je t’ », alors même qu’il n’est qu’une seule copule, « je t’aime », tout en contraignant à (ré)inventer une orientation — un ici maintenant —, en écrivant jusqu’au ressassement que le passé ne fut pas confusion, mais accomplissement du je, de son étrangeté.
Il faudrait s’attarder sur la manière, variée, dont la perte irréparable et ce qu’elle entraîne s’exprime dans ’j. Ce qui est le plus remarquable à mes yeux, c’est que l’expression écrite du deuil, ici, restitue avec force ce qu’éprouve toute personne vivant la mort de l’aimé(e). D’abord un ensemble de questions dont aucune n’a réellement de réponse, chacune ne faisant que renvoyer à la solitude maintenant vécue — « Tu ne seras pas là je n’étais pas là / Je ? là ? qu’est-ce ? / Nous n’étions qu’ici «. Ensuite, l’ordre du monde défait se dit par la mise en pièces des règles convenues de la syntaxe : phrases inachevées ou réduite à très peu de mots, à un mot, comme si la trituration de la langue pouvait aboutir à comprendre l’incompréhensible qu’est la disparition. Enfin, surtout dans la dernière partie, des énoncés bien détachés par des blancs qui, sans former une suite continue pour le sens, aboutissent à la nécessité de continue à écrire l’indicible, ce que reprend la quatrième de couverture. Cette nécessité achève le long cheminement qui commence de façon très négative — « Je n’aime pas Rabat » — et se termine dans la ville culturelle marocaine : « Prends place, narrateur, je l’altéré définitif nous débouche une bouteille à Tanger ».
Caroline Sagot Duvauroux, ’j, éditions Unes, 2015, 64 p., 16 €. Recension publiée dans Sitaudis le 18 juin 2015.
________________________________
1. Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, "Le Refuge en Méditerranée", centre international de poésie Marseille, 2014, np.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j : recension, deuil, douleur, écrire, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2015
Georg Trakl, "Chant d'un merle captif", dans Œuvres complètes
Chant d’un merle captif

Souffle obscur dans les branchages verts.
Des fleurettes bleues flottent autour du visage
Du solitaire, du pas doré
Mourant sous l’olivier.
S’envole, à coups d’aile, la nuit.
Si doucement saigne l’humilité,
Rosée qui goutte lentement de l’épine fleurie.
La miséricorde de bras radieux
Enveloppe un cœur qui se brise.
Georg Trakl, Œuvres complètes, traduites de l’allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 130.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, chant d'un merle captif, nuit, solitude, olivier, cœur | ![]() Facebook |
Facebook |
01/04/2015
Saint-John Perse, Exil
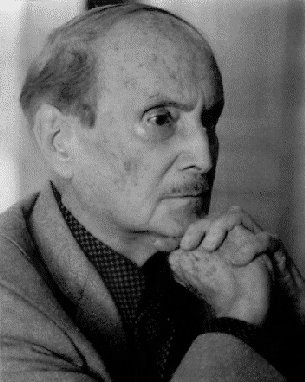
Photo Lucien Clergue (1974)
Portes ouvertes sur les sables, portes ouvertes sur l’exil,
Les clés aux gens du phare, et l’astre roué vif sur la pierre du seuil :
Mon hôte, laissez-moi votre maison de verre dans les sables...
L’Été de gypse aiguise ses fers de lance dans nos plaies,
J’élis un lieu flagrant et nul comme l’ossuaire des saisons,
Et, sur toutes les grèves de ce monde, l’esprit du dieu fumant déserte sa couche d’amiante.
Les spasme de l’éclair sont pour le ravissement des Princes en Tauride.
· * *
À nulles rives dédiée, à nulles pages confiée la pure amorce de ce chant...
D’autres saisissent dans les temples la corne peinte des autels :
Ma gloire est sur les sables ! ma gloire est sur les sables !... et ce n’est point errer, ô Pérégrin,
Que de convoiter l’aire la plus nue pour assembler aux syrtes de l’exil un grand poème né de rien, un grand poème fait de rien...
Sifflez, ô frondes par le monde, chantez, ô conques sur les eaux !
J’ai fondé sur l’abîme et l’embrun et la fumée des sables. Je me coucherai dans les citernes et dans les vaisseaux creux,
En tous lieux vains et fades où gît le goût de la grandeur.
Saint-John Perse, Exil, éditions de La Baconnière, Neufchâtel, 1952, p. 7-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-john perse, exil, lucien clergue, solitude, mer, sable | ![]() Facebook |
Facebook |
13/01/2015
Écrits de Laure, texte établi par Jérôme Peignot et le Collectif Change

De la fenêtre présente et invisible
je voyais tous mes amis
se partageant ma vie
en lambeaux
ils rongeaient jusqu’aux os
et ne voulant pas perdre un si beau morceau
se disputaient la carcasse
La solitude ronge comme un chancre
Briser ce cercle
Arracher ce baillon
Tristesse et Amertume
rongent, rongent, rongent
le cœur comme les rats
Honte à toi
sans doute ?
Mais pas sûrement
un si curieux décalage
des mots
Qui braver ?
Le quotidien
le gris le terne
Que m’importe où je suis
si je sais où je vais
puis-je savoir où je vais
sans connaître où je suis
je peux le savoir
dans la mesure où je me situe
Aujourd’hui
c’est l’heure trouble
dans les rues grises et désertes
l’heure où les chauffeurs d’autobus
excédés des journées
enfilent des avenues
qui s’écartent toutes nues comme
des jambes de femme
chacun est rentré chez soi
pour oublier
dans les oins du ménage
qu’il ferait bon vivre
sous le soleil.
À chaque départ
Je prenais le train
Là même où les acrobates
font le saut périlleux :
sous les voûtes vitrées
des grandes gares
Écrits de Laure, texte établi par Jérôme
Peignot et le Collectif Change, éditions
Jean-Jacques Pauvert, 1977, p. 90, 121, 141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, texte établi par jérôme peignot et le collectif change, tristesse, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2014
Jacques Dupin, Une apparence de soupirail

Toi, immobile sur la pont de fer. Regardant un autre récit. Regardant avec mes yeux. Regardant le temps immobile.
J'ai croisé dans la rue le rire d'un aveugle. Les nuages, les falaises, la mer : serrés contre sa poitrine. La musique commence dans les fenêtres...
... Et reculant sur l'échiquier enfantin. L'absence de sujet déchire le sommeil de tous. Perd du terrain. Tire un oiseau en vol.
Un essai de lumière sous la porte, et ce long possessif dol reptilien aiguisant la langue. A travers la porte, devant l'élévation de la nuit...
Une serpillière à grande eau sur les roses du carrelage. Et le bec de la charbonnière contre la vitre. Quand la pensée du double compense la faiblesse du bras.
Jacques Dupin, Une apparence de soupirail, Gallimard, 1982, p. 12-16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, une apparence de soupirail, amour, solitude, nuit, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2014
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
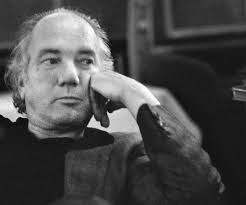
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
rien de ce tourment qui m'épuisait
comme la poésie qui portait mon âme,
rien de ces mille crépuscules, de ces mille miroirs
qui me précipitent dans l'abîme.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
que j'ai dû traverser à gué comme le fleuve
dont les âmes sont depuis longtemps étranglées par les mers,
et tu ne sais rien de cette formule magique
que notre Lune m'a révélé entre les branches mortes
comme un fruit de printemps.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
qui me chassait à travers les tombeaux de mon père,
qui me chassait à travers des forêts plus grande que la terre,
qui m'apprenait à voir des soleils se lever et se coucher
dans les ténèbres malades de ma tâche journalière.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit,
du trouble qui tourmentait le mortier,
rien de Shakespeare et du crâne brillant
qui, comme la pierre, portait des cendres par millions,
qui roulait jusqu'aux blanches côtes,
au-delà de la guerre et de la pourriture avec des éclats de rire.
Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit
car ton sommeil passait par les troncs fatigués
de cet automne, par le vent qui lavait tes pieds comme la neige.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée" / La Différence, 2012, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, frère, nuit, savoir, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |






