15/04/2023
Benoît Casas, Combine

571
Nous
partageons
le monde
à nous deux
d’une manière
bizarre
peut-être est-ce
nous-mêmes
que nous
partageons
en deux.
580
Seuls
nous ne
sommes pas
nous ne sommes
jamais
sinon
vertige
et vide.
598
Alors
nous en
étions là
et que fallait-il
faire
continuer
bien sûr
continuer
alors j’ai
continué.
604
Maintenant
il faut
ne plus
être seuls
ne plus
attendre
ne plus
avoir peur.
Benoît Casas, Combine,
NOUS, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, combine, solitude, partage | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2023
Armand Robin, Le monde d'une voix

Solitaire
Je n’ai pas de jour selon vos bonjours ;
Mais jours se veulent bonjours
Que dans l’aube authentique du règne du travail.
Mes bonjours ne salueront
Que l’aube authentique du monde du travail.
Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard,
1958, p. 163.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d’une voix, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2022
Gustave Roud, Journal 1916-1976
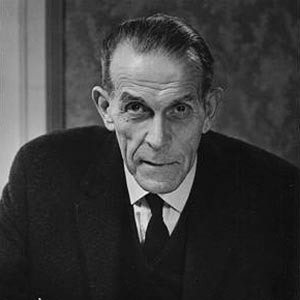
Je pense parfois : c’est ma solitude qui a altéré si profondément ma joie au spectacle du monde. Si jadis (sans que je voulusse l’analyser) elle naissait d’une correspondance que j’établissais entre une passion dominante, un sentiment que l’heure exaltait et tout ce qui entourait ma présence centrale, de plus en plus maintenant elle nécessite pour s’épanouir un calme désespéré, une tristesse sans sursauts où je me sens peu à peu descendre. C’est alors que naît pour ainsi parler mon regard véritable. Posé sur chaque chose, il l’épuise lentement, et je savoure tout objet pour lui-même et pour l’accord qu’il forme avec d’autres sans rien sentir d’autre en moi lui répondre et lui donner un sens ; c’est dire que je ne peux plus traduire, et moins encore interpréter le monde visible, mais seulement transcrire ce qui transparaît sous l’incessante variation de l’heure, de ses éléments éternels, par le sens des mots, leur musique, et le rythme de la phrase, l’âme aussi dépouillée qu’un peintre.
Gustave Roud, Journal, 1916-1976, Zoé, 2022, p. 91-92.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roue, journal, solitude, tristesse, interprétation | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2022
Umberto Saba, Il Canzoniere

La solitude
Saison changeante, ombre et soleil
font le monde varié, qui dans son aspect riant
nous console, et de ses nuages nous peine.
Et moi, qui à tant de nos apparences et à mes
yeux portait une infinie gratitude
je ne sais aujourd’hui si je dois m’affliger
ou m’en aller joyeux comme quand on sort d’une épreuve :
je suis triste et pourtant la journée est si belle ;
dans mon cœur seulement il fait pluie et soleil.
D’un long hiver je sais faire un printemps ;
quand la route au soleil est une traînée d’or,
le bonsoir, je le dis à moi-même.
J’ai mes brouillards et mes beaux temps en moi tout seul
comme en moi seul est ce parfait amour
pour que l’on souffre tant, moi je ne pleure plus :
en mes yeux en mon cœur je trouve suffisance.
Umberto Saba, Il Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 146.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, il canzoniere, solitude, pluie, soleil | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2021
Antoine Emaz, Soirs
30.01.98
accorder la langue
sur peu de choses
là ce soir
seul
avec
le jour en vrac
tout est passé
*
restent l’herbe
quelques feuilles tordues sèches
le froid clair encore le mur
entre l’herbe et le mur
la lumière glace
à chaque fois renvoie
une paroi de froid
à la fin le crépi
craque gris
dans le soleil qui baisse
voilà
Antoine Emaz, Soirs,
Tarabuste, 1999, p. 74-75.
Photo T. H., 2007
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, solitude, mur | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2021
Baudelaire, Fusées

Dieu est un scandale, — un scandale qui rapporte.
Il n’y a que deux endroits où l’on paie pour avoir le droit de dépenser, les latrines publiques et les femmes.
Ce qu’il y a d’enivrant dans le mauvais goût, c’est le plaisir aristocratique de déplaire.
Cet homme est si peu élégiaque, si peu éthéré, qu’il ferait horreur même à un notaire.
Après une débauche, on se sent toujours plus seul, plus abandonné.
Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1258, 1258, 1259, 1262, 1265.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, scandale, goût, élégiaque, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2021
Baudelaire, Fusées
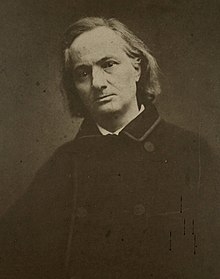
À chaque lettre de créancier, écrivez cinquante lignes sur un sujet extra-terrestre et vous serez sauvés.
De la langue et de l’écriture, prises comme opérations magiques, sorcellerie évocatoire.
Il y a dans l’acte de l’amour une grande ressemblance avec la torture ou avec une opération chirurgicale.
Quand j’aurai inspiré le dégoût et l’horreur universels, j’aurai conquis la solitude.
Beaucoup d’amis, beaucoup de gants — de peur d’attraper la gale.
Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, 1961, p. 1250, 1256, 1257, 1258, 1258.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Baudelaire, Charles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, fusées, amour, solitude, ami | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2021
Kafka, Journaux

Avant de s’endormir. Cela paraît si affreux d’être célibataire, et, vieux monsieur, de quémander un accueil en ayant du mal à conserver sa dignité quand on veut passer une soirée avec des gens, rapporter son repas à la maison dans sa propre main, ne pouvoir attendre personne paresseusement et avec une tranquille confiance, ne pouvoir faire de cadeaux qu’à grand-peine ou en s’énervant, prendre congé devant la porte de la maison, ne jamais pouvoir se précipiter en haut de l’escalier avec sa femme, être malade et n(avoir pour seule consolation que la vue de sa fenêtre quand on peut s’asseoir, n’avoir dans sa chambre que des portes de côté qui donnent sur les appartements d’autrui, avoir à ressentir les membres de sa famille comme des étrangers, avec lesquels on ne peurt rester ami que par le mariage, d’abord le mariage de ses parents, ensuite, quand l’effet en est passé, le sien propre (...)
Kafka, Journaux, traduction Robert Kahn, NOUS, 2020, p. 216-217.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, journaux, célibataire, solitude, ennui | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2021
Borges, En marge de "Lune d'en face"
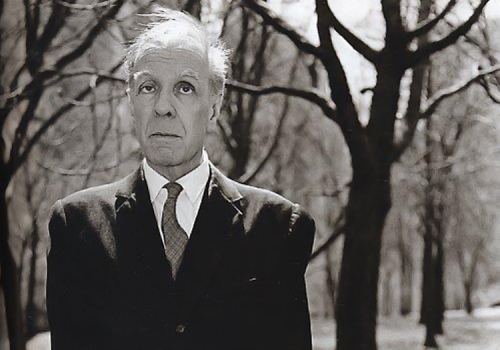
Sur les allées de Nîmes
Comme ces rues de ma patrie
Dont la fermeté est un appel dans mon souvenir
Cette allée provençale
Étend sa facile rectitude latine
À travers un vaste faubourg
Généreux et dégagé comme une plaine.
Dans un canal l’eau va disant
La douleur qui convient à sa pérégrination dénuée de sens
Et ce susurrement est une ébauche de l’âme
Et la nuit est douce comme un arbre
Et la solitude incite à l’errance.
Ce lieu est semblable au bonheur,
Et moi je ne suis pas heureux.
Le ciel vit une pleine lune
Et un haut-parleur me déclare une musique
Qui dans l’amour se meurt
Et resurgit en un douloureux apaisement.
Ma difficile obscurité mortifie le calme.
Avec ténacité me harcèlent
L’affront d’être triste dans la beauté
Et le déshonneur d’un espoir insatisfait.
Borges, En marge de « Lune d’en face », traduction Jean-Pierre Bernès, dans Œuvres, I, Pléiade/Gallimard, 1992, p. 72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Borges, Jorge Luis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : borges, en marge de « lune d’en face », les allées de nîmes, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2021
Henri Michaux, Lune d'en face

Un adieu
Soir que creusa notre adieu.
Soir acéré, délectable et monstrueux comme un ange de l’ombre.
Soir où nos lèvres vécurent dans l’intimité nue des baisers.
L’inévitable temps débordait
la digue inutile de l’étreinte.
Nous prodiguions une mutuelle passion, moins peut-être à
nous-mêmes qu’à la solitude déjà prochaine.
Nous allâmes jusqu’à la grille dans cette dure gravité de l’ombre,
qu’allège déjà l’étoile du berger.
Comme on revient d’une prairie perdue, je revins de ton étreinte.
Comme on dort d’un pays d’épées, je revins de tes larmes.
Soir qui se dresse vivant, comme un rêve
parmi les autres soirs.
Plus tard je devais atteindre et déborder
les nuits et les sillages.
Henri Michaux, Lune d’en face, dans Œuvres, I, traduction Jean-Pierre Bernès, Pléiade/Gallimard, 1993, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, lune d'en face, un adieu, solitude, étreinte | ![]() Facebook |
Facebook |
02/03/2021
Samuel Beckett, Malone meurt

Cette fois je sais où je vais. Ce n’est plus la nuit de jadis, de naguère. C’est un jeu maintenant, je sais jouer. Je n’ai pas su jouer jusqu’à présent. J’en avais envie, mais je savais que c’était impossible. Je m’y suis quand même appliqué, souvent. J’allumais partout, je regardais bien autour de moi, je me mettais à jouer avec ce que je voyais. Les gens et les choses ne demandent qu’à jouer, certains animaux aussi. Ça commençait bien, ils venaient tous à moi, contents qu’on veuille jouer avec eux. Si je disais, Maintenant j’ai besoin d’un bossu, il en arrivait un aussitôt, fier de la belle bosse qui allait faire son numéro. Il ne lui venait pas à l’idée que je pourrais lui demander de se déshabiller. Mais je ne tardais pas à me retrouver seul, sans lumière. C’est pourquoi j’ai renoncé à vouloir jouer et fait pour toujours miens l’informe et l’inarticulé.
Samuel Beckett, Malone meurt, éditions de Minuit, 1951, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, malone meurt, jouer, solitude, informe | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2020
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-sept, dix-huit

07.09.13
Séparé de tout, séparé de tous.
Toute communauté est une réponse à cette scission générale. Elle camoufle la solitude des corps, l’éparpillement des groupes. Elle tente de désigner ce qui les unit quand tout effort descriptif ne peut que creuser davantage distance et attirance. Le langage fait son œuvre. Il accomplit le paradoxe du vivant : il entretient le sentiment d’un gain de proximité et il approfondit l’abîme.
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-sept, dix-huit, Poésie/Flammarion, 2020, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, dix-sept, dix-huit, communauté, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2020
Umberto Saba, Du Canzionere

Seul
Je suis seul. Nul n’écoute ou
est vain tout appel aux amis
dispersés.
La haine brille come un glaçon, et je pense
que je te verrai ce soir, toi que j’aime.
Je pense : dans le jour qui révèle,
dans l’ombre qui dérobe, j’ai tant fait,
tant erré, pour me dire en paix quelques
mots.
Umberto Saba, Du Canzoniere, traduction P.
Renard et B. Simeone, Orphée / La Différence,
1992, p. 63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, du canzoniere, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2020
Paul de Roux, Au jour le jour, carnets 2000-2005

Tout se résume en cela : l’insatisfaction de soi-même.
À tant d’appels, combien de réponses ? Et parmi les réponses, combien vont plus loin que le geste ébauché, que le geste interrompu.
La page du jour d’ouvre devant toi. Que vas-tu y écrire ? « À toi de voir », dit une voix. C’est de voir, justement, qu’il s’agit. De faire tomber les écailles qui vous bouchent la vue.
Paradoxalement, c’est de la qualité de la solitude vécue par un homme que dépend la qualité de ses rapports avec autrui, qu’ils soient amicaux ou amoureux. À chacun d’entre nous de découvrit le bon usage de sa solitude.
Paul de Roux, Au jour le jour, carnets 2000-2005, Le Bruit du temps, 2014, p. 145, 162, 167.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, au jour le jour, carnets, insatisfaction, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2020
Leopoldo Maria Panero (1948-2014), Le dernier homme (poésie 1980-1986)
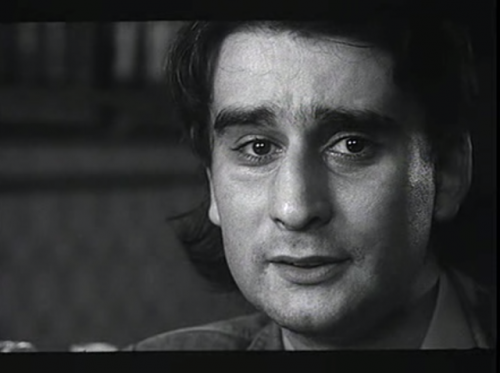
Troubadour j’ai été, je ne sais qui je suis
Ce n’est que dans la nuit que je trouve mon aimée
dans la nuit, esseulé
dans la plaine sans personne
sauf une femme qui hurle
la tête dans la main
ce n’est que dans la nuit que je trouve mon aimée
la tête dans la main
Je lui offre comme l’encens
que d’autres rois lui offrent
mes propres souvenirs
en lui tendant la main
puis elle me tend sa tête
et avec son autre main
elle m’indique la nuit
Seul dans la nuit, à neuf heures
je sors chercher mon aimée
et dans la plaine comme cerfs
galopent les souvenirs
J’eus la voix, troubadour,
j’ai été, aujourd’hui sans chant
je ne sais qui je suis et
j’entends un fantôme dans la nuit
j’entends les morts réciter mes vers.
Leopoldo Maria Panero, Le dernier homme,
traduction de l’espagnol Rafael Garido,
Victor Martinez et Cédric Demangeot,
Fissile, 2020, p. 141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leopoldo maria panero, le dernier homme, troubadour, solitude, rois mages | ![]() Facebook |
Facebook |






