09/12/2012
Pierre Reverdy, Chair vive

Chair vive
Lève-toi carcasse et marche
Rien de neuf sous le soleil jaune
Le der des der des louis d'or
La lumière sui se détache
sous les pellicules du temps
La serrure au cœur qui éclate
Un fil de soie
Un fil de plomb
Un fil de sang
Après ces vagues de silence
Ces signes d'amour au crin noir
Le ciel plus lisse que ton œil
Le cou tordu d'orgueil
Ma vie dans la coulisse
D'où je vois onduler les moissons de la mort
Toutes ces mains avides qui pétrissent des boules de fumée
Plus lourdes que les piliers de l'univers
Têtes vides
Cœurs nus
Mains parfumées
Tentacules des singes qui visent les nuées
Dans les rides de ces grimaces
Une ligne droite se tend
Un nerf se tord
La mer repue
L'amour
L'amer sourire de la mort
Pierre Reverdy, Bois vert (1948-1949), dans Œuvres
complètes, II, édition préparée, présentée et annotée
par Étienne-Alain Hubert, 2010, p. 448-449.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, chair vive, la vie, signes d'amour | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2012
Jean Genet, Le condamné à mort
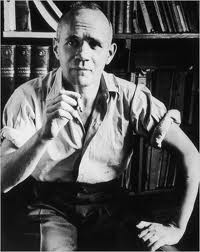
Le condamné à mort
[...]
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou
Que ma main plus légère et plus grave qu'une veuve
Effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve,
Laisse tes dents poser ton sourire de loup.
Ô viens mon beau soleil ô viens ma nuit d'Espagne,
Arrive dans mes yeux qui seront morts demain.
Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.
Mène-moi loin d'ici battre notre campagne.
Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir,
Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire
Accueillir la rosée où le matin va boire,
Le clocher peut sonner : moi seul je vais mourir.
Ô viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde !
Visite dans sa nuit ton condamné à mort.
Arrache-toi la chair, tue, escalade, mords,
Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde.
Nous n'avion pas fini de nous parler d'amour.
Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes.
On peut se demander pourquoi les Cours condamnent
Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Amour viens sur ma bouche ! Amour ouvre tes portes !
Traverse les couloirs, descends, marche léger,
Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger,
Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes.
Ô traverse les murs ; s'il le faut marche au bord
Des toits, des océans ; couvre-toi de lumière,
Use de la menace, use de la prière,
Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Jean Genet, Le condamné à mort, dans Le condamné à mort,
L'enfant criminel, Le funambule, L'Arbalète, 1958, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le condamné à mort, amour, assassin | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2012
Roberto Juarroz, dixième poésie verticale

La folie de ne pas être fou,
de repousser le bras tendu
les zones intérieures
où guette le marécage,
fait parfois fouler
les pieds abandonnés.
Ne pas être fou
à certains moments,
ressemble trop à la folie.
Excessive, insupportable intensité,
se défendant à la fois des tignasses flottantes
et des cheveux intolérablement lisses.
Il est nécessaire, de temps en temps,
de se reposer de ne pas être fou.
La locura de no estar loco,
de rechazar con el brazo estirado
las zonas interiores
donde aguarda la ciénaga,
hace pisar a veces
los pies abandonados.
No estar loco,
en algunos momentos,
se parece demasiado a la locura.
Excesiva, insoportable ntensidad,
defendiédose a la vez de las greñas flotantes
y del cabello intolerablemente liso.
Es precisa, cada tanto,
descabsar de no estar loco.
Roberto Juarroz, dixième poésie verticale,
traduction de François-Michel Durazzo,
José Corti, 2012, p. 129 et 128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto juarroz, dixième poésie verticale, poésie argentine, folie | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2012
Georges Lambrichs, Pente douce

Une confidence
L'habitude se reconnaît dans un circuit mental rapide et paresseux. Rapide : il est commode, en effet, d'abréger ce qui ne mérite pas de soutenir l'attention au profit d'une disponibilité de l'esprit. Et paresseux : qui peut empêcher d'apercevoir à temps le saugrenu qui menacerait l'ordre du sommeil. D'ailleurs, à quel défaut de sa naissance l'habitude serait-elle prise qui pourait la faire considérer à juste titre comme une nouvelle attendue ?
Venant de Saint-Malo — où l'on avait retrouvé, en pleine dérive, un ami frappé par le chagrin , lui connaissait-on d'autre lien que celui qu'il venait de rompre ? mais il devait avoir son idée là-dessus — on flânait dans Dinan, débouchant place Du Guesclin qu'on n'avait pas cherchée, quand faussant compagnie sans autre explication, je le vois s'introduire dans la boutique d'un bourrelier.
Après une attente forcée devant la vitrine où étaient exposés fouets et cravaches, nerfs de bœuf et sachets de sable, tous obets d'autant moins fascinants qu'ils sont montrés à l'état neuf, je l'aperçus qui sortait quelque peu rougissant avec un paquet blanc en fuseau tellement bien ficelé qu'on ne pouvait à première vue soupçonner ce qu'il contenait. Passé le moment de stupeur et de rire mêlés, je me dis qu'il reprenait goût à la vie et qu'il avait probablement l'intention à sa manière de rechercher un contact avec ce qui avait bien failli mourir.
[...]
Georges Lambrichs, Pente douce, nouvelles, préface de Jean Roudaut, éditions de la Différence, 1983 [1972], p. 31-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, pente douce, jean roudaut, confidence, dépression | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2012
Jean Bollack, une traduction de Sappho
En hommage à Jean Bollack, philosophe, philologue et critique, décédé le mardi 4 décembre 2012.
On trouvera une biographie et une bibliographie sur le site www. jeanbollack.fr
Une traduction de Sappho par Jean Bollack :
Aphrodite, sur ton siège chatoyant, immortelle,
Fille de Zeus, tressant des pièges,
Souveraine, je te supplie, ne paralyse pas mon esprit, ni dans la lassitude,
Ni dans la souffrance.
Viens ici. Une autre fois, à un autre moment,
Tu as entendu mes paroles au loin,
Et tu m’as écouté. Tu as quitté la demeure en or
De ton père, et tu es venue.
Tu as attelé ton char ; ils se sont faits beaux, les rapides
Moineaux, qui te conduisaient autour de la terre noire,
Tournant dru ; le tourbillon de leurs ailes est parti du centre
Du ciel, traversant l’éther.
En un instant, ils étaient là. Et toi, la bienheureuse,
Avec tout le sourire d’un visage d’immortelle
Tu m’as demandé ce que je subissais encore, et ce qui
Encore faisait que je t’appelle,
Et ce que c’est que je veux le plus qu’il m’arrive
Dans mon esprit en délire. « Qui est-ce qu’encore je dois
Persuader de te conduire, toi aussi, dans ton amour ?
Qui est-ce
dis, ô Sappho, qui te maltraite ?
C’est sûr : si elle évite, vite elle courra après
Et si elle refusait les cadeaux, elle en donnera.
Et si elle n’aime pas, vite elle aimera,
Serait-ce contre sa volonté ».
Viens à moi, maintenant aussi, et libère-moi de mes atroces
Soucis, et tout ce dont mon esprit
Désire l’achèvement, achève-le. Et toi, en personne,
Sois mon alliée.
(Sappho, fragment 1 Lobel- Page)
© Photo Tristan Hordé. Jean Bollack en avril 2010.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, sappho, poésie grecque, antiquité, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2012
Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé)

à ma mère
alors poème
– enfant en moi de sept mois n’était pas un
non-parlant mais ce
tout-oreille
qu’effondra en lui-même
aussi bien commença
l’extrême silence d’une
(bien que revenue) disparue-mère
l’indispensable qui (don de langue)
fait sol
et
sens – a
lors poème
(persiste
ce mouvement tiers cette absence
– réel l’impossible retour n’efface
pas le manque fracturant et fondant
aujourd’hui)
ce tout multiple – poème – possiblement
disjoncte
Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé),
Flammarion, 2005, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, l’inadéquat (la langue crée le dé), la mère, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2012
Philippe Jaccottet, À la lumière d’hiver

Sur tout cela maintenant je voudrais
que descende la neige, lentement,
qu’elle se pose sur les choses tout au long du jour
— elle qui parle toujours à voix basse —
et qu’elle fasse le sommeil des graines,
d’être ainsi protégé, plus patient.
Et nous saurions que le soleil encore,
cependant, passe au-delà,
que, si elle se lasse, il redeviendra même un moment
visible, comme la bougie derrière son écran jauni.
Alors, je me ressouviendrais de ce visage
qui demeure, lui aussi, derrière
la lente chute des cristaux humides,
qui change, avec ses yeux limpides ou en larmes,
impatiemment fidèles...
Et, caché par la neige,
de nouveau, j’oserais louer leur clarté bleue.
Fidèles yeux de plus en plus faibles jusqu’à
ce que les miens se ferment, et après eux, l’espace
comme un éventail peint dont il ne resterait plus
qu’un frêle manche d’os, une trace glacée
pour les seuls yeux sans paupières d’autres astres.
Philippe Jaccottet, À la lumière d’hiver précédé de
Leçons et de Chants d’en bas, Gallimard, 1977, p. 96-97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, À la lumière d’hiver, neige, visa | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2012
Aragon, La Valse des adieux

« Depuis des mois et des mois, je savais à quoi m'en tenir, je connaissais le fond de l'abîme... »
Qui parle ? Mais qui vous voudrez J'ai l'habitude de parler à la première personne. Pas vous ? De toute façon, dire je, dire moi, est le plus simple : le lecteur, ensuite, en dispose.
Laissons là les guillemets : depuis des mois, je connaissais... Une amie à moi me disait ces jours-ci au téléphone : Ah quelle invention la solitude... Oui. Mais encore on peut la tenir pour un progrès sur ce silence qu'on promène avec soi parmi les gens bruyants et bavards. Ou pire : dans leur compagnie, la nécessité des propos comme de feuillages à cacher le fond noir du puits. Il y a diverses façons de se taire. Il y a diverses façons d'être seul.
Ces dernières semaines, j'étais isolé du monde. Par le mal qui se niche ici ou là dans l'homme, et en devient la grande affaire, si bien que le temps n'a plus de poids, que les jours passent, et les nuits. Tout prend le caractère équivoque des rêves. Des rêves ? Il n'est même pas si sûr qu'il s'agisse des rêves. Cela ressemble à la vie. Une longue histoire. Et puis pas seulement : à la vie en général. À la mienne. À ma vie, cette vie dont je sais si bien le goût amer qu'elle m'a laissé, cette vie à la fin des fins qu'on ne m'en casse plus les oreilles, qu'on ne me raconte plus combien elle a été magnifique, qu'on ne me bassine plus de ma légende. Cette vie comme un jeu terrible où j'ai perdu Que j'ai gâchée de fond en comble.
Aragon, La Valse des adieux, dans Œuvres romanesques complètes V, préface de Jean Ristat, édition publiée sous la direction de Daniel Bougnoux, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2012.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la valse des adieux, la solitude, la vie, les rêves | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2012
Jude Stéfan, Disparates

Elle
elle allait en bottes, yeux en amande,
anneaux aux oreilles, surgissant au
grenier et penchée, Gitane abandonnée,
sauvage et sévère, aux jambes de balle-
rine, éprise du bleu, tentures, châles,
gants, soudain un furtif baiser, courait
à la mer au loin s'y aventurant, grimpait
aux arbres, dérobait des bagatelles, jouait
à la belote contrée, sifflait son chat,
attaquait la carambole, faubertait son
pavé, grugeait ses noix, frottait des pommes
à son coude, « ma beauté » à son oreille, un
peigne écarlate, gênée des tourterelles
et du sumac, effrontée, téméraire, palpée
sous tous les pores, impérieuse, ni rosée
ni perle, ni nymphe ni soleil, mais chair
même, peau, amie amante épouse, un bienfait
une chance. Elle
qui m'eût tué
qui me voulait
Jude Stéfan, Disparates, Gallimard, 2012, p. 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, disparates, amour, amie, amante | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2012
Max Jacob, Le Laboratoire central, Les Pénitents en maillot rose
Pour saluer la publication des Œuvres de Max Jacob en "Quarto" (Gallimard), suite

Le testament de la biche
Quelle forêt ! poudre de rose !
Le ciel est couleur de vin blanc.
Et sur le ciel vin blanc se pose
Chaque branche comme un cheveu.
C'est comme si'il n'y avait jamais eu de vent.
Comme si tout était parent
Fille ou neveu.
Comme si les arbres montaient à cheval frère à frère
Ainsi sur une estrade les vaches se font traire.
Et aussi comme si avec des chiffres de millions
On faisait difficilement une division
Ainsi vont les arbres feuillus, roses dans l'air.
Aubade ! aubade ! ô faon né du flanc de la mère
La bivhe est morte en te mettant sur terre
Et tes yeux, deux boules de jais, des yeux de verre
Sont moins émerveillés par la forêt en l'air
Que par la patte agonisante
Qui se pose sur un papier à lettres,
Le papier à en-tête de la maman
« Ceci ! ceci est ! ceci est mon testament. »
Max Jacob, Le Laboratoire central, dans Œuvres, édition établie, présentée et commentée par Antonio Rodriguez, Préface de Guy Goffette, Quarto / Gallimard, 2012, p. 608.
Nocturne
Sifflet humide des crapauds
bruit des rames la nuit, des rames...
bruit d'un serpent dans les roseaux,
d'un rire étouffé par les mains,
bruit d'un corps lourd qui tombeà l'eau,
bruits des pas discrets de la foule,
sous les arbres un bruit de sanglots,
le bruit au loin des saltimbanques.
Max Jacob, Les Pénitents en maillot rose, dans Œuvres, édition établie, présentée et commentée par Antonio Rodriguez, Préface de Guy Goffette, Quarto / Gallimard, 2012, p. 679.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jacob Max | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jaob, le laboratoire central, les pénitents en maillot rose, antonio rodriguez | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2012
Max Jacob, Le Cornet à dés dans Œuvres
Pour saluer la publication des Œuvres de Max Jacob en "Quarto" (Gallimard).

Allusions à un apprentissage de la peinture
Passer des baccalauréats ! Mme S.. est devenue folle : tant de jeunes peintres dans une chambre ! Passer des baccalauréats ! où sont mes livres ? faudra-t-il repasser les deux ? alors j'ai encore perdu deux ans ! Passer des baccalauréats ! M. Matisseest mourant dans une chambre : « Enseignez donc le dessin à mon jeune frère puisqu'il veille près de vous ! »Mais non, si mes baccalauréats ne comptent pas, n'ai-je pas ma licence en droit qui les suppose ? Il y a des lits de fer dans ma chambre en désordre ! J'ai couché chez un ami, Mme S... est devenu folle. Encore faudrait-il que le diplôme de licencié ne fût pas égaré. Oh Dieu ! quelle délivrance ! j'allais perdre encore deux ans pour préparer mon baccalauréat ; car je ne suis, savez-vous, pas très fort en latin.
Musique mécanique dans un bistro
Le corbeau d'Edgar Poe a une auréole qu'il éteint parfois.
Le pauvre examine le manteau de saint Martin et dit : « Pas de poches ?»
Adam et Éve sont nés à Quimper.
Pourquoi cet envoi d'un melon à Adolphe : est-ce ne injure ? eh ! je ne m'appelle pas Adolphe. Pourquoi 'annoncer son suicide ? savait-elle que je l'aimais ?
On allait jadis rue de la Paix dans un coupé
Pour nos poupons et leurs poupées. Aujourd'hui ce sont des coupons que pour Bébé nous découpons
Quand on n'est pas trop occupé.
Titre d'un grand tableau dans un petit musée : « Pour féliciter les marins de leur naufrage le roi Louis XVI en uniforme descend une échelle de corde. » Don de l'État.
Le panier qui avait descendu saint Paul des remparts se trouva empli de fleurs miraculeuses et la corde fut traitée come celle des pendus.
Max Jacob, Le Cornet à dés dans Œuvres, édition établie, présentée et commentée par Antonio Rodriguez, Préface de Guy Goffete, Quarto / Gallimard, 2012, p. 422 et 432-433.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jacob Max | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jacob, le cornet à dés, humour, antonio rodriguez, guy goffette | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2012
Patrice de la Tour du Pin, Une Somme de poésie

Un corps à naître
Du plus secret, des fonds de la moelle et du sang,
Un corps de femme doit surgir…
Il se forme, il est pris déjà dans mon désir
Qui rôde sur ses seins, ses jambes, les découvre
Brusquement de la nuit qui voudrait les retenir ;
Et tout le corps émerge enfin dans l’ombre douce,
Ses bras, ses yeux fermés encore, et cette bouche
Où ma vie tout entière entrera d’un baiser.
Et tout s’étonne autour, chancelle de surprise,
Les arbres ont plié leurs branches sur les brises,
Tout se retient… Et moi de même, à m’épuiser…
Elle sera plus belle à retarder l’étreinte ;
Il faut laisser monter aux vagues de désir
Ce qui la pressentait aux songes, à la crainte,
À l’espoir que ses yeux se dorent de plaisir ;
Et découvrir la place, ombrée par les cheveux,
Où mon baiser vraiment fera mourir deux êtres…
Attendre ? Ce n’est pas celle qui doit venir,
Rien qu’un pâle mirage au monde nébuleux,
Pas vraiment elle et sa surprise, sur mes rêves,
Pas la chair qui ne fait qu’une chair avec moi…
Quand mon baiser sera comme un appel de lèvres
D’agonisant qui cherche l’air une dernière fois.
Patrice de la Tour du Pin, Une Somme de poésie, I, Gallimard, 1981, p. 84-85.
À propos de Patrice de la Tour du Pin
Les histoires de la littérature au XXe siècle consacrent très peu de place à Patrice de La Tour du Pin (1911-1975), poète plutôt oublié et peu lu aujourd’hui. Ce n’est pas tant ses exigences de poète chrétien qui l’ont mis à l’écart — Pierre Emmanuel (né en 1922), Jean-Claude Renard (né en 1916), ses quasi contemporains, avec des choix spirituels analogues, ont eu une reconnaissance du public qui lui a échappé — que son isolement général du paysage poétique. Mais aussi sa vie à côté, jamais mondaine, éloignée du monde de l’édition : il a vécu l’essentiel de sa vie au château familial de Bignon-Mirabeau, dans le Gâtinais, sans autre souci que de se consacrer à l’écriture.
Son premier livre, La Quête de joie, salué par Supervielle, est édité à compte d’auteur en 1933, repris en 1939 par Gallimard. C’est le point de départ d’une œuvre importante, tous ses textes étant progressivement réunis sous le titre Une Somme de poésie à partir de 1946, somme sans cesse augmentée jusqu’à former dans l’édition définitive revue par l’auteur trois gros volumes, sous-titrés : I. "Le jeu de l’homme en lui-même" (1981), II. "Le jeu de l’homme devant les autres" (1982), III. "Le jeu de l’homme devant Dieu" (1983). Chacun des volumes est à son tour divisé en livres. Ces trois volumes constituent aux yeux de ceux qui les étudient un ensemble très structuré, mais la complexité du projet fait qu’ils ont été reçus comme un amas de recueils hétérogènes.
Les études de l’œuvre ne manquent pas(1), surtout depuis la disparition de Patrice de la Tour du Pin. Elles restituent le foisonnement du travail poétique, et notamment situent la place de La Quête de joie, livre fondateur, dans l’édifice. Résumer les contenus d’Une Somme de poésie, c’est-à-dire de 40 années de réflexions, est exclu ; on se limitera à relever l’importance du mot "jeu", à la fois jeu avec le langage et jeu comme action dramatique, ce que soulignait Patrice de la Tour du Pin lui-même : « J’ai bien fait de m’en tenir au terme de "jeu" pour désigner en même temps ce que je suis, ce que je fais, ce que je cherche », et il ajoutait « le mot même de "jeu" me ramène au plaisir naïf, natif de l’enfant »(2). Le jeu théâtral, ici comme ailleurs, revêt sans aucun doute une dimension cathartique, mais il est aussi, profondément, au service de la « tentative d’élucidation du mystère de l’homme et non plus seulement de l’individu. »(3) Pour un des commentateurs, on peut lire Une Somme de poésie comme une « longue pièce théâtrale en 3 actes ("jeu") avec un acteur unique ("l’homme"). Le sujet de l’œuvre est également unique : la recherche d’une parole poétique susceptible d’accueillir et de refléter la présence du divin, qu’elle soit en nous, chez les autres ou en Dieu lui-même. »(4)
De longs développements seraient aussi nécessaires à propos de l’idée de "joie", de celle de "quête", toutes deux essentielles dans La Quête de joie et ensuite, à l’exemple de la quête du Graal. Ce n’est pas la seule rencontre avec le Moyen Âge : Une Somme de poésie « partage avec la poésie médiévale cette extrême attention de tous les sens à la nature environnate, cette perception de la nature, non comme un spectacle que l’on contemple, ais une immerson dans un univers dont on fait partie. »(5) Bien que la recherche de Patrice de la Tour du Pin exige souvent des lecteurs un minimum de connaissances théologiques, bien des poèmes débordent largement ce cadre : on peut lire cette poésie "classique" (plutôt en vers comptés) sans avoir la foi, tout comme on peut lire Claudel.
La collection Poésie / Gallimard a fait paraître en 2011 Poèmes choisis, après, en 1967, de La Quête de la joie.
1 Cette présentation de Patrice de la Tour du Pin emprunte à : Marie-Josette Le Han, Patrice de la Tour du Pin : La quête d’une théopoésie, Honoré Champion, 1996 ; Luca Pietromarchi, Les Anges sauvages, La Quête de joie de Patrice de la Tour du Pin, Honoré Champion, 2001, Patrice de la Tour du Pin : La Quête de joie au cœur d’Une Somme de poésie, aces du colloque au Collège de France, 25-26 septembre 2003, textes réunis par Isabelle Renaud-Chamska, éditions Droz, 2005.
2 Patrice de la Tour du Pin, Une Somme de poésie, II, p. 229.
3 Marie-Josette Le Han, op.cit., p. 49.
4 Luca Pietromarchi, op.cit., p. 10.
5 M. Zink, dans Isabelle Renaud-Chamska, op.cit., p. 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrice de la tour du pin, une somme de poésie, un corps à naître, étreinte | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2012
Gérard Titus-Carmel, Ici rien n'est présent

Angle mort
J'appuie le front contre ma paume, le coude bien planté au bord du monde et, les yeux grand ouverts, je disparais lentement en moi.
Pourtant ma mémoire pèse de tout son poids, cherchant un point d'équilibre entre ce qu'elle tisonne infiniment et ce qu'elle s'obstine à oublier. La conque amie de la main devient alors tiédeur et confidence, que la nuit seule parvient à distraire Mais déjà au silence de mon corps j'ai gagné une contrée, une terre d'innocence. Et j'attends.
(L'attente, c'est cet animal sans nom, recroquevillé dans le contre-jour de la chambre, comme à l'angle perdu de la nuque : il tremble de tous ses membres sans que cela se voie vraiment, et c'est pitié. Mais les murs se resserrent autour de lui, qui n'est plus que boule et terreur.
Et je m'avance dans l'attente, c'est-à-dire vers l'ombre de la bête innommée, suffocante.
[...]
Gérard Titus-Carmel, "Angle mort", dans Ici rien n'est présent, Champ Vallon, 2003, p. 49-50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard titus-carmel, ici rien n'est présent, angle mort, l'attente, la mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2012
Renée Vivien, La Vénus des aveugles

Chanson pour mon ombre
Droite et longue comme un cyprès,
Mon ombre suit, à pas de louve,
Mes pas que l’aube désapprouve.
Mon ombre marche à pas de louve,
Droite et longue comme un cyprès,
Elle me suit, comme un reproche,
Dans la lumière du matin.
Je vois en elle mon destin
Qui se resserre et se rapproche.
À travers champs, par les matins,
Mon ombre me suit comme un reproche.
Mon ombre suit, comme un remords,
La trace de mes pas sur l’herbe
Lorsque je vais, portant ma gerbe,
Vers l’allée où gîtent les morts.
Mon ombre suit mes pas sur l’herbe
Implacable comme un remords.
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes,
Librairie Alphonse Lemerre, 1944, p. 204-205.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renée vivien, la vénus des aveugles, chanson, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2012
Pascal Quignard, Les Désarçonnés

La Boétie
Nous naissons tout à coup dans l'air atmosphérique, aveuglés par la lumière solaire, asservis aux plus humiliantes dépendances.
La liberté ne fait pas partie de l'essence de l'homme
La détresse originaire impose à la survie du petit qui vient de crier soin, propreté, secours, nourriture, défense. C'est-à-dire : la détresse originaire impose les autres à ce qui n'a eu dans sa conception aucune autonomie ; elle impose la famille, l'obéissance, la peur, la langue commune, la religion, l'élevage, la convention des vêtements, l'arbitraire de l'éducation, la tradition de la culture, l'appartenance à la nation. Toute cette étrange « aide » plonge l'enfant dans un mixte d'amour et de haine, envers le père tout neuf et à l'encontre de la mère-source qui l'a expulsé dans la lumière et abandonné le souffle. C'est un mixte d'admiration et de blessure, à la fois désirer l'autre et être désiré par lui, capter sans prendre, pourchasser sans tuer, désirer le désir de chacun, tuer sans que cela se voie, voler tout.
[...]
Ovide
L'anthropomorphose n'est pas achevée.
On ne peut définir l'homme sans en faire une proie pour l'homme.
La question humaniste : « Qu'est-ce que l'homme ? » énonce un danger de mort.
Si on forme le vœu de ne pas exterminer les humains qui ne répondent pas à leur définition — religieuse, biologique, sociale, philosophique, scientifique, linguistique, sexuelle — l'homme doit être laissé comme incompréhensible.
Ovide : L'homme doit être laissé comme non fini, c'est-à-dire comme appartenant à une espèce en cours de métamorphose infinie dans une nature qui est elle-même une métamorphose infinie.
Pascal Quignard, Les Désarçonnés, chapitre XL et XLII, Grasset, 2012, p. 121 et 126.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les désarçonnés, la boétie, ovide, l'homme, la naissance | ![]() Facebook |
Facebook |






