24/11/2012
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes

Et tu as traversé la mort
comme en la neige l’oiseau
toujours noir scellant l’issue…
Le temps a dégluti
les adieux que tu lui offris
jusqu’à l’extrême abandon
au bout de tes doigts
Nuit d’yeux
S’immatérialiser
Ellipse, l’air a baigné
la rue des douleurs…
Und du gingst über den Tod
wie der Vogel im Schnee
immer schwarz siegelnd das Ende –
Die Zeit schluckte
was du ihr gabst an Abschied
bis auf das äusserste Verlassen
die Fingerspitzen entlang
Augennacht
Körperlos werden
Die Luft umspülte – eine Ellipse –
die Strasse der Schmerzen –
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes,
traduit de l’allemand par Lionel Richard,
Denoël, 1967, p. 258-259.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, brasier d’énigmes et autres poèmes, le temps, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2012
Henri-Pierre Roché, Don Juan et...

Don Juan et Denise
Don Juan est assis à côté de Denise dans le grand salon. Auprès d'eux, le Prélat somnole, bien que, là-bas, devant le clavecin, la Duchesse chante un air de bravoure. Denise, ses cheveux sont bien plantés sur sa nuque.
Ils sont assis, sages, face à la musique. Pourtant leurs épaules convergent un peu. Ils sont enfermés dans une boule de cristal qui les isole — une boule pure, fraîche, sonore, où retentissent les battements de leurs cœurs.
La Duchesse chante une romance maintenant.
C'est le vieux duc branlant qui l'a commise. Il y a semé des grandes vagues en carton, et des vertiges en plaine.
Denise écoute — son oreille est mignonne — écoute, ravie. Son nez gracieux palpite un peu. Son œil candide monte et baisse avec les vagues — et il donne un clin d'œil vers Don Juan, pour voir où il en est.
Don Juan l'intercepte et retient un fou rire.
Denise hésite, se penche, elle va parler. Pourvu que non ! car le rire s'échappera hors de Don Juan à travers le salon, et il ne pourra plus le rattraper.
« Qu'avez-vous ? » dit-elle.
Il fait à Denise un petit geste de ne pas parler.
Est-ce douleur du rire supprimé ? Il a fait un petit geste de commandement, au lieu du geste tendre qu'il voulait.
Denise n'en revient pas. Elle est de profil, piquée. La boule de cristal est fêlée. Au premier regard les morceaux tomberont.
Qu'elle est longue la romance ! Don Juan sent Denise, le vieux duc, la chanson, la Duchesse, le Prélat, les fauteuils, comme une bande d'ennemis démasqués.
La romance finit. Il file aux écuries.
« Je te retrouve, mon cheval ! Que j'ai bien fait de me tromper, dis ? Sans quoi, vois-tu, il m'aurait fallu même danser tout à l'heure. »
En selle.
Henri-Pierre Roché, Don Juan et..., André Dimanche, 1994 [1920], p. 117-118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri-pierre roché, don juan et..., séduction, rire | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2012
Jean de la Croix, Cantique spirituel, traduction de Jacques Ancet

Chansons entre l'âme et l'époux
Épouse
[1]
Mais où t'es-tu caché
me laissant gémissante mon ami ?
Après m'avoir blessée
tel le cerf tu as fui
sortant j'ai crié, tu étais parti.
[2]
Pâtres qui monterez
là-haut sur les collines aux bergeries,
si par chance voyez
qui j'aime dites-lui
que je languis, je souffre et meurs pour lui.
[3]
Mes amours poursuivrai,
j'irai par les montagnes et les rivières,
les fleurs ne cueillerai,
ne craindrai lions, panthères
et passerai les forts et les frontières.
[4]
Demande aux créatures
Ô forêts et taillis
que mon ami a de sa main plantés,
verdoyantes prairies
de fleurs tout émaillées,
dites si parmi vous il est passé.
[5]
Réponse des créatures
Mille grâces versant,
en hâte par ces bois il est passé
et en les regardant
son visage a jeté
sur eux le vêtement de la beauté.
*
Canciones entre el alma y el esposo
[1]
Esposa
Adónde te escondiste
amado y me dejaste con gemido ?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido
sali tras ti clamando, y eras ido
[2]
Pastores los que fuerdes
allá por las majadas al otero
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero
decidle que adolezeo, peno u muero.
[3]
Buscandos mi amores
iré por esos montes y reberas
ni cogeré las flores
ni temeré les fieras
y pasaré los fuertes y fronteras.
[4]
Pregunta a las criaturas
O bosques y espesuras
plantadas por la mano del amado
O prado de venduras
de flores esmaltado
decid si por vosotros ha pasado
[5]
Respuesta de las criaturas
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
e yéndolos mirando
con sola su figura
vestido los dejó de hermosura.
Jean de la Croix, Cantique spirituel, traduction de Jacques Ancet dans Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Œuvres, édition publiée sous la direction de Jean Canavaggio, Bibliothèque de la Pléiade, 2012, p. 696-699.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de la croix, cantique spirituel, jacques ancet, épouse, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2012
Lorine Niedecker, Louange du lieu et autres poèmes

Paul
quand les feuilles
tombent
leurs tiges
tapissent
l'allée
à la lumière
de la ronde tenue
la lune
joue
pour les feuilles
quand elles perdent
ces petites
choses ténues
Paul
Lorine Niedecker, Louange du lieu
et autres poèmes, traduit par Abigail
Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès,
Corti, 2012, p. 48.
Paul
when the leaves
fall
from their stems
that lie thick
on the walk
in the light
of the full note
the moon
playing
to leaves
when they leave
the little
thin things
Paul
Lorine Niedecker, Lorine Niedecker,
Collected Works, edited by Jenne
Penberthy, Universityof California
Press, 2002.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorine niedecker, louange du lieu et autres poèmes, feuilles, automne | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2012
Malcom Lowry, Pour l’amour de mourir

Le passé
Comme une vieille échelle pourrie
Qu’on a jeté d’une scierie désaffectée
Et qui flotte, émergeant seulement par le haut,
Tandis que, tout imprégné d’eau, le reste baigne,
Rongé par les tarets, encroûté de bernacles
Et de moules accrochées en papillotes bleues ;
Puante, alourdie d’algues et de ces curieux êtres
Qui vivent de la mort et de la marée basse,
Route vermiculée, en proie à l’helminthiase :
Telle est ma conscience.
De temps en temps, je la sèche au soleil,
Je l’appuie (contre rien du tout,
Puisqu’elle ne monte nulle part) ;
Mais je la garde, on ne sait jamais, ça peut servir.
Qui sait si elle n’est pas récupérable,
Si on ne pourrait pas la radouber un peu ?
Et chaque nuit sans raison ma cervelle
Monte et descend les barreaux de l’échelle.
Malcom Lowry, Pour l’amour de mourir, traduction de
J.-M. Lucchioni, préface de Bernard Noël,
éditions de La Différence, 1976, p. 97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcom lowry, pour l’amour de mourir, le passé, le temps | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2012
Laure (Colette Peignot), Écrits

La vie répond – ce n’est pas vain
on peut agir
contre – pour
La vie exige
le mouvement
La vie c’est le cours du sang
le sang ne s’arrête pas de courir dans les veines
je ne peux pas m’arrêter de vivre
d’aimer les êtres humains
comme j’aime les plantes
de voir dans les regards une réponse ou un appel
de sonder les regards comme un scaphandre
mais rester là
entre la vie et la mort
à disséquer des idées
épiloguer sur le désespoir
Non
ou tout de suite : le revolver
il y a des regards comme le fond de la mer
et je reste là
quelquefois je marche et les regards se croisent
tout en algues et détritus
d’autres fois chaque être est une réponse ou un appel
Laure, Écrits de Laures, précédé de Ma mère diagonale,
par Jérôme Peignot, avec une Vie de Laure par Georges
Bataille, Pauvert, 1971, p. 150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laure (colette peignot), Écrits, georges bataille, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2012
Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope et autres poèmes

Aboulez !
Faites en l'offrande bazardez tout
le Golgotha n'était que l'œuf factice
cancer angine poitrine tout nus est bon
crachez-nous votre tuberculose ne soyez pas radin
aucune broutille n'est trop insignifiante pas même une thrombose
toutes maladies vénériennes seront particulièrement les bienvenues
cette vieille toge dans la naphtaline
ne soyez pas sentimental vous n'en aurez plus besoin
balayez-la aussi nos la mettrons dans la marmite avec le reste
avec votre amour partagé et non partagé
les choses saisies trop tard les choses saisies trop tôt
l'esprit qui souffre scrotum de taureau châtré
vous ne le guérirez pas vous ne le supporterez pas
c'est vous c'est la somme de votre être le premier imbécile venu est
forcé d'avoir pitié de vous ]
alors empaquetez cet ensemble purulent et expédiez-nous ça
toute la souffrance diagnostiquée mal diagnostiquée
demandez à vous amis de faire de même nous saurons l'utiliser
nous y attacherons sud sens nous mettrons cela dans la marmite avec
le reste ]
tout se réduit alors en sang de l'agneau
(1938)
Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope et autres poèmes, traduit de l'anglais et présenté par Édith Fournier, Les éditions de Minuit, 2012, p. 30-31.
Ooftish
offer it up plank it down
Golgotha was only the potegg
cancer angina it is all one to us
cough up your T.B. don't be stingy
no trifle is too trifling not even a thrombus
anything venereal is especially welcome
the old toga in the mothballs
don't be sentimental you won't be wanting it again
send it along we'll put it in the pot with the rest
with your love requited and unrequited
the things taken too late the things taken too soon
the spirit aching bullock' s scrotum
you won't cute it you won't endure it
it is you it equals you any fool has to pity you
so parcel up the whole issue and send it along
the whole misery diagnosed undiagnosed misdiagnosed
get your friends to do the same we'll make use of it
we'll make sense of it we'll put it in the pot with the rest
it all boils down to blood of lamb
(1938)
Samuel Beckett, dans Collected poems, 1930-1978, Londres, John Calder, 1984, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, peste soit de l'horoscope, abandon | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2012
Francis Ponge, Prose ou poésie
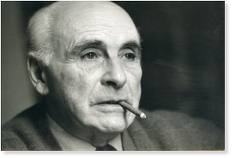
Prose ou poésie
Bien sûr j'ai lu les Poèmes en prose de Baudelaire et les proses de Mallarmé dans Divagations : sont-ce des poèmes en prose ? Cette antinomie entre poésie et prose est un non-sens. [...] J'aime Connaissance de l'Est de Claudel, mais non pas Les Nourritures terrestres de Gide, un livre que l'on peut appeler de prose poétique. Le fait qu'il n'y a plus de règles fixes de prosodie, proésie, signifie qu'il est impossible de classer intelligemment des proses comme poèmes et d'autres non. Une des premières anthologies de poèmes en prose d'après-guerre s'achève, je pense, sur moi. [...] L'anthologie commençait avec Parny au XVIIIe siècle. Ensuite venaient Aloysius Bertrand, Michaux, moi-même. Mais mes textes critiques, mes textes sur les peintres par exemple, sont tout aussi difficiles, souvent plus difficiles, à écrire que ceux considérés comme poétiques. Je ne fais pas de différence. Mes audaces et mes scrupules sont les mêmes, quelque genre que vous assigniez au texte. Mon premier recueil, publié en 1926, s'intitulait Douze petits écrits et s'ouvre avec trois ou quatre po... choses que l'on peut considérer comme des poèmes, si cela vous plaît.
Francis Ponge, "entretien avec Anthony Rudolf", 4 mai 1971, Modern poetry in Translation, n°21, juillet 1974, dans Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, traduction de l'anglais par Bernard Beugnot, p. 1409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, prose ou poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2012
Andrea Zanzotto, Idiome

Écoutant depuis le pré
Sur la touche, le doigt anéanti insiste
sur une note toujours ratée
et pourtant inhumainement juste
au-delà de tout exemple réussie
Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,
puis, il s’estropie, en un mouvement
de trille raté
au-delà de tout exemple
néanmoins reréussi
Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie
parvient sur cette note, sur ce doigt
énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,
qui veut la prendre en charge, donner crédit
à une partition universelle possible,
déverser d’une bande enregistrée
dans une autre
non moins mythique instrument
une adresse ou une déclaration d'expéditeur
insistante comme bec de pic-vert,
c’est sur ce doigt que tape l’offre,
sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,
et, toujours creusant sur cette touche,
et toujours la ratant, dans la déserte
réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,
son obstination contre tout pourquoi,
son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,
ajuste, devine
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan
(Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idome | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2012
Emily Dickinson, Le vent se mit à bercer l'herbe, traduction Pierre Leyris

Le vent se mit à bercer l’Herbe
Le Vent se mit à bercer l’Herbe
Avec des Airs de Basse grondeuse —
Lançant une Menace à la Terre —
Une Menace au Ciel.
Les Feuilles se décrochèrent des Arbres —
Et s’égaillèrent de toutes parts
La Poussière se creusa elle-même comme des Mains
Et dispersa la Route.
Les Chars se hâtèrent dans les Rues
Le Tonnerre se rua lentement —
L’Éclair exhiba un Bec Jaune
Et puis une Griffe livide.
Les Oiseaux verrouillèrent leurs Nids —
Le Bétail s’enfuit vers les Granges —
Vint une goutte de Pluie Géante
Et puis ce fut comme si les Mains
Qui tenaient les Barrages avaient lâché prise
Les Eaux Dévastèrent le Ciel,
Mais négligèrent la Maison de mon Père —
N’écartelant qu’un Arbre —
The Wind begun to rock the Grass
The Wind begun to rock the Grass
With threatening Tunes and low —
He threw a Menace at the Earth —
A Menace at the Sky.
The Leaves unbooked themselves from Trees —
And started all abroad
The Dust did scoop itself like Hands
And threw away the Road.
The Wagons quickened on the Streets
The Thunder hurried slow —
The Lightning showed a Yellow Beak
And then alivid Claw.
The Birds put up the Bars to Nets —
Ther came one drop of Giant Rain
And then as il the Hands
That held the Dams had parted hold
The Waters Wrecked the Sky,
But overlooked my Fathers’s House —
Just quartering a Tree —
Emily Dickinson, traduction Pierre Leyris dans son Anthologie
de la poésie américaine du XIXe siècle, édition bilingue, Gallimard,
1995, p. 332-333.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, le vent, l'herbe, l'orage, la pluie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2012
Christiane Veschambre, Après chaque page

On n'écrit pas pour se bâtir un "soi" — je n'écris pas pour devenir "moi".
On n'écrit pas plus pour "s'emparer du monde", ainsi que le dit un article rendant compte du roman "événement de la rentrée" (septembre est aussi le mois de la rentrée dite littéraire en France). Le journaliste se félicite de cette détermination de l'auteur, et de ce que, en même temps, son livre "invite à rester soi".
C'est d'abord désemparé, dessaisi qu'on vient à écrire. Dessaisi de tout contenu préalable, de toute forme reconnue. Dessaisi du rassurant partage forme / contenu. Aussi y a-t-il peu de chances pour que le livre qui naîtra peut-être de cet "espace vide", comme le nommait Peter Brook en parlant des conditions nécessaires du travail théâtral, fasse partie des "romans de la rentrée".
Quelque chose du "moi" et du "monde" s'effrite, s'écroule, se dissout. La lumière de septembre (m') ouvre l'espace intérieur et extérieur, au-dedans et au-devant de moi, qui délivre des confrontations dialectiques, quelque chose veut, comme un animal caché sous la terre, sous l'eau ou dans la grotte, surgir et le traverser, cet espace, et c'est avec des mots qu'il me faut le laisser venir. Lui qui vient d'un monde sans mots, sans catégories, sans intentions.
Et il disparaîtra. Ce qui surgit, toujours disparaît. Ça s'appelle la Vie. Ça ne se capture pas, ça ne se construit pas, ça ne se crée pas. Ça peut nous traverser, ça peut redonner vie, imprévisible, inassignable, à nos mots. Ça nous échappe, nous la perdons. Mais de la même façon que nous voulons vivre, encore vivre, jusqu'à la mort, contre la mort, nous l'espérons, la Vie, avec nos mots, après chaque page, nous la perdons, nous l'attendons, la prochaine fois peut-être, elle nous adviendra, et nous disparaissons.
Christiane Veschambre, Après chaque page, Le Préau des collines, 2010, p. 32-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, après chaque page, écrire, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2012
e. e. cummings, 95 poèmes, traduit par Jacques Demarcq

60
plonge au fond du rêve
qu'un slogan ne te submerge
(l'arbre est ses racines
et le vent du vent)
fie-toi à ton cœur
quand s'embrasent les mers
(et ne vis que d'amour
même si le ciel tourne à l'envers)
honore le passé
mais fête le futur
(et danse ta mort
absente à cette noce)
ne t'occupe d'un monde
où l'on est héros ou traître
(car dieu aime les fille
et demain et la terre)
e. e. cummings, 95 poèmes, traduit et
présenté par Jacques Demarcq, Points /
Seuil, 2006, p. 93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, 95 poèmes, jacques demarcq, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2012
Claude Dourguin, Laponia

Sans que l'on sache pourquoi, imprévu, offert que l'on découvre voici un jour de rémission. Le matin fleurant la glace a tendu une ciel d'azur pâle dont le cœur s'émeut, fragile, insolite. Froissé de blanc au lever, les heures une à une l'ont lissé, purifié, et il règne désormais impeccable, dépositaire de l'élégance arctique faite de dépouillement, de subtilité, de vigueur à la fois. Impressionné, saisi comme par la déférence instinctive au seuil de lieux saints, on avance plus grave qu'à l'ordinaire, mais c'est une gravité pleine, heureuse.
Le chemin forestier coupe à travers les pins, vient longer un lac modeste, figure blanche sur fond blanc combien plus vivante et suggestive que celle de Malevitch, sur quelques kilomètres l'esprit se propose une petite énigme esthétique à résoudre. Les pins reviennent, clairsemés, avec leurs branches irrégulières, mal fournies, leur port un peu bancal qui témoigne assez de ce qu'ils endurent. Nul tragique, pourtant, ne marque le paysage, entre conte et épopée plutôt la singularité des lieux soumis à des lois moins communes que les nôtres, obligés à un autre ordre. Chaque arbre tient à son pied, qui s'allonge démesurée et filiforme son ombre claire, grise sur la neige. Ces grands peuplements muets et fragiles d'ombres légères comme des esprits, le voyageur septentrional les connaît bien, une affection le lie à eux. Il traverse sans bruit leur lignes immatérielles dans le souvenir vague, qui les fait éprouver importunes, grossières, de la densité, de la fraîcheur, de l'odeur terrestre ailleurs, sur quelque planète perdue.
Claude Dourguin, Laponia, éditions Isolato, 2008, p. 37-38.
©Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, laponia, grand nord, neige, pins | ![]() Facebook |
Facebook |
11/11/2012
Pascal Quignard, La Haine de la musique
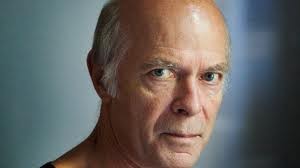
La musique multipliée à l'infini comme la peinture reproduite dans les livres, les cartes postales, les films, les CD-ROM, se sont arrachées à leur unicité. Ayant été arrachées à leur unicité, elles ont été arrachées à leur réalité. Ce faisant, elles se sont dépouillées de leur vérité. Leur multiplication les a ôtées à leur apparition. Les ôtant à leur apparition, elle les a ôtées à la fascination originaire, à la beauté.
Ces anciens arts sont devenus des scintillations éblouissantes de miroirs, un chuchotement d'échos sans source.
Des copies et non des instruments magiques, des fétiches, des temples, des grottes, des îles.
Le roi Louis XIV n'écoutait qu'une seule fois les œuvres que Couperin ou que Charpentier proposaient à son attention dans sa chapelle ou dans sa chambre. Le lendemain, d'autres œuvres étaient prêtes à sonner pour le première et la dernière fois.
Comme ce roi appréciait la musique écrite, l lui arrivait de demander à entendre deux fois une œuvre qu'il avait particulièrement appréciée. La cour s'étonnait de sa demande et la commentait. Les mémorialistes en portaient mention dans leurs livres comme d'une singularité.
*
L'occasion de la musique, pendant des millénaires, fut aussi singulière, intransportable, exceptionnelle, solennelle, ritualisée que pouvaient l'être une assemblée de masques, une grotte souterraine, un sanctuaire, un palais princier ou royal, des funérailles, un mariage.
Pascal Quignard, La Haine de la musique, Calmann-Lévy, 1996, p. 280-281.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la haine de la musique, la reproduction, la copie | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2012
Antoine Emaz, Soirs

30.01.98
accorder la langue
sur peu de choses
là ce soir
seul
avec
le jour en vrac
tout est passé
restent l'herbe
quelques feuilles tordues sèches
le froid clair encore le mur
entre l'herbe et le mur
la lumière glace
à chaque fois renvoie
une paroi de froid
à la fin le crépi
craque gris
dans le soleil qui baisse
voilà
peu de choses
dans un temps bref où passent
beaucoup de morts trop
vite
la vie dure
poser le peu comme simple
autant que possible
l'œil ras
dans l'herbe courte
les mots
on ne sait pas trop
ils tracent comme des bouclettes
des mèches de sens sans
tête
même hors vent ils frisent
quand sur la table
une bouteille tient nette
sa forme
pour bien faire il faudrait
des mots cendriers lourds
des pavés de verre clair quand
dehors brûle
[...]
Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,
1999, p. 74-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoin eemaz, soirs, les mots, le peu, l'herbe | ![]() Facebook |
Facebook |





