29/08/2015
Jeanpyer Poëls, La vie en vie
Brouette
La vie brouette la vie
et son envers la poursuit
modèle des palissades
ou sous l’envers d’une vie
bourrue une vie ou deux
comme une qui fait le guet
La brouette de la vie
saigne et dérange la vie
Curieuses
La vie attire les badauds sur un damier
la mort également qui a son bel canto
un damier se réduit à un seul carré noir
un bel canto finit par les désoler tous
Jeanpyer Poëls, La vie en vie, La Porte,
2015, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanpyer poëls, la vie en vie, la mort, damier, bel canto | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2013
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes

Voilà, et en dépit
De la mort qui nous fixe,
Une fois encore, pour reprendre tes mots,
Je vote pour :
Pour que la porte soit porte
Et la serrure serrure.
Pour que la bête morne, dans la poitrine,
Soit cœur... C'est que nous tous, nous avons dû
Apprendre ce que cela veut dire,
Trois ans sans fermer l'œil,
Et chaque matin s'enquérir
De ceux qui sont morts dans la nuit.
1940
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, traduits par
Marion Graf et José-Flore Tappy, La Dogana, 2010, p. 133.
Publié dans Akhmatova Anna | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, l'églantier fleurit et autres poèmes, la nuit, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2012
Jean-Claude Pirotte, Cette âme perdue
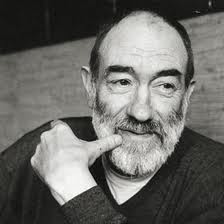
la mort s'approche à petits pas
c'est la tortue je suis le lièvre
on voit luire sa carapace
merveilleusement ciselée
et ses yeux aux lourdes paupières
simulent une somnolence
de personnage centenaire
dans un refrain de romance
gothique ou dans un roman noir
écrit par madame Radcliffe
on garde peut-être en mémoire
une ode de William Cliff
on conjure avec les moyens
du bord l'avenir immédiat
on lit deux vers d'Armand Lubin
courir vite ne sert à rien
on avance ainsi pas à pas
de borne en borne vers le lieu
où la tortue vous attendra
en ouvrant largement les yeux
Jean-Claude Pirotte, Cette âme perdue,
Le Castor Astral, 2911, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, cette âme perdue, la mort, william cliff, armand lubin | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2012
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes

Et tu as traversé la mort
comme en la neige l’oiseau
toujours noir scellant l’issue…
Le temps a dégluti
les adieux que tu lui offris
jusqu’à l’extrême abandon
au bout de tes doigts
Nuit d’yeux
S’immatérialiser
Ellipse, l’air a baigné
la rue des douleurs…
Und du gingst über den Tod
wie der Vogel im Schnee
immer schwarz siegelnd das Ende –
Die Zeit schluckte
was du ihr gabst an Abschied
bis auf das äusserste Verlassen
die Fingerspitzen entlang
Augennacht
Körperlos werden
Die Luft umspülte – eine Ellipse –
die Strasse der Schmerzen –
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes,
traduit de l’allemand par Lionel Richard,
Denoël, 1967, p. 258-259.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, brasier d’énigmes et autres poèmes, le temps, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2012
Jacques Roubaud, Quelque chose noir
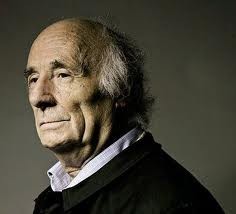
Envoi
S'attacher à la mort comme telle, y reconnaître l'avidité d'un réel, c'était avouer qu'il est dans la langue, et dans toutes ses constructions, quelque chose dont je n'étais plus responsable.
Or, c'est là ce que personne ne supporte plus mal. Où sont les insignes de l'élection individuelle sinon en ce qu'un ordre vous est obéissant, avec ses raisons de langue.
La mort n'est pas une propriété distinctive, telle qu'à jamais les êtres qui ne la présenteraient pas, à jamais s'excluraient des décomptes.
Ni les Trônes, ni les Puissances, ni les Principautés, ni l'Âme du Monde en ses Constellations.
Cela que pourtant tu t'efforçais de frayer, par photons évaporants, par solarisation de ta nudité précise.
La transcription réussie, l'ombre ne devait être nulle part appuyée plus qu'en ce lieu où le soleil avait poussé l'évidence jusqu'au point de conclure : le lit, de fesses qui s'écartent en brûlant.
Or, et c'est là ce que personne ne tolère plus mal, l'écriture de la lumière ne réclame pas l'assentiment.
Pour qui sait lire, seuls les limbes de l'entente.
Et le soleil, qui t'empaquetait entre deux vitres.
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 93-94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, la mort, la mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2012
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau

Je ne cherche pas à me consoler, comme tant de bêtes, avec l'herbe grasse des prairies. On ne noie pas sa mort en l'étourdissant avec trop de biens. Rien ne peut la rassasier, ni même l'enivrer. Alors, pourquoi lui fournir plus qu'elle ne demande ? Un corps léger donne autant de joie qu'un repas de gala ! L'important, c'est de vivre intensément et non de raboter la terre pour empeser tous ses copeaux au fond de soi. Le massif n'épargne jamais l'entrée des couteaux. Les lames connaissent par cœur nos géométries secrètes. Pourquoi les perdre dans l'épais, les accumulations de vivres ? Certaines vaches, en se gonflant ainsi, se disent : Plus je prends de terre, plus elle me gardera en son affection. Pensent-elles se rendre ainsi nécessaires ? Plus grande sera leur chute. Rien en vaut une cuisine légère !
Les ventres pesants, couchés, se perdent dans de mauvais rêves. Ma mission n'est pas la torpeur, mais la contemplation, le détachement des ligaments bestiaux
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau, roman intérieur, éditions Léo Scheer, 2005, p. 37-38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, journal d'un veau, la mort, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2012
Yves Boudier, Consolatio
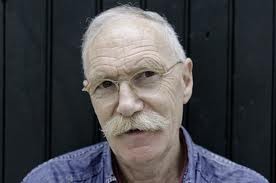
L'aube
toison gardienne
« Il pleut dans mes yeux... »
innocente le corps
de n'être que
vision indocile
du sexe vif
(aliénance des rêves)
je ne marche jamais seul
dans le sommeil
ce qui voile en moi
ne prouve rien
seulement dit
la jointure
l'humanité Janus
cette voie
vers
la nuit d'où naissent les enfants
Je ferme les yeux
cède
au cœur vigile
la présence animale
touche le seuil
désincarne
le verbe
la forêt gagne
et la mort passagère
découpe dans
les draps
au lever des chimères
Yves Boudier, Consolatio, postface de Martin Rueff,
"La mort au carré", Argol, 2012, p. 9-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves boudier, consolatio, martin rueff, la nuit, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2012
Tommaso Landolfi, La Muette

[...]
Oui, je voudrais parler un peu d'elle, mais vraiment d'elle, de cette elle-là, avant d'en venir à l'autre. Je voudrais, mais je ne sais pas ; je ne sais dire qu'une seule chose, et pour la dire, il faut que je reprenne pour la troisième fois cette malheureuse phrase dans laquelle je me suis enfermé, je ne sais pas pourquoi. Oui, je me débats et je tâtonne : je voudrais au moins savoir qui est celle que j'ai tuée, que j'ai faite mienne pour l'éternité, et ce n'est certainement pas ainsi que je le saurai. (Du moins, je ne le crois pas, mais il m'arrive de ne pas pouvoir résister à la tentation peccamineuse de la définir , et avec le froid langage de la raison.) Mais finissons-en ! J'ai dit au commencement : son regard était muet de quelque chose ; puis j'ai contredit partiellement cette proposition pour la réaffirmer d'une certaine manière tout de suite après ; et maintenant, à force de me balancer sur cette image médiocre et fort relative, je devrais me reporter à la première affirmation, misérable que je suis ! Et pourtant il en est presque ainsi : son âme, comme son regard, était muette de quelque chose. De tout. Ou plutôt, c'étaient ses quinze ans qui étaient muets, muets de tout autant qu'avides de tout. Je ne peux rien dire d'autre, mais peut-être déjà que tout est là ; et le lac de sang qui bouillonne dans mon cœur. De ce qui était le plus important (de son amour ?) elle ne parlait jamais ; qui sait ? elle ne pouvait peut-être pas ; et sa mutité m'enveloppait, m'assourdissait, m'ôtait la mémoire, comme la voix même du silence. Ets-ce que j'aurais pu ne pas...
Tommaso Landolfi, La Muette [Tre racconti], nouvelles, traduit de l'italien par Viviana Paques, Gallimard, 1970, p. 29-30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tommaso landolfi, la muette, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2012
Tristan Corbière, Paris nocturne

Paris nocturne
— C'est la mer : — calme plat — et la grande marée,
Avec un grondement lointaine, s'est retirée.
Le flot va revenir, se roulant dans son bruit —
— Entendez-vous gratter les crabes de la nuit...
— C'est le Styx asséché : Le chiffonnier Diogène,
Sa lanterne à la main, s'en vient errer sans gêne.
Le long du ruisseau noir, les poètes pervers
Pêchent ; leur crâne creux leur sert de boîte à vers.
— C'est le champ : Pour glaner les impures charpies
S'abat le vol tournant des hideuses harpies.
Le lapin de gouttière, à l'affut des rongeurs,
Fuit les fils de Bondy, nocturnes vendangeurs.
— C'est la mort : La police gît — En haut, l'amour
Fait la sieste en tétant la viande d'un bras lourd,
Où le baiser éteint laisse sa plaque rouge...
L'heure est seule — Écoutez : ... pas un rêve ne bouge.
— C'est la vie : Écoutez : la source vive chante
L'éternelle chanson, sur la tête gluante
D'un dieu marin tirant ses membres nus et verts
Sur le lit de la morgue... Et les yeux grand'ouverts !
Tristan Corbière, Poèmes retrouvés, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes ; Tristan Corbière, édition établie par Pierre-Olivier Walzer, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1979, p. 888.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ristan corbière paris nocturne, la mer, la mort, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2012
Pascal Quignard, La barque silencieuse

Le chat
Une goutte d'encre rejoint un peu de la nuit qui était en amont de la source de chaque corps. Lire, écrire, vivre : champs magnétiques où sont jetées les limailles des aventures, des chagrins, des hasards, des épisodes, des fragments, des blessures. C'était une bibliothèque entière de petits classeurs noir et rouge où je consignais mes lectures. Ces classeurs me suivirent quarante ans durant dans la vallée de la Seine et dans la vallée de l'Yonne. Je ne savais plus si j'écrivais avec eux ou pour eux. Un jour on demanda à Isaac Bashevis Singer pourquoi il persistait à rédiger ses livres en Yiddish alors que tous ses lecteurs avaient été exterminés dans les camps de la mort.
— Pour leur ombre, répondit-il.
On écrit mieux pour les yeux de ceux qu'on aimait que dans le dessein de se soumettre au regard de ceux qui vous domineront.
On écrit pour des yeux perdus. On peut aimer les morts. J'aimais les morts. Je n'aimais pas la mort chez les morts. J'aimais la crainte qu'ils en avaient eue.
La mort est l'ultima linea sur laquelle s'écrivant les lettres de la langue et s'inscrivent les notes de la musique.
La narration que permettent les mots entre-blanchis et découpés de la langue écrite récipite les hommes en spectres.
Le malheur hèle en nous des yeux morts pour être diminué.
D'animaux à hommes, un regard suffit pour comprendre.
Un vrai livre est ce regard sûr.
*
Je connaissais une légère démangeaison au centre de la paume. C'était cela, un fantôme. Une caresse qui manque. J'avais déjà dans la main le désir de caresser un animal qui fût doux et chaud et dont l'échine fasse cercle soudain sous les doigts tandis qu'un son tout bas halète, ronronne, enfle, s'égalise, bourdonne enfin continûment comme le bourdon de l'orgue.
Dans les chaussures, au fond de l'armoire, là où le chat aimait se retrancher quand il n'était pas heureux, il désira mourir.
Il s'était glissé au-dessous du lit d'appoint pour les nourrissons, au-dessus du transat replié, près de la boîte en bois qui contient le marteau, les clous, les crochets pour les tablettes et les ampoules qu'on visse dans les douilles des lampes.
Pascal Quignard, La barque silencieuse, Dernier royaume VI, Folio Gallimard, 2011 [Seuil, 2009], p. 216-217.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le chat, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
12/04/2012
Claude Dourguin, Journal de Bréona, dans Conférence, automne 2011

Les disparus. Ce qui à tout jamais fut englouti avec eux,
la conscience aiguë, térébrante que l'on en éprouve. Nous bouleversent non tant les supposés secrets des morts, que l'énigme irrémédiablement close de leurs pensées profondes, de leurs désirs, de leurs rêves. Déjà, vivants, ils nous laissaient perplexes, malheureux d'ignorer, au fond, ce à quoi ils aspiraient en vérité, quels que fussent leurs propos, désorientés, affolés, consternés par cette impossibilité — on en avait la certitude douloureuse — fatale en quelque sorte, à connaître la vérité de leur être. Non qu'ils dissimulassent, choix dont on leur laissait d'ailleurs la légitimité, mais au profond d'eux-mêmes il y avait comme un puits insondable, un tréfonds d'obscurité inaccessible, terrible, désespérant à quoi jamais on n'aurait accès.
Et maintenant ils sont partis, ont emmené avec eux dans un ailleurs innommable, pour nous à tout jamais perdu, ce qui les constituait, les fondait, cela, on en est assuré, certain, n'était pas accessoire mais les qualifiait, donnait à leur être leur unicité irremplaçable. On avait toujours souffert de se trouver, quel que fût le degré de confiance, d'intimité, irrémédiablement séparé, confronté à une profondeur que l'imagination se représentait à peine, réduit, de toutes manières, à soi-même. Certes, on accordait sans façon à l'autre cette réserve, on la reconnaissait. Mais cela ne changeait rien au sentiment de solitude à quoi on était assigné — ontologiquement. À cette heure, séparé jusqu'à sa propre mort, on éprouve dans la souffrance par instants violente, tout ce qui à coup sûr, nous a manqué, ces horizons qui nous auraient agrandis, ces savoirs qui nous auraient tellement enrichis, ces parcelles imaginaires qui nous auraient accomplis, favorisés d'autres territoires : c'est cela le deuil.
Dans ce constat que l'amertume soit bannie, que tout regret cède le pas. Que leur fin soit pour nous l'impulsion d'un départ neuf, le gage d'un commencement — notre élan qui les assure, sait-on ? de n'être pas venus pour rien.
Claude Dourguin, Journal de Bréona, dans Conférence, n° 33, automne 2011, p. 100-101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude douguin, journal de bréaona, la mort, l'énigme | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2012
Ernst Meister, Espace sans paroi

Là-bas sur les récifs
un murmure, te semble-t-il,
de non et de rien.
À proximité de toi
la vague déferle.
Là ! hors
de la mer élargie
bondit dans l'air un dauphin.
Dort auf den Klippen
ein Gemurmel, scheint dir,
vom Nicht und Nichts.
In deiner Nähe
die Welle schlägt an.
Da ! aus
gebreitetem Meer
spring hoch auf
ein Delphin.
*
Les éloignements
nous font vivre.
La mort
nous apparaît
aussi lointaine que la plus haute
étoile.
L'empressement de la nature
met en nous la mesure.
Wir leben
von den Entfernungen.
Der Tod
kommt uns vor
so weit wie der höchste
Stern.
Ein Geschäftiges der Natur
setzt Maße in uns.
Ernst Meister, Espace sans paroi, traduit de l'allemand
par Jean-Claude Schneider, Atelier La Feugraie, 1992, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst meister, espace sans paroi, la mort, la mer | ![]() Facebook |
Facebook |
13/01/2012
Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco

ACHILLE. As-tu déjà pensé qu'un petit enfant ne boit pas, parce que pour lui n'existe pas la mort ? Toi, Patrocle, as-tu bu dès ton enfance ?
PATROCLE. Je n'ai jamais rien fait qui ne fût avec toi et comme toi.
ACHILLE. Je veux dire, quand nous étions toujours ensemble et jouions et chassions et que la journée était brève, mais que les années ne passaient pas, savais-tu ce qu'était la mort, ta mort ? Parce que dès l'enfance on se tue, mais on ne sait pas ce que c'est que la mort. Puis vient le jour où tout d'un coup l'on comprend, on est dans la mort et, dès lors, on est des hommes faits. On se bat et on joue, on boit, on passe la nuit dans l'impatience. Mais as-tu jamais vu un jeune garçon ivre ?
PATROCLE. Je me demande quand ce fut pour la première fois. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Il me semble avoir toujours bu et ignoré la mort.
ACHILLE. Tu es comme un enfant, Patrocle.
PATROCLE. Demande-le à tes ennemis, Achille.
ACHILLE. Je le ferai. Mais la mort pour toi n'existe pas. Et il n'est pas de bon guerrier qui ne craigne la mort.
PATROCLE. Pourtant je bois avec toi cette nuit.
ACHILLE. Et tu n'as pas de souvenirs ? Tu ne dis jamais: « J'ai fait ceci, j'ai fait cela », en te demandant ce que tu as véritablement fait, ce que tu as laissé de toi sur la terre et dans la mer ? À quoi sert de passer des jours si l'on n'en a point souvenir ?
PATROCLE. Quand nous étions deux jeunes garçons, Achille, nous ne nous rappelions rien. Seul nous importait d'être toujours ensemble.
ACHILLE. Je me demande si quelqu'un encore en Thessalie se rappelle ce temps. Et quand de cette guerre reviendront les compagnons là-bas, qui donc passera sur ces routes, qui donc saura qu'un jour nous aussi nous y fûmes — et que nous étions deux enfants comme maintenant il y en a certainement d'autres ? Sauront-ils, les enfants qui grandissent à présent, ce qui les attend ?
PATROCLE. On ne pense pas à cela quand on est enfant.
ACHILLE. Il y aura des jours qui devront naître encore et que nous ne verrons pas.
PATROCLE. N'en avons-nous pas déjà vu beaucoup ?
ACHILLE. Non , Patrocle, pas beaucoup. Un jour viendra où nous serons des cadavres. Où nous aurons la bouche frappée comme par le poing de la terre. Et nous ne saurons même pas ce que nous avons vu.
Cesare Pavese, Dialogues avec Leuco [Dialoghi con Leuco], traduit de l'italien par André Cœuroy, Gallimard, "Du monde entier", 1964, p. 112-114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, dialogues avec leuco, achille, patrocle, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2011
Valérie Rouzeau, Va où

Me règle un peu mes comptes ici sur le papier couche ma vie séparée ma vie mirabelle et ma joie capitale allonge enfin mon tout
Que me coule douce la Seine j'y ai laissé ma main je n'en ai plus besoin c'était un coquillage
C'était toute pour des prunes
La main qui fait rougir fallait que l'écrevisse
J'ai noyé le chagrin et la gaieté me dure j'ai craché les noyaux
Ça ne me valait rien cette eau grise qui déchante je lui ai fait un lit
Et maintenant je ris ici au bord je sèche
Des pages pour ne pas vivre idiote pour m'entraîner au testament et en même temps purger ma peine
Pour aimer frères et sœurs humains réparer toute ma méchanceté
Trouver si le silence est d'or avant qu'il devienne de la boue
La mort ne fait pas mal qu'à l'âme si vous restez assis longtemps sur le marbre d'un disparu cher
Autant de pensées de jetées dans le vague d'un rêve éveillé
Un songe à répéter encore ni folle ni sage et ni françoise
Voilà pour m'apprendre à la fin pour m'exercer au jour le jour au soleil et au jour sans jour
Valérie Rouzeau, Va où, Le temps qu'il fait, 2002, p. 48 et 73.
© Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, va où, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2011
Pascal Quignard, La barque silencieuse
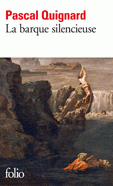
Le livre ouvre l’espace imaginaire, espace lui-même originaire, où chaque être singulier est réadressé à la contingence de sa source animale et à l’instinct indomesticable qui fait que les vivants se reproduisent.
Les livres peuvent être dangereux mais c’est la lecture surtout, par elle-même, qui présente tous les dangers.
Lire est une expérience qui transforme de fond en comble ceux qui vouent leur âme à la lecture. Il faut serrer les livres dans un coin car toujours les vrais livres sont contraires aux mœurs collectives. Celui qui lit vit seul son « autre monde », dans son « coin », dans l’angle de son mur. Et c’est ainsi que seul dans la cité le lecteur affronte physiquement, solitairement, dans le livre, l’abîme de la solitude antérieure où il vécut. Simplement, en tournant simplement les pages de son livre, il reconduit sans fin la déchirure (sexuelle, familiale, sociale) dont il provient.
Qu’est-ce qu’une autre vie sinon une autre intrigue linguistique ?
Le large existe.
Écrire déchire la compulsion de répétition du passé dans l’âme.
À quoi sert d’écrire ? À ne pas vivre mort.
Le large a inventé une place partout sur cette terre. Ce sont les livres. La lecture est ce qui élargit.
La mort est comme la langue. La mort est une machine à effacer des conditions de l’apparaître. La mort, comme la langue, apporte avec elle l’invisible. Plus encore, la mort apporte avec elle l’imprévisible. Matthieu XXV 13 : Nescitis diem neque horam. Vous ne savez ni le jour ni l’heure. La définition de la mort est le temps pur. L’homme, au fond de celui qui parle, n’est que le temps qui répond à la langue.
Pascal Quignard, La barque silencieuse, Folio/Gallimard 2011 [éditions du Seuil, 2009], p. 65, 102, 103, 103, 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le livre, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |





