28/03/2013
Andrea Zanzotto, Essais critiques

Pour Paul Celan
Pour quiconque, et tout particulièrement pour qui écrit des vers, prendre contact avec la poésie de Celan, fût-ce en traduction et sous une forme partielle et fragmentaire, se révèle bouleversant. Celan mène à bien ce qui ne semblait pas possible : non seulement écrire de la poésie après Auschwitz, mais encore écrire "dans" ces cendres-là pour aboutir à une autre poésie en pliant cet anéantissement absolu, tout en demeurant, d'une certaine façon, au sein de cet anéantissement. Celan traverse ces espaces effondrés avec une force, une douceur et une âpreté qu'on n'hésiterait pas à qualifier d'incomparables : mais frayant son chemin à travers les encombrements de l'impossible, il engendre une éblouissante moisson d'inventions, d'une importance décisive pour la poésie de la seconde moitié du XXe siècle, européen et au-delà, celle-ci se révèle néanmoins exclusives, excluantes, sidéralement inégalables, inimitables. Toute herméneutique, que toutefois elles attendent et prescrivent impétueusement, s'en trouve mise en crise.
Au reste, Celan avait toujours su que plus son langage allait de l'avant, plus il était voué à ne pas avoir de signification, pour lui, l'homme avait déjà cessé d'exister. Même si d'incessants sursauts de nostalgie pour une autre histoire ne font pas défaut dans ses écrits, celle-ci lui apparaît comme le développement d'une négation insatiable et féroce : le langage sait qu'il ne peut se substituer à la dérive de la déstructuration pour la transformer en quelque chose d'autre, pour en changer le signe : mais, dans le même temps, le langage doit "renverser" l'histoire, et plus que l'histoire, même s'il se révèle tributaire d'un tel monde, il doit le "transcender" pour en signaler au moins les effroyables déficits.
[...]
Andrea Zanzotto, Essais critiques, traduits de l'italien et présentés par Philippe Di Meo, éditions José Corti, 2006, p. 17-18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, essais critique, paul celan, poésie, auschwitz, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2013
William Carlos Williams, Un Jeune Martyr
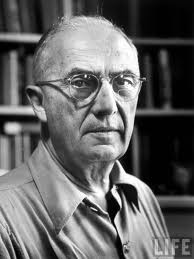
Le fermier
Le fermier absorbé dans ses pensées
marche à grands pas sous la pluie
au milieu de ses champs désolés, les
mains dans les poches,
la moisson déjà plantée
dans sa tête.
Un vent froid ridule l'eau
dans les herbes brunies.
De tous côtés
le monde s'en va roulant froidement :
vergers noirs
assombris par les nuages de mars _
laissant place à la pensée.
Par delà les taillis
hérissés près
de la voie ferrée lavée par la pluie
apparaît la silhouette artistique
du fermier — qui compose
— antagoniste
William Carlos Williams, Un Jeune Martyr, suivi de Adam
et Ève et la Cité, traduction de Thierry Gillybœuf, La Nerthe,
2009, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william carlos williams, un jeune martyr, le fermier, champ, pluie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2013
Thalia Field, L'amateur d'oiseaux, côté jardin

Ce crime porte un nom
Si on me disait qu'une pieuvre parle anglais, par exemple, ou ruse, je prendrais cela comme une qui m'intéresse, c'est ce dont elle parle.
(Markus Turovski)
Je n'ai aucune envie d'écrire ceci, ni en anglais, ni dans aucune autre langue, et puis de toute façon cela a déjà été écrit. Plus tard ce sera matière à discussion et d'autres appelleront ça un monologue ou un soliloque. Quelle différence ? Ils n'auront pas la moindre idée, voilà la différence. C'est maintenant que je dois noircir des pages, avant qu'il soit trop tard. La pression d'une désuétude calculée, de mon inactivité dans ma sémiosphère, la pression de l'abstraction (un numéro inscrit sur la bague à ma cheville : 1011-41278) — c'est l'Umwelt de qui d'abord ? Voilà de quoi se consoler un instant à peine.
Prenez Tennyson : « Si attentive au type, si dédaigneuse d'une vie. »
Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut comprendre ce que je raconte, même si j'écris dans une langue correcte et que le titre de mon article, « Entre l'air et l'espace », me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Une conversation franche entre organismes représente peut-être une valeur ajoutée pour le locuteur ou le destinataire, mais peu d'oiseaux écrivent des articles. Suis-je un cas particulier ? Un oiseau-mémoire qui est mort et a continué de vivre, explosant en plein vol, un puis plusieurs.
Je me souviens de Wittgenstein qui disait que même si un lion savait parler, nous ne le comprendrions pas. Je ne comprends pas, mais je crois que c'est juste.
Parler des espèces est plus difficile que de parler de soi. Certains avancent que les espèces sont des genres naturels avec des qualités essentielles. D'autres disant que les espèces ne sont que de l'ADN, une généalogie décodée. D'autres encore pensent que les espèces sont de simples flux, ou des individus, ou une question de contexte, ou une simple commodité. On a même qualifié les espèces d'investisseurs financiers qui maximisent les bénéfices en spéculant sur l'autoproduction. Vous dites espèces, moi je dis illusion, présent-passé, accident, karma, absurdité, ou simplement je ne dis rien.
[...]
Thalia Field, L'amateur d'oiseaux, côté jardin, traduit de l'anglais par Vincent Broca, Olivier Brossard et Abigail Lang, Les presses du réel, 2013, p. 61-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thalia field, l'amateur d'oiseaux, côté jardin, mémoire, wittgenstein, les espèes | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2013
Jean Ristat, N Y Meccano

Il y avait si longtemps d'amour qu'au matin
Un ange tombé dans la plume par surprise
La bouche encore nouée comme une rose
Ne m'avait tenu à l'ourlet d'un soupir
Ô il y avait si longtemps du tendre amour
Les doigts dépliés dans sa longue chevelure
comme un éventail de nacre au creux de l'épaule
Je me suis égaré dans un jardin chinois
Écoute mon cœur comme il bat pour la bataille
Et la fureur qui t'accable et la violence
De mes jambes dans le sable brûlant d'un drap
Ô beau fantôme par mégarde à la fenêtre
D'un rêve qui s'enfuit au hasard des rencontres
Et la seine berce un noyé qui me ressemble
Un couteau dans le dos pas besoin d'olifant
Sous l'oreiller pour la main le jour comme un gant
Retourné notre-dame agite ses grelots
Il y avait si long temps d'un grand vent de sel
Et d'épices sur mes lèvres pour un baiser
Et ce passant n'en sait rien à son miroir
Qui sourit poudré comme la lune d'hiver
[...]
Jean Ristat, N Y Meccano, Gallimard, 2001, p. 13-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, n y meccano, amour, rêve, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
24/03/2013
Paul Éluard, Mourir de ne pas mourir

Au cœur de mon amour
Un bel oiseau me montre la lumière
Elle est dans ses yeux, bien en vue,
Il chante sur une boule de gui
Au milieu du soleil
*
Les yeux des animaux chanteurs
Et leurs chants de colère ou d'ennui
M'on interdit de sortir de ce lit
J'y passerai ma vie
L'aube dans des pays sans grâce
Prend l'apparence de l'oubli.
Et qu'une femme émue s'endorme, à l'aube,
La tête la première, sa chute l'illumine.
Constellations,
Vous connaissez la forme de sa tête.
Ici, tout s'obscurcit :
Le paysage se complète, sang aux joues,
Les masses diminuent et coulent dans mon cœur
Avec le sommeil.
Et qui donc veut me prendre le cœur ?
*
Je n'ai jamais rêvé d'une si belle nuit,
Les femmes du jardin cherchent à m'embrasser —
Soutiens du ciel, les arbres immobiles
Embrassent bien l'ombre qui les soutient.
Une femme au cœur pâle
Met la nuit dans ses habits.
L'amour a découvert la nuit
Sur ses seins impalpables.
Comment prendre plaisir à tout ?
Plutôt tout effacer.
L'homme de tous les mouvements,
De tous les sacrifices et de toutes les conquêtes
Dort. Il dort, il dot, il dort.
Il raie de ses soupirs la nuit minuscule, invisible.
Il n'a ni froid ni chaud.
Son prisonnier s'est évadé — pour dormir.
Il n'est pas mort, il dort.
Quand il s'est endormi
Tout l'étonnait.
Il jouait avec ardeur,
il regardait,
Il entendait.
Sa dernière parole :
« Si c'était à recommencer, je te rencontrerais
sans te chercher. » ]
Il dort, il dort, il dort.
L'aube a beau lever la tête,
Il dort.
Paul Éluard, Mourir de ne pas mourir [1924], dans Œuvres complètes I, textes établis et annotés par Marcelle Dumas et Lucien Scheler, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968, p. 137-139.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, mourir de ne pas mourir, au cœur de mon amour, yeux, sommeil, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
23/03/2013
Écrits de Laure

Je le sens bien maintenant : « mon devoir m'est remis » lequel exactement ?
C'est parfois si lourd et si dur que je voudrais courir dans la campagne.
Nager dans la rivière
oublier tout ce qui fut, oublier l'enfance sordide et timorée, le vendredi Saint, le mercredi des cendres,
l'enfance tout endeuillée à odeur de crêpe et de naphtaline.
L'adolescence hâve et tourmentée.
Les mains d'anémiée.
Oublier le Sublime et l'infâme
Les gestes hiératiques
Les grimaces démoniaques.
Oublier
Tout élan falsifié
Tout espoir étouffé
Ce goût de cendres
Oublier qu'à vouloir tout
on ne peut rien
Vivre enfin
« Ni tourmentante
Ni tourmentée »
Remonter le cours des fleuves
Retrouver les sources des montagnes
les femmes les vrais hommes travailleurs
qui enfantent
moissonnant
M'étendre dans les prairies
Quitter ce climat
Ses dunes, ses landes sablonneuses, cette grisaille et ses déserts artificiels,
Ce désespoir dont on fait vertu,
Ce désespoir qui se boit
se sirote à la terrasse des cafés
s'édite... et ne demanderait qu'à nourrir très bien son homme
Vivre enfin
Sans s'accuser
ni se justifier
Victime
ou coupable
Comment dire ?
Un tremblement de terre m'a dévastée
On t'a mordu l'âme
Enfant !
Et ces cris et ces plaintes
Et cette faiblesse native
Oui —
Et s'ils ont vu mes larmes
Que ma tête s'enfonce
jusqu'à toucher
le bois
et la terre.
Écrits de Laure, précédé de Ma mère diagonale de Jérôme Peignot, avec un "vie de Laure" par Georges Bataille, Pauvert, 1971, p. 227-229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, jérôme peignot, georges bataille, enfance, désespoir, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
22/03/2013
Oskar Pastior, poèmepoèmes

le poème-d'auteur est triple en un c'est un lamento de l'auteur secundo un poème à prétentions généralisatrices tertio un filon pour de multiples sciences rien n'est impersonnel dans le poème-d'auteur est-il dit dans une généralité des plus banales mais la plupart des choses est/sont encore plus spécifique ainsi parle-t-on d'une stéréotypie c'est une sorte de formulaire d'identification reproduit mécaniquement où l'auteur se plaint parce que les symboles biographiques y sont trop réducteurs semble-t-il mais juste après ce manque déconcertant que ce n'est pas l'info tronquée qui le gêne mais au contraire l'impossibilité qu'elle le soit en d'autres termes l'égalité des chances est encore bien précaire opinion très individuelle exprimée par l'auteur c'est une misère puis sans transition suivent des réclamations ludiques au sujet de phytothérapie de loyer de temps ressenti de produit social de gourou d'angoisses et comme alibi quelques tentatives par clins d'œil cognitifs de vendre ça comme modèle d'existence et pour finir trois infinitifs tonitruants le poème-d'auteur est révélateur artisanal et porté en amulette il est décoratif
Avec moi on ne peut pas discuter est-il dit dans le poème-conversation p rce qu'ainsi y explique-t-on je n'offre ni garantie ni force de persuasion qui t'obligerait à me répondre non dit-on plus loin avec moi bien sûr on peu discuter c'est dans la nature des choses oi oui c'est bien triste dit-on à propos du dialogue ainsi croyons-nous qu'à force d'aveux nous arrivons ainsi à cerner le thème semble-t-il dit-on mais cela se perd dans la conversation
Oskar Pastior, poèmepoèmes, trad. de l'allemand et postface d'Alain Jadot, préface de Christian Prigent, éditions NOUS, 2013, p. 36, 72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oskar pastior, poèmepoèmes, christian prigent, auteur, conversation, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
21/03/2013
Georges Limbour, Soleils bas

Les bergers sans moutons
à Max Jacob
Nous sommes d'un pays
qui n'a pas d'arbres fruitiers
Nos mains ont pressé le lait
du sein de la cornemuse
Nos cœurs saignent dans les mûriers
pourquoi nos sœurs sont-elles laides
si les légendes nous abusent
Nous clouons les papiers blancs
des bouquetières du midi
sur les croix des cerfs-volants
aux migrations indéfinies
À ces cœurs mal équilibrés
toute la plaine se suspend
en avant-garde ils guideraient
des peuplades d'ambulants
Herbes rases séchées sans même de troupeau
Vous fleurissez très haut vos cœurs vains de papier
Trainant comme un regret leur queue de bigoudis
qui n'ont dans le sommeil frisé de chevelure
en ce morne pays rongé de roussissures.
Notre vie est penchée ainsi que des fumées
nos gestes de sonneurs n'énervent pas le ciel
Tels des bouquets noyés nos cerfs-volants dérivent
et le monde paraît les suivre.
Georges Limbour, Soleils bas, suivi de poèmes, de
contes et de récits (1919-1968), préface de Michel Leiris,
Poésie / Gallimard, 1972, p. 23-24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges limbour, soleils bas, légende, cerf-volant, berger | ![]() Facebook |
Facebook |
20/03/2013
Lorine Niedecker, Louange du lieu et autres poèmes (1949-1970)

Après Poésie complète de George Oppen et en même temps que L'Ouverture du champ de Robert Duncan, les éditions Corti publient dans leur "Série américaine" une partie importante de l'œuvre poétique de Lorine Niedecker (1903-1970) — les poèmes de sa dernière période (1957-1970) et une sélection d'un recueil précédent. Elle était jusqu'à aujourd'hui quasiment inconnue en France (comme l'ont été longtemps beaucoup de poètes américains), présente seulement par quelques traductions en revues, par Abigail Lang, notamment dans Vacarme en 2006 et 2008, et Sarah Kéryna dans Action poétique en 2001. Les traductions d'Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, qui donnent une idée très juste de la poésie de Lorine Niedecker, sont précédées d'une préface mêlant biographie et étude précise de l'œuvre.
Découvrant en 1931 dans la revu "Poetry" Louis Zukofsky, Lorine Niedecker a adopté ensuite dans son écriture quelques principes de ceux qui furent réunis sous le nom de poètes objectivistes : le refus de la métaphore, l'attention aux choses quotidiennes de la vie, le choix de l'ellipse (jusqu'à aboutir parfois à des poèmes difficiles à déchiffrer). Elle a rencontré les poètes (George Oppen, Charles Reznikoff, Carl Rakosi) qui se réclamaient peu ou prou de l'objectivisme théorisé par Zukofsky, mais c'est avec ce dernier qu'elle s'est surtout liée et qui sera jusqu'au bout un interlocuteur privilégié.
Le titre Louange du lieu a été retenu pour l'ensemble traduit parce que ce recueil, « synthèse de précision et de fluidité », « hymne et flux et autobiographie poétique », est bien, soulignent les traducteurs, la « somme de son œuvre ». La louange, c'est celle de la région natale, le Wisconsin, où Lorine Nediecker est restée l'essentiel de sa vie, sans pour autant vivre en recluse. Elle présente ainsi son environnement : « Poisson / plume / palus / Vase de nénuphar / Ma vie » et, dans un autre poème, elle évoque de manière un peu moins lapidaire sa vie dans ce pays de marécages et d'eau : « Je suis sortie de la vase des marais / algues, prêles, saules, /vert chéri, grenouilles / et oiseaux criards ». L'émotion est toujours retenue, mais présente cependant dans de nombreux poèmes à propos des saisons, notamment de l'automne (« Brisures et membranes d'herbes / sèches cliquetis aux petits / rubans du vent »), de l'hiver avec ses crues (« Assise chez moi / à l'abri / j'observe la débâcle de l'hiver / à travers la vitre ».
Les poèmes à propos de son environnement laissent percevoir une tendresse pour ces terres souvent couvertes d'eau, et l'on relève de multiples noms de plantes et de fleurs, une attention vraie aux mouvements et aux bruits de la nature :
Écoute donc
en avril
le fabuleux
fracas des grenouilles
(Get a load / of April's / fabulous // frog rattle)
Ce sont aussi des moments plus intimes qui sont donnés, sans pathos, dans des poèmes à propos de ses parents ou de son propre mariage ; il y a alors en arrière-plan, sinon quelque chose de douloureux l'expression d'une mélancolie : « Je me suis mariée / dans la nuit noire du monde / pour la chaleur / sinon la paix ». Cette mélancolie, toujours dite mezzo voce, est bien présente quand Lorine Niedecker définit la vie comme un « couloir migratoire » ou quand, faisant de manière contrastée le bilan de ses jours, elle écrit : « J'ai passé ma vie à rien ».
Dans des poèmes "objectifs", elle note de ces événements de la vie quotidienne qui ne laissent pas de trace dans la mémoire : « Le garçon a lancé le journal / raté ! : / on l'a trouvé / sur le buisson ». Cependant, il n'est pas indifférent qu'elle soit attentive à de tels petits moments de la vie ; elle est, certes, proche de la nature, mais cela ne l'empêche pas d'être préoccupée par la vie de ses contemporains, par le monde du travail. À la mort de son père, dont elle hérite, elle constate : « les taxes payées / je possèderai un livre / de vieux poètes chinois // et des jumelles / pour scruter les arbres / de la rivière ». On lira dans ces vers quelque humour, il faut aussi y reconnaître son indifférence à l'égard des "biens" (« Ne me dis pas que la propriété est sacrée ! Ce qui bouge, oui »), qu'elle exprime à de nombreuses reprises sans ambiguïté : « Ô ma vie flottante / Ne garde pas d'amour pour les choses / Jette les choses / dans le flot ». Sans être formellement engagée dans la vie politique, elle écrit à propos de la guerre d'Espagne, du régime nazi, sur la suite de la crise économique de 1929 (« j'avais un emploi qualifié / de ratisseuse de feuilles ») ou sur Cap Canaveral et sur diverses personnalités (Churchill, Kennedy). Elle se sait aussi à l'écart de son milieu de vie, sans illusion sur la manière dont elle serait perçue si l'on connaissait l'activité poétique qu'elle a en marge de son travail salarié : « Que diraient-ils s'ils savaient / qu'il me faut deux mois pour six vers de poésie ?».
C'est justement une des qualités de la préface de reproduire des documents qui mettent en lumière la lente élaboration des poèmes, depuis la prise de notes jusqu'au poème achevé. Il s'agit toujours pour Lorine Niedecker de réduire, de condenser encore et encore : elle désignait par "condenserie" (condensery) son activité. Son souci de la « matérialité des mots » l'a conduite à privilégier des strophes brèves (de 3 ou 5 vers) qui ne sont pas sans rappeler les formes de la poésie japonaise — Lorine Niedecker rend d'ailleurs plusieurs fois hommage à Bashô. Il faut suivre le cheminement des premiers poèmes proposés dans ce recueil (le premier livre publié, New Goose, 1946, n'a pas été repris) aux derniers, à la forme maîtrisée : c'est une heureuse découverte.
Un poème :
Jeune en automne je disais : les oiseaux
sont dans l'imminente pensée
du départ
À mi-vie n'ai rien dit —
asservie
au gagne pain
Grand âge — grand baragouin
avant l'adieu
de tout ce que l'on sait
Lorine Niedecker, Louange du lieu et autres poèmes (1949-1970), traduit par Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, éditions Corti, 216 p., 21 €.
Cette recension a d'abord été publiée dans la revue numérique "Les carnets d'eucharis".
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorine niedecker, louange du lieu et autres poèmes, abigail lang, maïtreyi et nicolas pesquès, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2013
Ophélie Jaësan, La Mer remblayée par le fracas des hommes

Éloge de la disparition
« Ce que nous appelons démesure, ce que Sophocle appelle la démesure, ce qui, d'après lui, est immédiatement puni de mort puni par les dieux, n'est que l'ensemble de nos propres mesures. » Jean Giono, Noé.
Parfois j'ai ce besoin — vital quasiment, du moins viscéral — d'être sur le départ. J e me souviens du ciel et de la terre, mais c'est un souvenir qui n'est plus ancré dans ma chair et il me faut aller tout de suite à sa rencontre, nourrir sa revivifiance, au risque de ne plus savoir quelque chose d'essentiel sur moi.
Moi ou eux — les hommes pareillement.
C'est donc d'abord une voie ferrée et je m'en vais, je fuis la ville, son agitation, son trop-plein, ses machines et autres engins. Je tente la campagne. Après un long voyage, j'arrive enfin dans une gare. Une simple gare avec un quai et une guérite. Alentour : rien. La nature. Je quitte la gare, seule. Je marche longtemps, très longtemps. Même fatiguée, il me faut poursuivre, car c'est autre chose qu'une nature remodelée par l'homme que je cherche.
Lorsque l'auto franchit le col, le temps change brusquement. La pluie cède à la neige, il y a du vent et du brouillard. L'autoroute que nous allons bientôt quitter ressemble à une nationale sans envergure. Un tapis blanc recouvre tout — les dernières maisons, les murets, les barrières, les barbelés —, tapis qui s'épaissit de minute en minute. Le ciel trop bas semble avoir eu le désir d'écraser la plaine. Brumes et vapeurs ont noyé la ligne de démarcation entre le ciel et la terre. Voilà qu'ils ne font plus qu'un. En silence, j'admire leur fusionnement.
Les cimes des arbres, leur branches, leurs troncs ont également été recouverts par la neige. Des arbres qui me paraissent maintenant figés dans une expression étrange, oscillant entre la sérénité et l'inquiétude.
Petit à petit, les traces du dernier passage des animaux dans la plaine ont toutes été effacées et les cris des oiseaux se sont tus.
Sur ce monochrome blanc, je rêve éveillée. Naît en moi alors le besoin d'écrire sur — ou à partir de — la disparition progressive des choses. Comme on ne peut plus les voir, on ne peut plus les nommer et elles finissent par disparaître. Mais en apparence seulement, puisque tout homme est Noé. Tout homme porte en lui la mémoire du monde. Longtemps après sa disparition.
Ophélie Jaësan, La Mer remblayée par le fracas des hommes, Cheyne, 2006, p. 58-59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ophélie jaësan, la mer remblayée par le fracas des hommes, la disparition, partir, nature, neige, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
18/03/2013
Henri Michaux, Épreuves exorcismes

Les craquements
À l'expiration de mon enfance, je m'enlisai dans un marais. Des aboiements éclataient partout. « Tu ne les entendrais pas si bien si tu n'étais toi-même prêt à aboyer. Aboie donc. » Mais je ne pus.
Des années passèrent, après lesquelles j'aboutis à une terre plus ferme. Des craquements s'y firent entendre, partout des craquements, et j'eusse voulu craquer moi aussi, mais ce n'est pas le bruit de la chair.
Je ne puis quand même pas sangloter, pensais-je, moi qui suis devenu presque un homme.
Ces craquements durèrent vingt ans et de tout partait craquement. Les aboiements aussi s'entendaient de plus en plus furieux. Alors je me mis à rire, car je n'avais plus d'espoir et tous les aboiements étaient dans mon rire et aussi beaucoup de craquements. Ainsi, quoique désespéré, j'étais également satisfait.
Mais les aboiements ne cessaient, ni non plus les craquements et il ne fallait pas que mon rire s'interrompît, quoiqu'il fît mal souvent, à cause qu'il fallait y mettre trop de choses pour qu'il satisfît vraiment.
Ainsi, les années s'écoulaient en ce siècle mauvais. Elles s'écoulent encore...
Henri Michaux, Épreuves exorcismes, dans Œuvres complètes I, édition établie par Raymond Bellour, avec Ysé tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1998, p. 781-782.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, Épreuves exorcismes, aboiement, craquement, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2013
Pierre Bergounioux, Préférences

La fixité relative des lieux accuse la fuite du temps irréparable, la perte et l'absence dont se paient chaque pas en avant, chaque instant.
Tulle existe encore depuis le jour de mes sept ans où je l'ai découverte, à l'est du bassin de Brive qui constituait, pour moi, le lieu géométrique de toute substance, attente et signification. C'était le milieu du siècle dernier, autrement dit le XIXe, l'Ancien Régime, les temps mérovingiens qui s'attardaient au-delà de leur âge dans la vieille Corrèze, en l'absence des signes du présent, de l'heure qu'il était partout ailleurs, sur la terre.
Sur la façade de l'immeuble qui abrite aujourd'hui le librairie Préférences, figurent encore les trois mots Bonneterie, Mercerie, Layettes, que j'ai sans doute lus lorsque, pour une raison oubliée, si je l'ai jamais sue, nous sommes montés de la sous-préfecture. Et si le monde réside, pour partie, dans l'idée qu'on s'en fait, cette version qui date de 1956, l'emporte sur toutes les autres parce qu'elle a pour ingrédients l'enfance, l'élémentaire et profus bonheur d'être qui accompagne l'inventaire émerveillé de la création.
C'est un peu plus tard qu'une ombre infiltre insensiblement le tableau, l'altère et gagne, de là, mon cœur, dont je serai le restant de mon âge à tenter de la chasser. Elle tient, cette ombre, à ce que la rumeur du dehors commence à résonner et contredit à l'évidence première. Elle infirme les suppositions qu'on tire spontanément de l'heure et du lieu qui nous sont assignés et qui appartenaient, je l'ai dit, au passé.
À ce maléfice, il existe un remède. Ce sont les livres. Ils parlent de ce qui se passe ailleurs, aident à rectifier les idées qu'on s'est faites sur la seule foi d'une expérience située et datée, anachronique, décentrée. Mais par l'effet même de la situation, ils ne parvenaient pas jusqu'à nous. On pouvait se procurer du fil, des boutons, de petits vêtements, qui ne sont pas rien, mais non pas l'explication approchée, lumineuse, libératrice de ce qui se passait dans le monde et, par contrecoup, chez nous.
[...]
Pierre Bergounioux, Préférences, Le Cadran ligné, 2012, np.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, préférences, temps, enfance, ombre, livres | ![]() Facebook |
Facebook |
16/03/2013
Julien Gracq, Petite suite à rêver
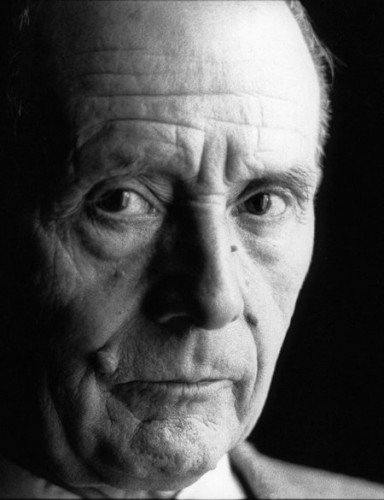
Petite suite à rêver
Sept heures du soir dans cette gare où le jour baisse, où le sol gelé rend au pas en écho l'exacte mesure de sa pesanteur. Rien de plus à chercher dans l'ancienne silhouette de ces arbres que le filigrane délié de leurs branches, comme pris dans le bristol fin d'une carte de Keepsake. Un rose théâtral à l'horizon paraphe d'un nom banal ce peu recommandable effet de neige. Ce monde borné s'accommode sans effort des pires compromissions, de la route familière de l'habitude où les pas s'enchaînent, où m'attendent le feu dans l'âtre et la campagne amicale, où le roman ouvert sur la table de jour en jour davantage s'irisera des nuances choisies des Veillées des chaumières. Il n'est plus question, décidément, de s'embarquer.
Mais le déclic soudain d'un signal resuscite en surimpression sur le quai toute une jungle. C'était rien. Paysage passionné, où le soleil mortel refond une lumière augurale comme une menace. Aux appels déchirants d'un horizon meublé de fantômes, il suffit de la brise qui secoue, entre les traverses des voies abandonnées, les pâquerettes hectiques déjà du souffle rauque des locomotives, pour soudain ranimer la mystérieuse rose des vents. Les sentiers engourdis, captivés par des reptations de lianes vont se perdre au hasard dans les sables, dans la mer. L'odeur du charbon chaud enivre comme l'air vicié des cavernes. Sous les doigts, aux pages sibyllines de l'indicateur Chaix, rongé de grilles, de lacets sinueux, d'itinéraires improbables, comme s'ouvrit la mer Rouge éclate le mot « Correspondance ! » Sur la ligne Montluçon-Grenoble, clé d'or du chiffre gras « 18 h 35 ». Le taureau de fer s'annonce avec une agitation bénigne, campagnarde, un roulement de chariots puérils comme un jeu d'enfants, encore fière du cahotement agricole accordé au rythme pastoral. Le lourd silence de la campagne rôde jusqu'aux abords du guichet dans les intervalles inégaux des chocs gourds de la pesée des bagages. Paix dérisoire, vertigineuse, miracle fragile des départs. Soudain la locomotive, folle, grisante, dépaysante comme un coup de passion au cœur d'une existence morne.
Tu ne m'aimais pas alors — et maintenant tu m'aimes.
Janvier 1942
Julien Gracq, Petite suite à rêver et autres inédits, dans Europe, "Julien Gracq", mars 2013, n° 1007, p. 8-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, petite suite à rêver, gare, locomotive | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2013
Jean Paulhan, Le clair et l'obscur

Je me suis trouvé en Quatorze, un jour d'avances et de reculs, coincé, entre quelques morts et mourants, dans une maison à demi démolie, sur laquelle s'obstinait pourtant le tir de l'artillerie — de plus d'une artillerie, car la maison, se trouvant à égale distinction des deux lignes et bien en vue, ne servait pas moins de cible à nos canons qu'aux canons adverses. Personne, de vrai, ne savait au juste qui se trouvait dedans, en sorte que, par l'effet d'une modestie commune aux hommes de guerre, chacun pensait y voir l'ennemi. Non pas tout à fait à tort, car nous n'occupions qu'une partie de la ruine. Mais il faut l'avouer, nous ne songions guère, pour le moment, à détruire nos voisins — si tant est qu'il y avait des ennemis — ni même à les chasser.
Au fait, à quoi songions-nous ? Imaginez là-dessus une lumière d'éclipse, des éclats ronflant à droite et à gauche, le bruit d'orgue que fait un obus en plein vol, un cadavre qui vous regarde sans vous voir, un cheval éclaté comme un poisson de grands fonds et, dans une poussière de pierre et de fumée que traversaient des fusées éclatantes, de tous côtés, le désordre et la dislocation.
Tout cela était étrange, mais à certains égards merveilleux. Et je dois avouer qu'il m'arriva un instant de m'en réjouir : que de feux d'artifice ! Que de châtaignes et de girandoles, de crapauds et d'acrobaties, de clowneries et de parades ! D'aimables figurants faisaient le mort à la perfection. Quel spectacle ! Est-ce donc pour moi qu'on a monté tout ça ?
C'était là sans doute une réflexion égoïste. Ce fut, en tout cas, une réflexion imprudente. Car elle déclencha presque aussitôt le sentiment irrésistible (avec l'angoisse qui s'ensuit) que je me trouvais dans quelque farce gigantesque. Non, rien là-dedans en pouvait être vrai. De toute évidence, il ne s'agissait que d'un cauchemar, dont je tentai de me tirer en donnant de grands coups de soulier dans une glace demeurée, par quel hasard ? intacte, et même brillante. La glace se fendilla, s'écailla, puis s'écroula dans un grand bruit, et je connus très bien que je ne rêvais. Je le connus, et me trouvai, chose curieuse, satisfait — en tout cas comblé. Il faut bien que la vérité — fût-elle atroce — nous soit d'un grand prix..
Jean Paulhan, Le clair et l'obscur, préface de Philippe Jaccottet, Le temps qu'il fait, 1985, p.27-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, le clair et l'obscur, philippe jaccottet, guerre de 14, fusée, glace, mort, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2013
Sébastien Smirou, C'est tout moi (Autoportraits, I)

La première fois que je vois un moi le premier miroir
je ne sais pas ni bien ni comment
que le rayons traversent l'espace
en douce du corps
jusqu'à son étendue à lui — car qui
les aurait propulsés ? — de miroir en question
jusqu'aux yeux en oblique
et qu'on me prendra si je peins
trop bien ce que je vois pour un gaucher.
*
Pour prendre la mesure au jugé du point de croix
en suspension je mets le doigt
comme sur un nœud du vide interposé — qui sait
si c'est le bon ? — qui chasse l'animal
jusqu'à buter toc-toc de l'ongle dans la confusion
pas de nœud qui tienne, bon
au troisième toc il est exactement trop tard
j'ai le compas dans l'œil qui pique
sur le premier venu du nez (encore toi ?)
Sébastien Smirou, C'est tout moi (Autoportraits, I), ink, 2009, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sébastien smirou, c'est tout moi (autoportraits, i), miroir, confusion, espace | ![]() Facebook |
Facebook |





