31/05/2015
Henri Thomas, La joie de cette vie
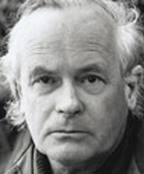
C’est une occupation de voir les nuages courir au vent, se déformer, diminuer, s’élever, s’étaler, disparaître furtivement, changer de lumière et d’ombres. Les nuages ne s’amassent pas dans le ciel à ma demande, mais presque.
Je n’ai pas vécu ce que j’écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l’écrivant — sur le mode de l’écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
C’est tellement étrange d’exister autrement qu’une plante ou un caillou, qu’il faudra peut-être s’excuser de mourir. Je suis là à six heures du matin, éveillé depuis quatre, le cœur battant, dans l’attente du jour qui sera sans doute encore obscur. Je n’ai, pour répondre de moi, que mes livres, que j’ai oubliés, après m’y être absorbé, peut-être résorbé. Ils sont pareils en cela aux amours, dont on n’a plus que le titre : un nom, un prénom, une couleur dominante ; le reste a disparu, comme l’herbe des champs, comme les lignes écrites il y a six mois ou dix ans.
Nous vivons sur (si l’on pense à la terre) ou sous (si c’est au ciel) d’anciennes terreurs, et c’est la même terreur. La chose et le mot viennent de terre ?
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 28, 30, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, nuage, écriture, réalité, vivre, amours passées, terreur | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2015
Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955

[...] Nous hériterons du mépris ou de leur tristesse, des eaux troubles, parce que notre vie sera plus vie que la leur. Mais nous enterrerons, mon amour, cet héritage.
Je t’aime, et ils choisissent tous en toi ton extrémité si belle pour te blesser et me blesser à travers toi si grossièrement, si atrocement.
Lorsque le plus haut point de la naïveté divine d’une femme sert à déchirer un homme qui l’adore, on ne peut rien dire, mon amour, rien c’est trop tout simplement en tous sens.
Il suffit que l’on confonde l’un des extrêmes grossièrement, avec ou sans veulerie, avec ou sans la lâcheté des prières, avec ou sans méchanceté attendrissante et tu perds ton centre le plus vrai, le seul vrai miracle, de bonté dure, d’amour, de vie.
Je t’aime mon amour, jamais n’effleure mon esprit ou ma peau que c’est toi qui me blesses tant, je n’ai pas assez d’humilité pour laisser la bêtise torturer ta naïveté de vierge. Si je dois mourir mon amour, je ne te laisserai pas là, si je dois vivre, je ne te laisserai pas là. Je t’aime si simplement fort.
L’orgueil est une forme d’humilité et l’humilité une forme d’orgueil.
Le centre de vie des êtres miraculeux comme toi se trouve au niveau des deux extrêmes.
Je t’aime comme personne ne t’aime et même si les longs moments de séparation que tu bâtis en toute naïveté, en tout amour me démolissent complètement, je ne t’en aimerai que plus peut-être en tout amour, en toute confiance.
Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955, Le bruit du temps, 2014, p. 565.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas de staël, lettres 1926-1955, lettre d'amour, blessure, orgueil, passion | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2015
Ariane Dreyfus, Nous nous attendons, Reconnaissance à Gérard Schlosser
« Encore une fois »
Derrière la porte il ne respire qu’à moitié
Si elle entre rien ne s’arrête
Ne s’oppose
À celle qui s’approche elle est vraie
Maintenant on peut s’ouvrir en deux
Les lèvres pas toutes seules
De toute sa figure il y va
Elle recule
Contre l’armoire l’attend, figée de désir
Pas froid chérie
Il faut poser sa robe
Ariane Dreyfus, Nous nous attendons (Reconnaissance
à Gérard Schlosser), Le CastorAstral, 2012, p. 98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aeiane dreyfus, nous nous attendons, reconnaissance à gérad schlosser | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2015
Eugène Savitzkaya, À la cyprine : recension

À la cyprine paraît en même temps qu’un roman, Fraudeur, longtemps après les poèmes de Cochon farci, en 1996, chez le même éditeur. On sait que cyprine désigne une espèce minérale, dont une variété de couleur bleue est utilisée comme pierre précieuse, mais il s’agit ici d’un homonyme ; "cyprine", dans ce livre, est le nom des secrétions vaginales provoquées par l’excitation sexuelle, en accord avec un extrait du Corps lesbien de Monique Wittig donné en exergue : « Une agitation trouble l’écoulement de la cyprine ». Donc, ces poèmes ne sont pas à proposer aux jeunes gens pubères ou, au contraire, on en encouragera la lecture, selon ce que l’on imagine que les dits pubères doivent connaître du vocabulaire et des pratiques sexuels.
Sans jeu de mots, Savitzkaya appelle un chat un chat, et l’on relèvera au fil de la lecture couilles, bite, chatte, baiser, cul, vit, con, également des expressions variées pour évoquer les parties du corps, éléments du désir, et les positions et actions des corps amoureux, par exemple "tailler une plume", "chas de l’aiguille", « babeurre suintant de la baratte », « cirer la fleur », etc. Le corps féminin est exalté, et surtout le sexe, parfois dans des vers au ton ronsardien, comme « doucement moussu de bouclettes ton ventre », mais souvent plutôt brutalement : « à grands coups de cul agite la fleurette reine ». Aux classiques métaphores végétales (« touffe », « tige », « rose ») s’opposent l’emploi recherché de « gynécée » au sens de pistil dans un poème où le corps devient fleur, ou l’inattendue qualification du vagin : « au goût de baie de genévrier ». L’homosexualité — masculine — a sa place (« maigre cul masculin / à cheval sur bâton nerveux ») parmi l’universel coït, conçu comme une dévoration : le corps de la crevette est absorbé par le poisson, lui-même par le héron, à son tour par l’air qui, enfin, disparaît dans l’univers, « vaisseau en mouvement ». La liste n’est pas close mais, si développée soit-elle, elle ne justifierait pas la lecture du recueil, la "poésie érotique" (ou prétendue telle) brodant sur quelques thèmes rebattus depuis fort longtemps. Ce sont donc d’autres caractères qui peuvent retenir le lecteur.
Tout d’abord, il peut reconnaître le bestiaire de Savitzkaya, qui définissait les animaux comme des « fragments de terre animés, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles »1 ; ils sont présents, par leur nom (mouche, pie, hirondelle, lézard, carpe, canard, moustique faisan, merle, brebis, hulotte, etc.), par ce que leur nom suggère (bouc, tourterelle, coq, dauphin — qui porte la coquille de Vénus sortie des eaux), ou comme personnages d’un récit. Ainsi, les trois cochons (l’un mâle, un autre femelle, un troisième « ange porcin ») trouvent un remède à leurs différences : « [...] tout s’aboucha, s’imbriqua / s’emboita, s’adonna, sabota, samedi / quand tout apparut ». C’est ce travail sur le son et le sens qui importe et fait exister le thème choisi. Ici, le jeu de mots d’un premier vers, « Cybèle bêle », ferait sursauter si l’on ne s’apercevait pas que le poème est organisé à partir de la récurrence de la consonne /b/ ; là, tous les vers riment en /ue/, le dernier à l’écart (« demain ») ; ailleurs, un néologisme, cofourchons, suit la série enfourchée, cofourchée, califourchon. Ajoutons l’emploi des quasi homophones (nous deux / nés d’eux), des quasi anagrammes (ovule / olive), la reprise dans un long poème de la cellule (qui + verbe) chaque fois avec le refrain « à ma porte marbrée », les jeux sur la polysémie (matrice, terme d’anatomie et de typographie), la construction syntaxique symétrique (« Si elle me le demande [...] / Si je lui demande [...] ») suivie par la position asymétrique des corps. Ajoutons encore des figures féminines, comme celles inverses d’Eulalie, la sainte violée, et d’Astrée, nom de la constellation de la Vierge dans la mythologie.
Ces éléments, parmi d’autres, donnent leur sens au recueil mais, cependant, À la cyprine n’emporte pas l’adhésion comme, par exemple, Cochon farci. L’univers si particulier de Savitzkaya est bien là, y compris avec des souvenirs d’enfance comme cette vision de l’enfant dans le pré, monté sur un jars, vision reprise dans Fraudeur, avec son obsession aussi caractère éphémère des choses et des sentiments, du temps qui passe, dès les premiers poèmes (« Elle passe, elle passe / la jolie, la jolie vie »). Sans doute est-ce l’absence d’homogénéité de l’ensemble qui gêne ; un poème sur un restaurant bruxellois ou un autre sur une bière, parmi d’autres, détonnent dans un ensemble thématique par ailleurs bien conduit, mais dont on sait qu’il est habituellement mal reçu.
1. Eugène Savitzkaya, dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991.
Eugène Savitzkaya, À la cyprine, éditions de Minuit, 2015, 104 p., 11, 50 €.
Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 18 mai.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, À la cyprine, corps, amour, désir, animaux, végétaux | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2015
Ingeborg Bachmann, Trois sentiers vers le lac

Problèmes, problèmes
« Alors à sept heures. Oui mon chéri. J’aimerais mieux. Café du Hochhaus. Parce que par hasard je... Oui, par hasard, de toute façon il faut que j’aille chez le coiffeur. À sept heures, c’est à peu près ce que je prévois si j’ai le temps de... Quoi, ah bon ? Il pleut ? Oui, je trouve aussi. Il pleut sans arrêt. Oui, moi aussi. Je suis contente. »
Beatrix souffla encore quelque chose dans le micro du combiné et posa le récepteur, soulagée elle se tourna sur le ventre et appuya de nouveau sa tête sur les coussins. Pendant qu’elle s’efforçait de parler avec animation, son regard était tombé sur le vieux réveil de voyage avec lequel jamais personne ne voyageait, il n’était effectivement que neuf heures et demie, ce qu’il y avait de mieux dans l’appartement de sa tante Mihailovics, c’état les deux téléphones, et elle en avait un dans sa chambre à côté de son lit, pouvait à tout moment parler dedans, se mettant alors volontiers les doigts dans le nez quand elle faisait semblant d’attendre posément une réponse, ou préférant encore, aux heures tardives, faire des pédalages ou exécuter des exercices encore plus difficiles, mais à peine avait-elle raccroché qu’elle était déjà rendormie. Elle était capable dès neuf heures du matin de répondre avec une voix claire et nette, et ce brave Erich pensait alors qu’elle était, comme lui, debout depuis longtemps, qu’elle était peut-être même déjà sortie et se trouvait en cette journée prête à toute éventualité.
Ingeborg Bachmann, Trois sentiers vers le lac, traduction de l’allemand Hélène Belleto, Actes Sud/Babel, 2006, p. 51-52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geborg bachmann, trois sentiers vers le lac, problème, téléphone, sommeil, regard, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2015
Gérard Macé, Les balcons de Babel

Le théâtre est bien réel, au nord éloigné d’un jardin où l’on a réuni les espèces végétales les plus rares : Assuérus Auréa, Catinat, Alice et Céleste, Cordélia, Clématis, Orion, Sirius et Cassiopée, Opéra, Châtelet, Crépuscule, Mentor et Spectabilis sont les héroïnes en pleine terre de ce théâtre naturel. Un sophora rapporté par un voyageur désœuvré, un prunus qui fleurit en avril, un arbre mâle et centenaire sont avec la maison de Cuvier, les serres tropicales, le jardin d’hiver et le petit labyrinthe, le vivarium à main gauche de l’éléphant de mer, les autres stations de cette promenade pour dieux minuscules, qui croient serrer le monde dans un mouchoir comme ils tiennent un dictionnaire dans leur main ; ici, c’est le jardin des nominations sous le ciel, dont les constellations trois à trois sont des miroirs tournants, qui nous montrent tour à tour, mais jamais dans le même ordre, les empreintes de nos rêves : la tête le père le cheval le vent les bois le coq ébouriffé la lune l’oreille le porc le tonnerre l’œil le faisan le lac la bouche la concubine le fou le souffleur le pendu.
Gérard Macé, Les balcons de Babel, Le Chemin / Gallimard, 1977, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard macé, les balcons de babel, théâtre, fleurs, labyrinthe, jardin, constellation, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2015
Sylvia Plath, Arbres d'hiver, précédé de La Traversée

Premières heures
Vide, je renvoie l’écho du moindre bruit de pas,
Musée sans statues, grandiose avec ses piliers, portiques, rotondes.
Dans ma cour jaillit et puis retombe une fontaine
Au cœur de nonne, aveugle au monde. Des lys de marbre
Exhalent leur pâleur comme du parfum .
Je m’imagine avec un vaste public,
Mère d’une blanche Nikê et de plusieurs Apollon aux yeux nus.
À la place, les morts me blessent de leurs attentions, et il ne peut [rien arriver.
Comme une infirmière muette et sans expression, la lune
Pose une main sur mon front.
Sylvia Plath, La Traversée, dans Arbres d’hiver, traductionFrançoise Morvan, précédé de La Traversée, traduction Valérie Rouzeau, Poésie / Gallimard, 1999, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d'hiver, précédé de la traversée, françoise morvan, valérie rouzeau, fontaine, lys, lune | ![]() Facebook |
Facebook |
24/05/2015
Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955

Parfois la distance de mon travail à mes rêves me fait rire, Maman, rire de moi avec tristesse. Et c’est certainement par le fait d’étudier qu’on reprend courage. Le fait qu’on peut se donner une raison de la croyance intuitive dans les grands peintres.
Qu’ont-ils fait, comment, pourquoi, quel était leur résultat après trois ans de contact non constant comme moi ?
Il faut savoir se donner une explication, pourquoi on trouve beau ce qui est beau, une explication technique.
C’est indispensable [de] savoir les lois des couleurs, savoir à fond pourquoi les pommes de Van Gogh à La Haye, de couleur nettement crapuleuse, semblent splendides, pourquoi Delacroix sabrait de raies vertes ses nus décoratifs aux plafonds et que ces nus semblaient sans taches et d’une couleur de chair éclatante. Pourquoi Véronèse, Vélasquez, Franz Hals, possédaient plus de 27 noirs et autant de blancs ? Que Van Gogh s’est suicidé, Delacroix est mort furieux contre lui-même, et Hals se saoulait de désespoir, pourquoi, où en étaient-ils ? Leurs dessins ? Pour une petite toile que Van Gogh a au musée de La Haye on a des notes d’orchestration de lui pendant deux pages. Chaque couleur a sa raison d’être et moi de par les dieux j’irai balafrer des toiles sans avoir étudié et cela parce que tout le monde accélère, Dieu sait pourquoi.
Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955, édition présenté, annotée et commentée par Germain Viatte, Le bruit du temps, 2014, p. 62.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas de staël, lettres, rêve, peintre, van gogh, delacroix, comprendre, suicide | ![]() Facebook |
Facebook |
23/05/2015
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses
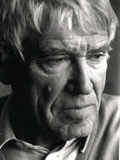
Nicolas de Staël
Tellement de force dans le geste, dans la simplicité, le dépouillement des formes, tellement de violence, d’intensité dans les couleurs qu’on est comme précipité dans l’immobilité d’une tourmente, tout à la fois transporté et cloué sur place. Plénitude et gouffre.
Désarroi de la lecture
Lire : triturer, malaxer, tordre et détordre au plus près d’une vérité qui échappe.
Des notes de lecture éparses sur la table, réduites au strict minimum, parfois plus développées, des phrases ou bribes de phrases recopiées, des réflexions adjacentes, d’inattendus croisements de chemins, une errance sans but, inquiète et captivante : le livre lu et relu se défait, soumis à une véritable mise en pièces — en vue de quelle remise en état pour l’instant douteuse, impossible, quelle reconstitution toujours à remettre en cause ?
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, Corti, 2007, p. 80, 84-85.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la rumeur de toutes choses, nicolas de staël, lecture, vérité, forme, couleur | ![]() Facebook |
Facebook |
22/05/2015
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

Reflet 1
Lèvres dévastées, le rouge vif déborde, les yeux sans fin au contour aguicheur, elle s’accroupit (pagne mauve lèvres offertes tee-shirt près du corps), regarde au loin, les traces noires autour des yeux, sourcils maladroitement repeints de la main d’une enfant, la lumière opaque, moue d’une fillette, rayons roses sur le corps, secret de la paille autour de ses cuisses refermées, elle s’imagine de l’autre côté du miroir.
Reflet 2
Les draps noirs sur les seins, dessein caché de l’autre monde. La dentelle d’une bretelle soutient la gorge dorée, dorure éternelle, les cheveux blonds, délavés par temps orageux, embroussaillés, sa bouche enflammée, le rouge dévie, regard docile presque doux (les pleurs ou le discours indicible d’une nuit blanche) elle tient au cœur du corps le drap froissé, elle, blonde à gémir, l’œil glauque et langoureux, désir tiède de l’autre corps, luxure des lumières, l’éclat de sa peau, en plein jour, émaillée.
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion, 1997, p. 103-104. © Photo Didier Pruvot.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, maquillage, seins, yeux, regard, miroir, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
21/05/2015
Hilda Doolittle, Trilogie

Hommage aux anges
[1]
Hermès Trismégiste
est le patron des alchimistes ;
sa province est la pensée,
inventive, rusée et curieuse ;
son métal est le vif-argent,
ses clients, orateurs, voleurs et poètes ;
vole donc, ô orateur,
pille, ô poète,
prends ce que la vieille église
trouva dans la tombe de Mithra,
bougie et écriture et cloche,
prends ce sur quoi la nouvelle église a craché
ce qu’elle a détruit et cassé ;
ramasse les fragments de verre brisé
et de ton feu et de ton haleine,
fais fondre et intègre,
ré-invoque, re-crée
l’opale, l’onyx, l’obsidienne,
à présent éparpillés en tessons
que foulent les humains.
H[ilda] D[oolittle], Trilogie, traduit par Bernard
Hoepffner, Corti, 2011, p. 57-58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hlda doolittle, trilogie, hermès, alchimiste, poète, voleur, orateur, mithra | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2015
Eugenio Montale, La tourmente et autres poèmes

Jour et nuit
Même une plume en volant peut dessiner
ta silhouette, ou le rayon qui joue à cache-cache
entre les meubles, répercuté du toit
par un miroir d’enfant. Sur le pourtour des murs
des traînées de vapeur allongent l’aiguille
des peupliers ; en bas sur le perchoir s’ébroue le perroquet
du rémouleur. Puis la nuit étouffante
sur la place, le bruit des pas, et toujours cette dure fatigue,
sombrer pour resurgir semblable
depuis des siècle, ou des instants, de cauchemars qui ne peuvent
retrouver la lumière de tes yeux dans l’antre
incandescent — les mêmes cris encore, les mêmes pleurs
sur la terrasse
si retentit le coup soudain qui te rougit
la gorge et brise l’aile, ô téméraire
annonciatrice d’aubes,
et que s’éveillent cloîtres et hôpitaux
au son lacérant des trompettes
(traduction Louise Herlin)
Eugenio Montale, La tourmente et autres poèmes, Poésies III, Gallimard,
1966, p. 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugenio montale, la tourmente, jour et nuit, lumière, arbres, cauchemar, aube | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2015
Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines

[...]
Pour commencer, je tourne le dos au passé, à l’enfance où il y a la mort...
Hors de ses jambes, pour que la phrase ne se referme pas...
Ce n’est pas le dernier jour... Au début, il faut écrire sans amour...
Pas question de décrire les lieux, les personnages... Pas trace d’affaire d’homme... Je refuse l’aide d’une description de la terre... Je ne tire pas profit d’une scène... d’un concours de circonstances qui m’aurait permis de franchir un grand pas... D’un trait de plume, j’écarte les événements : personne, rien... Je ne m’appuie sur personne et sur rien...
De la précarité, je fais un théâtre... Enfance encore... Difficile de s’arracher ces lambeaux d’enfance... Et cette haine qui me tient... Face au personnage féminin, je puise dans la haine mon désir de l’ouvrir... Je rêve de mise à nu, de sang... Ce n’est pas une violence mauvaise... C’est mon amour, de très loin, hors de portée des lèvres... Je dis mon amour, étourdi encore, désarmé par le bruit d’un pas... Désarmé comme par le fracas, plus haut, de la caisse... J’ai fait un pas et, à chaque pas, s’enfonce une dernière demeure.
J’ai fait un pas et rêve d’un autre pas comme au début de la vie... Presque la force d’écrire à bout portant...
Je parle du premier pas à partir de la mort... Un temps lointain... Quelques arpents de terre où j’aurais trouvé ma nourriture... Toute une histoire... Je me souviens de quelques pas perdus... Et de la peur, rencontrée à chaque coin de phrase...
[...]
Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines, dans L’introduction de la pelle, Seuil, 2014, p. 357-359.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, dix pas avant les ruines, enfance, écrire, peur, récit, personnage | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2015
Amelia Rosselli (1930-1996), Document 1967-1973

à Schubert
Une mélodie couleur orange avait retenti
dans mes oreilles si attentives au solfège
d’un violon assez net pour me toucher
jusque dans mes fibres nerveuses (le
grand cœur) qui ma tiraient par les cheveux
pendant que je dansais avec la mélancolie ce
soir-là où je n’avais pas de rendez-vous.
Mélodie éternelle et inexplosée, mélodie
de sentiments qu’on ne peut pas violer
dans le secret tombal de l’apôtre : apôtre
de quoi ? — d’une quasi désespérée quelquefois
allègre, exposition de vos tableaux
mentaux, sentimentaux et ordinaires : l’amour
dans une boîte bien fermée n’eut pas le temps
de demander pardon.
Amelia Rosselli, Document 1966-1973, traduction de
l’italien et postface de Rodolphe Gauthier, La Barque,
2014, p. 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amelia rosselli (1930-1996), document 1967-1973, schubert, mélancolie, mélodie, sentiment, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
17/05/2015
Tristan Corbière, Las Amours jaunes

À un Juvénal de lait
Incipit, parve puer, risu cognoscere
À grands coups d’aviron de douze pieds, tu rames
En vers... et contre tous — Hommes, auvergnats, femmes. —
Tu n‘as pas vu l’endroit et tu cherches l’envers.
Jeune renard en chasse... Ils sont trop verts — tes vers.
C’est le vers solitaire. — On le purge. — Ces Dames
Sont le remède. Après tu feras de tes nerfs
Des cordes-à-boyaux ; quand, guitares sans âmes,
Les vers te reviendraient, déchantés et soufferts.
Hystérique à rebours, ta Muse est trop superbe,
Petit cochon de lait, qui n’as goûté qu’en herbe,
L’âcre saveur du fruit encore défendu.
Plus tard, tu colleras sur papier tes pensées,
Fleurs d’herboriste, mais, autrefois ramassées,
Quand il faisait beau temps au paradis perdu.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros,
T. C., Œuvres complètes, édition établie par Louis Forestier
et Pierre-Olivier Walser, Pléiade / Gallimard, 1970,
p. 764-765.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, las amours jaunes, juvénal, sonnet, rimes, vers, muse, paradis pardu | ![]() Facebook |
Facebook |






