18/12/2012
Robert Duncan, L'ouverture du champ
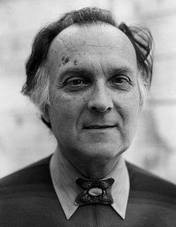
Commencement de l'écriture
une composition
Commencer à écrire.
Continuer enfin à écrire.
Écrire enfin pour continuer à commencer.
Surmonter le commencement.
Surmonter l'urgence.
Surmonter l'écriture en écrivant.
Ne jamais surmonter le commencement.
Écrire maintenant l'écriture.
Ne pas surmonter en commençant.
*
L'amour parfois progresse et admet. L'amour parfois surmonte et ne commence pas. L'amour comme élément permanent de certaines écritures imagine qu'aimer se développe pour admettre le commencement comme continuation.
Désir : hors de l'écriture. Urgence : hors de l'écriture. Poser l'attente n'est pas l'écriture. Désir est l'avant non-commençant du commencement. Urgence est un non-sentiment d'enfin commencer.
*
Quand je m'imagine ne pas surmonter mais admettre, aimer a lieu au lieu du désirer. Quand je m'imagine le commencement quotidien continuant, l'être n'est plus reformation mais répétition.
Le géant de toute la journée c'est l'éveil.
Le géant de toute la nuit c'est le sommeil.
Être un univers ! Être un univers !
Pris dans son discours continu.
Être renvoyé au rêve.
Quand je m'imagine en amant
L'Amour est revenu, je le dis, ici,
revient encore de Jour
de l'appétit pur, appartenant
au dire.
Le matin prend
le silence quand les mots parlent,
monologue au silence audible.
*
Un monologue ! Un monologue !
paroles oisives aux lumières bigarrées, illusions
de personne imaginée, en personne.
Le grand Pajambour roule son être éternel comme un roulement
de tambour
aux mesures d'un sommeil désordonné.
Discours désordonné.
Robert Duncan, L'ouverture du champ, traduction de Martin Richet,
José Corti, 2012, p. 33-34.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert duncan, l'ouverture du champ, écriture, amour, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
17/12/2012
Caroline Sagot Duvauroux, Le livre d'El d'où
Caroline Sagot Duvauroux et Jean-Louis Giovannoni, lecture à la librairie José Corti.
[...]
Ensuite je dirai c'est un poème mais n'en suis pas très sûre. Une conversation peut-être. De chaque chose je me suis servi pour qu'explosent des bulles à mes yeux surpris. Un jour je dirai l'histoire des amours affreuses qui peuplent les belles amours et puis un autre jour je tirerai la langue des langues despotiques. Mon chien parlera, tiens, pour te faire rire et avec toi, tous les anonymes que tu fus et que tu protégeais de moi et des langues mortes d'en savoir trop. Mais si je peux — le pourrai-je — j'écrirai le poème, il te regarde, le poème. Dans la prison de Bapaume les grands escogriffes aux yeux vides empruntent les recueils pour trouver des phrases belles pour leurs chéries. Ils avouent : Nous recopions. Je recopierai les vers qui traînent entre l'arme et la plaie. Si je ne le peux pas, si je ne sais pas, tu diras ce n'est pas très important en caressant mon corps mourant. Tu ne caresseras pas mon corps mourant.
*
[...]
Quelques autistes tranchent leurs mots au tranchant des distances. À ras le monde soudain. C'est là que la distance opère la langue. À ras. La mutile de tout le monde soudain. Mais aucun ne renonce. Le silence soudoie la linéarité de l'expression. Tout est possible soudain. Là gonfle dans mille directions. Le soudain monde.
Le silence serait-il l'enjeu de la parole ?
Alors la terre rouge naît du vert. La promenade déroule les épisodes du paysage dans le temps de la marche. C'est en couleur. Dans le temps de nos écrits, c'est noir et blanc. À cause du mauvais temps, sans doute, car on tourne en technicolor. On dit Vert dans le temps qui va. On arrache un pied à l'appui d'ensuite et le passé parle, les morts parlent. Ça sort de ligne, ça lève, c'est de l'annonce aussi, de l'ivraie, de l'ongle. Alors les temps tracent l'ébauche d'une langue de foin, de larmes, de poussière ; de jonchée. Des temps tournent bosse la terre se creuse, l'eau coule au front. La poésie ravine un principe linéaire.
*
Les mots du poème cherchent dans l'affinité avec la chose dont ils se séparent, le retour, la conversion dans la propulsion. Que la chose les expulse, soit, les exile, mais aussi les suinte, les épouse, les jouisse... rosée. Un instantané que révèle l'eau jaillissante. Un baptême de rosée ? La phrase cherche à exister quelque chose plus qu'à exister. Un écho rote sous la phrase les quelques mots qui font la phrase. Les sanglots des rouleaux qui n'aborderont pas. Ça remonte d'un mufle extravagant, ça reflue d'abordage, la langue du sanglot.
Caroline Sagot Duvauroux, La livre d'El d'où, José Corti, 2012, p. 46, 74-75 et 126.
©Photo Tristan Hordé.
Sur les livres de Caroline Sagot Duvauroux, on peut lire un article du poète Serge Ritman (Serge Martin) à l'adresse:
http://martinritman.blogspot.fr/2011/11/cacophonie-vs-polyphonie-ou-la.html
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, le livre d'el d'où, poème, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
16/12/2012
Paul Éluard, La vie immédiate

Maison déserte
abominables
Maisons
pauvres
Maisons
Comme des livres vides
*
Le temps d'un éclair
Elle n'est pas là.
La femme au tablier guette la pluie aux vitres
En spectacle tous les nuages jouent au plus fin
Une fillette de peu de poids
Passée au bleu
Joue sur un canapé crevé
Le silence a des remords.
J'ai suivi les murs d'une rue très longue
Des pierres des pavés des verdures
De la terre de la neige du sable
Des ombres du soleil de l'eau
Vie apparente
Sans oublier qu'elle était là
À promener un grand jardin
À becqueter un murier blanc
La neige de ses rires stérilisait la boue
Sa démarche était vierge.
Paul Éluard, La vie immédiate [1932], dans Œuvres complètes, I, préface et chronologie de Lucien Scheler, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, p. 391 et 396-397.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, la vie immédiate, pauvreté, le temps d'un éclair | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2012
Adonis, Chronique des branches

Miroir du chemin, Chronique des branches
I
Non pas l'estuaire des miroirs,
non pas la rose des vents.
Toute chose est une aile
ascendante dans mon sang,
dans les champs,
nageant dans l'orbite des saisons.
J'ai fait de mon visage le frère de l'herbe
et mes pas se sont livrés à la nostalgie
des miroirs.
J'ai vu les éléments pleurer, ouvrir
entre nous la blessure fraternelle.
J'ai reconnu le signe attestant
que je suis prélude à l'annonciation,
plante de l'Orient au jardin de la prophétie.
Non pas l'estuaire des miroirs,
non pas la rose des vents.
Toute chose est chemin,
les frontières et leurs étendards,
la rencontre et son ascension,
la voix, ma voix dans mes paumes,
les oiseaux qui s'éloignent
et laissent leurs noms parmi les branches,
les branches et leur histoire.
Adonis, Chronique des branches, traduit de l'arabe
par Anne Wade Monkowski et présenté par
Jacques Lacarrière, édition bilingue, Orphée /
La Différence, 2012, p. 47 et 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adonis, chronique des branches, miroir, chemin, prophétie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende (recension)

L'écriture du paysage
Le paysage est sans légende rassemble cinq poèmes, chacun composé de plusieurs suites de vers, qui composent un récit singulier et dont l'unité répond à celle des dessins (encre de Chine et aquarelle) de Guy Calamusa. La particularité du récit provient de son motif, exploré d'autres manières dans une partie importante de l'œuvre : que peut-on écrire (ou dessiner) de ce que l'on a vu ? Qu'est-ce qui, d'une expérience, peut être restitué par les mots ? Le titre semble donner une réponse, si "légende" désigne une note explicative : rien de juste ne sera dit — ce que confirme, inscrit avant la page titre, la mention Le vrai titre s'est effacé.
Le livre s'ouvre sur la description d'un paysage dessiné dans laquelle, pour le lecteur, tout apparaît lisible, soigneusement cerné, visible : le vert y domine et s'y détachent des formes. Cependant, cette reconstruction du paysage par les lignes et les couleurs et par la mémoire n'est guère satisfaisante pour James Sacré ; le temps passant, venu le moment de l'écriture, les mouvements observés avaient perdu de leur réalité et il devenait impossible de leur redonner un sens, comme si tout ce qui avait été vu, vécu, s'était défait, que les différents éléments du paysage — les pentes, les vallées, les arbres — et les femmes qui y travaillaient ne pouvaient être mis en place, que la tentative du regard sur le passé était vouée à échouer : tout se perdrait dans le vert, couleurs à peine présente sur le dessin. On relève au fil des pages les verbes qui traduisent la difficulté, voire l'impossibilité, de tenir ensemble les différents moments du temps, à associer les pièces d'un espace qui se dérobe : brouiller, trembler, déchirer, détruire, (se) défaire.
Plus loin, quand on lit « Je me rappelle très bien », suivi d'un embryon de description, vient rapidement le regret de ne maîtriser que de « fragiles souvenirs » ; on ne peut plus vraiment distinguer les éléments perçus, il s'agit seulement de « silhouettes » — et l'on passe à « J'ai cru reconnaître », mais il ne reste plus qu' « une broussaille / De ratures ni dessin ni rien d'écrit »(1). Il y a une perte irréparable, puisque rien ne peut faire que ce qui constituait un ensemble ne soit pas, dans l'écrit ou le dessin, en désordre. Cette relation du paysage réel, dans lequel on a vécu, et de l'écrit est décevante, et les traits sur la page ne parviennent pas mieux que les mots à approcher la réalité — « Quelqu'un n'est plus/ Qu'un léger dessin de rien ». C'est aussi vers le rien que s'abîment les jours de l'enfance, qu'elle soit ou non mise en parallèle avec le présent ; dans les écrits de James Sacré, un passage s'effectue aisément entre le présent (celui par exemple du travail agricole au Maroc) et le passé (celui de la ferme des parents) : mêmes gestes, rapport aux choses analogue, mais « presque tout / Disparaît dans un poème ».
James Sacré, répondant à la question "Où écrivez-vous ?"(2), précise qu'au moment de l'écriture à sa table, de la reprise de brouillons, interviennent
le souvenir et toute une activité de la mémoire qui mêle à d'anciens sentiments de présence ceux désormais de l'absence et de l'éloignement, de la perte des lieux et des visages, des temps et des espaces ... même quand c'est dans le plus grand effort de continuité avec le "brouillon" d'abord vécu autant qu'écrit. (p. 47)
Sans doute, c'est dire que « Le monde nous échappe. Et puis / Notre désir aussi » ; ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en inquiéter, la poésie n'est pas vouée à fixer les formes des paysages ni à être lieu de mémoire. La re-présentation déçue, le fait qu'écrire n'aboutit — en apparence — qu'à de « minuscules machines de mots pour rien dire », n'empêche pas le poème d'être là, sans qu'il ait pour sujet on ne sait quelle impossibilité de dire quelque chose du réel. Peut-être échoue-t-on dans le désir de fixer une figure stable des choses, mais reprendre inlassablement l'arrangement des mots — des lignes — aboutit à donner un regard sur le monde, si fragmenté qu'il apparaisse ; on pense évidemment à Giacometti qui affirmait : « Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais qu'une pâle image de ce que je vois »(3). Il y a toujours chez James Sacré le désir de faire entendre « Le bruit ténu du vivant », et si difficile soit-il à restituer, il est là :
On nomme des endroits de ce monde
L'oued Bouskoura, la rivière Vendée
Un nom de village ou plusieurs choses
Une échelle un puits des noms des mots
Comme pour mieux se tenir au monde
Avec un dessin c'est pas mieux, tout s'éboule
Et pas grand chose
Qui reste dans les mains. Quand même
On est bien.
James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,
Al Manar / éditions Alain Gorius, 48 p., 16 €.
© Photo Tristan Hordé.
1 Ce qui établit une continuité avec les livres précédents : par exemple, Broussaille de prose et de vers (où se trouve pris le mot paysage), publié en 2006 (éditions Obsidiane), abordait aussi, d'une autre manière, le motif de la perte.
2 dans fario, n°11, printemps-été 2012.
3 Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1992, p. 84.
Publié dans RECENSIONS, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, souvenir, description, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2012
Jean-Claude Pirotte, Cette âme perdue
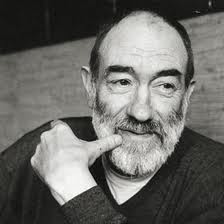
la mort s'approche à petits pas
c'est la tortue je suis le lièvre
on voit luire sa carapace
merveilleusement ciselée
et ses yeux aux lourdes paupières
simulent une somnolence
de personnage centenaire
dans un refrain de romance
gothique ou dans un roman noir
écrit par madame Radcliffe
on garde peut-être en mémoire
une ode de William Cliff
on conjure avec les moyens
du bord l'avenir immédiat
on lit deux vers d'Armand Lubin
courir vite ne sert à rien
on avance ainsi pas à pas
de borne en borne vers le lieu
où la tortue vous attendra
en ouvrant largement les yeux
Jean-Claude Pirotte, Cette âme perdue,
Le Castor Astral, 2911, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, cette âme perdue, la mort, william cliff, armand lubin | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2012
Marie de Quatrebarbes, Les pères fouettards me hantent toujours

12
On se vêt et dévêt, des matins gris
Il y a des trucs que tu laisses en bas de la page
Tu jettes l'eau de la casserole, mise à sac
On ne pourrait pas se comprendre, s'appesantir
On dirait « il y a des trucs qui traînent un peu partout »
Un froid me mange, fait battre mes paupières
Comme dans le vent, coller au bout des doigts
Nous sommes dix en un même cœur
« Il est où l'animal »La fille entraperçue
Elle est passée à l'orange, quand le feu est arti
Et c'est bien ça la vie un long bruit de succion
Trace sur la longueur, votre bouche ovale
Que l'altitude relève les saveurs
Les caresses ne laissent jamais de traces
Et si je tourne la page, elles retombent
Du peu de vie au prix des confitures
Il a la dent dure et mes nuits sont trop courtes
Je me lève le matin pour tout recommencer
Mon corps s'étiole, les deux morceaux scintillent
Ma poitrine se soulève, une main dans l'été
J'allais les bras ballants sans le vouloir
La torsade du temps me rappelle aux ondes noires
Je ne pensais pas découvrir
Ce que rencontrant, comprenant
À quel point fort lorsqu'immanent
Loin de s'abattre comme un jugement
Il se construit au gré du vent
Comme un tout petit enfant
Marie de Quatrebarbes, Les pères fouettards me hantent
toujours, Lanskine, 2012, p. 48-50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les pères fouettards me hantent toujours, des trucs, la vie ordinaire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2012
Ludovic Degroote, Monologue

[...]
tout l'amour que ma mort a consolidé entre nos parents n'a pas empêché de les perdre chacun dans une douleur qu'ils ne pouvaient exprimer à l'autre qu'à travers du silence, par pudeur, ou par crainte de l'envahir, d'aviver sa peine, ou de je ne sais quoi qui aurait nécessairement accru cette douleur
ma disparition a créé beaucoup de souffrance et ça me fait mal, j'aurais bien évidemment préféré vivre, faire vivre les autres, mais j'ai pris toute la place, ma mort les a plongés dans ce lieu commun où chacun se sépare, prenant appui contre son propre vide, je n'ai jamais rien réclamé
nous avançons dans le monde comme des êtres disparus
et nous replions dès qu'on s'imagine que notre monde intérieur ne nous expose pas, car nous sommes devenus dans une histoire qui nous dépasse et que je te laisse continuer avec la sincérité trompeuse qui semble nous donner de la profondeur et nous articuler si loin en nous que nous croyons établir un espace où chacun de nous deux ne serait plus seul
alors que dans ces vies incluses que leur silence contient il est difficile de s'entendre
[...]
Ludovic Degroote, Monologue, Champ Vallon, 2012, p. 24-25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, monologue, disparition, douleur, vie intérieure | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2012
Jean-Paul Michel, Je ne voudrais rien qui mente dans un livre
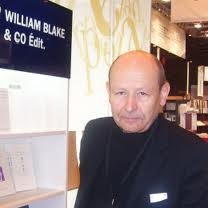
La vie est une brûlure, pas un calcul
IV
Des oliviers plantés avec soin devant nos yeux couvrent
comme une mer la sèche
montagne. Les hommes, ainsi, habitent,
de leur talent l'espace entier du vivable ils
façonnent un visage tenable devant
le chaos des monts : c'est
la torche qu'ils allument leur
poème — devant le tout de l'être, avec modestie,
ferveur. Cette poursuite de travaux salubre est
leur arque. Une cloche soudain taille dans le silence un
ordre On remercie, reconnaissant, de
ce qu'une musique humaine puisse
borner le silence donné — ce don
d'un monde plus grand et
meilleur
Ces signes ne sont pas sans portée. Puisses-tu
carillon matinal valoir métaphore pour
un signe vers
le tout de l'être en sa beauté terrible — d'un coup surgi
surgi
attisant nos désirs ! Puisses-tu
poème comme un cri scander
à l'égal de ces notes dans l'aube — et, comme elles, d'assez
de portée un chant
pur
À cette condition, la parole n'aurait pas été chose vaine
Penser est habiter. Il n'y a d'autre mesure que la parole
L'Être n'a pas de plein La vérité est son voile Chaque
possibilité nouvelle de la parole, de ce voile, un pli
nouveau. Chacun de ces plis porte
le chiffre d'un poète.
Jean-Paul Michel, Je ne voudrais rien qui mente dans un livre,
Flammarion, 2010, p. 250-251.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, je ne voudrais rien qui mente dans un livre, parole, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2012
Pierre Reverdy, Chair vive

Chair vive
Lève-toi carcasse et marche
Rien de neuf sous le soleil jaune
Le der des der des louis d'or
La lumière sui se détache
sous les pellicules du temps
La serrure au cœur qui éclate
Un fil de soie
Un fil de plomb
Un fil de sang
Après ces vagues de silence
Ces signes d'amour au crin noir
Le ciel plus lisse que ton œil
Le cou tordu d'orgueil
Ma vie dans la coulisse
D'où je vois onduler les moissons de la mort
Toutes ces mains avides qui pétrissent des boules de fumée
Plus lourdes que les piliers de l'univers
Têtes vides
Cœurs nus
Mains parfumées
Tentacules des singes qui visent les nuées
Dans les rides de ces grimaces
Une ligne droite se tend
Un nerf se tord
La mer repue
L'amour
L'amer sourire de la mort
Pierre Reverdy, Bois vert (1948-1949), dans Œuvres
complètes, II, édition préparée, présentée et annotée
par Étienne-Alain Hubert, 2010, p. 448-449.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, chair vive, la vie, signes d'amour | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2012
Jean Genet, Le condamné à mort
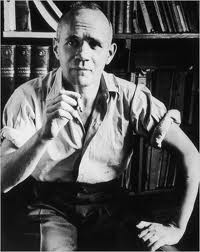
Le condamné à mort
[...]
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou
Que ma main plus légère et plus grave qu'une veuve
Effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve,
Laisse tes dents poser ton sourire de loup.
Ô viens mon beau soleil ô viens ma nuit d'Espagne,
Arrive dans mes yeux qui seront morts demain.
Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.
Mène-moi loin d'ici battre notre campagne.
Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir,
Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire
Accueillir la rosée où le matin va boire,
Le clocher peut sonner : moi seul je vais mourir.
Ô viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde !
Visite dans sa nuit ton condamné à mort.
Arrache-toi la chair, tue, escalade, mords,
Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde.
Nous n'avion pas fini de nous parler d'amour.
Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes.
On peut se demander pourquoi les Cours condamnent
Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Amour viens sur ma bouche ! Amour ouvre tes portes !
Traverse les couloirs, descends, marche léger,
Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger,
Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes.
Ô traverse les murs ; s'il le faut marche au bord
Des toits, des océans ; couvre-toi de lumière,
Use de la menace, use de la prière,
Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Jean Genet, Le condamné à mort, dans Le condamné à mort,
L'enfant criminel, Le funambule, L'Arbalète, 1958, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le condamné à mort, amour, assassin | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2012
Roberto Juarroz, dixième poésie verticale
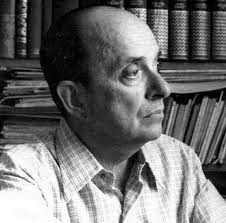
La folie de ne pas être fou,
de repousser le bras tendu
les zones intérieures
où guette le marécage,
fait parfois fouler
les pieds abandonnés.
Ne pas être fou
à certains moments,
ressemble trop à la folie.
Excessive, insupportable intensité,
se défendant à la fois des tignasses flottantes
et des cheveux intolérablement lisses.
Il est nécessaire, de temps en temps,
de se reposer de ne pas être fou.
La locura de no estar loco,
de rechazar con el brazo estirado
las zonas interiores
donde aguarda la ciénaga,
hace pisar a veces
los pies abandonados.
No estar loco,
en algunos momentos,
se parece demasiado a la locura.
Excesiva, insoportable ntensidad,
defendiédose a la vez de las greñas flotantes
y del cabello intolerablemente liso.
Es precisa, cada tanto,
descabsar de no estar loco.
Roberto Juarroz, dixième poésie verticale,
traduction de François-Michel Durazzo,
José Corti, 2012, p. 129 et 128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto juarroz, dixième poésie verticale, poésie argentine, folie | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2012
Georges Lambrichs, Pente douce

Une confidence
L'habitude se reconnaît dans un circuit mental rapide et paresseux. Rapide : il est commode, en effet, d'abréger ce qui ne mérite pas de soutenir l'attention au profit d'une disponibilité de l'esprit. Et paresseux : qui peut empêcher d'apercevoir à temps le saugrenu qui menacerait l'ordre du sommeil. D'ailleurs, à quel défaut de sa naissance l'habitude serait-elle prise qui pourait la faire considérer à juste titre comme une nouvelle attendue ?
Venant de Saint-Malo — où l'on avait retrouvé, en pleine dérive, un ami frappé par le chagrin , lui connaissait-on d'autre lien que celui qu'il venait de rompre ? mais il devait avoir son idée là-dessus — on flânait dans Dinan, débouchant place Du Guesclin qu'on n'avait pas cherchée, quand faussant compagnie sans autre explication, je le vois s'introduire dans la boutique d'un bourrelier.
Après une attente forcée devant la vitrine où étaient exposés fouets et cravaches, nerfs de bœuf et sachets de sable, tous obets d'autant moins fascinants qu'ils sont montrés à l'état neuf, je l'aperçus qui sortait quelque peu rougissant avec un paquet blanc en fuseau tellement bien ficelé qu'on ne pouvait à première vue soupçonner ce qu'il contenait. Passé le moment de stupeur et de rire mêlés, je me dis qu'il reprenait goût à la vie et qu'il avait probablement l'intention à sa manière de rechercher un contact avec ce qui avait bien failli mourir.
[...]
Georges Lambrichs, Pente douce, nouvelles, préface de Jean Roudaut, éditions de la Différence, 1983 [1972], p. 31-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, pente douce, jean roudaut, confidence, dépression | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2012
Jean Bollack, une traduction de Sappho
En hommage à Jean Bollack, philosophe, philologue et critique, décédé le mardi 4 décembre 2012.
On trouvera une biographie et une bibliographie sur le site www. jeanbollack.fr
Une traduction de Sappho par Jean Bollack :
Aphrodite, sur ton siège chatoyant, immortelle,
Fille de Zeus, tressant des pièges,
Souveraine, je te supplie, ne paralyse pas mon esprit, ni dans la lassitude,
Ni dans la souffrance.
Viens ici. Une autre fois, à un autre moment,
Tu as entendu mes paroles au loin,
Et tu m’as écouté. Tu as quitté la demeure en or
De ton père, et tu es venue.
Tu as attelé ton char ; ils se sont faits beaux, les rapides
Moineaux, qui te conduisaient autour de la terre noire,
Tournant dru ; le tourbillon de leurs ailes est parti du centre
Du ciel, traversant l’éther.
En un instant, ils étaient là. Et toi, la bienheureuse,
Avec tout le sourire d’un visage d’immortelle
Tu m’as demandé ce que je subissais encore, et ce qui
Encore faisait que je t’appelle,
Et ce que c’est que je veux le plus qu’il m’arrive
Dans mon esprit en délire. « Qui est-ce qu’encore je dois
Persuader de te conduire, toi aussi, dans ton amour ?
Qui est-ce
dis, ô Sappho, qui te maltraite ?
C’est sûr : si elle évite, vite elle courra après
Et si elle refusait les cadeaux, elle en donnera.
Et si elle n’aime pas, vite elle aimera,
Serait-ce contre sa volonté ».
Viens à moi, maintenant aussi, et libère-moi de mes atroces
Soucis, et tout ce dont mon esprit
Désire l’achèvement, achève-le. Et toi, en personne,
Sois mon alliée.
(Sappho, fragment 1 Lobel- Page)
© Photo Tristan Hordé. Jean Bollack en avril 2010.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, sappho, poésie grecque, antiquité, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2012
Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé)

à ma mère
alors poème
– enfant en moi de sept mois n’était pas un
non-parlant mais ce
tout-oreille
qu’effondra en lui-même
aussi bien commença
l’extrême silence d’une
(bien que revenue) disparue-mère
l’indispensable qui (don de langue)
fait sol
et
sens – a
lors poème
(persiste
ce mouvement tiers cette absence
– réel l’impossible retour n’efface
pas le manque fracturant et fondant
aujourd’hui)
ce tout multiple – poème – possiblement
disjoncte
Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé),
Flammarion, 2005, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, l’inadéquat (la langue crée le dé), la mère, poème | ![]() Facebook |
Facebook |







