18/11/2012
Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope et autres poèmes
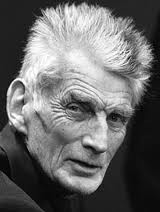
Aboulez !
Faites en l'offrande bazardez tout
le Golgotha n'était que l'œuf factice
cancer angine poitrine tout nus est bon
crachez-nous votre tuberculose ne soyez pas radin
aucune broutille n'est trop insignifiante pas même une thrombose
toutes maladies vénériennes seront particulièrement les bienvenues
cette vieille toge dans la naphtaline
ne soyez pas sentimental vous n'en aurez plus besoin
balayez-la aussi nos la mettrons dans la marmite avec le reste
avec votre amour partagé et non partagé
les choses saisies trop tard les choses saisies trop tôt
l'esprit qui souffre scrotum de taureau châtré
vous ne le guérirez pas vous ne le supporterez pas
c'est vous c'est la somme de votre être le premier imbécile venu est
forcé d'avoir pitié de vous ]
alors empaquetez cet ensemble purulent et expédiez-nous ça
toute la souffrance diagnostiquée mal diagnostiquée
demandez à vous amis de faire de même nous saurons l'utiliser
nous y attacherons sud sens nous mettrons cela dans la marmite avec
le reste ]
tout se réduit alors en sang de l'agneau
(1938)
Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope et autres poèmes, traduit de l'anglais et présenté par Édith Fournier, Les éditions de Minuit, 2012, p. 30-31.
Ooftish
offer it up plank it down
Golgotha was only the potegg
cancer angina it is all one to us
cough up your T.B. don't be stingy
no trifle is too trifling not even a thrombus
anything venereal is especially welcome
the old toga in the mothballs
don't be sentimental you won't be wanting it again
send it along we'll put it in the pot with the rest
with your love requited and unrequited
the things taken too late the things taken too soon
the spirit aching bullock' s scrotum
you won't cute it you won't endure it
it is you it equals you any fool has to pity you
so parcel up the whole issue and send it along
the whole misery diagnosed undiagnosed misdiagnosed
get your friends to do the same we'll make use of it
we'll make sense of it we'll put it in the pot with the rest
it all boils down to blood of lamb
(1938)
Samuel Beckett, dans Collected poems, 1930-1978, Londres, John Calder, 1984, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, peste soit de l'horoscope, abandon | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2012
Francis Ponge, Prose ou poésie
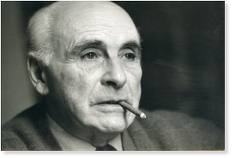
Prose ou poésie
Bien sûr j'ai lu les Poèmes en prose de Baudelaire et les proses de Mallarmé dans Divagations : sont-ce des poèmes en prose ? Cette antinomie entre poésie et prose est un non-sens. [...] J'aime Connaissance de l'Est de Claudel, mais non pas Les Nourritures terrestres de Gide, un livre que l'on peut appeler de prose poétique. Le fait qu'il n'y a plus de règles fixes de prosodie, proésie, signifie qu'il est impossible de classer intelligemment des proses comme poèmes et d'autres non. Une des premières anthologies de poèmes en prose d'après-guerre s'achève, je pense, sur moi. [...] L'anthologie commençait avec Parny au XVIIIe siècle. Ensuite venaient Aloysius Bertrand, Michaux, moi-même. Mais mes textes critiques, mes textes sur les peintres par exemple, sont tout aussi difficiles, souvent plus difficiles, à écrire que ceux considérés comme poétiques. Je ne fais pas de différence. Mes audaces et mes scrupules sont les mêmes, quelque genre que vous assigniez au texte. Mon premier recueil, publié en 1926, s'intitulait Douze petits écrits et s'ouvre avec trois ou quatre po... choses que l'on peut considérer comme des poèmes, si cela vous plaît.
Francis Ponge, "entretien avec Anthony Rudolf", 4 mai 1971, Modern poetry in Translation, n°21, juillet 1974, dans Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, traduction de l'anglais par Bernard Beugnot, p. 1409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, prose ou poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2012
Andrea Zanzotto, Idiome
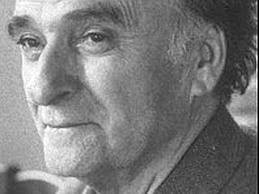
Écoutant depuis le pré
Sur la touche, le doigt anéanti insiste
sur une note toujours ratée
et pourtant inhumainement juste
au-delà de tout exemple réussie
Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,
puis, il s’estropie, en un mouvement
de trille raté
au-delà de tout exemple
néanmoins reréussi
Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie
parvient sur cette note, sur ce doigt
énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,
qui veut la prendre en charge, donner crédit
à une partition universelle possible,
déverser d’une bande enregistrée
dans une autre
non moins mythique instrument
une adresse ou une déclaration d'expéditeur
insistante comme bec de pic-vert,
c’est sur ce doigt que tape l’offre,
sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,
et, toujours creusant sur cette touche,
et toujours la ratant, dans la déserte
réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,
son obstination contre tout pourquoi,
son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,
ajuste, devine
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan
(Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idome | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2012
Emily Dickinson, Le vent se mit à bercer l'herbe, traduction Pierre Leyris

Le vent se mit à bercer l’Herbe
Le Vent se mit à bercer l’Herbe
Avec des Airs de Basse grondeuse —
Lançant une Menace à la Terre —
Une Menace au Ciel.
Les Feuilles se décrochèrent des Arbres —
Et s’égaillèrent de toutes parts
La Poussière se creusa elle-même comme des Mains
Et dispersa la Route.
Les Chars se hâtèrent dans les Rues
Le Tonnerre se rua lentement —
L’Éclair exhiba un Bec Jaune
Et puis une Griffe livide.
Les Oiseaux verrouillèrent leurs Nids —
Le Bétail s’enfuit vers les Granges —
Vint une goutte de Pluie Géante
Et puis ce fut comme si les Mains
Qui tenaient les Barrages avaient lâché prise
Les Eaux Dévastèrent le Ciel,
Mais négligèrent la Maison de mon Père —
N’écartelant qu’un Arbre —
The Wind begun to rock the Grass
The Wind begun to rock the Grass
With threatening Tunes and low —
He threw a Menace at the Earth —
A Menace at the Sky.
The Leaves unbooked themselves from Trees —
And started all abroad
The Dust did scoop itself like Hands
And threw away the Road.
The Wagons quickened on the Streets
The Thunder hurried slow —
The Lightning showed a Yellow Beak
And then alivid Claw.
The Birds put up the Bars to Nets —
Ther came one drop of Giant Rain
And then as il the Hands
That held the Dams had parted hold
The Waters Wrecked the Sky,
But overlooked my Fathers’s House —
Just quartering a Tree —
Emily Dickinson, traduction Pierre Leyris dans son Anthologie
de la poésie américaine du XIXe siècle, édition bilingue, Gallimard,
1995, p. 332-333.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, le vent, l'herbe, l'orage, la pluie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2012
Christiane Veschambre, Après chaque page

On n'écrit pas pour se bâtir un "soi" — je n'écris pas pour devenir "moi".
On n'écrit pas plus pour "s'emparer du monde", ainsi que le dit un article rendant compte du roman "événement de la rentrée" (septembre est aussi le mois de la rentrée dite littéraire en France). Le journaliste se félicite de cette détermination de l'auteur, et de ce que, en même temps, son livre "invite à rester soi".
C'est d'abord désemparé, dessaisi qu'on vient à écrire. Dessaisi de tout contenu préalable, de toute forme reconnue. Dessaisi du rassurant partage forme / contenu. Aussi y a-t-il peu de chances pour que le livre qui naîtra peut-être de cet "espace vide", comme le nommait Peter Brook en parlant des conditions nécessaires du travail théâtral, fasse partie des "romans de la rentrée".
Quelque chose du "moi" et du "monde" s'effrite, s'écroule, se dissout. La lumière de septembre (m') ouvre l'espace intérieur et extérieur, au-dedans et au-devant de moi, qui délivre des confrontations dialectiques, quelque chose veut, comme un animal caché sous la terre, sous l'eau ou dans la grotte, surgir et le traverser, cet espace, et c'est avec des mots qu'il me faut le laisser venir. Lui qui vient d'un monde sans mots, sans catégories, sans intentions.
Et il disparaîtra. Ce qui surgit, toujours disparaît. Ça s'appelle la Vie. Ça ne se capture pas, ça ne se construit pas, ça ne se crée pas. Ça peut nous traverser, ça peut redonner vie, imprévisible, inassignable, à nos mots. Ça nous échappe, nous la perdons. Mais de la même façon que nous voulons vivre, encore vivre, jusqu'à la mort, contre la mort, nous l'espérons, la Vie, avec nos mots, après chaque page, nous la perdons, nous l'attendons, la prochaine fois peut-être, elle nous adviendra, et nous disparaissons.
Christiane Veschambre, Après chaque page, Le Préau des collines, 2010, p. 32-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, après chaque page, écrire, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2012
e. e. cummings, 95 poèmes, traduit par Jacques Demarcq
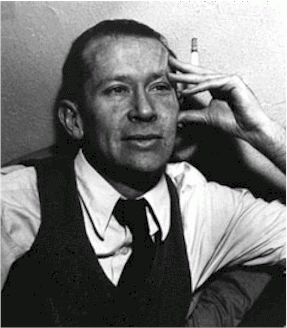
60
plonge au fond du rêve
qu'un slogan ne te submerge
(l'arbre est ses racines
et le vent du vent)
fie-toi à ton cœur
quand s'embrasent les mers
(et ne vis que d'amour
même si le ciel tourne à l'envers)
honore le passé
mais fête le futur
(et danse ta mort
absente à cette noce)
ne t'occupe d'un monde
où l'on est héros ou traître
(car dieu aime les fille
et demain et la terre)
e. e. cummings, 95 poèmes, traduit et
présenté par Jacques Demarcq, Points /
Seuil, 2006, p. 93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, 95 poèmes, jacques demarcq, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2012
Claude Dourguin, Laponia

Sans que l'on sache pourquoi, imprévu, offert que l'on découvre voici un jour de rémission. Le matin fleurant la glace a tendu une ciel d'azur pâle dont le cœur s'émeut, fragile, insolite. Froissé de blanc au lever, les heures une à une l'ont lissé, purifié, et il règne désormais impeccable, dépositaire de l'élégance arctique faite de dépouillement, de subtilité, de vigueur à la fois. Impressionné, saisi comme par la déférence instinctive au seuil de lieux saints, on avance plus grave qu'à l'ordinaire, mais c'est une gravité pleine, heureuse.
Le chemin forestier coupe à travers les pins, vient longer un lac modeste, figure blanche sur fond blanc combien plus vivante et suggestive que celle de Malevitch, sur quelques kilomètres l'esprit se propose une petite énigme esthétique à résoudre. Les pins reviennent, clairsemés, avec leurs branches irrégulières, mal fournies, leur port un peu bancal qui témoigne assez de ce qu'ils endurent. Nul tragique, pourtant, ne marque le paysage, entre conte et épopée plutôt la singularité des lieux soumis à des lois moins communes que les nôtres, obligés à un autre ordre. Chaque arbre tient à son pied, qui s'allonge démesurée et filiforme son ombre claire, grise sur la neige. Ces grands peuplements muets et fragiles d'ombres légères comme des esprits, le voyageur septentrional les connaît bien, une affection le lie à eux. Il traverse sans bruit leur lignes immatérielles dans le souvenir vague, qui les fait éprouver importunes, grossières, de la densité, de la fraîcheur, de l'odeur terrestre ailleurs, sur quelque planète perdue.
Claude Dourguin, Laponia, éditions Isolato, 2008, p. 37-38.
©Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, laponia, grand nord, neige, pins | ![]() Facebook |
Facebook |
11/11/2012
Pascal Quignard, La Haine de la musique
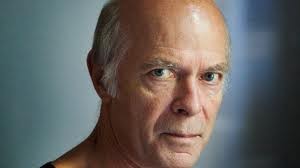
La musique multipliée à l'infini comme la peinture reproduite dans les livres, les cartes postales, les films, les CD-ROM, se sont arrachées à leur unicité. Ayant été arrachées à leur unicité, elles ont été arrachées à leur réalité. Ce faisant, elles se sont dépouillées de leur vérité. Leur multiplication les a ôtées à leur apparition. Les ôtant à leur apparition, elle les a ôtées à la fascination originaire, à la beauté.
Ces anciens arts sont devenus des scintillations éblouissantes de miroirs, un chuchotement d'échos sans source.
Des copies et non des instruments magiques, des fétiches, des temples, des grottes, des îles.
Le roi Louis XIV n'écoutait qu'une seule fois les œuvres que Couperin ou que Charpentier proposaient à son attention dans sa chapelle ou dans sa chambre. Le lendemain, d'autres œuvres étaient prêtes à sonner pour le première et la dernière fois.
Comme ce roi appréciait la musique écrite, l lui arrivait de demander à entendre deux fois une œuvre qu'il avait particulièrement appréciée. La cour s'étonnait de sa demande et la commentait. Les mémorialistes en portaient mention dans leurs livres comme d'une singularité.
*
L'occasion de la musique, pendant des millénaires, fut aussi singulière, intransportable, exceptionnelle, solennelle, ritualisée que pouvaient l'être une assemblée de masques, une grotte souterraine, un sanctuaire, un palais princier ou royal, des funérailles, un mariage.
Pascal Quignard, La Haine de la musique, Calmann-Lévy, 1996, p. 280-281.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la haine de la musique, la reproduction, la copie | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2012
Antoine Emaz, Soirs

30.01.98
accorder la langue
sur peu de choses
là ce soir
seul
avec
le jour en vrac
tout est passé
restent l'herbe
quelques feuilles tordues sèches
le froid clair encore le mur
entre l'herbe et le mur
la lumière glace
à chaque fois renvoie
une paroi de froid
à la fin le crépi
craque gris
dans le soleil qui baisse
voilà
peu de choses
dans un temps bref où passent
beaucoup de morts trop
vite
la vie dure
poser le peu comme simple
autant que possible
l'œil ras
dans l'herbe courte
les mots
on ne sait pas trop
ils tracent comme des bouclettes
des mèches de sens sans
tête
même hors vent ils frisent
quand sur la table
une bouteille tient nette
sa forme
pour bien faire il faudrait
des mots cendriers lourds
des pavés de verre clair quand
dehors brûle
[...]
Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,
1999, p. 74-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoin eemaz, soirs, les mots, le peu, l'herbe | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2012
Pascal Commère, Des laines qui éclairent, Une anthologie 1979-2009
D'une lettre déchirée en septembre (1996)
Vers l'eau noire
Au mur d'une chambre une lampe allumée
près d'une image — ses yeux bleus, l'éclusière
poussait de son ventre le levier des vannes.
Derrières, les prés bêtes un peu blanches, et
tout près un canal. Un bateau dans septembre
remontant vers l'eau noire.
Des îles
Aujourd'hui vous suivez le cortège — une amie
se marie. Je vous demande comment sont les îles,
vous ne répondez pas, ou tout bas. Les îles
sont souvent si petites, on les cherche
du doigt le soir sur un atlas.
Vous revenez
un jour de pluie — salut à Perros pour ce carré
de bleu là-bas... Rien ne change, le temps
joue avec les essuie-glaces, un pare-brise
éclaire. Le soir vient, une route en croise une autre,
une autre quelque part, toujours. Une route perdue.
Pascal Commère, Des laines qui éclairent, Une anthologie
1979-2009, Le temps qu'il fait, 2012.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal commère, des laines qui éclairent, une anthologie 1979-2009, l'eau noire, des îles | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2012
Édith Azam, Salle de spectacle du silo d'Arenc

J'écrire ?
J'écrire et ne sais pas pourquoi j'écris
J'écrire me connaît
L'acte d'écrire nous sait par cœur
Écrivant ce n'est pas moi
non ce n'est absolument pas moi qui écrit
Écrire me bouillonne et cherche plus que moi dans moi
Mais je ne décide pas
Je ne décide pas jamais ce que j'écrire
Je n'ai que la volonté d'écrire
mais que j'écrire c'est plus que moi
écrire me boursoufle me fatigue m'épuise
et j'aimerais ne pas j'écrire
j'aimerais plus jamais ça mais j'écrire plus fort que moi
À chaque fois l'acte d'écrire emporte tout et malgré moi
Alors j'écris
J'écris le hurlement d'écrire qui a su remonter jusqu'à moi
Le hurlement d'écrire tient debout dans le corps
Il faudrait retrousser la peau
Il faudrait bien admettre enfin
qu'écrire n'est rien d'autre
que notre chair hurlante
Édith Azam, Salle de spectacle du silo d'Arenc, architecte Roland Carta, photographies Lisa Ricciotti, éditions Al Dante, 2012, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2dith azam, salle de spectacle du silo d'arenc, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2012
Claude Chambard, Cet être devant soi

J'ignore l'année, j'ignore la saison, je ne sais quand la promesse n'a plus été tenue. Je criais dans le noir, tête bêche dans le lit, étouffé par l'édredon silourd, j'ouvrais les bras en vain. Je n'acceptais pas de vivre dans la terreur. J'ai perdu. C'est ainsi que je suis mort. C'est ainsi que j'ai ramassé mes vêtements & que je suis passé du côté des mortels. C'est ainsi que tu as fait mon portrait pour que je puisse avoir un visage & que je guérisse, que je guérisse d'Elle. Tu as dessiné mon visage quotidien, tu l'as apprivoisé, rendu possible, visible. C'est un visage qui me fait bon usage. Il se défraîchit un peu, mais c'est la suite des jours & des nuits tout simplement. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de Paradis, que l'on peut vivre sans, que l'on peut aimer sans s'alarmer. Nous n'en savons rien — pourtant. Quand tu oublies je me souviens. Quand j'oublie tu te souviens. Hui, nous faisons ce qui est possible. C'est peu. C'est suffisant pour tenir l'un & l'autre au fil de mots communs.
*
Sur le motif
en haut de la colline
peinture à la plume
légèreté acérée
mordre le papier
entrer dans la matière
creuser le sillon
— nuées d'oiseaux blancs —
la ville qui dort toi
colombe verte
dans la chambre secrète
la moiteur des draps
autour du corps qui souffre
le gant de toilette sur le front
tu t'éveilleras légère
guérie des fracas de la nuit
en haut de la colline
sur le motif
Claude Chambard, Cet être devant soi, encres de Anne-Flore Labrunie, Æncrages, 2012, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être devant soi, aimer | ![]() Facebook |
Facebook |
06/11/2012
Anne-Marie Albiach, Figure vocative

Anne-Marie Albiach (9 août 1937-4 novembre 2012
Cette douceur
dans un temps immédiat
ce même souffle ascendant
élague nos gestes musicaux
une architecture sauvage
immémorielle
en deçà des perspectives d'une raison
Respiration, souffle dans ces univers parallèles
pour lesquelles le passage est telle déchirure
d'un arbre qui éclate ses fruits la nuit
jusqu'au redressement de la pierre incessante
Silence de la mutité bleue
une ferveur parcourt les membres endoloris
sous les sarcasmes
Anne-Marie Albiach, Figure vocative, Al Dante,
2006 [1985], p. 24-25
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne-marie albiach, figure vocative, cette douceur | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2012
Jean-Claude Pirotte, Revermont
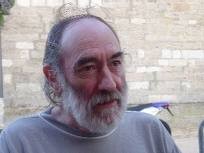
L'air de la rue ce sont les miasmes
respirés par les électeurs l'eau croupie
de leurs ablutions empoisonne les chats
un cadavre de pigeon roule à l'égout
j'aurai vu cela de mon vivant dit l'homme
qui s'attarde et pose son sac au pied du mur
il se parle à lui même car il est seul
mais des yeux morts le surveillent
ce ne sont pas les yeux des morts pas encore
mais ceux des vivants les complices
qui espèrent voir enchaîner cet homme
par les gardiens des puanteurs légales
Jean-Claude Pirotte, Revermont, Le temps qu'il fait,
2008, p. 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, revermont, la rue, la loi | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2012
Nathalie Sarraute, Enfance

J'ai l'embarras du choix, il y a des livres partout, dans toutes les pièces, sur les meubles et même par terre, apportés par maman et Kolia ou bien arrivés par la poste... des petits, des moyens et des gros...
J'inspecte les nouveaux venus, je jauge l'effort que chacun va exiger, le temps qu'il va me prendre... J'en choisis un et je m'installe avec lui sur mes genoux, je serra dans ma main le large coupe-papier en corne grisâtre et je commence... D'abord le coupe-papier, tenu horizontalement, sépare le haut des quatre pages attachées l'une à l'autre deux par deux, puis il s'abaisse, se redresse et se glisse entre les deux pages qui ne sont plus réunies que sur le côté... Viennent ensuite les pages "faciles" : leur côté est ouvert, elles ne doivent être séparées que par le haut, puis quatre "difficiles", et ainsi de suite, toujours de plus en plus vite, ma main se fatigue, ma tête s'alourdit, bourdonne, j'ai comme un léger tournis... « Arrête-toi maintenant, mon chéri, ça suffit, tu ne trouves vraiment rien faire de plus intéressant ? Je le découperai moi-même en lisant, ça ne me gêne pas, je le fais machinalement...»
Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, 1983, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie sarraute, enfance, lire | ![]() Facebook |
Facebook |





