11/10/2012
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau

Je ne cherche pas à me consoler, comme tant de bêtes, avec l'herbe grasse des prairies. On ne noie pas sa mort en l'étourdissant avec trop de biens. Rien ne peut la rassasier, ni même l'enivrer. Alors, pourquoi lui fournir plus qu'elle ne demande ? Un corps léger donne autant de joie qu'un repas de gala ! L'important, c'est de vivre intensément et non de raboter la terre pour empeser tous ses copeaux au fond de soi. Le massif n'épargne jamais l'entrée des couteaux. Les lames connaissent par cœur nos géométries secrètes. Pourquoi les perdre dans l'épais, les accumulations de vivres ? Certaines vaches, en se gonflant ainsi, se disent : Plus je prends de terre, plus elle me gardera en son affection. Pensent-elles se rendre ainsi nécessaires ? Plus grande sera leur chute. Rien en vaut une cuisine légère !
Les ventres pesants, couchés, se perdent dans de mauvais rêves. Ma mission n'est pas la torpeur, mais la contemplation, le détachement des ligaments bestiaux
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau, roman intérieur, éditions Léo Scheer, 2005, p. 37-38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, journal d'un veau, la mort, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2012
Giorgio Agamben, Nudités

Identité sans personne
[...] Persona signifiait à l'origine "masque" et c'est à travers le masque que l'individu acquiert un rôle et une identité sociale. Ainsi, à Rome, tout individu était identifié par un nom qui exprimait son appartenance à une gens, à une lignée, mais celle-ci, à son tour, se trouvaient définie par le masque en cire de l'aïeul que chaque famille patricienne conservait dans l'atrium de sa demeure. De là à faire de la personne la « personnalité » qui définit la place de l'individu dans les drames et dans les rites de la vie sociale, il n'y a qu'un pas et persona a fini par indiquer la capacité juridique et la dignité politique de l'homme libre. Quant à l'esclave, tout comme il n'avait pas d'aïeux, ni de masque, ni de nom, il ne pouvait pas davantage avoir une « personne », une capacité juridique (servus non habet personam). La lutte pour la reconnaissance est donc, à chaque fois, une lutte pour le masque, mais ce masque coïncide avec la « personnalité » que la société reconnaît à chaque individu (ou avec le « personnage » qu'elle fait de lui avec sa connivence plus ou moins réticente).
Il n'est donc pas étonnant que la reconnaissance des personnes ait été pendant des millénaires la possession la plus jalouse et la plus significative. Si les autres êtres humains sont importants et nécessaires, c'est avant tout parce qu'ils peuvent me reconnaître. Le pouvoir lui-même, la gloire, la richesse, tout ce à quoi "les autres" semblent être si sensibles n'a de sens, en dernière analyse, qu'en vue de cette reconnaissance de l'identité personnelle. On peut bien, comme aimait à le faire, selon les récits, le calife de Bagdad Haroun-al-Rashid, se promener incognito par les rues de la ville et s'habiller comme un mendiant ; mais s'il n'y avait jamais un moment où la gloire, les richesses et le pouvoir étaient reconnues comme « miens », si, comme certains saints invitent à le faire, je passais tout ma vie dans la non-reconnaissance, alors mon identité personnelle serait perdue à jamais.
Giorgio Agamben, Nudités, traduction de l'italien par Martin Rueff, éditions Payot & Rivages, 2012 [2009], p. 69-70.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio agamben, nudités, identité, personne, martin rueff | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2012
Valérie Rouzeau, Va où

Des heures de nuit des heures de jour je fais mon temps je pointe quoi passe
Poèmes à la chaîne j'avance bien j'oublierai peut-être au bout tout
Si je détache mieux mes syllabes de mon sentiment dans le vide si je tiens le rythme d'enfer
M'évertue à poursuivre juste sans sauter une seule ligne de chance j'oublierai peut-être au bout tout
Tellement tout sera loin au bout après des saisons de peine lourde mon boulet sous des tas de feuilles
*
Me mets en quarantaine pour faire mes lignes quoi d'autre
Me dégourdis les doigts sentiment sur la touche tac tac tac suis toquée
Me ressemble à l'index toc toc toc suis frappée
Ça peut durer longtemps de pianoter toujours et de taper jamais
Si je perdais mon temps il me ferait ce coup-là de me retrouver
Valérie Rouzeau, Va où, Le temps qu'il fait, 2002, p. 23 et 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, va où, écrire, le temps | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2012
Raymond Farina, Éclats de vivre

Mascarade, 1
Ne va pas changer de pays
Ne va pas changer de planète
Déroute l'Ange de la Mort
en changeant de nom simplement
Ou pour cesser enfin
d'être l'ombre d'un nom
fais de ton âme sable
trace de tes syllabes
& laisse s'envoler
loin de ces maisons graves
tes prénoms officiels
& ton prénom secret
Mais ne plains pas celui
qui s'énerve à ta porte
toi qui n'es maintenant
qu'anonyme moineau
semblable en gris
à tes semblables
simple comme en son ciel
le dieu sans attributs
qui souffle ses soleils
Raymond Farina, Éclats de vivre,
Dumerchez, 2006, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond farina, Éclats de vivre, mascarade; le nom | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2012
Colette, La Paix chez les bêtes

Les couleuvres
Ce sont deux pauvres sauvageonnes, arrachées, il y a quelques jours, à leur rive d'étang, à leurs joncs frais, au tertre chaud, craquelé sous le soleil, dont elles imitent les couleurs fauves et grises. Elles ont fait un voyage maudit, avec deux cents de leurs pareilles, étouffées dans une caisse, bruissantes, et le marchand qui me choisit celles-ci brassait ce vivant écheveau, ces cordages vernissés, démêlait d'un doigt actif les lacets minces, les fouets robustes, les ventres clairs et les dos jaspés.
« Ça, c'est un mâle... Et ça c'est une grosse femelle... Elles s'ennuieront moins, si vous les prenez toutes les deux...»
Je ne saurais dire si c'est d'ennui qu'elles s'étirent, contre les vitres de leur cage. Les premières heures, je faillis les lâcher dans le jardin, tant elles battaient de peur les parois de leur prison. L'une frappait sans relâche, de son dur petit nez, le même joint de vitres ; l'autre s'élevait d'un jet jusqu'au toit grillagé, retombait molle comme une verge d'étain entrain de fondre, et recommençait... Leur offrir, à toutes deux, la liberté, la jardin, le gazon, les trous du mur... Mais les chattes veillaient, gaies et féroces, prêtes à griffer les écailles vulnérables, à crever les vifs yeux d'or.
J'ai gardé les couleuvres et je plains en elles, encore une fois, la sagesse misérable des bêtes sauvages, qui se résignent à la captivité, mais sans jamais perdre l'espoir de redevenir libres. La secrète horreur, l'horreur occidentale du reptile ressuscite en moi, si je me penche longtemps sur elles, et je sais que le spectacle de leur danse, le mot sans fin qu'elles écrivent contre la vitre, le mouvement mystérieux d'un corps qui progresse sans membres, qui se résorbe, se projette hors de soi, ce spectacle dispense la stupeur.
[...]
Colette, La Paix chez les bêtes, dans Œuvres, II, texte établi, présenté et annoté par Michel Mercier, Bibliothèque de la Pléiade, édition publiée sous la direction de Claude Pichois, Gallimard, 1986, p. 127-128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colette, la paix chez les bêtes, les couleuvres, bêtes sauvages | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende,

Malgré des mots qu'on y met
Je me rappelle très bien, près d'une ville dont on pourrait dire le nom
La forme d'un village courant sur l'arête d'un long rocher
On le voir à partir d'un autre parvis de pierre
De ce côté-ci de la faille avec du vert qui suit un cours d'eau.
Il y a eu soudain la présence d'un jeune garçon
Dans un vêtement blanc, son invite à traverser. Quelques mots.
On pourrait dire son nom et donner une adresse.
Une autre année le village est resté dans la solitude de nos yeux.
Dans son peu de vert, avec le brillant d'un souvenir.
Une autre année presque tout
Disparaît dans un poème.
*
Je m'en retourne où je ne verrai pas
Ce qui ressemble à du paysage déchiré dans la montagne;
Si le vif des pentes nues
En cette fin d'octobre, et quelques silhouettes dans le lointain
Peut-être une ou deux mules, la pointe d'un capuchon
Ou le geste qui dresse
Un outil agricole dans un endroit plus cultivé du pays
Vont pas quand même
Récrire dans l'œil de ma mémoire
Ce dessin broussaillé qui déchire le temps ?
[...]
James Sacré, Le paysage est sans légende, "Al Manar", éditions Alain Gorius, 2012, p. 20-21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, paysage, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
05/10/2012
Dominique Meens, Vers

Une lune énorme a surgi du bois
les engoulevents pétaradaient moi
ahuri j'inventais l'œil rond du lièvre
et l'heure dont je goutais l'humeur mièvre
dans sa nuit que fait le poète il boit
j'étranglerai la mienne sans émoi
quelque chaleur moite la tourterelle
ronronne il est midi le ciel querelle
venteux dessous du vert qu'il voudrait bleu
deux geais ont grincé j'arrive avec eux
noué l'appel anxieux d'un crécerelle
à l'orage imprévu qui précisément grêle
*
Novembre aux embruns de mélancolie
m'a cloué le bec je mâche ma nuit
ravale mes pleurs et mon cœur s'enfuit
d'un lieu perdu comme un amour s'oublie
non la cause mais l'effet où tout sombre
tout et rien soit la parence des mots
dont s'éprennent les esprits animaux
à la peine à la peine à la pénombre
novembre courtois la chanson est neuve
paroles en l'air musique à l'envers
avec un pendu au diable vauvert
imagine autour la ronde des veuves
et la mandragore et ses cris plaintifs
l'orfèvre bientôt et ses pendentifs
Dominique Meens, Vers, P. O. L, 2012, p. 78 et 38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique meens, vers, les mots, lyrisme, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
04/10/2012
Sylvia Plath, Ariel, traduction Valérie Rouzeau

Tu es
Le plus heureux des clowns sur les mains,
Les pieds dans les étoiles, le crâne rond comme la lune,
Avec tes ouïes de poisson dans l'eau. Averti du bon sens
Du dodo, l'enfant do,
Enroulé sur toi-même telle une pelote de laine.
Occupé à tirer à toi la nuit comme le hibou..
Muet comme un topinambour du quatre juillet
Au premier avril,
Oh mon glorieux, mon petit pain.
Flou comme la brume, guetté comme un colis,
Et pus lointain que l'Australie.
Notre Atlas au dos courbé, notre crevette voyageuse.
Un bourgeon douillet à son aise
Come un hareng dans son bocal.
Nerveux come une fièvre sauteuse.
L'évidence telle une addition juste.
Une ardoise nette, avec ton visage dessus.
Sylvia Plath Ariel, Présentation et traduction de Valérie
Rouzeau, Poésie / Gallimard, 2009, p. 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, ariel, valérie rouzeau, fantaisie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2012
Luc Bénazet et Benoît Casas, Envoi

— J'ai une proposition à te faire.
— Dis !
— Dire ? Non. Précisément.
Mais voici ce que je peux t'écrire :
je ne sais pas exactement
Quelle est cette proposition ;
Il s'agit grosso modo de ceci
(que je nomme mais qui reste à inventer)
une conversation écrite
*

9 octobre
[raisin]
poème de saison
où la lumière s'éteint.
marqueurs :
lampes jaunes
dehors plomb
cendre pluie
refuge : érémitisme laborieux.
Livres, livres, écran, souris.
Livres. Noms.
construction lente.
Vers du jour.
14/10/10
quatre. Condensation lente, transformation du métal, lignes et [points épars —
la veine rouge est de type nuage
coulures. à flanc, une cabane. L'été est prochain
la direction dans l'espace est homonyme à la saison
18 octobre
dans le métro
sur le journal
puis sur écran
saisi par la photographie
de ce sol rouge
de cette bosse toxique
savoir du désastre :
brûlures, irritation ophtalmiques
résidus corrosifs, bauxite
L'œil reste captif
de l'impact
de ce miroir rouge
de cette force plate
de cette étendue
feu liquide.
Luc Bénazet et Benoît Casas, Envoi, Héros-Limite,
2012, p. 5 et 35-36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc bénazet et benoît casas, envoi, conversation écrite | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2012
Marie Cosnay, Des métamorphoses

L'incendie debout sur ses petites pattes rouges s'élevait, trouait le ciel pâle à souhait. Des silhouettes allaient à travers les giclées verticales du feu. De lourdes flammes léchaient les vitrines, les bibliothèques, les salons, les chambres et les cabanons où se camouflaient à l'écart des villes, parfois sur des rivages de magnificence, parfois dans les collines ou les territoires déserts, les plus innocentes des grandes et petites personnes. Dans les forêts les arbres tendaient les bras. Des suppliants, transformés en troncs et têtes feuillues pour peine reçue et fautes anciennes. La terre était remuée. C'était une odeur de pins, une odeur peu commune de montagne ou de sexe, une odeur interdite. L'odeur inconnue s'élevait de la terre noire et grasse qui gigotait, soufflait d'abruptes cheminées, on ne sait pas exactement ce qui bougeait, vermines ou corps inachevés. On voulait respirer, respirer, courir et galoper, mais on allait à tout petits pas. Les arbres terrifiants se courbaient et une armée ensevelie d'enfants gémissait à petits pleurs. Les tertres improvisés grondaient, les bouches de terre haletaient.
Marie Cosnay, Des métamorphoses, collection "Grands fonds", Cheyne éditeur, 2012, p. 61-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, des métamorphoses, paysage, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
01/10/2012
Maurice Scève, Délie

L'ardent désir du haut bien désiré,
Qui aspirait à celle fin heureuse,
A de l'ardeur si grand feu attiré,
Que le corps vif est là poussière ombreuse ;
Et de ma vie, en ce point malheureuse,
Pour vouloir toute à son bien condescendre,
Et de mon être, ainsi réduit en cendre,
Ne m'est resté que ces deux signes-ci :
L'œil larmoyant pour piteuse te rendre,
La bouche ouverte à demander merci.
Sur le Printemps que les Aloses montent,
Ma Dame et moi sautons dans le bateau,
Où les pécheurs entre eux leur prise coptent,
Et une en prend, qui, sentant l'air nouveau,
Tant se débat qu'enfin se sauve en l'eau,
Dont ma Maîtresse et pleure et se tourmente.
« Cesse, lui dis-je, il faut que je lamente
L'heur du poisson que n'a su attraper,
Cat il est hors de prison véhémente,
Où de tes mains ne peux onc échapper. »
Maurice Scève, Délie, édition présentée, établie et
annotée par Françoise Charpentier, Poésie / Gallimard,1984, p. 97, 174.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice scève, délie, dame, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2012
Emily Dickinson, Poèmes, traduits par Claire Malroux

La « Nature » est ce que nous voyons —
La Colline — l'Après-Midi —
L'Écureuil — l'Éclipse — Un beau Bourdon —
Mieux — la Nature est Paradis —
La Nature est ce que nous entendons —
Le Loriot — la Mer —
Le Tonnerre — un Grillon —
Mieux — la Nature est Harmonie —
La Nature est ce que nous connaissons —
Mais sans avoir l'air de le dire —
Si débile est notre Sagesse
Face à sa Simplicité
"Nature" is what we see —
The Hill — the Afternoon —
Squirrel — Eclipse — the Bumble bee —
Nay — Nature is Heaven —
Nature is what we hear
The Bobolink the Sea —
Thunder — the Cricket —
Nay — Nature is Harmony —
Nature is what we know —
Yet have no art to say —
So impotent Our Wisdom is
To her Simplicity
Emily Dickinson, Poèmes, traduit et préfacé par
Claire Malroux, Belin, 1989, p. 193 et 192.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, poèmes, claire malroux, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2012
Jacques Dupin, L'embrasure

Ce qu'une autre m'écrivait
comme avec une herbe longue et suppliciante
toi, toute, en mon absence, là,
dans le pur égarement d'un geste
hostile au gerbier du sang,
tu t'en délivres
tel un amour qui vire sur son ancre, chargé
de l'ombre nécessaire,
ici, mais plus bas, et criant
d'allégresse comme au premier jour
et toute la douleur de la terre
se contracte et se voûte
et surgit en une chaîne imprévisible
crêtée de foudre
et ruisselante de vigueur
*
Malgré l'étoile fraîchement meurtrie
qui bifurque
— c'est sa seule cruauté le battement
de ma phrase qui s'obscurcit
et se dénoue —,
il est encore capable, lui, de soutenir
la proximité du murmure
Jacques Dupin, L'embrasure, Gallimard, 1969,
p. 32 et 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, l'embrasure, amour, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2012
Henri Thomas, La joie de cette vie
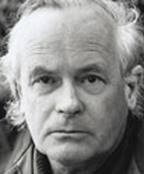
J'écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l'on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.
Si la mort est la solution forcée du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c'est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.
Je n'ai pas vécu ce que j'écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l'écrivant — sur le mode de l'écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
Je n'ai, pour répondre de moi, que mes livres, que j'ai oubliés, après m'y être absorbé, peut-être résorbé. Ils sont pareils en cela aux amours, dont on n'a plus guère que le titre : un nom, un prénom, une couleur dominante ; le reste a disparu comme l'herbe des champs, comme les lignes écrites il ya six mois ou dix ans.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 21, 28, 29, 30, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2012
Paul Claudel, Cinq grande odes

La Muse qui est la grâce
Encore ! encore la mer qui revient me chercher comme une barque,
La mer encore qui retourne vers moi à la marée de syzygie et qui me lève et remue de mon ber comme une galère allégée,
Comme une barque qui ne tient plus qu'à sa corde, et qui danse furieusement, et qui tape, et qui saque, et qui fonce, et qui encense, et qui culbute, le nez à son piquet,
Comme le grand pur sang que l'on tient aux naseaux et qui tangue sous le poids de l'amazone qui bondit sur lui de côté et qui saisit brutalement les rênes avec un rire éclatant !
Encore la nuit qui revient me rechercher,
Comme la mer qui atteint sa plénitude en silence à cette heure qui joint l'Océan les ports humains pleins de navires attendants et qui décolle la porte et le batardeau !
Encore le départ, encore la communication établie, encore la porte qui s'ouvre !
Ah ! je suis las de ce personnage que je fais entre les hommes ! Voici la nuit ! Encore la fenêtre qui s'ouvre !
Et je suis comme la jeune fille à la fenêtre du beau château blanc, dans le clair de lune,
Qui entend, le cœur bondissant, ce bienheureux sifflement sous les arbres et le bruit de deux chevaux qui s'agitent,
Et elle ne regrette point la maison, mais elle est comme un petit tigre qui se ramasse, et tout son cœur est soulevé par l'amour de la vie et par la grande force cosmique !
[...]
Paul Claudel, "Quatrième ode", dans Cinq grandes odes, préface de Jean Grosjean, Poésie / Gallimard, 1966 [1913], p. 73-74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, cinq grandes odes, la muse, la mer, la nuit | ![]() Facebook |
Facebook |





