24/10/2012
Jean Arp, Jours effeuillés

Jumeaux de sève
Une rue vide sans fin.
Des maisons vides.
Des chambres vides.
Un homme vide la bouche ouverte.
comme un nid vide
est réconforté coup sur coup du vide.
Un homme à cheval sur une femme.
Deux femmes nues se battent avec de vieux balais...
Des tabourets à tentacules.
Un crâne en pain sur une étagère.
Un cœur humain en guise d'éponge.
Des personnes plus éteintes que des lampes à pétrole éteintes disparaissent dans un tunnel noir.
Un deuxième homme à cheval sur une femme
arrive au grand galop
et annonce à hauts cris sa découverte sensationnelle :
une poudre qui provoquera en plein jour une nuit totale
et dont il fera immédiatement la démonstration.
Des chevaux attendent immobiles sur un radeau
dans une rue couverte de confetti blancs
le dégel d'un écho.
Sur une chaise qui a le hoquet
traînent des baisers momifiés.
Au moindre frôlement la chaise fait entendre un bruit cru
dû au passage de l'air dans la glotte.
Un mendiant couvert de la tête aux pieds
d'une barbe noire et malodorante
vend des clefs pour ouvrir la porte
qui donne sur l'incessante nudité de la lumière infinie.
Une fleur travestie en chair et en os
vend des mannequins porte-bonheur
parés de leurs plus beaux atours.
Un ange sombre vend des boussoles
pour trouver le chemin du ciel.
Dans chaque tiroir d'une grande commode en verre
dort un homme grand
déguisé en mite.
Sur le lit conjugal parmi les houpettes des franges
et des incrustations de dentelles vénitiennes
repose un estomac verni
dans lequel se mirent des jumeaux de sève.
Jean Arp, Jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs, 1920-1965, Gallimard, 1966, p. 385-386.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean arp, jours effeuillés, jumeaux de sève, vide | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2012
Catherine Pozzi, Très haut amour

Ave
Très haut amour, s’il se peut que je meure
Sans avoir su d’où je vous possédais,
En quel soleil était votre demeure
En quel passé votre temps, en quelle heure
Je vous aimais,
Très haut amour qui passez la mémoire,
Feu sans foyer dont j’ai fait tout mon jour,
En quel destin vous traciez mon histoire,
En quel sommeil se voyait votre gloire,
Ô mon séjour…
Quand je serai pour moi-même perdue
Et divisée à l’abîme infini,
Infiniment, quand je serai rompue,
Quand le présent dont je suis revêtue
Aura trahi,
Par l’univers en mille corps brisée,
De mille instants non rassemblés encor,
De cendre aux cieux jusqu’au néant vannée,
Vous referez pour une étrange année
Un seul trésor
Vous referez mon nom et mon image
De mille corps emportés par le jour,
Vive unité sans nom et sans visage,
Cœur de l’esprit, ô centre du mirage,
Très haut amour.
Catherine Pozzi, Très haut amour, poèmes et
autres textes, édition de Claire Paulhan et Lawrence
Joseph, Poésie / Gallimard, 2002, p. 23-24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, très haut amour | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2012
Henri Pichette, Les ditelits du rougegorge

Petit propriétaire à la cravate rouge
il chante contre l'intrus
il se rengorge se redresse
il se crête se hérisse
il se campe torse bombé
tant le cœur lui bat que le sang lui bout
ses yeux flamboient
son corps saccade
et plus il mélodie plus il furibonde
Gare la bagarre !
on pourrait bien se voler grièvement
dans les plumes.
Le rougequeue pour s'amuser du rougegorge,
il lui crie :
Cou en feu ! cou en feu !
Et le rougegorge de répondre, qui se rit :
Feu au cul ! feu au cul !
Si tarde à partir l'hirondelle,
C'est que l'hiver se tient loin d'elle ;
Quand le rougegorge est à l'huis,
C'est que l'hiver de près le suit.
Quand les hirondelles s'en vont,
Le rougegorge s'en vient.
Henri Pichette, Les ditelis du rougegorge, Gallimard,
2005, p. 49, 62 et 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pichette, les ditelits du rougegorge, dicton | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2012
Aragon, Les Adieux et autres poèmes
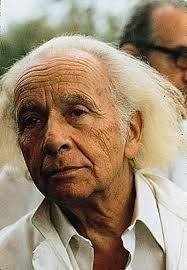
Échardes
I
Cesse donc de gémir. Rien de plus ridicule
Q'un homme qui gémit
Si ce n'est un homme qui pleure
II
Je me promène
Avec un couteau d'ombre en moi
Je me promène avec
Un chat dans ma mémoire
Je me promène
Avec un pot de fleurs fanées
Je me promène
Avec un vêtement irréparable
Je me promène
Avec un grand trou dans mon cœur
III
Crois moi
Rien ne fait si mal qu'on pense
IV
Plus le poème est court
Plus il entre dans la chair
V
Il faut chasser de la cité ce poète
Il n'y a pas dans la cité de place
Pour l'exemple de la douleur
VI
Nous avons tout fait pour ceux qui étouffent
Tout fait pour ceux qui demandent de l'air
Construit sur la nuit des fenêtres
Ouvert partout des dispensaires
Épargnez-nous ce bruit de plaintes
VII
Il n'y a jamais rien de si beau qu'un sourire
Et même avec un visage défiguré
N'as-tu pas souci d'être beau
Aragon, Les Adieux et autres poèmes, dans Œuvres poétiques complètes, II, édition publiée sous la direction d'Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 1129-1130.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, échardes, les adieux, sourire, poète | ![]() Facebook |
Facebook |
Gérard Titus-Carmel, Ici rien n'est présent

Angle mort
(récit)
J'appuie le front contre ma paume, le coude bien planté au bord du monde et, les yeux grands ouverts, je disparais lentement en moi.
Pourtant ma mémoire pèse de tout son poids, cherchant un point d'équilibre entre ce qu'elle tisonne infiniment et ce qu'elle s'obstine à oublier. La conque amie de la main devient alors tiédeur et confidence, que la nuit seule parvient à distraire. Mais déjà au silence de mon corps j'ai gagné une contrée, une terre d'innocence. Et j'attends.
(L'attente, c'est cet animal sans nom, recroquevillé dans le contre-jour de la chambre, comme à l'angle perdu de la nuque : il tremble de tous ses membres, sans que cela se voie vraiment, et c'est pire. Mais les murs se resserrent autour de lui, qui n'est plus que boule et terreur.)
Et je m'avance dans l'attente, c'est-à-dire vers l'ombre de la bête innommée, suffocante.
[...]
Gérard Titus-Carmel, Ici rien n'est présent, Champ Vallon, 2003, p. 49-50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard titus-carmel, ici rien n'est présent, l'attente, la mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2012
Marie-Laure Zoss, Une syllabe, battant de bois

I.
pars, érafle de tes jours le dedans, tes jours à mesure sous tes gestes déboîtés ; ton visage de plusieurs feuillets : tu n'en connais plus aucun, tu empaquètes l'ordinaire ; dans un no man's land faire mine d'être là, sur un filet de souffle déjà rétracté ; agrégé dans sa propre farine — ne la tourne plus dans celle du monde, quelque chose te réfrène vers l'intérieur, toi si singulier soudain — l'intérieur, s'il en est encore un ; plie bagages ; s'infliger telles désertions, dites, qui le voudrait ?
à travers la nuit l'esprit ficelle dans les vallées l'aboiement des chiens errants, déballe des rouleaux d'ombre sur la caillasse ; comme si on avait changé d'espèce : une chair recroquevillée, à la merci du vaste, où s'engouffrent froid bouillon d'urine, vent himalayen et suif ; et ce vert, l'étincelant mercure des saules
2.
ni la tasse d'eau à boire d'un trait, ni l'assiette — jamais ne l'entameras, posée sous le ciel ; moins qu'une miette sur un toit d'argile, pas de pays — qu'un puits d'azur entre autre solives ; toi à la traîne des vivants, soigneusement balaie dans un seul angle tes navrantes forces ; par ce châssis de peuplier fondra le soleil d'hiver jusqu'aux rigoles, et le compte des jours qui restent, un par un s'étouffant dans la vallée qui fatigue ses poussières carrossables, le cœur devenu dur battant d'une cloche de bois — tu aurais mieux fait de ne jamais ; une plaine soulève, à rebours de soi, le pas, sans relâche pique ses meutes de terre pelée
Marie-Laure Zoss, Une syllabe, battant de bois, dans fario, 11, printemps-été 2012, p. 167-168.
L'ensemble des poèmes composant Une syllabe, battant de bois a été publié en 2012 aux éditions Cheyne.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, une syllabe, battant de bois, partir | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2012
Boris Pasternak, dans Quatre poètes russes

Le poème d'avant les poèmes
Laisse de toi les mots descendre
Comme d'un clos le zeste et l'ambre :
Distraitement et richement,
Lents, très lents, très lentement.
*
Ébranlant la branche odorante
Ébranlant la branche odorante
Lampant dans ces ombres ce bien-être,
De calice en calice allait courante
Une moiteur qu'hébéta la tempête.
Par les calices roulait, sur deux
Calices glissa, sur eux deux,
En goutte d'agate volumineuse,
Se suspendit, pudique, lumineuse.
Le vent peut bien, soufflant sur les spirées,
Martyriser cette goutte, l'écraser.
Une, intacte, elle reste : goutte des deux
Calices s'entrebaisant, buvant à deux.
Ils rient, tentent de s'entr'échapper,
De se remettre droits comme avant cette goutte :
Ils ne peuvent plus égoutter leurs bouches hors cette goutte
Et même qui les coupe ne peut les séparer.
Boris Pasternak, dans Quatre poètes russes, V. Maïakovski, B. Pasternak, A. Blok, S. Essénine, texte russe traduit et présenté par Armand Robin, éditions du Seuil, 1949, p. 115 et 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris pasternak, dans quatre poètes russes, fleur, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2012
René Char, Fenêtres dormantes et porte sur le toit

Légèreté de la terre
Le repos, la planche de vivre ? Nous tombons. Je vous écris en cours de chute. C'est ainsi que j'éprouve l'état d'être au monde. L'homme se défait aussi sûrement qu'il fut jadis composé. La roue du destin tourne à l'envers et ses dents nous déchiquettent. Nous prendrons feu bientôt du fait de l'accélération de la chute. L'amour, ce frein sublime, est rompu, hors d'usage.
Rien de cela n'est écrit sur le ciel assigné, ni dans le livre convoité qui se hâte au rythme des battements de notre cœur, puis se brise alors que notre cœur continue à battre.
*
Une rose par mégarde.
Une rose sans personne.
Une rose pour verdir.
*
Nous vivons avec quelques arpents de passé, les gais mensonges du présent et la cascade furieuse de l'avenir. Autant continuer à sauter à la corde, l'enfant-chimère à notre côté.
René Char, Fenêtres dormantes et porte sur le toit, Gallimard, 1979, p. 52, 54 et 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, fenêtres dormantes et porte sur le toit, rose, la terre, le passé | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2012
Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud (recension)

Rimbaud est toujours resté très présent dans la réflexion d’Yves Bonnefoy sur la poésie. Ce fort volume le prouve qui réunit, avec Rimbaud par lui-même paru pour la première fois en 1961, divers textes : préfaces, articles, conférences — dont les plus récentes ouvrent le livre en indiquant pourquoi Rimbaud et Baudelaire ont marqué l’existence de Bonnefoy : « révélation de ce qu’est la vie, de ce qu’elle attend de nous, de ce qu’il faut désirer en faire. » Qu’un écrivain de cette grandeur dise que Rimbaud a été pour lui un guide, et en quoi il l’a été, cela suffirait pour désirer le lire attentivement.
Dans les deux premières conférences qui donnent leur titre à l’ouvrage comme dans son Rimbaud, Yves Bonnefoy construit par touches successives un portrait intérieur de Rimbaud et de l’examen attentif de l’œuvre tire une leçon de vie. L’analyse met en valeur l’acharnement de Rimbaud à toujours vouloir extraire le vrai des choses, et découvre l’insatisfaction continuelle du jeune poète allant vers autrui, toujours à dénoncer la misère et toujours dans l’utopie, toujours déçu et toujours repris par des chimères. Par dessus tout, Rimbaud est occupé par la question de l’écriture ; ce qu’il écrit dans sa lettre à Demeny du 15 mai 1871 (dite "lettre du voyant"), c’est ce que représente à ses yeux la poésie. Elle est, comme le résume Yves Bonnefoy, « accès à nos vrais besoins, lesquels sont d’assumer notre finitude, d’en reconnaître l’infini intérieur, ramassé sur soi, de nous ouvrir de ce fait à des rapports de plus d’immédiateté avec nos proches dans une société qui pourrait en être transfigurée ».
Sans doute cela est-il devenu clair aujourd’hui pour beaucoup. Ce qui l’est moins peut-être, et il faut savoir gré à Yves Bonnefoy de l’écrire à plusieurs reprises, c’est que travailler dans la langue de manière à en modifier l’ordre, c’est toucher profondément l’ordre des choses. C’est la leçon que donne sa lecture du sonnet Voyelles, où le chaos introduit dans la perception permet de voir ce sur quoi le regard ordinaire passe sans s’arrêter. « Épiphanie de l’indéfait », Voyelles enterre le lyrisme romantique, « le désordre qui se répand dans l’emploi des couleurs va ruiner toutes les figures de l’être au monde ancien et avec celles-ci balayer les espérances que Rimbaud jusqu’alors avaient fait siennes, dans l’espace de la pensée d’autrefois. » Yves Bonnefoy suit la volonté de Rimbaud de mettre à bas les manières de comprendre le monde, notamment celles du milieu parisien de la poésie qu’il ne supporte pas. Contrairement aux poètes qu’il rencontre, et c’est pourquoi sans doute l’œuvre de Rimbaud garde toute sa force aujourd’hui, la poésie était pour lui « une expérience directe de l’unité, de sa présence au cœur de tous les actes de l’existence et de tous les emplois de mots, dans ce seul vrai infini qu’est la réalité quotidienne ». Leçon toujours et encore à répéter, contre la pression incessante qui pousse à ne pas penser et à ne pas agir autrement que dans la norme. "Notre besoin de Rimbaud", il est, dans « l’éternel effondrement », de comprendre que « si l’esprit est souvent, ou toujours, illusionné, il n’est pas, comme tel, dans son essence, illusoire ».
Le livre dense qu’était Rimbaud par lui-même, ici sous le titre Rimbaud, rompait en 1961 avec les lectures de Rimbaud. On était peu habitué à l’époque — l’est-on nettement aujourd’hui ? — à une lecture, à un commentaire qui s’efforcent de penser l’œuvre comme une « biographie spirituelle ». On retient ici de l’analyse précise des poèmes comment s’opéra le rejet de la poésie subjective, et en quoi Les Illuminations furent la « reconnaissance d’un échec » : la vie vécue comme opaque, noire. Rimbaud, à la fin de 1874, entreprend l’apprentissage de plusieurs langues (allemand, italien, russe, arabe) et Yves Bonnefoy rappelle que « la poésie ne se fait qu’en portant à l’épreuve de l’absolu une langue », et qu’il faut « en voir la secrète et active dénégation dans cette étude de la parole ». Renoncement ? oui, mais l’œuvre est toujours là pour « témoigner de l’aliénation de l’homme, et l’appeler à passer du consentement sans bonheur à l’affrontement tragique de l’absolu ».
Les huit études qui composent le reste (un tiers) du volume offrent notamment des lectures de poèmes ("Les Reparties de Nina", "Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs") et un examen détaillé des rapports complexes de Rimbaud à sa mère. On relira en particulier la comparaison des poétiques de Mallarmé et de Rimbaud, et ce que ce dernier a un moment rêvé du rôle social du poète — rêve dont on peut se demander comment il serait reçu aujourd’hui quand on en lit la synthèse de Yves Bonnefoy :
Le poète : celui qui apportera aux délibérations de la société son expérience de la subjectivité toujours en désordre, de l’imaginaire toujours en proie aux fantasmes, autrement dit son affrontement des désirs sans mesure et des visions chimériques. Tout cela désormais non plus idolâtré ni dénié, mais traversé, malmené, accepté, compris.
Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud, Seuil, 2009, 23 €.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, notre besoin de rimbaud | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2012
Jacques Roubaud, Quelque chose noir
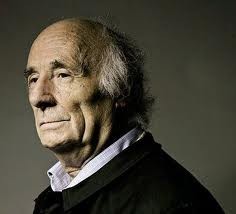
Envoi
S'attacher à la mort comme telle, y reconnaître l'avidité d'un réel, c'était avouer qu'il est dans la langue, et dans toutes ses constructions, quelque chose dont je n'étais plus responsable.
Or, c'est là ce que personne ne supporte plus mal. Où sont les insignes de l'élection individuelle sinon en ce qu'un ordre vous est obéissant, avec ses raisons de langue.
La mort n'est pas une propriété distinctive, telle qu'à jamais les êtres qui ne la présenteraient pas, à jamais s'excluraient des décomptes.
Ni les Trônes, ni les Puissances, ni les Principautés, ni l'Âme du Monde en ses Constellations.
Cela que pourtant tu t'efforçais de frayer, par photons évaporants, par solarisation de ta nudité précise.
La transcription réussie, l'ombre ne devait être nulle part appuyée plus qu'en ce lieu où le soleil avait poussé l'évidence jusqu'au point de conclure : le lit, de fesses qui s'écartent en brûlant.
Or, et c'est là ce que personne ne tolère plus mal, l'écriture de la lumière ne réclame pas l'assentiment.
Pour qui sait lire, seuls les limbes de l'entente.
Et le soleil, qui t'empaquetait entre deux vitres.
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 93-94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, la mort, la mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2012
Béatrice et Stello Bonhomme, Kaléidoscope d'enfance

Dans le tissu de certaines journées se trouve comme la forme en creux d'une possibilité plus pure et plus belle qu'on pourrait presque saisir et cette possibilité se plaît pourtant toujours à vous échapper.
La clarté de l'air, la transparence est parfaite, le soleil possède le glacis de certains matins d'hiver, on sent une limpidité dans l'atmosphère. Cependant le moment d'en jouir paraît déjà terminé et toute cette splendeur ne se présente à vous que comme un déjà-vu d'enfance, cette clarté n'est qu'un simple reflet, un peu plus terne, d'une journée encore plus ciselée de bleu, plus joyeuse. Du temps passé.
La lumière est voilée par une pellicule très fine, le voile que posent sur leur tête les pleureuses.
Aujourd'hui lorsque je vois l'aube s'effranger de mauve, je pense à ce lit en berceau au centre de rayons caressants que mon regard ensommeillé filtre dans la chambre aux bougainvilliers.
Les murs étaient tapissés de mauve très pâle où se jouaient les clartés feuillues en ombres chinoises.
Matin brûlé de neige pari les mimosas en fleurs, je courais dans le jardin d'arbre en arbre. L'année veloutée était déjà si chaude dans la touffeur de l'été qu'elle exaltait l'odeur du jasmin.
Aux matins premiers de mon enfance.
Béatrice et Stello Bonhomme, Kaléidoscope d'enfance, éditions de la revue NU(e), avril 2012, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : béatrice et stello bonhomme, kaléidoscope d'enfance, enfance, temps passé | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2012
Samuel Beckett, Soubresauts

Assis une nuit à sa table la tête sur les mains il se vit se lever et partir. Une nuit ou un jour. Car éteinte sa lumière à lui il ne restait pas pour autant dans le noir. Il lui venait alors de l'unique haute fenêtre un semblant de lumière. Sur celle-là encore le tabouret sur lequel jusqu'à ne plus le vouloir ou le pouvoir il montait voir le ciel. S'il ne se penchait pas au-dehors pour voir comment c'était en dessous c'était peut-être parce que la fenêtre n'était pas faite pour s'ouvrir ou qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas l'ouvrir. Peut-être qu'il ne savait que trop bien comment c'était en dessous et qu'il ne désirait plus le voir. Si bien qu'il se tenait tout simplement là au-dessus de la terre lointaine à voir à travers la vitre ennuagée le ciel sans nuages. Faible lumière inchangeante sans exemple dans son souvenir des jours et des nuits d'antan où la nuit venait pile relever le jour et le jour la nuit. Seule lumière donc désormais éteinte la sienne à lui celle lui venant du dehors jusqu'à ce qu'elle à son tour s'éteigne le laissant dans le noir. Jusqu'à ce que lui à son tour s'éteigne.
Samuel Beckett, Soubresauts, éditions de minuit, 1989, p. 7-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, soubresauts, la nuit, la lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2012
Jean-Pierre Verherggen, Ni Nietzsche, Peau d'Chien !

Par-delà le larbin papal
Iéna, 18 janvier 1889
Il déclame continuellement. D'une voix affectée. Sciemment. En faisant usage de mots grandiloquents !
En donnant dans le voussoiement apprêté !
L'entregens !
L'affèterie !
Le cul pincé !
La girie mélo et le compassement gourmé.
Dans l'excellence de la révérence !
En donnant dans le frotte manche. Dans l'éminence. Dans l'altesse Dans la hauterie et la lèche de loque à reloqueter.
En donnant dans le torchon empesé. Le faste alpenrosé et le plastron suranné.
En se magnant le popotin.
En chauffant la colle à larbins et en activant le protocole du tapis déroulé.
En donnant dans le milady et le béni-oui-oui de garden-party.
En faisant des guiliguilis et des entrechats à la Nietzschejinski.
(Vaslav !)
Et tac quand c'est un graf !
Et toc quand c'est un herzog !
En claquant de la botte devant le moindre titulaire d'un poste !
Et la carpette jusqu'à terre quand c'est un freiher, un ritter ou un canard edler.
Et mille autres manières. Palefrenières !
Et mille autre tics ! Diplomatiques, aristocratiques ou ecclésiastiques !
La brosse à reluire et le sir d'encaustique, sœur de la pâte à faire briller !
Toutefois, si, en retour, on lui donne de la Majesté
ou mieux : de la Sainteté !
Nietzsche sourit,
consent à cette petite entorse,
à condition, dit-il,
qu'on le compte pour Innotzschecent Quatorze !
Jean-Pierre Verherggen, Ni Nietzsche, Peau d'Chien !, TXT/Limage 2, 1983, p. 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre verherggen, ni nietzsche, peau d'chien, discours | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2012
Yaël Cange, L'en-allée

Ce que j'aime à la fin ?
« Pas de cœur. » C'est bien ce qu'on disait, non ? N'en quelles contrées déjà ? N'sais plus. Sauf qu'il y faisait froid : « Pas de cœur », pensez ! De quel regard Ah ! Doux regard en si fol appel de vous — ces mots m'auront privée ! Vous étiez — dès l'heure présente — toutes mes blessures à venir.
« Qu'une main vienne à se tendre » — peu de choses que j'ai demandé là ? Cela m'est — jusqu'à maintenant — tendresse apeurée. Comme autant d'étoiles qui finiraient de s'éteindre.
Qu'aucun, aucune — ne l'ait présagé seulement !
Au reste : longtemps — que je n'aime plus personne.
Mais si. Toi peut-être. À toi je peux parler. Imagine : « pas de cœur ». « Pas de cœur » — moi, ça ?
Toutes ces lyres, ces luths pourtant — qu'il croyait vous porter !
Ç'aurait dû se passer ainsi, non ?
[...]
*
Presque nuit déjà
Pourquoi diable — ce cri — qui me troue la gorge ?
Mais cet état — que ronces — ou fibres au-dedans appellent : de parfait abandon. L'avez-vous connu, vous ?
Serait temps, oui, de perdre cœur. Le mieux. Le meilleur ce serait, sans doute, contre un tel sentiment de tendresse blessée.
Yaël Cange, Pierre Cordier et Gundi Falk, L'en-allée, préface de Claude Louis-Combet, Bruxelles, La Pierre d'Alun, 2012, p. 35, 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yaël cange, l'en-allée, le cri, aimer | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2012
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau

Je ne cherche pas à me consoler, comme tant de bêtes, avec l'herbe grasse des prairies. On ne noie pas sa mort en l'étourdissant avec trop de biens. Rien ne peut la rassasier, ni même l'enivrer. Alors, pourquoi lui fournir plus qu'elle ne demande ? Un corps léger donne autant de joie qu'un repas de gala ! L'important, c'est de vivre intensément et non de raboter la terre pour empeser tous ses copeaux au fond de soi. Le massif n'épargne jamais l'entrée des couteaux. Les lames connaissent par cœur nos géométries secrètes. Pourquoi les perdre dans l'épais, les accumulations de vivres ? Certaines vaches, en se gonflant ainsi, se disent : Plus je prends de terre, plus elle me gardera en son affection. Pensent-elles se rendre ainsi nécessaires ? Plus grande sera leur chute. Rien en vaut une cuisine légère !
Les ventres pesants, couchés, se perdent dans de mauvais rêves. Ma mission n'est pas la torpeur, mais la contemplation, le détachement des ligaments bestiaux
Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau, roman intérieur, éditions Léo Scheer, 2005, p. 37-38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, journal d'un veau, la mort, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |





