21/12/2016
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l'immobilité de Douve
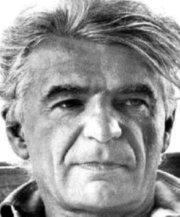
Vrai nom
Je nommerai désert ce château que tu fus,
Nuit cette voix, absence ton visage,
Et quand tu tomberas dans la terre stérile
Je nommerai néant l’éclat qui t’a porté.
Mourir est un pays que tu aimais. Je viens
Mais éternellement par tes sombres chemins.
Je détruis ton désir, ta forme, ta mémoire,
Je suis ton ennemi qui n’aura de pitié.
Je te nommerai guerre et je prendrai
Sur toi les libertés de la guerre et j’aurai
Dans mes mains ton visage obscur et traversé,
Dans mon cœur ce pays qu’illumine l’orage.
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve,
Mercure de France, 1954, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de douve, désir, visage, voix, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2016
Jean-Pierre Verheggen, Pubère, Putains - Porches - Porchers - Stabat Mater

Porches, Porchers
I.
Nous détestions les fermes.
Les fermiers.
Replets.
Satisfaits.
Les métayers et leurs ouvriers.
Saisonniers.
Dupés.
Exploités.
Leurs aoûterons.
Leurs tâcherons.
Leurs souillons.
Leur promiscuité.
Acceptée.
Entérinée.
Avalisée.
II.
Nous détestions leurs messiers.
Leurs palefreniers ou valets.
Laquais.
Laids.
Envoyés valdinguer.
Étriller ou faucher.
Aider les faucheurs armés.
Arnachés ou épongés.
Irrelevés.
III.
Nous détestions les travailleurs des champs tout entiers.
Puants.
Infamants.
Paysans.
Les peaussiers.
Plaigneurs.
Quémandeurs.
Les taupiers.
Les faneurs.
Suants. Gagneurs.
Les échardonneurs.
Les échenilleurs.
Les soigneurs attitrés.
Bousés. Bouseux.
Beaucoup trop courageux.
[...]
Jean-Pierre Verheggen, Pubères, Putains -
Porches - Porchers - Stabat mater, Labor, 1991, p. 13 à 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre verheggen, pubères, putains - porches - porchers - stabat mater | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2016
ART ROMAN EN PÉRIGORD




Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en périgord, modillon, chapiteau | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2016
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

À Grete Bloch 8.VI.14
Chez nous les parents ont coutume de dire que les enfants vous font sentir à quel point on vieillit. Quand on n’a pas d’enfants, ce sont vos propres fantômes qui vous le font sentir, et ils le font d’autant plus radicalement. Je me souviens que dans ma jeunesse, je les attirais hors de leur trou, ils ne venaient guère, je les attirais avec plus de force, je m’ennuyais sans eux, ils ne venaient pas et je commençais à croire qu’ils ne viendraient jamais. À cause de cela j’ai déjà été souvent bien près de maudire mon existence. Par la suite ils sont quand même venus, de temps à autre seulement, c’était toujours du beau monde, il fallait leur faire des courbettes bien qu’ils fussent encore tout petits, souvent ce n’était nullement eux, ils avaient seulement l’air de l’être ou bien ils le donnaient seulement à entendre. Cependant lorsqu’ils venaient pour de bon, ils se montraient rarement féroces, on n’avait pas lieu d’être très fier d’eux, ils vous sautaient dessus tout au plus comme le lionceau saute sur la chienne, ils mordaient , mais on ne s’en apercevait qu’en maintenant l’endroit mordu avec le doigt et en y appuyant l’ongle. Plus tard, il est vrai, ayant grandi, ils sont venus et sont restés à leur guise, de tendres dos d’oiseaux sont devenus des dos de géants comme on voit sur les monuments, ils sont entrés par toutes les portes, enfonçant celles qui étaient fermées, c’étaient de grands fantômes fortement charpentés, une foule anonyme, on pouvait se battre avec l’un d’eux ; mais non pas avec tous ceux qui formaient cercle autour de vous.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 683.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, marthe robert, fantôme | ![]() Facebook |
Facebook |
17/12/2016
Bernard Noël, Qu'est-ce qu'écrire, I

Qu’est-ce qu’écrire, I
(…)
Nous écrivons avec des mots. Nous savons tous qu’écrire, c’est d’abord rassembler des mots. Nous le faisons sans savoir ce qu’ils sont, ni quel type d’outillage ils représentent, ni de quelle partie de nous ils sortent avec un tel naturel. Parfois, ce naturel tombe en panne, et une maladie s’ensuit dans le corps. Parfois, celui qui écrit ne supporte plus que son texte ne soit qu’un texte, et il fait tomber en panne ce naturel.
L’amour, l’écriture, le jeu, etc., déclenchent un emportement dans le mouvement duquel leur acteur touche l’autre : un autre qui peut être réellement l’autre, mais qui peut aussi être une figure que nous ne touchons qu’en nous.
L’amour, l’écriture, le jeu, etc., ont ainsi dans leur activité même un sens qui nous suffit et qui fait, par exemple, que nous ne cherchons pas à sentir dans la main qui écrit une main plus ancienne, pas plus que nous cherchons à connaître la besogne qu’elle pourrait secrètement poursuivre sous le masque de l’écriture.
(…)
Bernard Noël, La Place de l’autre, Œuvres, III, P.O.L, 2013, p. 203.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, qu'est-ce qu'écrire, la place d l'autre, l'amour, le jeu | ![]() Facebook |
Facebook |
16/12/2016
Georges Didi-Huberman, Essayer voir

Le lieu malgré soi
« La raison, l’art, la poésie ne nous aident pas à déchiffrer le lieu d’où ils ont été bannis (la ragione, l’arte, la poesia, non aiutano a decifrare il luogo da cui sono state bandite.) » Dans cette phrase de Primo Levi extraite de son livre admirable Les Naufragés et les rescapés, le « lieu » en question désigne, bien sûr, le camp d’Auschwitz et, en général, la réalité du Lager, ce lieu échafaudé contre l’homme, ce lieu conçu pour la négation et l’extermination d’une humanité tout entière. On sait aussi que, malgré cette impossibilité à comprendre intégralement, malgré cette « indéchiffrabilité » du lieu où Primo Levi fut exposé au pire, la raison, l’art et la poésie lui furent bien nécessaires et, même, vitales, comme il le développe dans les mêmes pages — notamment lorsqu’il écrit : « Quant à moi, la culture m’a été utile : pas toujours, parfois, peut-être par des voies souterraines et imprévues, mais elle m’a servi et m’a peut-être sauvé » (…).
Georges Didi-Huberman, Essayer voir, Les éditions de Minuit, 2014, p. 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2016
Jacques Roubaud, Octogone
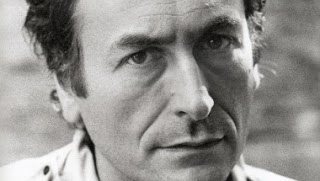
Vitez
Cheveux noirs, regard brun, traits coupés au couteau
Le sourire du chat, ne montrant pas ses dents
Pas de chaleur, pas d’émotion, ombre portée
Double, à grand froid, comme un rasoir sifflant l’espace.
Janséniste baroque et modeste d’orgueil,
À cinquante ans ! jouant Faust nu, diogénique
Sort d’une malle, s’étonne, choque, puis convainc
Occupant le plateau investi de son pas.
Tenant les vers immensément serrés, distincts,
Médités (de Maïakovski contre Aragon)
Rafales de la voix et diction de l’esprit.
Tout d’intellect, insensuel, insaisissable
Il savait ne laisser personne indifférent
Au total un génie étrange, saisissant.
Jacques Roubaud, Octogone, Gallimard, 2014, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rougeaud, octogone, citez, portrait, génie, maïkovski, aragon | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2016
John Clare (1793-1864), Poèmes et proses de la folie

Je sens que je suis
Je sens que je suis je sais seulement que je suis
Que je foule la terre non moins morne et vacant
Sa geôle m’a glacé de sa ration d’ennui
A réduit à néant mes pensées en essor
J’ai fui les rêves passionnés dans le désert
Mais le souci me traque — je sais seulement que je suis
J’ai été un être créé parmi la race
Des hommes pour qui ni temps ni lieux n’avaient de bornes
Un esprit voyageur qui franchissait l’espace
De la terre et du ciel comme une idée sublime —
Et libre s’y jouait comme mon créateur
Une âme sans entraves — comme l’Éternité
Reniant de la terre le vain le vil servage
Mais à présent je sais que je suis — voilà tout
John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare, traduction
Pierre Leyris, Mercure de France, 1969, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, poèmes et proses de la folie, terre, rêve, temps, lieu | ![]() Facebook |
Facebook |
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Paysage mauvais
Sables de vieux os _ Le flot râle
Des glas : crevant bruit sur bruit…
— Palud pâle, où la lune avale
De gros vers pour passer la nuit.
— Calme de peste, où la fièvre
Cuit… Le follet damné languit.
— Herbe puante où le lièvre
Est un sorcier poltron qui fuit…
— La Lavandière blanche étale
Des trépassés le linge sale,
Au soleil des loups… — Les crapauds,
Petits chantres mélancoliques
Empoisonnent de leurs critiques,
Les champignons, leurs escabeaux.
Tristan Corbière, Les amours jaunes, dans
C. Cros, T. Corbière, Œuvres complètes,
édition P.-O. Walzer, Pléiade/Gallimard,
1970, p. 794.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, paysage mauvais, mer, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2016
Tim Burton, La triste fin de l'enfant huître. L'étang l'hiver

Justine
Par peur de poursuites en justice
appelons la juste Justine
(ou bien « la droguée qui était folle
de colle).
Pourquoi je connais
son vice effréné ?
Eh bien quand elle mouche son nez
Sur sa face reste collé le kleenex
Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître,
traduction René Belleto, 10/18, 1998, p. 107 et 109.
L'étang l'hiver



Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tim burton, la triste fin de l'enfant huître. l'étang l'hiver (décembre 2016 | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2016
Jean-Claude Pinson, Pastorale surréaliste à Nantes

Pastorale surréaliste à Nantes
Rue MarieAnne du Boccage
où Vaché en convalo à l’hosto
pas encore devenu Lycée Guist’hau),
avec Breton André fit un beau tapage,
se foutant pas mal des us du bocage
cent ans plus tard ou presque, un promoteur
se piquant de pastorale, malgré le bruit des moteurs,
eut bingo l’idée rentablement bébête
de baptiser « Clos des Poètes »
un immeuble cossu avec un zeste de verdure
(plus une entrée, surtout, contre gueux sécure)
un temps, j’y créchai par hasard
en stabulation libre, quoique un peu à l’étroit
dans un mal fichu T1 bis pas très droit,
y paissant néanmoins bien peinard
maintes pages avec en plus droit de pacage
auprès de Marie-Anne née Lepage,
poète plus connue sous le nom d’Anne-Marie du Boccage
Jean-Claude Pinson, dans NU(e) 61, "Jean-Claude Pinson",
octobre 2016, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, pastorale surréaliste à nantes, breton, vaché, pastorale, poète | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2016
Pierre Bergounioux, Métamorphoses

[…] Combien de fois, tombant inopinément, des années plus tard, sur des hommes bâtis en athlètes, des femmes faites qui se donnent pour avoir été de mes élèves, n’ai-je pas éprouvé une tristesse insidieuse, un sentiment de perte irréparable. Le garçonnet brillant, la fillette vive, résolue, étincelante à qui tout semblait permis, disparus, le feu éteint, la promesse oubliée. Comme si nous procédions, nous aussi, par métamorphoses complètes, séparés de ce qui palpitait, tremblait d’être, insoucieux d’y revenir en pensée. Comme si l’esprit, à l’instar du corps, son compère, avait dépouillé l’éclat natif, la puissance originelle qui l’animaient.
Il y a l’inverse, aussi, la même tristesse, si l’on veut, mais résultant de la constatation opposée. On croise des femmes, des hommes qu’on n’a pas connus avant et dont il se vérifie, très vite, que ce sont des enfants. Comme ces derniers, ils l’ignorent, et ce qu’il faut bien envisager un jour, dût-il en cuire et d’autant plus, sans doute, qu’il en cuit. Ils laissent le monde extérieur empiéter sur eux-mêmes, persévèrent dans l’inachèvement, le confus, l’odieux qui qualifient aussi l’enfance. Et pour le coup, c’est aux insectes à métamorphoses incomplètes, qui croissent en volume sans changer de forme, que je songe.
Pierre Bergounioux, Métamorphoses, dans Penser/Rêver, « L’enfant dans l’homme », printemps 2002, p. 24-25.
© Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, métamorphoses, élève, adulte, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2016
René Crevel, Le clavecin de Diderot

Pourquoi ces souvenirs ?
[…]
Salauds !
On les connaît vos écoles, vos lycées, vos lieux de plaisir et de souffrance. Y prenait-on quelque élan, c’était pour aller se casser la gueule contre des mosaïques de sales petits intérêts, qui servent de sol, de murs, de plafond à vos bâtiments publics et demeures privées.
Digne confrère de toutes les hargneuses théologies, l’humanisme donne pour une pensée libre sa pensée vague, et ainsi décide n’importe qui à reconnaître de droit sinon divin, du moins nouménal, l’exercice de ses facultés et métiers envers et contre les autres. Bien entendu, plus civilisé sera le pays, plus chaude sera la lutte entre individus. Le capitalisme se réjouit de cet état de concurrence. Les chrétiens respirent : chacun pour soi et Dieu pour tous.
Es langues anciennes, à la maladie, à la mort, en passant par la littérature, l’art, l’inquiétude, les bars, les fumeries et les divers comptoirs d’échantillonnages sexuels, jusqu’ici, pour qui voulait faire son chemin, il s’agissait de se spécialiser c’est-à-dire, sur toute carte de visite réelle ou idéale, d’annoncer, à la suite de son nom, une virtuosité particulière.
Un peu d’habileté, les thèmes les plus ressassés faisait figure, sinon d’excellent, du moins de très honorable Camembert.
René Crevel, Le clavecin de Diderot [1932], collection Libertés, J.J.Pauvert, 1966, p. 42-43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené crevel, le clavecin de diderot, hmansme, individu intérêt | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2016
Paul Auster, Disparitions

Nonterre
I
Accompagnant tes cendres, à peine
écrites, effaçant
l’ode, les racines avivées, l’œil
autre — de leurs mains gauches, ils t’ont traîné
dans la ville, t’ont serré
dans ce grand nœud de jargon, et ne t’ont rien
donné. Ton encre a appris
la violence du mur. Banni,
mais toujours au cœur
d’un calme fraternisant, tu retournes les pierres
d’une invisible terre, et rends douce ta place
parmi les loups. Chaque syllabe
est entreprise de sabotage.
Paul Auster, Disparitions, traduction Danièle Robert,
Babel, 2008 [Actes Sud 1994], p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul auster, nanterre, disparitions, jargon, encre, loup, syllabe | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2016
Jean de Sponde, Œuvres littéraires
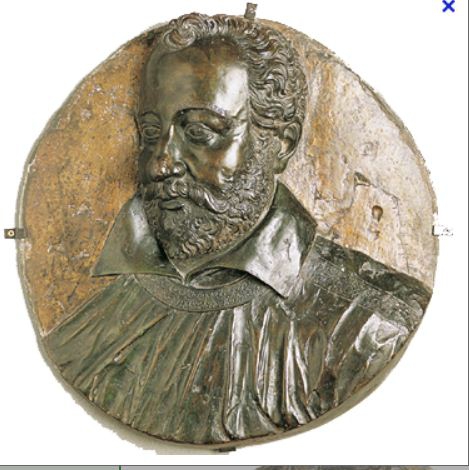
Qui sont, qui sont ceux-là, dont le cœur idolâtre,
Se jette aux pieds du Monde, et flatte ses honneurs ?
Et qui sont ces valets, et qui sont ces seigneurs ?
Et ces Ames d’Ébène, et ces Faces d’Albastre ?
Ces masques desguisez, dont la troupe folastre,
S’amuse à caresser je ne scay quels donneurs
De fumées de Court, et ces entrepreneurs
De vaincre encore le Ciel qu’ils ne peuvent combattre ?
Qui sont ces lovayeurs qui s’esloignent du Port ?
Hommagers à la vie, et félons à la Mort,
Dont l’estoille est leur Bien, le vent leur Fantasie ?
Je vogue en mesme mer, et craindroy de périr,
Si ce n’est que je scay que ceste mesme vie
N’est rien que le fanal qui me guide au mourir.
Jean de Sponde, Œuvres littéraires, édition Alan Boase,
Droz, 1978, p. 261.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de spondée, œuvres littéraires, idole, mondanité, masque, vie, mort, guide | ![]() Facebook |
Facebook |





