20/03/2017
Oswald Egger, Rien, qui soit : recension
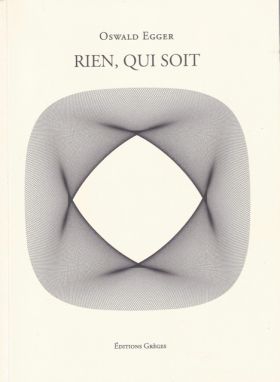
On ne peut que constater ce fait : la poésie de langue allemande contemporaine, si l’on excepte comme d’habitude Celan, Bachmann, peut-être Enzensberger, est fort peu connue en France, malgré le travail de quelques traducteurs et des éditeurs qui les accueillent. Jean-René Lassalle est un de ces infatigables passeurs qui, entre autres, a permis de lire Paul Wühr (1927-2016 ; Matière à l’autre bout l’esprit, 2016, Grèges), Franz Josef Czernin (né en 1952 ; Le Labyrinthe d’abord emprunte le fil rouge, 2011, Grèges) et a contribué à faire connaître Friederike Mayröcker grâce à une anthologie dès 2003 (Métaux voisins, L’Atelier de l’Agneau). Il présente aujourd’hui une anthologie d’un poète que l’on dit parfois, à tort, "expérimental" : comme si la poésie devait suivre des normes ; Oswald Egger est dans la tradition d’un Oskar Pastior (1927-2006 ; voir Poèmespoèmes, nous, 2013) qui s’en prenait dans sa poésie à toutes les propositions logiques et aux descriptions des choses, comme le faisaient aussi à leur manière Ernst Jandl (1925-2000) et Reinnard Priessnitz (1945-1985).
À ces brefs rappels, on ajoutera quelques éléments empruntés à la présentation de Jean-René Lassalle, dont une partie est reprise sur le site des éditions Grèges. Oswald Egger, né en 1963, appartient à la minorité germanophone du Tyrol italien ; après avoir vécu à Vienne, il a rejoint un groupe « néo-utopiste » d’artistes à Hombroïch (proche de Dusseldorf). Rien, qui soit, anthologie chronologique, rassemble deux recueils complets, le premier chapitre d’un autre et des extraits de 6 autres ; le traducteur définit l’ensemble de manière elliptique : comme « la construction d’un texte-monde poétique et philosophique visionnaire. » Il est bon de lire d’abord les quelques pages denses de cette postface pour mieux apprécier les poèmes d’Oswald Egger.
Dans les textes retenus, seuls deux recueils et le premier chapitre d’un troisième ont été repris en entier, et des extraits sont donnés des autres ensembles, trop volumineux. Les recueils ont été publiés entre 1999 et 2013 et chacun témoigne de recherches formelles complexes, prose et vers alternent et se mêlent, les poèmes versifiés obéissant souvent à des contraintes fortes. Ainsi, ce que décrit le traducteur, Susjardins compte 12 poèmes (qui correspondent aux 12 mois de l’année) de 12 vers, chacun pouvant être lu comme un poème. Album Nihilum est composé de 3650 quatrains, 10 pour chaque jour de l’année ; etc. La relation au passé littéraire ne s’opère pas seulement par des choix formels mais aussi, peu repérables pour un lecteur non germanophone, par des citations ou des jeux avec les classiques ; mais on reconnaîtra cependant dans une prose de Constance discontinue le début de L’Enfer de Dante : « Au milieu de la vie je me retrouvai comme dans une forêt (sans chemin). »1 Les recherches d’Oswald Egger sont ailleurs et, ce qui est le plus apparent, dans la néologie, plus aisée en allemand qu’en français puisque deux noms peuvent être joints et la création reste interprétable, même si elle n’est pas acceptée dans les dictionnaires ; l’adaptation en français passe par le mot-valise avec par exemple "hazarmonieux", "souchécorce". D’autres formations dérangent plus vivement l’ordre de la langue, comme le changement de genre ("la paysage"), l’association de deux mots de langues différentes ("chiarobscur") ou la création d’une unité qui apparaît vraisemblable (« chapiteaux et copouilles s’entrecollent »). La néologie est très présente dans Rien, qui soit : c’est qu’il y a, affirmée, la nécessité d’inventer et de tout dire, à nouveau, parce que « Les mots dans la glace à dégeler, rassembler les / troupeaux de parole tirés des cavités du cerveau./ »
Tout dire ? Qu’en est-il, par exemple, de ce que l’on voit devant un paysage : « La lumière du soir déferle par couloirs rouge et or dans les graminées, [etc.] » ? ce qui importe n’est pas ce qui est immédiatement vu, mais les « perspectives camouflées », non ce qui serait caché mais ce que les mots permettent de rêver : « après les ombres, pourraient-elles aussi s’évanouir les choses qui les conditionnent ? ». On pourra lire, à la suite d’un vers qui engage une représentation, un vers, qui sans déranger l’ordre syntaxique, oriente vers une autre vision des choses :
Chaque jour maintenant le soleil brille et je n’ai plus froid malgré la gelée. (vers 1)
Les saules candi houspillaient des pousses de rave sous les roseaux, consolé. (vers 2)
On parlera d’incompatibilité sémantique si l’on prétend qu’un poème doit "avoir un sens". Il faut d’abord répondre avec Oswald Egger qu’on ne sait pas vraiment ce qu’est un poème ; ensuite, que ce genre d’énoncé permet de « défragmenter la Terre plate (et la palette de ses nuances en parole) » et qu’il n’empêche pas de porter attention à ce qui se passe : le chantier de la Postdamer Platz, à Berlin, après la chute du mur, est le motif d’un long poème, la nature sous toutes ses formes (végétale, minérale, animale) est sans cesse présente dans ses métamorphoses. Mais ce qui apparaît tout autant, ce sont les transformations continues d’un "je" omniprésent et qui questionne sa relation au monde : « Est-ce que la multiplication des voix d’un je qui parle ne l’emportait pas sur un autre qui ne parle pas et lui reste non-dit ? (et ainsi de suite) » La lecture de Rien, qui soit, demande quelque effort (et c’est heureux !), comme celle de Joyce de qui on l’a rapproché, mais elle fait entrer dans ce monde qui est le nôtre, dans ce labyrinthe qu’est la pensée sur le monde.
________________________________________________________
1 Comparer avec la traduction de Jacqueline Risset : « Au milieu du chemin de notre vie / je me retrouvai par une forêt obscure /car la voie droite était perdue. » (GF-Flammarion, 1985, p. 25 [fermer la parenthèse]
Oswald Egger, Rien, qui soit, traduit de l’allemand et présenté par Jean-René Lassalle, Grèges, 2016, 152 p., 14 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 22 février 2017.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald effer, rie, qui soit, jean-rené lassalle | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2017
Catherine Benhamou, Hors jeu

Hors jeu
1
Normalement on ne me voit pas.
Vous n’êtes pas censés me voir.
Je suis à l’intérieur de la poubelle qui est à l’intérieur de la pièce qui se joue en ce moment même à l’intérieur du théâtre.
La poubelle est censée être ouverte côté mur du fond.
C’est une poubelle confortable avec vue sur le mur du fond.
Noir. Le mur du fond est noir.
Ceux qui jouent là, sur la scène, les deux acteurs visibles, on les appellera par commodité le vieux et le non vieux.
Il y a aussi le père qu’on appellera par commodité le père.
Et il y a la mère qui est morte.
Normalement on ne me voit pas.
Ni dans le monde ni hors du monde.
Ni ici ni ailleurs.
Ni dans la vie ni dans le théâtre.
Entre les deux.
Entre les deux je suis.
L’auteur m’a jetée à la poubelle.
Invisible.
Cachée en pleine lumière.
Sourde aux appels des autres personnages.
Morte pour le public.
Hors jeu. Seule.
[…]
Catherine Benhamou, Hors jeu, dans Rehauts, n°38, hiver 2016, p. 56-57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine benhamou, hors jeu, théâtre, comédienne, poubelle, personnage | ![]() Facebook |
Facebook |
18/03/2017
Fabienne Raphoz, Blanche baleine

De la remise
dans les caisses rouges
- à petits bois
une couleuvre a mué
mon père
ses caisses rouges
- à pommes
devant le Môle
Idared
Mutsu
Melrose
classées
dans sa chambre
il ne sait plus
que pommier
refrain : une couleuvre
- aveugle
a mué
Fabienne Raphoz, Blanche baleine,
Héros-Limite, 2017, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, blanche baleine, couleuvre, pommes, père, refrain, mue | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2017
Henri Thomas, La monde absent
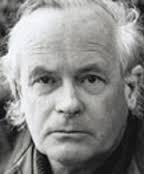
Je ne suis pas vraiment enclos
dans la vie aux barrières vagues,
souvent je tombe, parfois, héros
de l’immobile, sur une vague
je reste, toute une seconde.
Faut-il éviter cette tombe
à chaque instant rouverte ?
Ces stratagèmes pour ma perte,
ces ruses brutales, racontent
un ennemi toujours alerte
qui vole par le monde.
Sur le poème commencé
une lumière tombe
et les mots à peine tracés
se perdent comme l’ombre
des feuilles bougeant en été.
Le ciel enfle sa forme ronde,
immense absurdité.
Henri Thomas, Le monde absent, dans
Poésies, Poésie / Gallimard, 1970, p. 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
16/03/2017
Orson Welles, Lettre à l'Observer

(…) dénoncer l’incompétence des gouvernants, et déclarer ensuite que la direction du monde devrait être laissée exclusivement entre ces mains incompétentes, c’est manifester un bien extraordinaire désespoir.
Dans les circonstances actuelles, l’incitation à abandonner le bateau qui coule n’est pas seulement quelque chose de futile ; c’est aussi un cri de panique.
Orson Welles, Lettre à l’Observer, dans Ionesco, Notes et contrenotes, Idées/Gallimard, 1979, p. 155.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orson welles, lettre à l’observer, ionesco, notes et contentes, incompétence, panique | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2017
Cécile A. Holdban, Mobiles

Photographie Frédéric Tison (blog Les Lettres Blanches)
Les feuilles pendues aux arbres rappellent les oiseaux morts
une petite fille marche le soleil est mûr
le chemin bien droit
les pas légers dans la poussière
elle déjoue d’une tresse qui saute la pesanteur
sous les arbres
elle si petite l’ombre l’avalera
l’araignée approche
les cœurs seront jetés
les fragments rassemblés
dans la nuit d’une toile
Cécile A. Holdban, Mobiles, dans Europe,
janvier-février 2016, p. 265-266.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, mobiles, arme, oiseau, fille, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2017
Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik

J’appelle
Le soulevant comme un athlète,
je le portais en acrobate,
et, comme on appelle les électeurs au meeting,
comme les villages
au feu
sont appelés par le tocsin,
j’appelai :
« Le voilà !
le voilà !
Prenez-le ! »
Quand
un tel monument se mettait à hurler,
ces dames,
s’écartant de moi,
par la poussière,
par la boue,
par la neige,
filaient comme un feu d’artifice :
« Nous, c’est plutôt la petite taille,
nous, c’est plutôt le genre tango… »
Je ne puis porter,
et je porte mon fardeau.
Je veux le jeter,
et je sais,
je ne vais pas le jeter.
Les arcs des côtes vont lâcher.
Sous la pression a grincé la cage thoracique.
Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik (1917-1930),
traduction Andrée Robel, Gallimard, 1969, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir maïakovski, lettres à lili brik (1917-1930), fardeau, crainte | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2017
David Lespiau, Carabine souple

0
Déplacement des nuages sous un ciel sombre
la pluie en suspens, petite ville balayée par le souffle
accéléré de la nuit, pleine lune, hurlements de coyotes
sur des tombes ouvertes, fermées, dans l’ombre de ce qui se passe
sur l’avenue principale. Rangées de commerces, drugstores, saloon, prison
la terre foulée au centre, sable et boue. Montée de la poussière
en boucle, du matin au soir.
1
Les portes du saloon firent viyou viyou et l’Angleux fut dans la place
Le comptoir était désert, Martha en profitait pour faire du rangement
en haut. Les mouchoirs de John constamment enrhumé
jonchaient le sol, dépliés, souillés, comme des remords tardifs
Un frisson parcourut l’échine de Martha, penchée par-dessus la balustrade
— Pierre ! Montez donc
Ses seins tombaient sous son tablier, désignant lAngleux comme cible idéale
— Je monte, Martha, je monte
Les marches de l’escalier défilèrent sous ses bottes, la rampe glissa sous son gant
avant la fin de la phrase, il était à l’étage
— Je suis ravie de vous voir, dit Martha
ramassant un mouchoir aperçu au pied de la commode
et ne sachant plus qu’en faire, le plongeant dans la poche avant de son tablier
— Vous êtes enrhumée ? demanda Pierre
— Non c’est Johnny
— Je vois, vous faites paroi nasale commune, poursuit-il finement
— Oui non
2
— Je ne suis pas celle que vous pensez
— Moi non plus, répondit Pierre Vivante, qui faisait le malin
dans un excellent français
— Vous vous êtes fait un torticolis au cou, non ?
— Hum
— Ça va mieux ?
— I have mal au neck
— C’est le canapé ?
C’était le canapé
[…]
David Lespiau, Carabine souple, L’Ours Blanc, 2016, p. 5-6.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david lespiau, carabine souple, western, décor, saloon, hôtel, plaisanterie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/03/2017
Cécile Mainardi, L'histoire très véridique et émouvante de ma voix de ma naissance...

20
À 6 ans, mon pèe ramène à la maison un magnétophone, nous jouons pendant des heures à nous enregistrer à tour de rôle. Ma mère dit je ne sais pas trop quoi avec sa voix qui, sans être forte, semble celle d’une géante quad on la réécoute. Elle-même dit qu’elle ne se reconnaît pas, qu’elle n’en revient pas d’avoir cette voix. Je m’amuse à la lui faire réentendre. Elle me dit maintenant qu’il lui semble entendre la voix de sa sœur aînée. Je lui dis : « Si, c’est toi, écoute ! » Nous sommes en haut des escaliers qui mènent au premier, assis sur les dernières marches. Jamais aucun objet ne nous a fait tenir si près du sol. Nous sommes près de nos voix ; nos voix près de nos bouches ; nos bouches près de nos cœurs.
Cécile Mainardi, L’histoire très véridique et très émouvante de ma voix, de ma naissance à ma dernière chose prononcée, Contre-Pied, 2016, p.20. © Photo Brigitte Palaggi.
11/03/2017
Étienne Faure, Vues prenables

Puis les crues avaient délogé les morts
et les cadavres d’animaux qi dormaient sous l’eau
en un boueux désordre.
Une table flottait dans la Seine,
à quel repas en aval conviée, emportée sans hâte
— ce fut à Rouen qu’elle s’arrêta
à l’auberge où Flaubert l’attendait
avec d’autres ; toute la littérature
était là, à boire, à dévorer,
à ne vouloir jamais sortir de l’auberge
que la pluie ne coupât leur vin.
La vie,
sous la besogne outrancière des mots,
ils l’attrapaient comme idée,
pouce, index et majeur ramassés en grappe,
à s’aider de ces mains veinées
où coule en transparence une vieille vendange,
puis pour ne pas finir dans le vin aigre d’un tonneau
juraient, raturaient, buvaient
et contre Accoutumance, chien commun
tirant sa renommée de grammairien
d’une langue asséchée dans le jardin des maîtres,
aux jours de pluie rêvaient la canicule, en crevaient,
belle outre de vin noir — c’était du vent.
Littérature
Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon, 2009.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, littérature, flaubert, pluie, mot, vin | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2017
Pierre Silvain, Les chiens du vent, encres de Jean-Claude Pirotte

Sous la poussière il retrouve
L’ardoise d’enfance fêlée
Avec les griffures intactes
Proclamant sa détresse d’être
Celui qui toujours demeure
Au seuil du monde déchiffrable
Dans l’attente d’une aveuglante
Révélation ou d’un anéantissement
Rien n’a changé
Tout continue de se refuser
Là derrière
Pierre Silvain, Les chiens du vent, encres
de Jean-Claude Pirotte, Cadex, 2002, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, les chiens du vent, ardoise, monde, révélation, encres de jean-claude pirotte | ![]() Facebook |
Facebook |
09/03/2017
Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia

Qu’est-ce que, pratiquement, je poursuis ?
— La combinaison de mots, phrases, séquences, etc., que je suis seul à pouvoir bricoler et qui — dans ma vie pareille, comme toute autre, à une île où les conditions d’existence ne cessent d’empirer — serait mon vade mecum de naufrage, me tenant lieu de tout ce qui permet à Robinson de subsister : caisse d’outils, Bible, voire Vendredi (si je dois finir dans une solitude à laquelle je n’aurai pas le cœur d’apporter le catégorique remède).
— Ou plutôt ce qui me fascine, c’est moins le résultat, et le secours qu’en principe j’en attends, que ce bricolage même dont le but affiché n’est tout compte fait qu’un prétexte. Au point exact où les choses en sont au-dedans comme au-dehors de moi, quoi d’autre que ce hobby pourrait m’empêcher de devenir un Robinson qui, travaux nourriciers expédiés, ne ferait plus que se laisser glisser vers le sommeil, sans même regarder la mer ?
Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, 1981, p. 195.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d’olympia, bricolage, robinson, vendredi, solitude, fascination | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2017
Pierre Michon, Le Roi du bois

Tôt un matin, j’allais me couper des sifflets sous un taillis, dans un de ces fonds humides où viennent des essences tremblantes que le moindre souffle agite, saules et trembles, et qui recueillent à leur pied de pauvres espèces, les couleuvres, les grenouilles : on fait dans ces écorces les meilleurs sifflets, on en tire une plainte ténue mais exagérée comme le chant des crapauds. Oui, Dieu sait que je n’allai chercher là que de bons sifflets. L’odeur des feuilles pourries montait et penché là-dedans j’avançais avec précaution, très occupé, le regard à hauteur de terre. Le jour de juin me trouva dans ce sous-bois. À un détour par une trouée je vis au loin le front d’un palais dans le soleil levant en haut de la colline : rien n’y bougeait, nul n’était levé, c’était clair et inhabité comme un rocher ; ici les brumes de la nuit persistaient, les feuillages retombaient, tout était noir. J’étais bien.
Pierre Michon, Le Roi du bois, éditions infernales, 1992, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, le roi du bois, sifflet, arbre, grenouille, couleuvre, palais | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2017
Apollinaire, Le Guetteur mélancolique

La nudité des fleurs c’est leur odeur charnelle
Qui palpite et s’émeut comme un sexe femelle
Et les fleurs sans parfum sont vêtues par pudeur
Elles prévoient qu’on veut violer leur odeur
La nudité du ciel est voilée par des ailes
D’oiseaux planant d’attente émue d’amour et d’heur
La nudité des lacs frissonne aux demoiselles
Baisant d’élytres bleus leur écumeuse ardeur
La nudité des mers je l’attire de voiles
Q’elles déchireront en gestes de rafale
Pour dévoiler au stupre aimé d’elles leurs corps
Au stupre des noyés raidis d’amour encore
Pour violer la mer vierge douce et surprise
De la rumeur des flots et des lèvres éprises
Apollinaire, Le Guetteur mélancolique, dans Œuvres
poétiques, Pléiade :Gallimard, 1965, p. 574.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire, le guetteur mélancolique, nudité, fleur, mer, demoiselle, ciel | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2017
Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes

« Faire attention », c’est là, apparemment, un savoir commun. Nous savons faire attention à toutes sortes de choses et même ceux qui sont le plus férocement attachés aux vertus de la rationalité occidentale ne refuseront pas ce savoir aux peuples qu’ils jugent soumis à des superstitions. D’ailleurs, même les animaux aux aguets témoignent de cette capacité..
Et pourtant, on peut dire tout aussi bien que, dès lors qu’il s’agit de ce que ‘on nomme « développement » ou « croissance », l’injonction est de surtout ne pas faire attention. Il s’agirait de ce qui commande tout le reste, nous sommes sommés de penser la possibilité de réparer les dommages qui en sont le prix. En d’autres termes, alors que nous avons bien plus de moyens de prévoir et de mesurer ces dommages, on nous demande le même aveuglement que nous attribuons à ces civilisations du passé qui ont détruit l’environnement dont elles dépendaient. Et l’on détruit de manière seulement locale et sans avoir, contrairement à ce que nous avons fait en un siècle, exploité jusqu’à la raréfaction les « ressources » constituées au cours de millions d’années d’histoire terrestre(bien plus longtemps pour les nappes aquifères).
Ce que nous avons été sommés d’oublier, n’est pas la capacité de faire attention, mais l’art de faire attention. Si art il y a, et non pas seulement capacité, c’est qu’il s’agit d’apprendre et de cultiver, c’est-à-dire, littéralement, de faire attention. Faire au sens où l’attention, ici, ne se rapporte pas à ce qui est a priori défini comme digne d’attention, mais oblige à imaginer, à consulter, à envisager des conséquences mettant en jeu des connecions entre ce que nous avons l’habitude de considérer comme séparé. Bref, faire attention, au sens où l’attention requiert de savoir résister à la tentation de juger.
Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, Résister à la barbarie qui vient, La Découvete/Poche, 2013, p. 51-52.





