04/12/2018
Pierre Reverdy, Le gant de crin

Le lyrisme n’a rien de commun avec l’enthousiasme, ni avec l’agitation physique. Il suppose au contraire une subordination quasi-totale du physique à l’esprit. C’est quand il y a le plus : amoindrissement de la conscience du physique et augmentation de la perception spirituelle, que le lyrisme s’épanouit. Il est une aspiration vers l’inconnu, une explosion indispensable de l’être dilaté par l’émotion vers l’extérieur.
La carrière des lettres et des arts est plus que décevante ; le moment où on arrive est souvent celui où on ferait bien mieux de s’en aller.
Pierre Reverdy, Le gant de crin, Plon, 1927, p. 36-37, 60
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le gant de crin, lyrisme, enthousiasme, inconnu, carrière | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2018
Suzanne Doppelt, Rien à cette magie

la terre est ronde comme un œuf de poule ou d’autruche, un cercle imprécis dix-neuf fois plus grand que la lune d’où un jeune homme est tombé avec son double effronté, la jolie boule du monde, c’est son modèle réduit, de toutes les figures la plus semblable à elle-même, il doit se courber pour la reproduire puis la traverser. Une circumnavigation destinée à lui seul plus à quelques marins appointés, il faut du souffle et le sens de l’orientation car le commencement et la fin se confondent, un troisième œil électrique aussi afin de maintenir le fantôme en image, le ballon d’essai si bien gonflé et suspendu au bout d’un fil, une idée fixe toujours sur le point d’être emportée. Par le milieu un trop plein d’air ou un mauvais courant, un microclimat et plus rien ne tourne rond, il lui faudra des lunettes spéciales le laissant voir sans lui montrer grand-chose, le vide d’un rêve qui se déplie et se replie, neuf sphères qui composent le système du monde, moins une , peinte et cadrée avec grand art.
Suzanne Doppelt, Rien à cette magie, P. O. L, 2018, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suzanne doppelt, rien à cette magie, terre, double, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2018
Laurent Cennamo, L'herbe rase, l'herbe haute

Le mot "épinette" me revient, en lien d’abord avec cette minuscule église — une sorte de châsse géante, illuminée, au bord de l’Arno, à Pise : Chiesa della Spina. Ensuite avec un rêve de la nuit passée où, peut-être à Pise justement, je voyais, en gros plan, jaillissant de la terre, la partie centrale (une sorte de longue épine) en or (en tout cas dorée) d’une sorte de balance dont les deux plateaux étaient absents ou avaient disparu. Chose précieuse, antique, brillant de mille deux (un peu menaçante également), que je suis très fier de pouvoir nommer, presque doctement, à quelqu’un qui est là dans la nuit : « antene » (qui s’écrit peut-être avec un accent circonflexe — antêne— comme s’il s’agissait d’un mot grec). Mot très ancien, oublié, écrit sur le sable ou sur fond d’or, de feuillage de fin d’octobre bruissant, éblouissant.
(le mot "épinette")
Laurent Cennamo, L’herbe rase, l’herbe haute, Bruno Doucey, 2018, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent cennamo, l'herbe rase, l'herbe haute, épinette, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2018
Yves Bonnefoy, L'heure présente
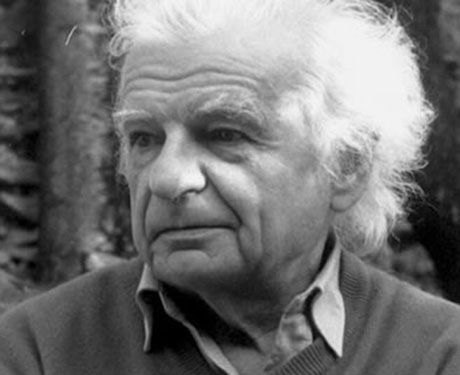
Dans le miroir
Imagine placé dans une chambre
Un grand miroir. La clarté des fenêtres
S’y prend, s’y multiple. Ce qui existe
Devient ce qui apaise. Là, dehors,
C’est à nouveau le lieu originel.
Passent Adam et Eve dont les mains
Se rejoignent ici, dans cette chambre,
Elle, tout une longue jupe, à falbalas.
J’ai pris un fruit, c’ était dans un miroir,
L’image n’en fut pas troublée, le jour d’été
En éprouva à peine un frémissement.
J’en perçus la couleur, la saveur, la forme,
Puis le posai, dehors. Et vint la nuit
Dans le miroir, et les fenêtres battent.
Yves Bonnefoy, L’heure présente, Mercure de France,
2011, p. 29.
Communiqué d'une revue amie :
https://revuecatastrophes.wordpress.com/13-le-meilleur-de...
et ici l'ensemble à télécharger au format pdf :
https://revuecatastrophes.files.wordpress.com/2018/11/cat...
Amicalement,
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, l’heure présente, miroir, illusion, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2018
Shakespeare, Sonnet

Sonnet CXXXV
Chacune a ce qu’elle désire, toi tu as ton Oui,
et Oui en prime, et Oui encore plus ; plus
qu’assez je suis ce qui te vexe encore quand
ainsi je m’ajoute à ton doux Oui ; toi dont le
Oui est large et spacieux, m’accorderas-tu de
cacher mon Oui dans le tien ? En d’autres
Oui semblera digne et pour mon Oui pas
l’ombre d’un je veux bien ? La mer toute
d’eau reçoit bien encore la pluie qu’elle ajoute
abondante à son magasin ; toi riche en Oui
ajoute pareil à ton Oui ce Oui de moi qui
fera ton Oui plus large encore. Un « Non ! »
cruel est tuant pour les prétendants ; pense-
les tous un seul, et moi dans ce seul Oui.
Shakespeare, traduction Pascal Poyet, dans
Koshkonong, n° 15, automne 2018, p. 1.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnet cxxxv, pascal poyet, oui | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2018
Malcolm Lowry, Pas de compagnie hormis la peur (traduction Jean Follain)

Pas de compagnie hormis la peur
Comment tout a-t-il donc commencé
et pourquoi suis-je ici à l’arc d’un bar à peinture brune craquelée
de la papaya, du mescal, de l’Hennessy, de la bière
deux crachoirs géants
pas de compagnie sauf celle de la peur
peur de la lumière du printemps
de la complainte des oiseaux et des autobus
fuyant vers des lieux lointains
et des étudiants qui s’en vont aux courses
des filles qui gambadent les visages au vent,
pas de compagnie hormis celle de la peur
peur même de la source jaillissante.
Toutes les fleurs au soleil me semblent ennemies
ces heures sont-elles donc mortes ?
Malcolm Lowry, Poèmes inédits, traduction Jean
Follain, dans Les Lettres Nouvelles, ‘’Malcolm
Lowry’’, Mai-juin 1974, p. 229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Lowry Malcolm | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, pas de compagnie hormis la peur, jean follain | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2018
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean
Une bouteille à la mer
Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, c'est-à-dire jusqu'à ces moments privilégiés où un enfant commence à prendre conscience de lui-même et de ce qui l'entoure, il me semble avoir toujours entendu une certaine voix qui résonnait en moi, mais à une grande distance, dans l'espace et dans le temps.
Cette voix ne s'exprimait pas en un langage connu. Elle avait le ton de la parole humaine mais ne ressemblait ni à ma propre voix ni à celle des gens qui me connaissent. Elle ne m'était pourtant pas étrangère, car elle semblait avoir une sorte de sollicitude à mon égard, une sollicitude tantôt bienveillante et rassurante, tantôt sévère, grondeuse, pleine de reproches et même de colère.
Les moments où j'entendais cette voix étaient ceux où ma vie paraissait suspendue dans le vide, interrompue, arrêtée, comme une horloge dont on ne voit plus bouger les aiguilles et dont on n'entend plus le battement.
Cette expérience très ancienne, primitive, sauvage, surtout secrète (car je n'en parlais à personne), s'est reproduite souvent au cours de mon existence, mais jamais elle n'a été aussi expressive, aussi intense que pendant mon extrême jeunesse, car rien ne pouvait alors en fausser la signification : elle résonnait dans une étendue absolument vacante, absolument solitaire.
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean, Gallimard, 1990, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, on vient chercher monsieur jean, une bouteille à la mer, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2018
Buson, le parfum de la lune

toute la nuit
sans un bruit la pluie
sur des sacs de graines
jour de pluie
loin de la capitale
une demeure dans les fleurs de pêchers
hésitant à le jeter
je pique le rameau de saule en terre
le son de la pluie
nuit courte
une averse
sur l’auvent en bois
au bord du chemin
des jacinthes d’eau arrachées fleurissent
la pluie du soir
Buson, le parfum de la lune, traduction Cheng
Wing fun et Hervé Collet, Moudarren,
1992, p. 39, 49, 53, 73, 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buson, le parfum de la lune, plie, fleurs, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2018
Jules Supervielle, Le Forçat innocent

Le miroir
Qu’on lui donne un miroir au milieu du chemin,
Elle y verra la vie échapper à ses mains,
Une étoile briller comme un cœur inégal
Qui tantôt va trop vite et tantôt bat si mal.
Quand ils approcheront, ses oiseaux favoris,
Elle regardera mais sans avoir compris,
Voudra, prise de peur, voir sa propre figure,
Le miroir se taira, d’un silence qui dure.
Jules Supervielle, Le Forçat innocent, dans Œuvres complètes,
édition Michel Collot, Pléiade / Gallimard, 1996, p. 280.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le forçat innocent, miroir, cœur, vie, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2018
Jacques Moulin, Sauvagines

Regard de clairière
Paupières feuillues
Œil de lynx
Oreilles sylvestres
Nez en l’air jusqu’à terre
Nez en flair avec
L’humus l’humeur des vents
L’ardeur des fumées
L’honneur du poil ou de la plume
Mains moussues
Corps tendu vers l’attente l’accueil
Il avance sans appareil photo
— l’appareil ne l’appareille jamais
Il avance toutes antennes offertes
Live sauvagement live
Il ne vient pas faire photo
Gonfler l’album thésauriser le cliché
Jouer la montre la démonstration
Il vient comprendre attendre entendre
Goûter à l’espace apprécier les lieux
Se dissoudre en eux
Garantir sa communion avec le vivant
Il est vivant au sein du vivant
Comme la pierre il est posé là
Dans le mitan du monde
Un coup de sécateur — sa dentition sauvage
Et il attend il observe il écoute il respecte
Il est à l’affût il s’affûte corps et esprit
[…]
Jacques Moulin, Sauvagines, éditions la clé à molette, 2018, p. 27-28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, sauvagines, image, jeu de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2018
Ana Tot, mottes mottes mottes

l’éternel détour
expulsé s’entend
sans retour
définitif pourtant
qu’est-ce que c’est
le déversé est absorbé
le répandu évaporé
une seule plongée
dans la même eau
pas davantage
mais la rivière l’ignore
au demeurant s’écoule
et s’écoulant demeure
irréversible est vue d’esprit
qu’espoir et désespoir
à parts égales égarent
le ponctionné quand on y pense
si ça nous chante o l’y reverse
dans le cours d’eau ou d’autre chose
ou dans le cours tout court des choses
Ana Tot, mottes mottes mottes, le grand os,
2018, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mottes mottes mottes, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2018
Basho, seigneur ermite

Cette eau de source,
est-ce la pluie printanière
s’égouttant des cimes des arbres ?
Séparons-nous maintenant
comme un bois de cerf se ramifie
au premier nœud
Pieds lavés,
je m’endors pour une courte nuit
tout habillé
À l’extrémité de la feuille
au lieu de tomber
la luciole s’envole
Ruines d’un château —
je visite en premier
l’eau limpide de l’ancien puits
Basho, seigneur ermite, l’intégrale des haïkus,
édition bilingue Makoro Kemmoku et
Dominique Chipot, La Table ronde,
2012, p. 168, 172, 175, 177, 180.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basho, seigneur ermite, pluie, séparation, luciole, château | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2018
Jean-Luc Sarré, Bardane

Feuilles mortes
(il en reste)
vieux chiffons
déchets
on fourre on entasse
on bourre
mais pas trop
on brûle en face
au fond d’une cour
dans un bison rouillé
l’hiver dont les volutes s’élèvent
entre la mer et ce balcon
où je disperse les mietets
d’un poème fragile
Jean-Luc Sarré, Bardane, farrago,
2001, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2018
Jean Tardieu, Da capo
Le procès de la mante religieuse
Mais oui ! Messieurs les juges
J’ai mangé mon mari
Mas oui je l’ai mangé
Elle rabâche elle balance
Ses antennes de télégraphe
Gauche droite elle vacille végétale
Elle tangue bateau sans ses voiles
Triangle cornu
Implacable et nu
Pourquoi me punir
Je n’ai rien fait de mal
J’obéis à ma loi
Qui échappe au tribunal
Mais oui je l’ai aimé
Voilà pourquoi
Je l’ai mangé
Elle se dandine
Longues cuisses vertes
La force la forfaiture
Et la démente nature
Et si vous continuez
Messieurs les juges
Je vais manger vos hermines
Comme di je vous aimais
Je suis la veuve éternelle
Jean Tardieu, Da capo, Gallimard, 1995, p. 48-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, le procès de la mante religieuse | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2018
Guillaume Apollinaire, Calligrammes

L’avenir
Soulevons la paille
Regardons la neige
Écrivons des lettres
Attendons des ordres
Fumons la pipe
En songeant à l’amour
Les gabions sont là
Regardons la rose
La fontaine n’a pas tari
Pas plus que l’or de la paille ne
[s’est terni
Regardons l’abeille
Et ne songeons pas à l’avenir
Regardons nos mains
Qui sont la neige
La rose et l’abeille
Ainsi que l’avenir
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, avril
1918, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 300.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, calligrammes, avenir, rose, abeille, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |






