13/08/2016
Anna Glazova, Expérience du rêve

choses dont on a besoin
nées du besoin
autrement dit faim et froid,
ni se décomposant ni s’amaigrissant.
besoin dont est tissée la limite rugueuse du monde
choses importantes — signifiant
impondérables comme la lumière
et distinguer ce qui signifie
et ce que tu signifies
n’est pas nécessaire
mais il importe
que les signes discriminent
taillent
lumière entière autant qu’obscurité.
Anna Glazova, Expérience du rêve, traduit du russe
par Julia Holter et Jean-Claude Pinson, joca seria,
2015, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna glazova, expérience du rêve, besoin, lumière, obscurité, faim, froid | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2016
Paul Claudel, Connaissance de l'Est

Heures dans le jardin
Il est des gens dont les yeux tout seuls sont sensibles à la lumière ; et même qu’est, pour la plupart, le soleil, qu’une lanterne gratuite à la clarté de quoi commodément chacun exécute les œuvres de son état, l’écrivain conduisant sa plume et l’agriculteur ses bœufs. Mais moi, j’absorbe la lumière par les yeux et par les oreilles, par la bouche et par le nez, et par tous les pores de la peau. Comme un poisson, j’y trempe et je l’ingurgite. De même que les feux du matin et de l’après-midi mûrissent, dit-on, comme des grappes de raisin encore, le vin dans sa bouteille qu’on leur expose, le soleil pénètre mon sang et désopile ma cervelle. Jouissons de cette heure tranquille et cuisante. Je suis comme l’algue dans le courant que son pied seul amarre, sa densité égalant l’eau, et comme ce palmier d’Australie, touffe là-haut sur un long mât juchée de grandes ailes battantes, qui, toute traversée de l’or du soir, ploie, roule, rebondit dessus de l’envergure et du balan de ses vastes fonds élastiques.
[…]
Paul Claudel, Connaissance de l’Est [1900], Poésie/Gallimard, 1974, p. 132-133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance d l'est, heures dans le jardin, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2016
Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant

Hai-Kai
(La nuit du 1er septembre 1923 entre Tokyô et Yokohama)
À ma droite et à ma gauche il y a une ville qui brûle mais la lune entre les nuages est comme sept femmes blanches.
La tête sur un rail mon corps est mêlé au corps de la terre qui frémit. J’écoute la dernière cigale.
Sur la mer sept syllabes de lumière une seule goutte de lait.
Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant [1929], dans Connaissance de l’Est, Poésie / Gallimard, 1974, p. 198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, l'oiseau noir dans le soleil levant, lune, nuit, cigale, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
01/03/2016
Paul Celan, Grille de parole

Avec lettre et horloge
De la cire
pour sceller le non-écrit
qui devina
ton nom,
qui chiffre
ton nom.
Viens-tu maintenant, nageante lumière ?
Des doigts, de cire eux aussi,
passés en d’étranges,
de douloureux anneaux.
Fondus leurs bouts.
Viens-tu, nageante lumière ?
Vides de temps les alvéoles de l’horloge,
nuptial l’essaim multiple,
prêt au voyage.
Viens, nageante lumière.
Mit Brief und Uhr
Wachs,
Ungeschriebnes zu siegeln,
das deinen Namen
erriet,
das deinen Namen
verschlüsselt.
Kommst du nun, schwimmendes Licht ?
Finger, wächsern auch sie,
durch fremde,
schmerzende Ringe gezogen.
Fortgeshmolzen die Kuppen.
Kommst du, schwimmendes Licht ?
Zeitleer, die Waben der Uhr,
bräutlich das Immentausend,
reisebereit.
Kommst, schwimmendes Licht.
Paul Celan, Grille de parole [Sprachgitter], traduit
de l’allemand par Martine Broda, Christian Bourgois,
1991, p. 19 et 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul cela, grille de parole, avec lettre et horloge, martine broda, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2015
Stéphane Korvin, noise

la fin. longtemps la répéter, ne pas la retenir, avec les mains qui fabriquent ces jours-ci des pansements discrets.
Je sais ce qu’il faut faire. s’accoter, être un cylindre, collecter la lumière, l’informité ne pas la répandre trop vite, les jours sont si longs, ils dorment dans la paume avec des idées de vertige
comme tout le monde, l’épuisante matière, la fabrique aimer, nous tournons autour d’une impression ténue
nos malléoles se heurtent, les voyages sont serrés, les chemins jouent à creuser et s’évaser, rien accueille, ici heurte
les lettres se logent, lentement elles forment des fleurs, des lettrines, la tête s’éprend, toute seule elle ne crépite pas
les couleurs se retirent et tombent jusqu’aux solives, un cœur claque quand l’oiseau entre
deux ou trois semaines : elles se taisent, passent et pendulent
si je savais parler je te glisserais « accorde tes rêves »
Stéphane Korvin, noise, isabelle sauvage, 2015, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane korvin, noise, lumière, aimer, lettres, couleur, parler, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2015
Édith Azam, Vous l'appellerez : Rivière

Elle regarde à nouveau le moulin, pense qu’il a encore vieilli, qu’elle ne lui connaît pas d’enfance, qu’il perd ses osselets en inventant des mots qui ne s’oublient jamais, qu’elle a mille ans d’absence sur tous les dictionnaires, que la vie n’est qu’un tour de passe-passe, que ses yeux s’habituent à la nuit, que dans ses mains à lui, même affaiblies, la lumière sera : toujours belle.
Rivière
ils ont bien vu
oui
en retrouvant le sol
qu’elle pouvait
se glisser
partout
qu’elle était
pour la terre
la source :
le langage
Édith Azam, Vous l’appellerez : Rivière, La Dragonne, 2013, p. 74.
©Photo Chantal Tanet.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, vous l’appellerez : rivière, regard, enfance, mot, absence, nuit, lumière, langage | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2015
Ana Luisa Amarl, L'art d'être tigre

art premier
Du point le plus reculé
de l’âme
un tigre saute en direction
de la lumière
pour ensuite retenir
son geste,
figeant membre
et son
le vent lui décoche
une flèche d’azur,
un recoin où le temps
se fixe mieux,
à en illuminer toute la
clairière
et inquiéter
le tout
Ana Luisa Amaral, L’art d’être tigre,
traduit du portugais par Catherine
Dumas, le phare du cousseix, 2015, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana luisa amaral, l’art d’être tigre, lumière, saut, vent, inquiétude | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2015
Emily Jane Brontë, Poèmes

Mon plus grand bonheur, c'est qu'au loin
Mon plus grand bonheur, c'est qu'au loin
Mon âme fuie sa demeure d'argile,
Par une nuit qu'il vente, que la lune est claire,
Que l’œil peut parcourir des mondes de lumière —
Que je ne suis plus, qu'il n'est
Terre ni mer ni ciel sans nuages —
Hormis un esprit en voyage
Dans l'immensité infinie.
[Février ou mars 1838]
I’m happiest when most away
I’m happiest whan most away
I can bear my soul from its home of clay
On a windy night when the moon is bright
Ant the eye can wander through worlds of light —
When I am not and none beside —
Nor earth nor sea nor cloudless sky —
But only spirit wandering wide
Through infinite immensity.
[February or March, 1838]
Emily Jane Brontë, Poèmes, traduction de
Pierre Leyris, Poésie Gallimard, 1963, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, poèmes, bonheur, lumière, immensité | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2015
Samuel Beckett, Soubresauts

Assis une nuit à sa table la tête sur les mains il se vit se lever et partir. Une nuit ou un jour. Car éteinte sa lumière à lui il ne restait pas pour autant dans le noir. Il lui venait alors de l’unique haute fenêtre un semblant de lumière. Sous celle-là encore le tabouret sur lequel jusqu’à ne plus le pouvoir ou le vouloir il montait voir le ciel. S’il ne se penchait pas au-dehors pour voir comment c’était en dessous c’était peut-être parce que la fenêtre n’était pas faite pour s’ouvrir ou qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas l’ouvrir. Peut-être qu’il ne savait que trop bien comment c’était en dessous et ne désirait plus le voir. Si bien qu’il se tenait tout simplement là au-dessus de la terre lointaine à voir à travers la vitre ennuagée le ciel sans nuages. Faible lumière inchangeante sans exemple dans son souvenir des jours et des nuits d’antan où la nuit venait pile relever le jour ou le jour la nuit. Seule lumière donc désormais éteinte la sienne à lui celle lui venant du dehors jusqu’à ce qu’elle à son tour s’éteigne le laissant dans le noir . Jusqu’à ce que lui à son tour s’éteigne.
Samuel Beckett, Soubresauts, Minuit, 1989, p. 7-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, soubresauts, nuit, ciel, lumière, nuage | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2015
André Frénaud, Hæres,

Sur la route
Douce détresse de l’automne,
des abois très lointains,
une échauffourée de nuages, comme un remuement
de souvenirs qui se cachent.
Et la lisière des peupliers pour donner figure
à la lumière qui va venir.
André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, sur la route, automne, nuages, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2015
Denis Roche (11/1937-3/09/2015), Les idées centésimales de Miss Élanize

Et au printemps, l’honneur de la porte
Qui s’ouvre à l’expérience réaliste, la
Pomme la plus remplie de jus roule à la rencontre
Des salles de dessins (et c’est l’exacte
Rencontre avec l’image des personnage de
Livres, ceux qui n’ont pas fini de pécher par
Exaltation, et qui n’ont de cesse de me conseil-
Ler la honte, les premiers qui défilent
Devant les fresque de la salle de lecture
Désormais cette autre personne s’attache
À l’entretien de ma demeure). Comme le
Rat enfin, il faut inscrire le nom de
Celles qui ont pour principale distraction
De s’émouvoir à la lumière matinale
Objets de ma réussite et de mon arrivée
À la gare et de ma compagnie
Denis Roche, Les idées centésimales de Miss
Elanize, Seuil, 1964, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denis roche, les idées centésimales de miss elanize, printemps, image, représentaion, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
22/05/2015
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

Reflet 1
Lèvres dévastées, le rouge vif déborde, les yeux sans fin au contour aguicheur, elle s’accroupit (pagne mauve lèvres offertes tee-shirt près du corps), regarde au loin, les traces noires autour des yeux, sourcils maladroitement repeints de la main d’une enfant, la lumière opaque, moue d’une fillette, rayons roses sur le corps, secret de la paille autour de ses cuisses refermées, elle s’imagine de l’autre côté du miroir.
Reflet 2
Les draps noirs sur les seins, dessein caché de l’autre monde. La dentelle d’une bretelle soutient la gorge dorée, dorure éternelle, les cheveux blonds, délavés par temps orageux, embroussaillés, sa bouche enflammée, le rouge dévie, regard docile presque doux (les pleurs ou le discours indicible d’une nuit blanche) elle tient au cœur du corps le drap froissé, elle, blonde à gémir, l’œil glauque et langoureux, désir tiède de l’autre corps, luxure des lumières, l’éclat de sa peau, en plein jour, émaillée.
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion, 1997, p. 103-104. © Photo Didier Pruvot.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, maquillage, seins, yeux, regard, miroir, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2015
Eugenio Montale, La tourmente et autres poèmes

Jour et nuit
Même une plume en volant peut dessiner
ta silhouette, ou le rayon qui joue à cache-cache
entre les meubles, répercuté du toit
par un miroir d’enfant. Sur le pourtour des murs
des traînées de vapeur allongent l’aiguille
des peupliers ; en bas sur le perchoir s’ébroue le perroquet
du rémouleur. Puis la nuit étouffante
sur la place, le bruit des pas, et toujours cette dure fatigue,
sombrer pour resurgir semblable
depuis des siècle, ou des instants, de cauchemars qui ne peuvent
retrouver la lumière de tes yeux dans l’antre
incandescent — les mêmes cris encore, les mêmes pleurs
sur la terrasse
si retentit le coup soudain qui te rougit
la gorge et brise l’aile, ô téméraire
annonciatrice d’aubes,
et que s’éveillent cloîtres et hôpitaux
au son lacérant des trompettes
(traduction Louise Herlin)
Eugenio Montale, La tourmente et autres poèmes, Poésies III, Gallimard,
1966, p. 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugenio montale, la tourmente, jour et nuit, lumière, arbres, cauchemar, aube | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2015
André Gide, Les Nourritures terrestres

Adriatique, 3 heures du matin
Le chant de ces marins dans les cordages m’importune.
Oh ! si tu savais, si tu savais, terre excessivement vieille et si jeune, le goût amer et doux, le goût délicieux qu’a la vie si brève de l’homme !
Si tu savais, éternelle idée de l’apparence, ce que la proche attente de la mort donne de valeur à l’instant !
Ô printemps ! les plantes qui ne vivent qu’un an ont leurs fragiles fleurs plus pressées. L’homme n’a qu’un printemps dans la vie et le souvenir d’une joie n’est pas une nouvelle approche du bonheur.
Rome, Monte Pincio
Ce qui fit ma joie ce jour-là, c’est quelque chose comme l’amour — et ce n’est pas l’amour — ou du moins pas celui dont parlent et que cherchent les hommes. — Et ce n’est pas non plus le sentiment de la beauté. Il ne venait pas d’une femme ; il ne venait pas non plus de ma pensée. Écrirai-je, et me comprendrais-tu si je dis que ce n’était là que la simple exaltation de la lumière ?
J’étais assis dans ce jardin ; je ne voyais pas le soleil ; mais l’air brillant de lumière diffuse comme si l’azur du ciel devenait liquide et pleuvait. Oui, vraiment, il y avait des ondes, des remous de lumière ; sur la mousse des étincelles comme des gouttes ; oui, vraiment, dans cette grande allée on eût dit qu’il coulait de la lumière, et des écumes dorées restaient au bout des branches parmi ce ruissellement de rayons.
André Gide, Les Nourritures terrestres, édition publiée sous la direction de Pierre Masson, Pléiade / Gallimard, 2009, p. 373 et 374.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré gide, les nourritures terrestres, mort, instant, apparence, amour, beauté, rome, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2015
Jean-Claude Schneider, La Peinture et son Ombre
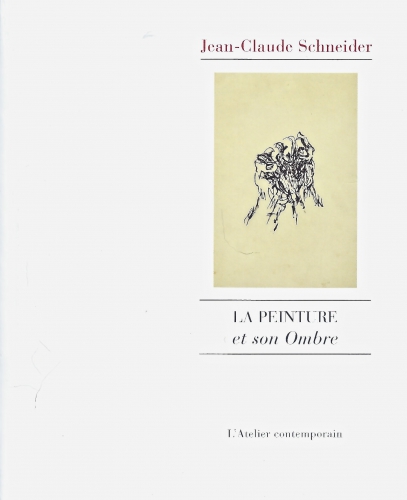
L’épaisseur du réel, peintures de Nicolas de Staël
[...]
D’autres peintures se vouent à l’expression de l’espace ou de la lumière ou des vibrations de couleurs, celle de Nicolas de Staël, d’emblée, veut dire l’épaisseur de la matière. Elle, matière, dont ma vue subit la brutalité lorsque l’obstrue ce chaos qui ne me parle pas encore. Masses opaques. Scellées. Ternes et mates. Où le densité croit avec la profondeur. Une infinité de gris. De murs. Pénétrant leur substance, j’habiterai ce mutisme, y décèlerai des assonances avec mes contradictions, mes apories, devinant qu’elles répètent les doutes, mes atermoiements. C’est cela qui affleure dans les toiles alors retenues par le peintre : un accord avec le monde dans lequel il se sent englué, et qu’au visage fermé des apparences répondent les traits illisibles de chorégraphies intérieures. Les titres énoncent l’âpreté de la tâche : la vie est dure, les portes n’ont pas de porte, contre le mur et l’horizon se brise l’élan des lames ; pour approcher le monde clos comme la prison de Piranèse qu’évoque une des toiles les chemins dénoncent leurs entraves. Tout : compact, confus, impénétrable. La lumière même est obstacle, l’air a pris corps. Les vides se comblent, non d’ajours, mais d’opacité. Il faut, pour traduire la nuit des fonds, saturer les tons les plus sombres, et qu’ils diffèrent à peine tant ils ont absorbé la moindre respiration, éteint toute vibration moins sourde. On n’irait pas, s’y enfonçant, traversant, vers le jour, mais vers plus de ténèbres encore. Graduée du plus dense au moins ténu, la pigmentation, de la teneur de l’ombre, énumère dans ces Compositions — ô la chimie des cémentations, la tectonique des intrications — la même abondance de textures, de chairs, que les natures mortes des primitifs hollandais. Les complexes charpentes qui étayent et tendent les peintures des années 47-49 morcellent et multiplient l’espace, y creusent un labyrinthe obscur et profond, citerne aux colonnes brisées ou voûtées, aux anfractuosités dérobées, enchevêtrées. C’est l’intérieur d’un corps.
[...]
Jean-Claude Schneider, La Peinture et son Ombre, "L’Atelier contemporain", éditions François-Marie Deyrolle, 2015, 208 p., p. 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude schneider, la peinture et son ombre, nicolas de staël, matière, lumière, opacité, nature morte, labyrinthe | ![]() Facebook |
Facebook |





