12/05/2016
Trois images de Londres



Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : trois images de londres, tamise, jardin | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2015
Deborah Heissler, Sorrowful Songs

Jardin — elle endormie
Un triomphe, une querelle d’ongles à la cloison des feuilles. Toucher absolu de la distance qui nous sépare désormais.
Ce matin la pluie dégringole, diffuse le long de la fenêtre, comme s’il avait fallu qu’accompagnée dans l’instant, elle le fût également sans que personne n’ai été averti. Sans bruit d’aucune sorte. J’ai pensé à ce moment, je m’en souviens, affronter l’image de son corps dans la pièce du bas. C’est le bois tiède du parquet qui a retenu mes pas.
Blanche est morte. Elle est morte hier soir.
Elle.
Lèvres entrouvertes.
Peau blessée.
Tresses soyeuses.
Je suis resté saisi à deux doigts d’elle, du bouquet d’ombre que les buissons depuis le jardin dandinent sur les murs, de la méridienne, des lettres du presse-papier, de son journal — le poète s’adresse sa femme —, d’autres passages réunis au fil des jours « Bribes de mondes égrenés qui explosent entre ses doigts » (Sylviane Dupuis).
[...]
Deborah Heissler, Sorrowful Sogs, dessins de Peter Maslow, préface de Claude Chambard, Æncrages & Co, 2015, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deborah heissler, sorrowful sogs, dessins de peter maslow, préface de claude chambard, pluie, jardin | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2015
Edward Estlin Cummings, Érotiques

dame est couverte
de fleurs
ses pieds sont effilés
formés chacun de cinq fleurs sa cheville
est une minuscule fleur
les genoux de ma dame sot deux fleurs
Ses cuisses sont de vastes et fermes fleurs de nuit
et exactement entre
elles endormie intensément
est
la fleur soudaine d’une totale stupéfaction
une dame couverte de fleurs
est un jardin d’ivoire.
Et la lune est un jeune homme
que je vois régulièrement autour du crépuscule
entrer dans le jardin et sourire
en lui-même.
Edward Estlin Cummings, Érotiques, traduit et
présenté par Jacques Demarcq, Seghers, 2012,
p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward estlin cummings, Érotiques, dame, fleur, cuisse, jardin, lune | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2015
François Muir, L'infamie de la lumière

Jardins
Lumière, lumière blanche, pas à pas
Lente approche, éphémère confrontation
Ombres souriantes, corolles de rose
De près, terre foulée, lents écarts
Corps sans attache, repos loin du ciel
Escale, séjour d’îles en îles
Fleuve
Frôlements
Nu, nage isolée
Passage sur la terre
Insensible au feu, à ses ramifications
Feu qui ne s’allume, ni ne s’éteint
Tête à tête, celui qui veille, celui qui s’absente
Cendres
Coupure, flots de silence
Converti à l’Autre, aux états, aux états
Loin du tumulte, étrave impassible
Cendres sur la terre, cendres dans les os
Lumière dans la lumière, sans laisser de traces
François Muir, L’infamie de la lumière, La Lettre volée,
2015, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois muir, l'infamie de la lumière, jardin, fleuve, cendres | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2015
Gérard Macé, Les balcons de Babel

Le théâtre est bien réel, au nord éloigné d’un jardin où l’on a réuni les espèces végétales les plus rares : Assuérus Auréa, Catinat, Alice et Céleste, Cordélia, Clématis, Orion, Sirius et Cassiopée, Opéra, Châtelet, Crépuscule, Mentor et Spectabilis sont les héroïnes en pleine terre de ce théâtre naturel. Un sophora rapporté par un voyageur désœuvré, un prunus qui fleurit en avril, un arbre mâle et centenaire sont avec la maison de Cuvier, les serres tropicales, le jardin d’hiver et le petit labyrinthe, le vivarium à main gauche de l’éléphant de mer, les autres stations de cette promenade pour dieux minuscules, qui croient serrer le monde dans un mouchoir comme ils tiennent un dictionnaire dans leur main ; ici, c’est le jardin des nominations sous le ciel, dont les constellations trois à trois sont des miroirs tournants, qui nous montrent tour à tour, mais jamais dans le même ordre, les empreintes de nos rêves : la tête le père le cheval le vent les bois le coq ébouriffé la lune l’oreille le porc le tonnerre l’œil le faisan le lac la bouche la concubine le fou le souffleur le pendu.
Gérard Macé, Les balcons de Babel, Le Chemin / Gallimard, 1977, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard macé, les balcons de babel, théâtre, fleurs, labyrinthe, jardin, constellation, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
07/02/2015
Jean Tortel, Relations

Phrases pour un orage
I
Le ciel un peu trop lent pour cette heureuse
Matinée, l’arbre un peu trop
Chargé d’épaisseur tendre.
Le jardin transpirait
Au point du jour.
Il respire encore.
II
Vogue et scintille
Avant midi
Ce nuage.
(Il vient du sud), et nu
Le risque d’un azur
Quand sa blancheur l’éprouve
Dès qu’elle est suscitée.
Plus pure si possible
Que lui, touché par elle
Et dénoncé.
Ou son langage,
Ou son éclat.
III
On n’est pas heureux
Sous l’azur fragile.
En ce jardin je sais je ne sais quoi.
Les feuilles sont un peu plus larges,
Un peu moins vertes que leur nom.
L’azur enfante l’ombre
(Le fruit sa pourriture).
La terre aborde son silence
Qui l’attendait.
[...]
Jean Tortel, Relations, Gallimard, 1968, p. 29-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, relations, phrases pour un orage, jardin, nuage, azur | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2014
Ariane Dreyfus, Nous nous attendons

« Encore une fois »
Derrière la porte il ne respire qu'à moitié
Si elle entre rien ne s'arrête
Ne s'oppose
À celle qui s'approche elle est vraie
Maintenant on peut s'ouvrir en deux
Les lèvres pas toutes seules
De toute sa figure il y va
Elle recule
Contre l'armoire l'accent, figée de désir
Pas froid chérie
Il faut poser sa robe
« Je vais au jardin »
Elle ouvre la main même s'il ne comprend pas
Être visible,
Est-ce se montrer ?
À un endroit, un cri de couleur
Le forsythia, se montre
Ariane Dreyfus, Nous nous attendons, Reconnaissance à Gérard Schlosser, Le Castor Astral, 2012, p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, nous nous attendons, jardin, vrai, lèvre, couleur, forsythia | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2014
Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures
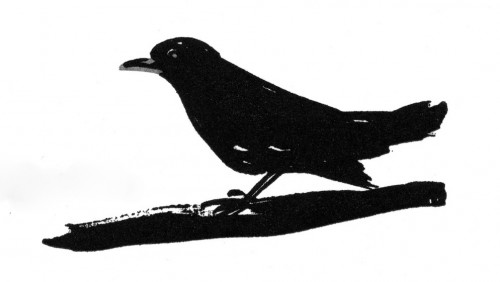
Dessin de Ianna Andréadis
Au merle de mon jardin
(avec l’aide de quelques-uns)
Le merle de mon jardin est un oiseau commun
mais c’est le merle de mon jardin ;
le merle de mon jardin est un oiseau commun
mais j’ai aussi treize manières de le regarder ;
le merle de mon jardin est un oiseau commun
mais il est à lui seul le voyage tout entier ;
le merle de mon jardin n’est ni le ciel ni la terre
mais il les réunit ;
il n’y a pas d’ailleurs de son monde pour l’être-là merle
du merle de mon jardin ;
parfois je suis un peu le merle de mon jardin
car je le suis des yeux ;
ainsi, pour le dire autrement, l’œil du merle de mon
jardin et mon regard ne font qu’un, mais j’ai moins
d’acuité pour observer le merle de mon jardin
qu’il n’en a pour me regarder depuis le
pommier ;
les ancêtres du merle de mon jardin volaient
avant les ancêtres de la chauve-souris ;
les ancêtres dinosaures du merle de mon jardin ne se
sont pas éteints,
ils se sont envolés ;
le merle de mon jardin contrairement à la mouche du pré
ne met pas ses pattes sur sa tête ;
dans la syrinx du merle de mon jardin,
il y a un peu du Solitaire masqué de Monteverde ;
jaune vif le bec du mâle merle noir : tordus merula de mon jardin
comme ceux de tous les mâles merles tordus sp
du monde sauf le bec du mâle Merle du Maranon Tordus maranonicus
du mâle merle cul-blanc Tordus obsoletus et du mâle Merle
Haux-Well Tordus hauxwelli
Une année, le merle de mon jardin a fait son nid quasi
sous mon nez ;
le merle de mon jardin mange souvent des baies de lierre au-dessus
de mon nez sur le gros mur moussu de mon jardin, l’été ;
le merle de mon jardin, comme le piapiateur noir de
Jacques Demarcq,
piapiate et tuititrix, son chant résonne refluifluité ;
le merle de mon jardin comme Jacob de Lafon soi-même
aime penser les choses par deux : baie et chat,
air et froid, œuf et bec, eux et eux, mais à
l’inverse de Jacob de Lafon il n’associe rien à
l’arôme du noyau ;
le merle de mon jardin, comme le merle de Ianna
(Andréadis)
peut rester longtemps immobile et regarder de
biais ;
comme Claude Adelen, j’ai tutoyé l’aire du merle de mon jardin
en vain ;
le merle de mon jardin se tait à la mi-juillet
mais garde son sale caractère — je l’appelle souvent
le pipipissed off merle de mon jardin parce que j’ai un rapport passionnel avec la langue anglaise et le merle de mon jardin ;
le merle de mon jardin se merle de tout c’qui s’passe et passe dans mon jardin ;
le merle de mon jardin aime que je parle de lui et me le fait savoir par un petit
puiitpitEncore, puitpitEncore ;
chaque hiver j’espère que le froid ne tuera pas le merle de mon jardin ;
le merle de mon jardin et moi sommes assez semblables
— à une petite différence près :
un jour le merle de mon jardin comme le Merle de Grand Caïman éteint
je le chialerai
Ceci étant :
le merle de mon jardin n’est sûrement pas mon merle comme mon jardin n’est finalement pas mon jardin mais le monde du merle de mon jardin et de quelques-uns, pendant l’été pendant l’hiver, par instants, ou bien alors, durant toute l’année, comme le merle de mon jardin : le milan, la buse, le faucon, le martinet, le coucou, le pic, la corneille, le geai, la pie, la pie-grièche, le rougegorge, la grive, l’hirondelle, le verdier, la mésange, le rougequeue, le pinson, le serin, la bergeronnette, le grosbec, la fauvette, le gobemouche coche de mon jardin , le grimpereau, le chardonneret, la sitelle, le tarin, le moineau, le troglodyte, le bruant ; mais aussi le renard, le hérisson, l’écureuil, la taupe, le mulot, l’épeire, le faucheux, le lézard, la couleuvre, l’argus, la piéride, le nacré, la petite tortue, le myrtil, le macaon, le cétoine, le capricorne, le carabe, l’apion, le clairon, le criocère, le hanneton, le bousier, le taupin, le gendarme, la punaise, le criquet, la sauterelle, la guêpe, le frelon, l’abeille, le bourdon, le syrphe, la mouche, la cordulie, mais encore la verge d’or, la gesse, la balsamine, le trèfle, l’œillet, la centaurée, le millepertuis, la carotte sauvage, le coquelicot, la reine des prés, la scabieuse, l’hortie, le cornouiller, le frêne, le noisetier, le noyer ; et tous les autres que je n’sais même pas nommer, que j’n’ai même pas vu ou que j’ai acclimatés à mon jardin à l’inverse du merle de mon jardin qui lui a choisi mon jardin.
(Bonnaz, août 2009)
Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures, Dessins de Ianna Andréadis, Genève, éditions Héros-Limite, 2011, p. 158-161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures, merle, jardin, fleurs, chant, ianna andréadis, jacques demarcq | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2014
E. E. Cummings, Paris, traduction Jacques Demarcq

le long des traîtres rues fragiles et éclatantes
du souvenir avance mon cœur chantonnant comme
un idot murmurant comme un ivrogne
qui (à un certain angle, soudain) aperçoit
le haut gendarme de mon esprit
être éveillé
n'étant dormir, ailleurs ont débuté nos rêves
à présent repliés : mais cette année achève
son existence tel un prisonnier oublié
- « Ici ? » - « Ah non, mon chéri ; il fait trop froid » -
Ils sont partis dans ces jardins passe un vent porteur
de pluie et de feuilles, emplissant l'ai de peur
et de douceur.... s'arrête ... (Mi-murmurant...mi-chantant
agite les toujours souriants chevaux de bois)
when you were in Paris on se retrouvait là
*
along the brittle treacherous bright sreets
of memory comes my heart,singing like
an idiot,whispering like a drunken man
who(at a certain corner, suddenly) meets
the tall policeman of my mind
awake
being not asleep,elsewhere our dreams began
which now are folded :but the year completes
his life as a forgotten prisoner
-"Ici ?" - "Ah non, mon chéri ; il fait trop froid"-
they are gone along these gardens moves a wind bringing
rain and leaves, filling the air with fear
and sweetness... pauses...(Halfwhispering...halfsinging
stirs the always smiling chevaux de bois)
when you were in Paris we meet here
E. E. Cummings, Paris, traduit de l'anglais et présenté par Jacques Demarcq, édition bilingue, Seghers, 2014, p. 95 et 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, paris, jacques demarcq, rue, jardin, rencontre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2014
Philippe Jaccottet, L'Ignorant, dans Œuvres

Chanson
Qui n'a vu monter ce rire
comme du fond du jardin
la lune encore peu sûre ?
Qui n'a vu s'ouvrir la porte
au bout de l'allée de pluie ?
(Ah ! qui entre dans cette ombre
ne l'oublie pas de sitôt !)
Les bras merveilleux de l'herbe
et ses ruisselants cheveux,
la flamme du bois mouillé
tirant rougeur et soupirs...
(Qui s'enfonce dans cette ombre
ne l'oubliera de sa vie !)
Qui n'a vu monter ce rire...
Mais toujours vers nous tourné,
on ne peut qu'appréhender
sa face d'ombre et de larmes.
Philippe Jaccottet, L'Ignorant, dans Œuvres, préface de Fabio Pusterla, édition établie par José-Flore Rappy, Pléiade /Gallimard, 2014, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, l'ignorant, jardin, ombre, herbe, tire, larme | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2013
Jean-Luc Sarré, La Part des anges
Une semaine avec les éditions La Dogana

Citadin, il aime les jardins
mais pour les rejoindre il lui faut
attendre les vacances d'été.
Un après-midi de septembre
il arrive que l'orage survienne
et le trouve, assis sur une fesse,
étrangement irrésolu.
Une tonnelle d'abeilles au travail
l'a détourné de son chemin
pis abandonné sur une souche.
Les gouttes sur les feuilles l'allègent
d'un fardeau qu'il ignorait porter.
*
Oublié le bâton de réglisse
qui jaunissait les commissures ;
une cigarette succédant
à l'indispensable cigarette
ils ne vivent plus que pour fumer.
Mieux vaut en ville être au moins deux
pour oser croiser les regards
réprobateurs ou amusés
— ceux-là sont les plus blessants —
mais parvenus dans les faubourgs,
certains aiment la garder au bec
en évoquant les larmes aux yeux
l'ambiance — Smoke gets in your eyes —
d'une innocente surprise-partie.
Jean-Luc Sarré, La Part des anges, La Dogana, 2007, p. 25, 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, la part des anges, jardin, orage, abeille, fumer | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2013
Jacques Réda, Hors les murs

Terminus
Sournoisement quelqu'un se lève dans la lumière
Soudain plus foncée, et les feuilles ne bougent pas.
Mais l'espace ouvre d'un coup ses invisibles portes
Et dans chacune on voit frémir la face du vent
Qui remue à son front désolé de lourdes roses
D'octobre s'illuminant dans l'ombre des jardins.
Car dans les sentiers en dédale tous les jardins
Ont à la longue dérouté si bien la lumière
Aveugle trébuchant parmi les lampes des roses
Qu'on pourrait la toucher qui respire et ne fuit pas
Mais se tient sans bouger sous le lierre, entre le vent
Et les voix prises du côté paisible des portes.
Elle n'ose pas comme le vent heurter aux portes
Ni s'ouvrir de force un passage dans les jardins :
Bientôt l'obscurité l'aura saisie. Et le vent
Commence à flairer les épaules de la lumière
Qui voudrait de nouveau s'échapper et ne peut pas
Sortir de ce halo dont l'enveloppent les roses.
De proche en proche on aperçoit encore ces roses
Penchant vers la chaleur qui chaque fois sourd des portes
Et des fenêtres dont les lampes ne craignent pas
D'affronter dans l'ombre où s'épaississent les jardins
Les derniers soubresauts indécis de la lumière
Seule devant la face indifférente du vent.
Et sur les maisons qui vont disparaître, le vent
Bâtit une maison noire où s'éteignent les roses
Et, secouant à son front leurs gouttes de lumière
Déclinante, il se rue à travers le flot des portes
Qu'on devine qui battent sans bruit. Et les jardins
Ne font plus qu'un seul remous de feuillages, et pas
La moindre lueur maintenant sous les roses, pas
De lampe sous la houleuse toiture du vent.
On se perdra peut-être à jamais dans ces jardins,
Sans fin leurré par la flamme équivoque des roses
Et toujours enfonçant tel le vent de fausses portes
Pour retrouver la trace ultime de la lumière.
N'abandonnez pas le passant au dédale, roses
D'octobre, au vent qui vous effeuille devant les portes
Et répand votre semence aux jardins sans lumières.
Jacques Réda, Hors les murs, "Le Chemin", Gallimard, 1982, p. 74-75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, hors les murs, jardin, rose, lumière, vent, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2013
Leonardo Rosa, Épigraphe pour un amour

Épigraphe pour un amour
Nos jours ont été si brefs et si hauts dans le ciel ami
les rêves de la maisonnette blanche
avec l'ombre tendre du cerisier
qui s'élargit dans le jardin pour nous protéger
En toi il ne restera de moi que les larmes
ensevelies dans la région d'enfance et peut-être le nom
qui fut le premier don de mon père
et que tu aimais dire jadis
comme une chose à toi.
Pour les nuits du froid dans le cœur
il ne me restera que l'ombre de ton corps dénudé.
Epigrafe per un amore
Furono brevi i nostri giorni e alti nel cielo amico
i sogni della bianca piccola casa
con l'ombra molle del ciliego
adagiata in giardino a coprirci.
In te di mio non resterà che il pianto
sepolto nell'angolo d'infanzia e forse il nome
che fu il primo dono di mio padre
e che tu amasti pronunciare un tempo
come cosa tua.
Per le notti fredde nel cuore
io non avrò che l'ombra del tuo corpo nudo.
Leonardo Rosa, dans NU(e) n° 29, "Leonardo Rosa", coordination Raphaël Monticelli, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonardo rosa, Épigraphe pour un amour, mort, jardin, corps, nom, revue nue | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2011
Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide...
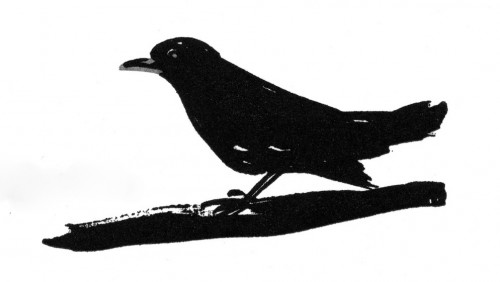
Dessin de Ianna Andréadis
Au merle de mon jardin
(avec l’aide de quelques-uns)
Le merle de mon jardin est un oiseau commun
mais c’est le merle de mon jardin ;
le merle de mon jardin est un oiseau commun
mais j’ai aussi treize manières de le regarder ;
le merle de mon jardin est un oiseau commun
mais il est à lui seul le voyage tout entier ;
le merle de mon jardin n’est ni le ciel ni la terre
mais il les réunit ;
il n’y a pas d’ailleurs de son monde pour l’être-là merle
du merle de mon jardin ;
parfois je suis un peu le merle de mon jardin
car je le suis des yeux ;
ainsi, pour le dire autrement, l’œil du merle de mon
jardin et mon regard ne font qu’un, mais j’ai moins
d’acuité pour observer le merle de mon jardin
qu’il n’en a pour me regarder depuis le
pommier ;
les ancêtres du merle de mon jardin volaient
avant les ancêtres de la chauve-souris ;
les ancêtres dinosaures du merle de mon jardin ne se
sont pas éteints,
ils se sont envolés ;
le merle de mon jardin contrairement à la mouche du pré
ne met pas ses pattes sur sa tête ;
dans la syrinx du merle de mon jardin,
il y a un peu du Solitaire masqué de Monteverde ;
jaune vif le bec du mâle merle noir : tordus merula de mon jardin
comme ceux de tous les mâles merles tordus sp
du monde sauf le bec du mâle Merle du Maranon Tordus maranonicus
du mâle merle cul-blanc Tordus obsoletus et du mâle Merle
Haux-Well Tordus hauxwelli
Une année, le merle de mon jardin a fait son nid quasi
sous mon nez ;
le merle de mon jardin mange souvent des baies de lierre au-dessus
de mon nez sur le gros mur moussu de mon jardin, l’été ;
le merle de mon jardin, comme le piapiateur noir de
Jacques Demarcq,
piapiate et tuititrix, son chant résonne refluifluité ;
le merle de mon jardin comme Jacob de Lafon soi-même
aime penser les choses par deux : baie et chat,
air et froid, œuf et bec, eux et eux, mais à
l’inverse de Jacob de Lafon il n’associe rien à
l’arôme du noyau ;
le merle de mon jardin, comme le merle de Ianna
(Andréadis)
peut rester longtemps immobile et regarder de
biais ;
comme Claude Adelen, j’ai tutoyé l’aire du merle de mon jardin
en vain ;
le merle de mon jardin se tait à la mi-juillet
mais garde son sale caractère — je l’appelle souvent
le pipipissed off merle de mon jardin parce que j’ai un rapport passionnel avec la langue anglaise et le merle de mon jardin ;
le merle de mon jardin se merle de tout c’qui s’passe et passe dans mon jardin ;
le merle de mon jardin aime que je parle de lui et me le fait savoir par un petit
puiitpitEncore, puitpitEncore ;
chaque hiver j’espère que le froid ne tuera pas le merle de mon jardin ;
le merle de mon jardin et moi sommes assez semblables
— à une petite différence près :
un jour le merle de mon jardin comme le Merle de Grand Caïman éteint
je le chialerai
Ceci étant :
le merle de mon jardin n’est sûrement pas mon merle comme mon jardin n’est finalement pas mon jardin mais le monde du merle de mon jardin et de quelques-uns, pendant l’été pendant l’hiver, par instants, ou bien alors, durant toute l’année, comme le merle de mon jardin : le milan, la buse, le faucon, le martinet, le coucou, le pic, la corneille, le geai, la pie, la pie-grièche, le rougegorge, la grive, l’hirondelle, le verdier, la mésange, le rougequeue, le pinson, le serin, la bergeronnette, le grosbec, la fauvette, le gobemouche coche de mon jardin , le grimpereau, le chardonneret, la sitelle, le tarin, le moineau, le troglodyte, le bruant ; mais aussi le renard, le hérisson, l’écureuil, la taupe, le mulot, l’épeire, le faucheux, le lézard, la couleuvre, l’argus, la piéride, le nacré, la petite tortue, le myrtil, le macaon, le cétoine, le capricorne, le carabe, l’apion, le clairon, le criocère, le hanneton, le bousier, le taupin, le gendarme, la punaise, le criquet, la sauterelle, la guêpe, le frelon, l’abeille, le bourdon, le syrphe, la mouche, la cordulie, mais encore la verge d’or, la gesse, la balsamine, le trèfle, l’œillet, la centaurée, le millepertuis, la carotte sauvage, le coquelicot, la reine des prés, la scabieuse, l’hortie, le cornouiller, le frêne, le noisetier, le noyer ; et tous les autres que je n’sais même pas nommer, que j’n’ai même pas vu ou que j’ai acclimatés à mon jardin à l’inverse du merle de mon jardin qui lui a choisi mon jardin.
(Bonnaz, août 2009)
Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures, Dessins de Ianna Andréadis, Genève, éditions Héros-Limite, 2011, p. 158-161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ianna andréadis, oiseaux, merle, jardin | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2011
Antoine Emaz, entretien (fin)
À propos de ce travail d’élagage, pourrait-on revenir à ton souci des mots brefs. Tu disais que tu les préférais parce qu’ils sont plus simples, mais ils ne le sont pas : quand tu parles du rien ou de la boue, il n’y a aucune simplicité, non ?
C’est vrai. Ce que j’aime bien, c’est une sorte d’épaisseur de sens dans un minimum de son. En plus, les mots que j’aime utiliser, comme rien, boue justement, sont la plupart du temps très usés - usés par le temps, par leur usage courant. Ils ne brillent pas, ils sont comme délavés à force d’avoir été utilisés par tout le monde dans la vie quotidienne ; il y a une profondeur du banal qui m’intéresse beaucoup. Je crois qu’on peut aller au plus profond de soi, ou de sa méditation sur la vie, sur la mort, avec des outils très simples.
J’aime bien aussi employer ces mots parce qu’ils offrent souvent la possibilité d’un double sens, d’une double lecture. Par exemple, « la vie dure ». Et puis, je n’aime pas quand il y a trop de musique ; je peux admirer quelqu’un comme Claudel dans ses vers ou son théâtre, mais ce n’est pas du tout ma direction, j’ai besoin de choses plus resserrées.
Quand on te lit, grâce à ces mots usés, on a l’impression que rien ne se passe ; il faut être attentif et respecter ta ponctuation, tes blancs, tes arrêts : à ce moment-là, les mots se chargent, comme une batterie se charge. Je pense au Reverdy de La Lucarne ovale, des Ardoises sur le toit …
Oui, et en cela je dois certainement quelque chose à Du Bouchet et à Reverdy. L’idée que le blanc te permet de charger un mot qui, sinon, resterait inerte, c’est tout à fait juste. Le blanc, c’est la résonance du mot, ce qui lui donne du relief. Dans les livres de Reverdy, au moins jusqu’aux Cravates de chanvre, on est à ce sujet dans quelque chose qui continue de nous interroger dans le contemporain.
Pourrait-on parler du problème de la mémoire, pas seulement de la mémoire des événements, aussi de la mémoire de l’enfance – il y a des fragments du temps de l’enfance qui viennent dans certains poèmes.
Cela vient plus souvent maintenant. Dans Peau, ensemble écrit depuis 2005, trois ou quatre poèmes renvoient très directement à l’enfance, de manière quasiment descriptive, ce qui n’était pas possible il y a vingt ans. C’est pourquoi François-Marie Deyrolle s’est arrêté à 1997 pour l’anthologie Caisse claire ; après 1997, notamment avec la série, Soirs, Ras, Os, De l’air, Peau, il y a des motifs qui sont apparus, absents auparavant. Notamment l’enfance et les événements du monde, le fonctionnement de la mémoire aussi. Est-ce que cela tient au vieillissement, ce motif de l’enfance ? À la mort des parents ? Je ne sais pas.
Mais cette mémoire de l’enfance est donnée au même plan que le présent ou que le proche passé ; on a l’impression que tous les temps se confondent.
Tu as raison. Je ne distingue pas les différents plans ; du présent est mêlé à du passé proche ou du passé lointain. Je ne sais pas comment cela fonctionne, je constate que c’est comme ça dans mon écriture. Dans un poème je ne "veux" jamais me souvenir, c’est le souvenir qui s’impose.
Quand tu travailles ta matière, tu sais bien qu’il y des temps différents…
Oui, et je les laisse tels quels. J’ai toujours tendance à faire confiance à ce qui s’est écrit au départ, comme malgré moi, comme si une vérité personnelle apparaissait dans le poème qu’il fallait que je respecte.
Ce que je lis quand le texte se rapporte à l’enfance, c’est toujours quelque chose de très obscur ; tu parles d’un mouvement vers l’origine dans un poème, « Comprendre que l’on n’en finira pas avant de connaître l’origine »…
Il s’agit bien pour moi d’essayer de voir d’où ça vient. Pour employer un vocabulaire chrétien, sans l’être, il y a bien une sorte de péché originel, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose dans "vivre" qui est faussé dès le départ, quelque chose de raté dans "vivre", et j’ai une conscience profonde de cela, qui a été fortement aiguisée par diverses circonstances. On ne comprend pas forcément ce qui est faussé, ce qui est raté, mais c’est, d’évidence. « Dans chaque poète il y a un enfant qui pleure », écrivait Reverdy. Chez tous les poètes que je connais un peu, derrière le masque social tu trouves une fêlure dès que tu grattes un peu, et il y a un lien entre cette fêlure et l’écriture, même si on n’est pas capable de le définir. Mieux vaut sans doute ne rien en savoir !
Mouvement qui évoque Beckett…
J’aime beaucoup Beckett ; chez lui tu retrouves cette simplicité, le très peu de mots pour aller au plus loin possible d’une sorte de condition humaine ; une manière de dire la vie, ce qu’il y a de manque dans vivre d’une façon extrêmement simple. Je me sens proche de cela, des derniers petits textes, Soubresauts, L’image, Le dépeupleur, avec la solidité étonnante de la langue en même temps que l’émotion.
Sur l’origine… Il y a un creusement : en quoi le passé fait écho au présent. Je crois qu’écrire est toujours lié au passé parce qu’on ne peut pas écrire sur une émotion originale, neuve. Il faut toujours que cette émotion entre en résonance avec du déjà vécu pour que de l’écriture puisse se faire, sinon tu es dans quelque chose où il y a une émotion très forte, mais comme tu ne l’as pas déjà vécue, en quelque sorte, tu ne peux pas l’écrire, tu n’as pas de langue. Il faut attendre qu’une émotion un peu analogue vienne recouvrir la première pour que tu puisses écrire quelque chose. Il y a une page très juste de Baudelaire à propos de la mémoire palimpseste, au début du Mangeur d’opium ; la mémoire comme stratification d’expériences et d’émotions, la dernière venue faisant résonner toutes les strates antérieures. Pour moi, je ne cherche pas à marquer dans le poème si c’est plus ou moins loin dans le passé : tout joue de manière un peu élastique ; il y a plein d’étages et tu bouges d’un étage à l’autre sans trop savoir où cela s’arrête. Donc, les temps se mêlent, et cela m’intéresse vraiment, cela se creuse…
Cela se creuse et toujours vers l’obscur.
Oui, parce que je pense que l’expérience forte rend muet, donc arriver à mettre des mots là-dessus ce n’est pas très évident. Mais … J’avais essayé une fois, avec de petites proses, de sérier les expériences fortes que j’avais eues dans l’enfance et dont je me souvenais. J’ai abandonné après deux ou trois textes, je n’ai jamais repris, sans doute parce que cela tournait trop vers le récit – je n’aime pas raconter. Le poème donne l’avantage de pouvoir jouer sur une sorte de clair-obscur, alors que si tu racontes tu es dans du « clair ». Quelqu’un m’avait demandé d’écrire sur un souvenir marquant, et j’ai dit tout de suite que je ne pouvais pas le faire.
C’était un sujet de rédaction…
(rire) La mémoire comme motrice, oui, et le travail sur mémoire et présent, oui aussi. Le poème me révèle quelque chose que je n’attendais pas, je ne pensais pas aller dans telle ou telle direction du temps. Encore une fois il n’y a pas une démarche volontaire d’aller vers le souvenir, du passé affleure au passage de tel ou tel truc dans le présent. Le poème en quelque sorte va noter cela.
C’est le poème-analyse…
(rire) Oui, auto-analyse anarchique…
Je reviens au poème titré Tours, où j’ai trouvé plus fort qu’ailleurs l’obsession de la chute, de l’écroulement.
Toute une série d’images disent l’obstacle ou la destruction. En ce sens, on pourrait dire que ma poésie est très négative. Il y a bien cette idée que tout est train de se défaire, tout s’éparpille. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais c’est en effet obsessionnel. Il y a sûrement à travers l’image quelque chose qui dirait la limite de vivre, le fait qu’il n’y a pas de plénitude possible de vivre, on est toujours dans l’étroit, dans l’exigu, dans ce qui se défait. Finalement, il ne restera rien, c’est sûr… Mais j’aime mieux le savoir, être lucide qu’aveugle… Cela donne une poésie assez sombre, on ne peut pas le nier.
Avec Tours, cette obsession de la chute trouvait une matière de choix, en même temps que tu faisais un choix politique…
Il y a cet enjeu politique, mais aussi quelque chose d’autre : comment une image, un événement se défont. Quelle que soit son importance, l’événement ne tient pas plus de trois semaines. Oublié. Rien ne tient.
D’où la douleur de la mémoire.
Oui, parce que si tu ne gardes pas un peu, ne serait-ce qu’à travers un poème, trace d’un événement, du vécu, il ne restera rien du tout. Même les poèmes, on n’est vraiment pas sûrs qu’ils tiennent longtemps…
Ils tiennent au moins pour toi.
Mais après, il ne faut pas rêver… Je rêve peu d’ordinaire…
Il y a une autre théâtre d’obsessions, un peu différent de l’obsession de la chute : l’enlisement avec le sable, la boue, la vase, l’obstacle avec le mur, la falaise, et la lourdeur – "lourd" est un mot très souvent employé dans tes poèmes : tout est lourd, et va tomber.
On revient à une sorte de morale ; très profondément il y a une impossibilité de vivre ou de se réaliser pleinement qui est fondamentale chez moi. On ne réalisera jamais tout ce qui était à faire, on mourra avant d’avoir fait tout ce que l’on pouvait faire. J’ai une conscience très forte de cela et, en même temps, aussi fortement, l’idée qu’il faut se tenir en face, résister, ne pas se laisser tomber, écraser.
C’est : titre d’un ensemble de tes poèmes.
Oui. Se tenir debout est une nécessité, ancrée en moi avec en même temps la certitude qu’à plus ou moins long terme, rien n’en restera, pas même les poèmes. Finalement, on vient de rien et l’on va vers rien – mais allons-y tranquillement, avec le sourire et en gênant le moins possible les autres.
Néanmoins, la crainte de la suffocation est forte.
Reprends l’étymologie d’ « angoisse » : l’étroitesse. Je ne suis pas dans un monde tranquille ; tu trouveras dans mes textes le mot « calme », pas celui de « paix » ; la tranquillité, un peu cependant avec le jardin, avec les végétaux. Sinon la vie au quotidien, c’est la difficulté, le stress, de la lourdeur, du poids : quand tu veux réaliser quelque chose, c’est lourd, tu vas peiner pendant des mois pour un résultat minime.
Par exemple dans ton métier de professeur ?
C’est un métier que j’aime bien, mais fatigant, répétitif, pénible. Pendant plusieurs années, il y a eu un combat syndical assez lourd pour améliorer une situation, mais pour déplacer un tout petit peu quelque chose, il faut des efforts énormes, et l’acquis est toujours remis en cause, alors même que la nécessité de changer est évidente pour tout le monde. Tout cela fatigue. La fatigue est un des motifs de mon écriture, et c’est bien la fatigue liée au travail ; même si elle n’est pas n’est pas lisible directement par le lecteur.
Là où je peux retrouver du calme, c’est ici, entre les murs du jardin : il y a là une sorte de sérénité, mais provisoire, je sais que cela ne va pas durer. Donc il faut en profiter tout de suite. Je ressens le dehors comme dangereux, parce que j’ai peu de pouvoir sur lui, et que je le ressens comme potentiellement agressif. Vivre dehors c’est entrer dans du malaise.
Ce qui apparaît quand on te voit dehors avec les autres…
Si tu le dis… Je ne sais pas d’où cela vient, cela doit s’ancrer dans l’enfance. Une sorte d’inaptitude à vivre. Je pense au titre que j’aime bien de Cocteau, La difficulté d’être, celui de Pavese, Le Métier de vivre. Je ne suis pas du tout suicidaire, mais il y a souvent des tensions très fortes ; il faut éviter ou affronter ces moments, et tâcher avec les autres comme avec soi-même de tenir le choc. Voilà quelque chose que j’admire chez James [Sacré] : je sais bien qu’au fond de lui-même il est inquiet, mais il a toujours une grande égalité d’humeur ; lire une page de lui, un paysage par exemple, a le don de me faire entrer dans une sorte de sérénité.
Il n’y a que là que la paix existe…
Oui, dans les mots. La nature, aussi.
Tes textes ne sont pas pessimistes ; on pourrait parler plutôt de lucidité – et la lucidité est positive, non ?
Oui, et c’est pour cela que j’ai toujours refusé le nihilisme. Il faut lutter plutôt qu’empirer. Par la lucidité, je rejoins Reverdy et, encore, les moralistes du XVIIe siècle : pas de faux-semblant. C’est comme ça, C’est.
Et le titre Caisse claire ?
Je voulais d’abord Cela, mais le titre n’était vraiment pas assez porteur pour l’éditeur. Après plusieurs autres, comme Un peu d’air et de peur, qui étaient trouvés trop noirs, je me suis arrêté à Caisse claire, avec l’image de la peau tendue sur laquelle on frappe. Comme si la peau était frappée par le dehors, ce qui arrive du monde, et par le dedans, par tout ce qui remonte de la mémoire…Cela produit un son, le poème. L’idée de la peau tendue me plaisait bien, l’idée aussi que la caisse claire est celle dans laquelle on sera au bout… Mais la plupart des gens ne voient pas ce deuxième sens…C’est celui que tu as lu en premier (rires).
©Photo Tristan Hordé
Publié dans Emaz Antoine, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, reverdy, mémoire, jardin | ![]() Facebook |
Facebook |






